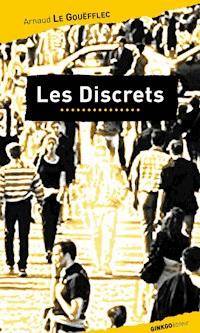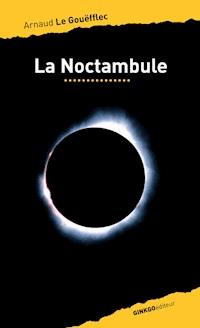Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ginkgo éditeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Albert Lampion est l’Irrésistible. Un beau matin, à son corps défendant, il est subitement devenu séduisant à l’extrême, et fait depuis chavirer tout ce qui porte jupon : « Je ne peux pas faire un pas dans la rue sans que l’amour frappe autour de moi, comme une grêle de balles. » Sa vie est devenue un enfer. Traqué par les maris, les femmes jalouses, les détectives privés et même la police, il n’a plus qu’un seul recours : Johnny Spinoza.
La question est : qu’est-il arrivé à Lampion ? Pourquoi un type aussi anodin s’est-il métamorphosé du jour au lendemain en un redoutable tombeur ?
Johnny Spinoza, sa secrétaire Cunégonde, le commissaire Pélage, sa femme et son amant… Tout le monde se débat dans une enquête surréaliste.
Un vaudeville halluciné, avec son lot de portes qui claquent, d’amants dans les placards, de placards à double fond, de séducteurs sur le retour et de mégères hystériques.
L’Irrésistible est un nouvel épisode des aventures de Johnny Spinoza, détective ramifié, déjà mis en scène dans Les discrets (Ginkgo éditions).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cher lecteur, Ginkgo éditeur a choisi de commercialiser ses livres numériques sans DRM (Digital Right Management) afin de vous permettre de lire nos ouvrages sur le support que vous souhaitez, sans restriction. Merci de ne pas en abuser et de ne pas diffuser ce fichier sur les réseaux peer-to-peer. Bonne lecture.
© Ginkgo éditeurwww.ginkgo-editeur.fr 34/38 rue Blomet - 75015 ParisRejoignez-nous sur Facebook
« Je peux résister à tout, sauf à la tentation. » Oscar Wilde
I - Filature
Comme souvent, tout commence par une filature.
La filature, c’est le pain quotidien du privé. Elle l’use au jour le jour, à l’image de ses pauvres semelles. Les gens croient que le détective passe son temps sur les scènes de crimes, à débrouiller les fils épais de pelotes complexes, une main enfoncée dans la poche de son imperméable, malaxant machinalement ses clefs de voiture, l’autre tenant sa pipe, le visage penché, tirant d’épaisses bouffées méditatives. Ils le voient souverain, toujours nimbé de fumées prodigieuses, une sorte d’encens divinatoire. Le détective est forcément un agent extralucide. Ses yeux percent les grossiers paravents du monde sensible. Pour le commun des mortels, c’est sûr, c’est un voyant, une sibylle. Il ne connaît pas l’ennui, vit dans la nouveauté perpétuelle, n’emprunte que des raccourcis ou des passages secrets, se jouant des encombrements. Il glisse de conclusion en conclusion. Les gens se le représentent en joueur d’échecs échafaudant des stratégies, se hasardant dans des diagonales cérébrales inédites qui le conduisent au coupable immanquablement, par la magie de la simple déduction. Ils l’imaginent, au terme de l’introspection, comme Archimède dans sa baignoire découvrant sa Loi, livrant à ses admirateurs la pelote de quelque nébuleuse affaire désormais débrouillée. Tâche alors aux rustauds agents d’aller appréhender le criminel : lui s’en lave les mains et repart à ses livres de logique.
Mais la vérité, c’est que le détective, confit dans son imperméable, vieille peau de lézard qui ne mue jamais, suit plus sûrement le fil emmêlé d’une foutue filature, qu’il se contente de marcher dans le sillage de pauvres gens à peine plus coupables que lui, à la queue leu leu, trottinant comme un caniche tenu en laisse, tirant la langue dans les côtes, glissant sur les pavés mouillés. Il n’y a pas de suspense dans la filature : tout le monde va au même endroit. Chez sa maîtresse ou son amant. C’est une des lois de l’humanité. Le détective n’est qu’une perle enfilée sur ce fil-là. Lorsqu’il s’arrête sous un porche, c’est moins la vénérable pipe du sage qu’il fume que les cigarettes, qu’il grille par quatre ou cinq. Et cette fumée-là, loin de l’inspirer, achève de le déprimer. Les amours des autres, c’est le spectacle le moins passionnant. Le privé, pourtant, est celui qu’on paye pour y assister, à l’image de ces gens qu’on rétribue pour remplir les salles des théâtres de boulevard le soir de la première. Il est bon public : à défaut d’applaudir, il ne siffle pas les acteurs. Il regarde d’un œil navré ces pauvres gens se consumer dans les flammes grotesques d’un Amour auquel il reste irrémédiablement étranger.
La filature : pourquoi les contes de fées et les mythes sont-ils à ce point farcis de métaphores de couturière ? Chaque fois que je file le train d’un quidam, je pense à la belle au bois dormant se piquant le doigt au fuseau d’une quenouille ou au vaillant petit tailleur, fier d’avoir tué sept mouches d’un seul coup de tapette, brodant sur sa ceinture : « sept d’un coup » et se retrouvant malgré lui bombardé tueur de géants. Et que dire de Pénélope s’épuisant sur son canevas ? Et d’Ariane embobinant cet abruti de Thésée avec son fil ? Les fileuses, les couturières sont les agents secrets des contes de fées et des légendes, et cette métaphore nous poursuit dans la vie : tout est cousu de fil blanc, et tout s’apparente en définitive à un jeu de pelotes qu’on dévide ou qu’on rembobine inlassablement, au fur et à mesure qu’on s’entortille dans le dédale des rues. Telle est la filature… Le mot est bien choisi. Il y a là en effet quelque chose du labeur des fileuses, qui s’épuisent leur vie durant à faire passer des fils aussi fins que des nerfs dans des chas d’aiguille indécelables. Il y a dans l’art de déambuler dans l’ombre, de tourner inlassablement aux mêmes angles de rues, de se glisser dans les mêmes cages d’escalier, toute une mécanique de manufacture de tapisserie qui épuise également le cerveau et la patience et transforme le brave détective privé en une sorte d’automate hagard, carburant au café noir, dont la toile même du costume semble nouée à d’invisibles ficelles tirées d’en haut par quelque despote qui tue l’ennui en épuisant ses marionnettes.
« Cent fois sur le métier tu remettras ton ouvrage… » Le métier, c’est la ville elle-même. On jurerait le dédale de ses rues conçu pour épuiser les plus fins limiers : escaliers traîtres, ruelles vicieuses, ponts obliques, épouvantable entremêlement de maisons poussées sur des coteaux, de charpentes juchées sur des gouffres, d’immeubles montés en mayonnaise, de demeures enchâssées les unes dans les autres, sorte de monticules empilés ravinés de coupe-gorges emberlificotés. Lorsqu’on circule en voiture, on oublie que, sous le fin tapis urbain, il y a des reliefs : la ville tout entière est un monstrueux pétrin rempli de pâte à pain gondolée et figée, baroque éclaboussure de bosses et de creux, un parfait matelas pour fakir. La cuvette du Pontique, par exemple, cet enfoncement qui creuse la partie ouest de notre ville, est un abîme adouci, lissé patiemment, comme un puits de glaise qu’ont modelé des doigts de potier, pour la réduire à une simple confluence de descentes, de virages en trompe-l’œil, de glissandos qui s’achèvent en hélice dans son tréfonds noueux. Quand, à la suite d’un de mes clients, je m’enfonce dans la cuvette, mes douleurs lombaires se réveillent, immanquablement. Car ce n’est pas le tout de se jeter dans le Pontique, encore faudra-t-il en revenir vivant, après s’être épuisé dans son dédale, remontant pied à pied, presque doigt à doigt, jusqu’à la place Wittgenstein. Cette ville aura été mon supplice et la cuvette du Pontique la cerise pourrie sur ce gâteau de douleur. Seul le tramway, cette prodigieuse invention, me soulage de temps à autre. Mais le tramway lui-même refuse de plonger dans le Pontique.
Pourquoi nos urbanistes n’ont-ils pas conçu des villes plates, avec des rues droites et un cadastre quadrillé ? Ça m’aurait tellement simplifié la tâche. J’aurais pu suivre les gens sans y penser, et surtout sans me déboîter un à un les éléments de la colonne vertébrale. J’aurais pu glisser là-dedans comme sur un tapis roulant, pris dans le flux comme un bois flottant dans le courant d’une rivière. Au lieu de ça, ces abrutis ont tout tordu, noué et renoué comme pour rendre le canevas impossible à démêler. C’est un kaléidoscope d’escaliers. Il n’y a que le détective qui en souffre. Les amoureux, eux, se fichent du relief et de ses complexités comme de leur première chemise : ils arpentent la ville d’un pas de ballerine, quand bien même ils ont largement dépassé le quintal et la cinquantaine. L’amour leur donne des ailes, sur lesquelles glissent l’adversité et tout ce qui est lourd et imparfait. Ils sont des bulles. Ils ricochent. L’amoureux présente invariablement les mêmes symptômes : yeux brillants, pouls accéléré, sourire prompt, gestes suspendus comme s’il cherchait quelque nuage auquel se raccrocher. Il oscille, il dodeline, il fait des entrechats, il bondit comme un cosmonaute. En lui s’est brisée la conscience de la pesanteur. Il s’envolerait qu’il n’en serait pas plus étonné. L’amour confère une énergie insoupçonnée à bien des messieurs qui jusque-là se traînaient lourdement dans le monde en ronchonnant : les voilà soudain plus verts que du petit bois. Ils abandonnent dans un cul-de-sac les grosses berlines qu’ils ont mis tant d’années à payer et pour lesquelles ils ont perdu leur vie à travailler, et redécouvrent subitement les vertus de la marche à pied. Il faut les voir trottiner, pétuler, s’arrêter à chaque point de vue pour contempler la ville et l’espace sans cesse renouvelé qu’elle leur offre comme une promesse sans fin. Rien n’est trop pentu pour eux : les bougres gravissent quatre à quatre des obstacles jadis insurmontables, préfèrent les escaliers aux ascenseurs, enjambent les balcons, font du trampoline sur les matelas, s’accrochent au lustre, et se risquent parfois dans des empoignades chevaleresques d’un autre âge, eux qui jusqu’ici avaient peur même de leur ombre. Telle est la grande loi que j’ai dégagée : l’amour est le suprême stupéfiant. Le philtre ultime. Il décuple l’audace, la force, l’agilité et la bêtise. Il transforme les vieux sages en jeunes blancs-becs hébétés, et les fortes dames aux lèvres pincées en midinettes prêtes à tomber en pâmoison au premier compliment galant.
Le détective, lui, amoureux de personne, traîne la langue et les souliers, affronte avec ses seules forces les courbes les plus pénibles. S’il s’envolait, d’un coup de vent trop appuyé, il mettrait cela sur le compte de la malchance ou crierait au complot. Chez lui, le sentiment de sa propre pesanteur est décuplé par l’expérience : une fois leurs amours dégonflées, les hommes chutent et s’écrasent sur la terre comme des éléphants privés d’hélium. Le détective est le baromètre des exploits de ses clients inconscients : du beau temps à l’avis de tempête, il prévoit avec lucidité les fluctuations du ciel amoureux. C’est un témoin, un veilleur. Et quand il s’aventure dans les galeries à étages du centre commercial, et qu’il lui faut grimper secrètement par les escaliers de service, il pense à sa vocation première et à ses vieux Sherlock Holmes. Non, il ne se voyait pas trimbalé de la sorte. La filature dégrade le privé en limier, le réduit au rang de casserole attachée aux basques des amoureux. Il fut un temps où il bondissait dans la chambre d’hôtel, au milieu des ébats, pour fracasser la scène du flash indécent de son appareil-photos. C’était le diable surgissant de la boîte à morale. Le détective de l’époque était un grossier, incapable de compassion. Avec la réforme des mœurs, les rustres d’antan se sont reconvertis dans la presse à scandales. Les nouveaux venus sont d’une autre trempe. De la brute, on est passé au dépressif. Finies les entrées saisissantes. Finies les courses-poursuites pour dérober la pellicule. Finis les planques dans les armoires, les sauts par la fenêtre, les coups de feu dans les rues grises et les coups de marteau au tribunal, le bruit des destins qui se brisent. L’adultère n’est plus un délit. Aujourd’hui, les gens ne cherchent plus à prouver, ils veulent juste savoir. On est dans le confidentiel, le délicat. L’intime. Le détective se contente désormais de prendre des notes. Et au plus fort des ébats, au lieu de fourbir son appareil, il reste à fumer sous un porche.
Le plus clair de mon temps, je suis donc payé pour renseigner de vieux maris épuisés. Pour la plupart, ils cherchent une simple confirmation. Oui, leur femme voit quelqu’un. Et l’identité de ce quelqu’un importe au plus haut point. On m’attend, le souffle court, espérant un choc. Le plus souvent déçus, mes clients haussent les épaules :
– Elle me quitte pour ce tocard ?
– J’en ai bien peur, monsieur.
– Je lui croyais plus de goût.
L’amour s’accommode mal de la déception. Je fournis de la déception.
Bien entendu, l’inverse se produit aussi. Lorsqu’untel découvrit avec qui sa femme le trompait, son visage jusque-là sévèrement ridé et barré de soucis exprima soudain une fierté toute juvénile. Et son amour enfoui sous les langes du quotidien ressurgit soudain, intact. Il lui fallait reconquérir celle qui, encore une fois, avait su le surprendre.
L’amour régénère les tissus plus vite que toutes les pommades du monde.
À force de réfléchir à ces vertus reconnues de tous, j’en suis arrivé à cette conclusion : celui qui saurait isoler sous une cloche de laboratoire le principe actif de l’amour balaierait d’un revers de manche mille siècles de croyances, de philosophies et de tâtonnements scientifiques – l’amour est la quintessence de l’existence. C’est de l’extrait de vitalité pure. Pas la peine de chercher le saint Graal dans les mythologies. Ce qui remplit la coupe ultime, c’est le désir amoureux.
Mais je m’égare. Lorsque l’irrésistible m’est tombé dessus, un mari jaloux m’avait payé pour que je suive sa femme. J’avais donc baguenaudé toute la journée dans les rues, suivi la dame au club, à la salle de gym, au patronage, éprouvé les reliefs, fatigué mes semelles, et failli m’endormir sous le porche.
C’est dans les moments où on s’y attend le moins que naissent les histoires les plus extraordinaires.
Cunégonde, ma secrétaire, dont la lucidité est proverbiale, m’avait pourtant prévenu :
– Une affaire va vous tomber dessus, patron, je le sens.
– Vous l’avez lu dans l’horoscope ? lui avais-je demandé, avec un rien de sarcasme dans la voix. L’enthousiasme de Cunégonde me tape parfois sur les nerfs.
– Je ne lis pas l’horoscope patron. Pas besoin de ces martingales. Faites un peu confiance au hasard. Tout est cyclique. Depuis que nous avons fondé l’agence, nous tournons sur le même essieu : filature, enquête extraordinaire, filature, drame poignant, filature, etc. La roue tourne : la banalité cède toujours la place à l’exceptionnel.
Cunégonde ne s’était jamais trompée, mais on ne vit pas que d’enthousiasme et d’eau fraîche. L’état désastreux de nos finances l’avait quand même poussée à prendre quelques précautions : elle s’adonnait dorénavant à la chimie amusante, dont elle espérait des retombées sonnantes et trébuchantes.
– L’avenir est dans la chimie, patron. Ça sert à tout. Pour relever les empreintes, pour précipiter les taches de sang. Rien qu’en versant quelques gouttes d’une solution sur le parquet du crime, vous verrez se dessiner le visage du tueur.
Aussi, tandis que je claudiquais sur les pavés, Cunégonde préparait-elle l’avenir. Et elle s’y employait, à son habitude, méthodiquement : elle décantait le sujet, elle le raffinait jusqu’à ce que tous ses secrets s’éventent. Dans son bureau, d’où elle avait déménagé les archives, montagne de papiers chancelante, elle avait installé un laboratoire d’un autre âge : dans cette caverne baroque, mon œil profane ne parvenait à distinguer qu’un énorme alambic, noyé dans des perspectives de verres à loupe.
– Vous comptez distiller ?
– Ce n’est pas la priorité, patron. Mais si nos finances s’effondrent définitivement, je mettrai au point un alcool de pomme de terre si toxique qu’il nous plongera dans l’oubli.
Le soir, tandis que je soignais mon dos, immobile sur le canapé, Cunégonde s’activait dans son petit monde, et des brumes soufrées, des relents de térébenthine, des effluves méphitiques venaient de temps à autre me chatouiller les narines. Une fois, on dut ouvrir en grand les fenêtres de l’appartement pour dissiper des vapeurs.
– À quoi va servir cette abomination ? ai-je râlé à la fenêtre.
Cunégonde, qui se tamponnait les yeux à côté de moi, a bredouillé :
– C’est un antipoison, patron.
– Ça aurait peut-être mieux marché si on avait absorbé le poison avant…
Dans l’armoire à potions de Cunégonde, qu’elle fermait à clef (de peur sans doute que je ne sois assez bête ou trop saoul pour aller m’y désaltérer), on trouvait pêle-mêle du cyanure, du curare, de la mort-aux-rats et même de la ciguë.
– Ça me rappelle mes années de lycée, Cunégonde.
– Les cours de chimie, patron ?
– Non ma chère, le grec antique. C’est en buvant la ciguë que Socrate a passé l’arme à gauche.
– Quelle drôle d’idée.
– Elle n’était pas de lui : on l’y a forcé. Il est mort de paralysie respiratoire.
– La ciguë ne provoque pas de paralysie respiratoire. Ils avaient dû la mélanger à d’autres substances. C’est intéressant.
Et elle disparut dans ses livres et ses cornues, n’en ressortant que quelques jours plus tard avec un air de triomphe, en brandissant un flacon verdâtre :
– Ciguë, datura, opium, patron. C’est ça, le cocktail qui a tué votre Socrate. Pourquoi a-t-il été condamné à boire la ciguë, au juste ?
– Il était accusé de corrompre la jeunesse.
Et comme elle fronçait le sourcil, j’ai ajouté :
– Par ses discours. Il entraînait les jeunes sur la voie de la philosophie.
– Ben voyons.
Cunégonde ne croit pas à la philosophie. Elle ne croit pas aux discours désintéressés. Pour elle, tout est à double tranchant. On ne philosophe que dans un but coupable, on n’ouvre la bouche que pour proférer des paroles à double sens, dont elle sait toujours mesurer la duplicité. Les concepts, pour elle, c’est juste des pendules pour hypnotiser les gogos.
Cunégonde, à force de persévérance, en est venue à la conclusion qu’il lui fallait travailler à partir des plantes elle-même. C’est fou ce qu’on peut trouver comme saloperies dans ces machins en pot. Les feuilles grasses, les pétales innocents sont gorgés de miasmes potentiels et de principes fatals. Je préfère les plantes carnivores, ou même herbivores, aux salades qui hantent nos jardins. Elles ne font pas que pousser en vampirisant l’eau de pluie et la lumière du soleil : elles nous guettent. Elles nous narguent. Comme je râlais de voir notre intérieur encombré de ces tueuses silencieuses, Cunégonde a déclaré :
– Je vais construire une serre.
Elle disposa donc, dans le petit jardin suspendu entre quatre murs de tôle, au fond du débarras, une serre grossière plafonnée d’un toit d’une transparence laiteuse. Là, elle fit prospérer des choses à cloches et à bulbes, des tiges à granules et pompons qui donnaient à notre ancien potager des allures de kermesse infernale.
– Et mes salades, Cunégonde ?
– Ne tentons pas le diable, patron. La ciboulette pourrait se gorger de sève de datura et les poireaux virer au pavot. Il vaut mieux que ce jardin soit exclusivement réservé aux toxiques.
– Heureusement que vous n’êtes pas aquariophile. Vous m’imposeriez des piranhas.
Et elle claquait des talons entre ses cultures et ses cornues, distillant, raffinant, laissant infuser ou décanter, s’affairant dans des nuages parfumés à la chlorophylle, ou pire.
– Le meurtre pousse comme le chiendent. On n’en arrache jamais les racines. Là, en ce moment, dit-elle en désignant par la fenêtre la ville immense, dans ce chaos de maisons et d’immeubles, dans ce capharnaüm, patron, quelqu’un met au point un plan diabolique pour tuer son prochain.
– Tout ça ne me dit pas pourquoi vous avez choisi la chimie plutôt que la balistique.
– La police sait très bien y faire, patron, avec les morts par balle. C’est facile. Tuer par balle, c’est presque signer son crime. La balle est un panneau fléché. Il suffit de retrouver l’arme, de mettre à rebours le projectile dans le canon, et le tour est joué. Les poisons c’est autre chose. Ils frappent sans faire de bruit, et on ne retrouve jamais les éprouvettes. Les criminels, les vrais – pas les pauvres hères égarés qui n’ont rien trouvé de mieux à faire que de se procurer une arme à feu –, les purs, les durs, les âmes noires et froides qui, lentement, mettent en œuvre leur plan de mort et tissent autour de leurs proies une toile d’araignée fatale, ces âmes-là tuent par poison. Combien de crimes chimiques ont-ils échappé à la sagacité des policiers ? Je maintiens que le poison est l’arme numéro un, qu’elle est infiniment répandue et que chaque jour, dans cette ville comme ailleurs, des doigts se crispent sur des pipettes, laissent tomber goutte à goutte des solutions dans des tubes à essai, mélangeant, recoupant, épurant et combinant d’effroyables cocktails qui tuent comme des flèches invisibles.
– Vous voyez le mal partout.
– Combien de morts douteuses, patron ? Combien de crimes jamais résolus ? Le commissaire Pélage dort sur un matelas de dossiers sans conclusion.
– Le commissaire aime le confort.
Cunégonde disparut quelques minutes dans son antre et en revint avec une petite fiole chapeautée d’un pressoir en caoutchouc.
– J’ai passé un mois là-dessus. Tout ce que j’ai découvert dans mes livres de chimie et de botanique, je l’ai synthétisé dans ce cocktail.
– Et que voulez-vous que je fasse de cette petite fiole ? Que je la siffle sous le porche en attendant le client ?
– Vous me remercierez, patron. C’est un antidote universel. En cas d’absorption de substance inconnue, une goutte de ce breuvage, avalée promptement, vous sauvera la mise, et peut-être la vie. Il réagit avec quatre vingt pour cent des toxiques : il déclenche le bon vieux réflexe vomitif. Si vous avez avalé une cochonnerie, vous la recrachez immédiatement.
– Avec ce que je fume ces temps-ci, il vaut mieux éviter.
Cunégonde ne fait que des cadeaux utiles.
C’est elle qui m’habille et me chausse. Elle est ma conseillère capillaire : c’est elle qui a mis au point ce parfum discret qu’elle juge préférable à mon after-shave d’antan qui, selon elle, sentait « le gazon fraîchement déroulé ».
– Un détective, dit-elle, se doit d’être élégant, mais sans ostentation. Pas de complet tape-à-l’œil, pas de parfums trop fleuris. Il faut qu’il soit à l’aise, et que son costume l’épouse. Il faut que, dans son sillage, quelque chose de léger se propage, et non cette perpétuelle pesanteur d’effluves de chapeau mouillé, de pardessus fumé, d’eau de Cologne et de pastilles à la menthe. Combien de professionnels aguerris ont-ils coulé par manque de vigilance dans le soin apporté à leur personne ? C’est un métier de communication, patron.
Je suis donc un détective propre, et quand je croise un collègue du syndicat des privés, avec sa vieille pelisse sur le dos, ses chemises douteuses et ses mains moites, je regarde mes chaussures, tant je me sens traître à la cause.
On se croise souvent, d’ailleurs, avec les collègues. Il n’est pas rare que d’un porche à l’autre, on se fasse un discret signe de la main. Puis on se sourit bêtement, l’air gêné. On fait mine de ne pas attendre. On est collègues, mais aussi concurrents. Ça tue toute velléité d’amitié. Mais on s’aime bien quand même, parce qu’on se comprend, fatalement. On est entortillé dans le même quotidien. On allume notre cigarette et on écrase notre mégot au même moment. Ça crée des liens. Parfois, nos clients sortent ensemble de l’hôtel, bras dessus dessous. On les suit alors à deux, en faisant attention à ne pas se bousculer et en se cédant le passage. C’est à force de politesses de ce genre que j’ai fini par adhérer au syndicat. Mais n’anticipons pas…
Tout a commencé dans une cabine téléphonique plantée devant l’hôtel des Faisans douillets.
II - Pantalonnade
– Allô, Monsieur Pantalon ?
– Lui-même.
– Johnny Spinoza à l’appareil. Je ne vous dérange pas ?
– Bon, au fait Spinoza ! a-t-il grogné.
Je pris une profonde inspiration :
– Vos craintes étaient fondées. Votre épouse voit quelqu’un, régulièrement, et cela se passe à l’hôtel des Faisans douillets.
Je le sentis s’étrangler à l’autre bout du fil. D’instinct, j’écartai le combiné de mon oreille. Comme prévu, il se mit à hurler si fort que les gens autour de la cabine sursautèrent comme un seul homme.
– Ils sont là-bas ?
– Je… Oui, monsieur. Ils viennent de monter à l’instant.
Il raccrocha brutalement. Je fronçai les sourcils. Cet abruti allait sûrement foncer dans le tas, avec pertes et fracas… J’aurais dû m’en douter avant d’appeler, avant même d’accepter le contrat. C’était bien le genre de Monsieur Pantalon, chef d’entreprise à la mâchoire carrée, aux veines encombrées, aux ventricules étranglés par mille contrariétés, mari jaloux et perpétuellement absent, qui exigeait que sa femme l’attende sagement, les mains posées sur le tablier, repas servi, lorsqu’il revenait de ses exploits professionnels et s’effondrait sur le canapé en soufflant des naseaux. Oui, c’était bien le genre à s’abîmer dans le scandale.
Je fis quelques pas nerveux autour de la cabine, jetant un coup d’œil coupable aux fenêtres des Faisans.
Après tout, peu m’importait les coups de gueule de Monsieur Pantalon et la manière dont son épouse et lui géraient leurs querelles conjugales. Normalement, en rigoureux professionnel, je n’avais pas à intervenir.
Mais en même temps que je me faisais cette réflexion, pris d’une impulsion subite, j’entrai dans le hall de l’hôtel. Ma vie est faite de ces élans-là. Je n’ai jamais su me laver totalement les mains des problèmes des autres.
Le réceptionniste, derrière son comptoir, déclara d’une voix pointue :
– Vous désirez quelque chose ?
– Je cherche une dame et un monsieur.
Il soupira.
– L’hôtel est plein de dames et de messieurs. C’est à ça que ça sert, les hôtels.
– Une dame brune, avec un chapeau.
– Je suis tenu au secret professionnel.