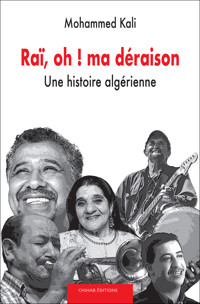L’œil et l’oreille
Des langues aux langages dans le théâtre algérien
Mohammed Kali
L’œil et l’oreille
Des langues aux langages dans le théâtre algérien
CHIHAB EDITIONS
Cet ouvrage a été soutenu par le programme d’aide à la publication de l’Institut Français d’Algérie.
© Éditions Chihab, 2022.
www.chihab.com
Tél. : 021 97 54 53 / Fax : 021 97 51 91
ISBN : 978-9947-39-507-3
Dépôt légal : décembre 2022.
Introduction
Ce quatrième de nos ouvrages portant sur le théâtre algérien constitue, avec les deux premiers, un nouveau jalon dans notre prospection relativement à l’historiographie du théâtre algérien dans l’évolution de ses thématiques et ses esthétiques depuis sa naissance, une mutation qui survient à chaque fois sous forme d’une rupture consécutivement à des accélérations dans l’histoire nationale.
Ainsi, Théâtre algérien, la fin d’un malentendu, notre premier essai, documente celle née durant la tragique décennie 1990 alors que l’État délaisse son monopole sur l’activité théâtrale exercée à titre professionnel et que le mouvement de théâtre amateur, libéré de l’embrigadement du parti unique et de ses satellites, dépérit. Une nouvelle génération d’amateurs, sans étriquées œillères idéologiques, évoluant dans un statut semi-amateur/semi-professionnel, refonde le théâtre algérien sur de nouvelles perspectives tant dans son fonctionnement (naissance de compagnies indépendantes) que dans ses choix artistiques et éthiques. Il s’ouvre sur tous les genres et toutes les formes sacrifiées auparavant au profit d’un théâtre de certitudes à propension propagandiste. Il s’engage ainsi dans la voie d’un théâtre privilégiant le questionnement ainsi que des esthétiques variées et des thématiques hardies.
100 ans de théâtre algérien, le deuxième essai, écrit à la faveur du centenaire du théâtre algérien, ouvre plus largement le champ d’investigation depuis le théâtre folklorique aux nouvelles écritures dramatiques et scéniques comme indiqué en sous-titre. L’ouvrage ne sacrifie nullement à une célébration de circonstance mais est centré sur l’exigence de revisiter l’histoire de ce théâtre pour en cerner le présent et interroger le contexte historique de sa genèse, de passer au crible le bien-fondé de certaines assertions données pour définitives et de relativiser, voire infirmer, certaines certitudes données jusque-là pour définitives.
Quant au présent ouvrage, il aborde la question des langues en partie réglée durant les années 1990 mais qui, depuis la fin de la décennie 2000 connaît un prodigieux développement. Il n’y est pas question du langage, au sens de la capacité à verbaliser, comme pourrait le suggérer un entendement hâtif de son titre, mais des langages qui, eux, renvoient à une autre réalité, celle des moyens mis en œuvre dans la traduction scénique d’un texte dramatique. De la sorte, se démarquant d’une historiographie qui, en notre pays, a été souvent celle de la dramaturgie, l’écriture scénique est mise en relief.
Pour plus de clarté dans le propos, rappelons que la question de la langue au théâtre et des langues en usage en Algérie (fus'ha, darja, tamazight et français), a corseté l’évolution du théâtre algérien depuis sa naissance en raison de l’histoire tourmentée de notre pays. La conclusion de cette question s’explique du fait que la question des langues a finalement perdu de son caractère extrêmement clivant parce que les conditions politico-idéologiques qui l’imposaient dans une situation de non-débat, ne se posent plus aujourd’hui dans les mêmes termes qu’auparavant.
Par ailleurs, sur le plan strictement théâtral, le théâtre, longtemps considéré comme un genre littéraire, n’est plus assimilé au seul texte dramatique, ce dernier n’étant plus considéré que comme une des composantes d’un spectacle. Ainsi, c’est durant les trois dernières décennies que l’expression verbale n’est plus prééminente dans un spectacle théâtral, le texte n’ayant plus la suprématie sur l’écriture scénique. Les metteurs en scène s’imposent alors en coauteurs à travers l’interprétation scénique qu’ils en donnent, de sorte que ce qui est verbal dans le spectacle est ramené au rang d’un langage au même titre que les autres qui le constituent (jeu du comédien, musique, chorégraphie, lumières, scénographie, etc.).
Ce sont ces éléments tels qu’articulés dans un spectacle qui bornent les fondements de la problématique abordée dans cet ouvrage, à savoir une approche de l’historiographie du théâtre algérien sous l’angle, tant des écritures dramatiques que scéniques. Cette démarche qui amoindrit l’hégémonie du textocentrisme1, s’est révélée fructueuse pour nous au regard des questionnements qu’elle a permis de formuler et des pistes de réflexions développées en conséquence.
De la sorte, à travers elle, la démonstration s’est articulée en deux grandes parties. La première retrace l’historique de l’apaisement progressif de la querelle en rapport aux langues et dont l’ultime phase a été remarquablement ponctuée à la veille de 2020, avec l’apparition éclatante du postdramatique et de la performance, un genre et une forme qui privilégient scéniquement le non verbal. À cet égard, faut-il le souligner, l’adoption par le théâtre algérien de ces dernières formes, ne résulte nullement d’une artificielle greffe en raison d’un effet de mode importée mais bien d’un accouchement résultant d’une évolution naturelle d’un théâtre algérien arrivé à un stade où les langages prennent de l’ascendant sur la question des langues.
Il n’est d’ailleurs pas sans intérêt de souligner que la transition s’est effectuée par le biais du théâtre de l’absurde devenu ces dernières décennies singulièrement prégnant dans la production théâtrale, ce genre leur étant d’ailleurs apparenté dans la forme, le visuel y étant aussi prépondérant que le verbal, ce dernier, dans certains cas, étant l’objet d’une déstructuration parasitant sciemment la communication. Et pour conclure le propos de cette partie, nous proposons l’analyse comparée de trois traductions scéniques de Fin de partie de Samuel Beckett, déclinées par trois compagnies.
Quant à la deuxième partie de l’ouvrage concernant toujours les langues, elle est consacrée au théâtre algérien d’expression française dont la partie visible, telle celle d’un iceberg, ne laisse pas imaginer l’ampleur, quantitativement et qualitativement, de celle invisible. Le paradoxe veut que ce répertoire soit méconnu en notre pays, voire boudé par la recherche comme par les femmes et hommes de théâtre qui préfèrent, dans leurs adaptations, puiser dans d’autres répertoires en langue française. D’où l’intérêt d’y voir clair d’autant que ce théâtre s’est développé profusément hors du territoire national, mutant en théâtre franco-algérien à l’instar d’un cinéma franco-algérien également visible principalement à l’étranger…
Le Postdramatique et la performance en épilogue à la question des langues
Au cours des deux dernières décennies, une des plus épineuses hypothèques qui pesaient sur la culture en général et sur la création théâtrale en particulier, a connu un progressif aplanissement. Centenaire parce que remontant au tout début du 20e siècle, elle a trait à la question des langues.
En effet, dans l’Algérie, colonie de peuplement entre 1830 et 1962, l’occupant positionne sa langue et sa culture au détriment de celles des colonisés. Une fois l’indépendance arrachée, il était donc naturel qu’il y ait un renversement de situation sauf que, entre autres questions culturelles, c’est celle des langues, singulièrement de la langue arabe, qui a été la principale affaire. Ainsi, entre autres domaines de la vie culturelle, la création théâtrale en matière de langage verbal a été affectée. Ce n’est qu’à l’issue des années 1990, en raison de la « tragédie nationale » et de la remise en cause de bien des certitudes affermies par l’idéologie dominante, qu’une détente sur cette question s’opère au théâtre.
Lorsque l’action s’impose en principal moteur de la représentation
Le couronnement du processus qui s’est engagé depuis s’est traduit de façon éclatante lors de l’édition 2017 du Festival national de Théâtre Professionnel (FNTP) avec Ma bqat hadra2, écrite et mise en scène par Mohamed Charchal. Ce spectacle a poussé la hardiesse créatrice jusqu’à l’anéantissement du texte dramatique, du moins du dialogue verbal, bousculant toute une tradition théâtrale et son terreau idéologique. Et, cerise sur le gâteau, il a décroché le grand prix du festival dans une compétition au demeurant très relevée.
Dans Finie la tchatche, les échanges deviennent progressivement dialogue de sourds, le spectacle chavirant dans sa moitié dans l’aphasie, la communication devenant non verbale, les personnages comme ayant basculé dans une régression infantile. L’action s’impose alors en unique moteur de la représentation. Elle s’appuie sur la performance, le spectaculaire et le clownesque, s’approprie avec bonheur les techniques de la famille Semianyki3, ainsi que toutes les formes d’expression visuelles des arts voisins. Elle s’enhardit dans ceux de la marionnette en leur expression la plus contemporaine, soit à un niveau supérieur d’accomplissement dont le théâtre de marionnettes en notre pays est encore très loin du fait du règne de l’archaïsme dans sa pratique. Le langage passe par des couleurs vives rehaussant les fantaisistes costumes des personnages, costumes qui dénotent leur étrangeté, leurs personnalités et leurs statuts respectifs. On est plongé dans le cartoonesque le plus farfelu dans le style d’un Tex Avery.
Dans un entretien qu’il nous a accordé Mohamed Charchal concède qu’en faisant primer le discours esthétique sur le discours verbal, il a minoré l’auteur dramatique qu’il est pour accorder la part belle au metteur en scène qu’il est aussi, par ailleurs :
« Oui, même assassiner l’auteur. J’aspire à une théâtralité authentique. Aujourd’hui, pour moi l’acteur est l’âme de la représentation théâtrale. Quand je lui supprime le texte, je le mets en danger. Comment exprimer une émotion, traduire une action sans recourir toujours à la parole ? Ces derniers temps, dans le théâtre algérien, on s’est vautré dans le verbiage et le ‘‘philosophisme’’ au point d’en avoir la migraine. Tu ne retiens rien de ces spectacles visuellement. C’est pour cela que j’ai laissé tomber l’auteur en moi. Avec le théâtre en arabe classique durant ces deux dernières décennies, on a atteint le fond. Auparavant, au moins, on parlait la langue avec laquelle le public réfléchit, car, qu’on le veuille ou pas, nous pensons et ressentons en darja ».
En décembre 2019, Mohamed Charchal récidive avec GPS4, une comédie muette de bout en bout. Présenté en janvier 2020 au 12e festival de théâtre arabe tenu à Amman, en Jordanie, il décroche l’unique prix de la manifestation portant le nom du mécène et homme de théâtre Cheikh Sultan Bin Mohamed Al Qasimi, l’Émir de Sharjah. La démonstration est faite du caractère potentiellement facultatif de la parole pour peu qu’on veuille en tempérer l’usage grâce à la mise en avant de l’action physique. Car, pour tout texte dramatique, c’est un canevas que Charchal a soumis à ses comédiens. Dans un entretien, il nous explique : « Sur cette base de travail, j’ai demandé aux comédiens de faire leurs propositions pour le remodeler et l’enrichir par d’autres idées. Cette approche nouvelle pour eux, les a enthousiasmés et les a fait adhérer de manière agissante au projet, ce qui a donné lieu à un laboratoire de création dont j’étais le maître d’œuvre. De la sorte, les tableaux et les scènes ont été dessinés. Mon texte s’est ainsi écrit au fur et à mesure de l’écriture scénique. Il a été un aboutissement et non un début ».
Ce faisant, au travers de leurs contributions respectives et de leurs propositions de jeu, les comédiens ont été élevés au rang de coauteurs. À cet égard, Estelle Moulard, tout en soulignant que dans les créations de plateaux l’acteur est bien plus qu’un interprète, sachant que « le personnage émanant d’un texte théâtral peut être interprété par une infinité d’acteurs différents, tandis que dans le cadre des écritures de plateau, le rôle semble davantage être lié à l’acteur qui l’a créé5 ».
Il a fallu huit heures de travail par jour, et parfois au-delà, durant quatre mois comme en théâtre laboratoire, pour qu’en 1 h 10 min se fasse succulemment la démonstration que le théâtre peut se passer du dialogue verbal. Sur scène, les personnages ne cessent d’échanger, même par le biais de la chorégraphie, tenant hautement lieu de canal de communication. Au staccato qui lui est imprimé dans le mouvement, elle est, par exemple, un vif échange de propos entre deux, trois personnages et plus, jusqu’à la foire d’empoigne. Le clownesque et le burlesque, à la façon d’un dessin animé déjanté, sont constamment en renfort. Les moments d’émotion ou de surprise ne manquent pas.
Mieux, théâtre-récit, GPS, en faisant l’économie de la verbalisation, se force à une ingéniosité et une virtuosité dans le déroulé d’images scéniques qui donnent à voir des situations et les actions/réactions de ses personnages campés par une dizaine de comédiens inspirés. La truculence, la fantaisie jusqu’au fantastique, l’humour et le gag mais aussi la gravité y passent pour transcender un réel dont on a perdu de vue l’étrangeté et l’absurdité par accoutumance. Charchal a installé aux commandes les langages qui sont l’essence de l’expression théâtrale. Et pour corser le tout, le metteur en scène supprime l’expression faciale à ses comédiens en leur faisant porter des masques la plupart du temps sauf au quatrième tableau. Le grimage des figures, lorsque les comédiens ne portent pas de masque, est saisissant. Les personnages ne sont pas porte-voix mais personnages agissants. La scénographie et les costumes appuient efficacement leur caractérisation.
Autre particularité dans GPS, il n’y a pas que le visuel qui raconte, le noir également lorsqu’il se fait total sur scène et que l’action se poursuit, le spectateur l’imaginant au son de suggestifs bruitages et en découvrant l’issue au retour de la lumière. Tout le long du spectacle, l’éclairage et la musique sont omniprésents en précieux renfort au jeu des comédiens, les deux utilisés au plus haut niveau de leurs potentialités expressives. Mené à un rythme effréné, le récit est visuellement un coup de théâtre permanent, transportant le spectateur de surprise en surprise. En raison de ces caractéristiques, il n’est pas abusif d’apparenter les deux spectacles de Mohamed Charchal à la commedia dell’Arte par leur forme, sauf que, contrairement à elle, ils se passent de l’expression verbale.
Et le « message » de GPS ? Qu’on se rassure, ce spectacle n’est pas qu’un exercice formel. Il y est question de l’aliénation de l’individu par le dressage institutionnalisé et la liberté conditionnée de ce dernier, une thématique que le postdramatique étrenne volontiers tout comme la tragicomédie, voire la commedia dell’Arte.
Mais en définitive, avec les deux spectacles sus-cités, au-delà de leur thématique et du dépassement des formes d’expression théâtrale éprouvées jusque-là, s’agit-il symptomatiquement d’un début de réponse à la problématique linguistique ayant pesamment marqué de son empreinte le théâtre algérien ou alors est-il seulement question de l’émergence d’une postdramaturgie ?
Très certainement et corollairement les deux à la fois.
Les langues, lieux de domination et de résistance sous régime colonial
Afin de prendre la mesure de l’étendue de l’évolution intervenue, remontons au tout début du 20e siècle, au temps de l’adoption du théâtre européen par les pionniers. À cette époque, l’Algérie avait vu la part de son identité arabo-musulmane niée par l’occupant ainsi que la fus'ha, la langue littéraire qui l’incarne selon la doxa nationaliste. Toutefois, une fois le pays libéré du joug colonial, plutôt que de s’apaiser, la mobilisation autour de cette question se transforme en un majeur enjeu de lutte autour de l’accaparement du pouvoir.
Mais revenons aux premières démarches engagées dans la fondation du théâtre algérien. Guardi Jolanda6 rapporte : « L’Émir Khaled, par exemple, après avoir obtenu un certain nombre de textes théâtraux qui lui avaient été offerts par George Abyad, fonda une association théâtrale nommée al-Madiyya, qui fut dirigée par as-Sayyd Iskandari ibn al-Qadi al-Mu’min. La même année, on note la naissance d’une compagnie théâtrale dans la capitale Alger, dirigée par Qaddor ibn Muhi ad-Din al-Halwi. Une autre compagnie fut créée à Blida. Mais déjà auparavant, d’autres compagnies avaient représenté un certain nombre de pièces, parmi lesquelles Almuru’awa al-wafa’ (Honneur et fidélité) en 1912, Mutqal al-Husayn (L’assassinat de Husayn) en 1913 et Ya’qob al-yahodi (Jacob l’hébreu) en 1914. On put également voir une pièce tirée de la tradition occidentale telle que Macbeth en 1912 ».
Ces spectacles ont été montés en langue arabe classique selon les mémorialistes. Cependant, ces derniers ont curieusement fait l’impasse sur le fait que le théâtre a été également étrenné dans la langue de l’occupant. Cette étonnante omission sera examinée plus loin, au chapitre consacré au théâtre francophone. Quant à l’option des pionniers faisant l’impasse sur le recours au parler populaire dans la pratique théâtrale, elle ne peut manquer d’interpeller. C’est que ces pionniers ne sont ni des dramaturges ni des artistes. Tous issus de la bourgeoisie locale et de l’intelligentsia citadine7, parfaits bilingues, l’usage de la fus'ha au théâtre répondait à un dessein revivaliste, celui de réaffirmer et de revigorer l’identité arabo-musulmane afin que l’autochtone retrouve l’estime de soi à une époque de défaite et d’humiliation.
Par ailleurs, outre cette visée, le choix du registre littéraire résulte également du fait qu’au début du 20e siècle, le théâtre est considéré comme un genre littéraire8 et qu’en conséquence, il ne devait pas s’exprimer dans le parler populaire.
De même, militance oblige et outre le choix d’un registre de langue écrite, il s’y ajoute une thématique passéiste liée au prestige de la civilisation arabo-musulmane. En effet, l’idée d’appartenance à l’arabo-islamité était à ce point ancrée dans la doxa nationaliste que près d’un demi-siècle plus tard, lorsqu’en 1949 des militants amazighophones s’avisent de revendiquer la reconnaissance de la dimension amazighe dans la définition de l’algérianité9, la direction du PPA/MTLD les accuse de « berbérisme ». Ils sont désavoués et réduits au silence10.
De la sorte, à l’indépendance, c’est la revendication identitaire « arabiste » qui occupe le devant de la scène politique et culturelle sous le règne du parti unique dans une dynamique jugée par ses opposants de revancharde à l’endroit de ce qui est appelé « la langue du colonisateur » par les uns et « butin de guerre » par les autres. Ainsi, parallèlement à côté d’une politique d’arabisation de l’enseignement et de l’environnement (enseignes des commerces, etc.), une campagne de « purification » de la darja est mise en œuvre pour en supprimer tout emprunt lexical au français.
Pour rappel, au théâtre, une mixité linguistique est intervenue en 1934 avec des pièces écrites en dialectal truffées de répliques en français, une résultante de la période du Front populaire, précédée deux années auparavant par une sorte de « fraternisation » entre artistes français « libéraux » et artistes « arabes ». La troupe de Bachetarzi s’est même renforcée d’éléments européens. Cependant, à peine une année après le déclenchement de la lutte de libération nationale, Bachetarzi note le reflux du mélange des deux langues en raison d’un divorce dû à la poussée indépendantiste : « Le mouvement national s’amplifiant d’année en année, le public trouvait l’introduction de mots étrangers à l’arabe contraire aux principes de la lutte du peuple algérien pour sa libération, exigeait la suppression du dialogue mixte, même dans les reprises des pièces théâtrales écrites déjà depuis plus de vingt ans. Nous ne devions reprendre ces dernières qu’après les avoir complètement modifiées au plan du langage11 ».
Les langues, enjeu de pouvoir à l’indépendance
L’occultation du passé est telle que le manifeste du théâtre algérien accompagnant le décret instituant le monopole étatique sur l’art théâtral en 1963, érige 1954 en date fondatrice dans l’histoire du théâtre algérien au détriment de la période de naissance et de maturation du théâtre algérien. Julie Champrenault note que dès l’indépendance du pays, la question du choix entre culture savante et culture populaire a été posée : « Les places respectives de la langue française et de la langue arabe étaient au cœur de ce dilemme. La question linguistique, qui s’était posée pour la littérature, résonnait également sur la scène du Théâtre national algérien qui rejeta dans un premier temps le français et hésita entre l’arabe littéraire et l’arabe dialectal. Les questions originelles des années 1920 refaisaient donc surface alors que la construction de la culture algérienne, réprimée pendant plus d’un siècle, était érigée en priorité nationale12 ».
Il n’en reste pas moins vrai que l’une des raisons de la volonté de « dé-francophonisation13 » à l’indépendance tient en partie à la domination d’une technostructure francophone dans les rouages des institutions et de l’économie. Cette élite francophone est préjugée/méjugée porteuse d’un projet moderniste de société, ce qui n’arrange pas les desseins des tenants du conservatisme14 ; ces derniers ne figuraient d’ailleurs pas seulement dans les rangs des arabophones. Pour imposer leurs vues, les tenants de l’arabisation allèguent la nécessité de parachever l’indépendance du pays par l’élimination de la dépendance linguistique et culturelle vis-à-vis de l’ex-occupant.
La langue, un accessoire de jeu
L’émergence de la revendication identitaire en 1982 a constitué une opposition frontale à la politique d’arabisation en raison de la perpétuation de la négation de l’amazighité15 qu’elle induisait.
Ce « Printemps berbère16 », épisodiquement réédité dans les décennies suivantes, favorise l’émergence du théâtre en tamazight17. En fait, il s’agit d’une résurgence même s’il est plus exact de parler d’un théâtre d’expression kabyle dans la mesure où dans les autres régions amazighophones du pays, il n’existe pas un mouvement théâtral autant structuré si ce n’est, modestement, en pays chaouia.
Le théâtre en tamazight ouvre une brèche
Pour rappel, le théâtre d’expression amazighe a commencé par être radiophonique en 1949, au sein de ce qui était nommé les « émissions de langues arabe et kabyle » (ELAK) de radio Alger. C’est Mohand Ousalem Lamrani, étudiant de l’institut d’études supérieures islamiques puis professeur de lycée, qui adapte en kabyle des farces et des pièces de Molière.
Quant à l’épreuve de la scène, elle est tentée par deux comédiens des ELAK18 dans une tournée en 1952 à Azazga et Azeffoun avec Si Meziane de Bachetarzi traduite par Mohamed Hilmi et Math-hechkouline (La superstitieuse) dont Hilmi est l’auteur. À l’évidence, la question identitaire n’était pas à l’ordre du jour, le souci des artistes était de présenter un spectacle dans la langue de leur public presque exclusivement amazighophone à l’époque. Après l’indépendance, des pièces de théâtre radiophoniques sont diffusées sur les ondes de la chaîne II de la radio nationale. Mais rien en dehors de ce créneau. Au milieu des années 1960, des élèves du lycée Amirouche de Tizi-Ouzou tentent de jouer des pièces en kabyle mais rencontrent l’opposition de l’administration de leur établissement. Ces mêmes élèves, arrivés à l’université d’Alger, fondent une troupe qui monte Mohamed, prends ta valise de Kateb Yacine en kabyle. Elle essuie le refus des autorités d’être jouée hors de l’enceinte universitaire.
À la veille des années 1980, lors de l’ouverture d’un centre universitaire en 1977 à Tizi-Ouzou, l’idée de faire du théâtre renaît. Une troupe monte en version kabyle Tighri n tlawin (La voix des femmes) et La guerre de 2000 ans de Kateb Yacine. Les représentations de cette troupe sont interdites en juin 1979 puis en janvier 1980. Le théâtre amazigh avait cependant réalisé une percée en France au sein du théâtre de l’immigration dans les années 1970 passant du sketch à un théâtre contemporain avec pour maître d’œuvre Abdallah Mohia, dit Mohand ou Yahia (1950-2004), qui réécrit des œuvres du répertoire universel.
Mohia, transcrit également Mohya, est auteur, parolier traducteur et adaptateur vers le kabyle d’une vingtaine de pièces de théâtre, pour nombre d’entre elles demeurées manuscrites et d’autres publiées dans le Bulletin d’Études berbères de l’université Paris 8 Vincennes. D’autres encore sont sous forme de K7 audio. En France où il s’installe en 1973, Mohia traduit Morts sans sépulture de Jean-Paul Sartre et coadapte La Putain respectueuse du même Sartre avec Mumuh Loukad. En 1974, L’exception et la règle de Bertolt Brecht est Llem-ik, ddu d ud’ar-ik. Elle est jouée lors du 1er Festival du théâtre de l’immigration par la troupe Imesdurar créée par Mohia. Aneggaru a d-yerr tawwurt est le titre, en 1994, de La décision de Bertolt Brecht. Après le « Printemps berbère », et en écho à l’émergence en force de la revendication identitaire amazighe, Mohia adapte en kabyle Le ressuscité, une nouvelle, du chinois Lu Xun ce qui donne Muhend u Caεban. En 1982, La Jarre de Pirandello est Tacbaylit. En 1984, ce sont Tartuffe de Molière (Si Partuf) et Ubu Roi d’Alfred Jarry (Čaεbibi), qui sont adaptées suivies du Médecin malgré lui de Molière (Si Leh’lu) et En attendant Godot de Samuel Beckett (Am win yettrajun R’ebbi). À partir de 1986, quatre autres adaptations voient le jour : Sinistri (La farce de Maître Pathelin), pièce d’un auteur inconnu, datant de 1464, Les fourberies de Scapin et Le malade imaginaire de Molière ainsi que Knock de Jules Romain sont également réécrits. Par la suite, c’est le tour de Les émigrés de Mrozeck en Sin nni, Le suicidé de Nikolaï Erdman en Axir akka, wala deg uz’ekka et l’adaptation d’une seconde nouvelle de Lu Xun La véritable histoire de Ah Qu qui donne Muh Terri.
Dans les années 1980, l’Algérie continue de vivre une guerre des tranchées autour de la question des langues dont la problématique est aggravée par les islamistes qui confèrent à la langue arabe une nouvelle dimension, celle du sacré, en soulignant qu’elle est celle de la révélation. Le pouvoir en rajoute une couche dans sa rivalité avec l’islamisme sur la question identitaire en promulguant des lois. Néanmoins, la donne islamiste ne va pas avoir d’impact en matière de langue sur la création théâtrale dans la décennie 1990 du fait que les islamistes sont occupés à une insurrection armée contre le régime. Ce dernier, étant occupé par l’islamisme armé, son plus mortel ennemi, la voie est libre pour les artistes pour créer. Le risque encouru n’en est pas moins grand puisque l’islamisme armé déclare tout art illicite. Des artistes, dont ceux de théâtre, sont assassinés19.
En fait, pour revenir, et plus anciennement dans le temps à la question du choix du registre de langue au théâtre, celle-ci a été en partie aplanie après la tentative infructueuse de l’élite lettrée de fonder un théâtre algérien fus'haphone entre 1910 et 1926. Le public avait fait défaut à ce théâtre langagier, la fus'ha, n’étant alors intelligible que par les lettrés20.
Après ces pionniers ayant étrenné l’art théâtral pour des raisons utilitaires, ce sont des artistes du monde de la variété qui reprennent l’initiative à leur compte mais en substituant la darja à la fus'ha. Sans formation initiale dans l’exercice de l’art dramatique, ces artistes détenaient sur leurs devanciers l’avantage de la familiarité de la scène et du public. Se fiant à leurs capacités éprouvées d’improvisation, ils développent un théâtre d’inspiration et d’instinct plus que de composition et de recherche, ce qui sera leur marque de fabrique jusqu’après la fin de la 2e Guerre Mondiale21. Ainsi, au terme de deux décennies après l’inaugurale Djeha de Allalou, en 1926, ils réussissent à former un public de théâtre malgré un environnement défavorable. L’adversité vient tant de la part de l’administration coloniale que des notables conservateurs « indigènes », particulièrement lorsqu’une évolution au plan thématique et artistique se manifeste après 1945.
L’espace scénique, lieu de représentation de la parole
À l’indépendance, Ould Abderrahmane Kaki (1934-1995) s’affranchit très tôt des normes linguistiques prescrites par l’idéologie régnante. Il inaugure une nouvelle perspective en inscrivant la question de la reconquête de l’identité nationale non dans une langue supranationale, la fus'ha, mais dans celle du patrimoine populaire oral. Il s’inspire de la langue des aèdes locaux, une koïnè dite chi’ir el melhoun, fixée au 16e siècle par Sidi Lakhdar Benkhelouf. Ce Mostaganémois, un poète-guerrier qui a combattu la Reconquista, a établi au 16e siècle les formes littéraires du chiir el melhoun tel qu’il est pratiqué depuis au Maghreb.
Cependant, Kaki ne se contente pas de pasticher le beau dire des aèdes mais aussi leurs techniques dans le jeu de l’acteur car, dans sa halqa, le meddah22 n’use pas uniquement de poésie mais met encore en scène son dire23. Enfin, au bénéfice de son théâtre qu’il veut identitaire, Kaki puise goulûment dans l’imaginaire du terroir, dans ses légendes et ses mythes. De la sorte, l’évolution qu’il imprime au théâtre algérien ne se limite pas qu’à la question linguistique. Il lui fait accomplir un bon qualitatif qui l’inscrit dans la modernité théâtrale puisqu’en même temps il concilie le patrimoine ancestral avec les techniques modernes forgées par l’avant-garde théâtrale en Europe. Comment y est-il arrivé et pourquoi lui et pas un autre ou d’autres ?
Dans son cas, il y a ses qualités intrinsèques, le prégnant terreau social, fait d’urbanité et de ruralité, ainsi que le riche humus culturel mostaganémois dans lequel il a baigné24. Il y a ensuite sa formation de qualité intervenue dans les années 1950 à un moment charnière de l’histoire nationale lorsqu’une jonction s’effectue entre artistes français et algériens. Fait notable, ses encadreurs venus de l’ex-Métropole en mission de formation, ne sont pas des mentors du tout-venant mais des figures de proue de l’avant-garde du théâtre français, celle de la tradition du théâtre populaire, avec les Cordreaux, Hermantier, D’Eshougues et quelques autres25 encore.
La troupe musico-théâtrale Es-saïdia dont Kaki était sociétaire, est de ce mouvement de théâtre semi-professionnel qui a bénéficié des précieux services de ces hommes à travers des stages de 1er, 2e et 3e degrés en actorat, dans le montage de spectacle, la mise en scène, l’écriture dramatique et le théâtre de marionnettes. En somme, la totale !
Par ailleurs, en Oranie, vers la fin de la décennie 1950, le niveau de l’activité théâtrale a qualitativement progressé avec le renfort de tournées de haute facture effectuées par des troupes débarquant de France. Ainsi, pour citer un exemple, en 1959, La Comédie Française est à Oran avec L’école des maris de Molière ainsi que Le jeu de l’amour et du hasard de Marivaux alors qu’au programme de la 1er édition du festival de Mers el Kébir, il y a entre autres Othello de Shakespeare et Antigone d’Anouilh.
Cette année-là, la troupe El Masrah surgeon d’Es-saïdia, donne au théâtre de verdure d’Oran un gala avec Cauchemar, un essai d’expression dramatique de Kaki qui désoriente le public « indigène » par sa nouveauté, car basé sur l’expression corporelle et la stylisation du jeu sur un fond musical rythmé, ce qui rappelle le Nô japonais. D’un autre côté, dans la même soirée, le même public se délecte de El Aroui Okacha, une loufoque adaptation libre par Kaki de George Dandin de Molière, sous forme de comédie de caractère, dont le même Kaki a assuré la mise en scène.
Début 1960, El Masrah présente une autre comédie amusante, Le docteur Mounir, une adaptation libre du Knock ou le Triomphe de la médecine de Jules Romain, écrite et mise en scène par Kaki, un spectacle qui tranche avec une précédente création, la tragique Dem el Hob. Kaki y campe le rôle principal car il est aussi comédien.
L’éclectisme chez ce créateur encensé par la presse s’affiche la même année par quatre fois. La première avec La valise de Plaute, un « étonnant » spectacle selon J-D Roob, le critique de l’Écho d’Oran, un journal qui tirait à 120 000 exemplaires. Le spectacle est mis en scène au profit d’une troupe européenne d’Oran, Kaki étant alors instructeur régional d’art dramatique attaché au Service de l’Éducation Populaire. Le spectacle emprunte dans sa forme à la commedia dell’arte.
La deuxième fois, Kaki s’affiche avec La cantatrice chauve d’Ionesco qu’il monte au petit théâtre de Bouisseville, sur la corniche oranaise, où il encadre une cotée troupe universitaire de la Sorbonne. J-D Roob titre : « C’était hardi, ce fut excellent ». Il précise : « Je pense que la cohésion de l’interprétation, le style, le rythme, élément essentiel du comique, sont à mettre à l’actif du metteur en scène M. Kaki ».
En juin, pour la troisième fois, Kaki présente Fin de partie de Beckett ; c’est encore du théâtre de l’absurde mais en darja avec la troupe El Masrah. En fin d’année, et pour la quatrième fois, c’est avec Arts et théâtre de Mostaganem, une troupe mixte (éléments français et algériens), que Kaki présente Le nouveau locataire d’Ionesco. Le lendemain de sa générale, l’Écho d’Oran titre « Magnifique succès ». Non sans orgueil, son correspondant local relève : « la mise en scène réglée par l’incomparable Kaki, a prouvé aux Mostaganémois, après Alger et Oran, les qualités de notre compatriote26 ».
Kaki démontre son intérêt pour un théâtre élitaire et un genre, le théâtre de l’absurde, apparu au début des années 1950 en Europe et qu’il est le premier à investir en Algérie. Cela change, faut-il le souligner, du tout au tout d’avec une pratique dominante dans le théâtre algérien qui consiste à assurer la recette en usant de la farce et d’une écriture dramatique se limitant pour l’essentiel à la réécriture de pièces françaises vidées de leur fond profond. Par ailleurs, la mise en scène de ces spectacles se résume généralement à régler les entrées et sorties des comédiens dans l’espace scénique alors que le jeu des acteurs doit essentiellement à leur instinct et à leur capacité d’improvisation de façon à maintenir l’intérêt du public.
En outre, en montant le théâtre de l’absurde avec El Masrah, Kaki s’offre de nouvelles alternatives en matière de formation de ses comédiens, ce genre ne s’appuyant pas sur le verbal pour passer la rampe. Ainsi, il permet de mettre en avant le jeu physique des comédiens. De plus, ce genre n’est pas sans renvoyer à la théorie du théâtre pauvre cher à Grotowski, un théâtre qui valorise le corps de l’acteur et sa relation avec le spectateur, un genre qui se passe des costumes, des décors et de la musique. C’est donc une approche tout à fait neuve dans le théâtre algérien. Dans sa pratique dans la direction d’acteur comme dans la mise en scène, Kaki ajoute les enseignements de la formation de l’acteur et la construction du personnage selon le système théorisé par Stanislavski. Il s’appuie également sur les travaux de Gordon Craig, Meyerhold, Piscator et Brecht.
Cette technicité d’avant-garde, Kaki est le premier algérien à la mettre en œuvre, ce dont atteste fin 1960 l’Écho dimanche27, l’édition dominicale de l’Écho d’Oran. Mais l’élan est interrompu, El Masrah cesse toute activité en novembre 1961 avec l’arrestation de son directeur, Abdelkader Benaïssa, pour son appartenance à l’organisation civile du Front de libération nationale (OCFLN). Kaki ne s’oublie pas à la veille du 5 juillet 1962, il met à profit la période du cessez-le-feu pour faire le rappel des compagnons qu’il a formés pour monter avec eux un nouveau spectacle écrit en prévision des festivités de l’indépendance.
Et ce qui ne gâte rien, il y investit le patrimoine immatériel maghrébin et une langue qui n’est ni de la darja, ni la fus'ha, mais une langue médiane s’inspirant de l’art oratoire du meddah. Cela donne 132 ans dans un genre qui relève du théâtre-récit avec par intermittence des illustrations de l’action. Et pour tout décor, la scène est nue, avec juste un accessoire alors que les costumes sont ceux des jeunes de l’époque, des tee-shirts sur des jeans. Il n’est pas anodin de mettre en relief le fait que si ce spectacle a aujourd’hui pris quelques rides, ce n’est pas dans sa forme mais dans certaines répliques nationalitaires imputables à l’euphorie de l’immédiate postindépendance. Cette fresque militante est suivie par Le peuple de la nuit et Afrique avant 1, qui constitue, avec elle, une trilogie politique dans la dramaturgie de Kaki.
Kaki s’impose dès lors comme l’homme de théâtre le plus important d’Algérie. Cette flatteuse reconnaissance, il la confirme trois années plus tard en creusant plus profondément le sillon avec El guerrab oua salihine, son chef-d’œuvre, inspiré de La Bonne âme du Sé Tchouan de Bertolt Brecht. En ce sens, Ould Abderrahmane aura été une leçon de théâtre28 dont l’influence va perdurer bien qu’il ait connu un assèchement29.
Abdelkader Alloula (1939-1994), l’autre grand novateur après lui, la maintiendra dans les années 1980 jusqu’aux années 1990, lorsque le théâtre algérien entame sa deuxième grande évolution consécutivement aux bouleversements politiques de l’après octobre 1988 et la décennie noire.
En effet, dans une approche similaire de ce genre appelé théâtre halqa, Alloula s’illustre en poétisant le parler algérien. Et c’est dans un théâtre de l’écoute qu’il s’engage. En cette période, où les salles de cinéma ont fermé et où les chaînes satellitaires n’arrosent pas encore le territoire national, le public fait montre d’une capacité d’écoute, reliquat d’une culture de l’oralité. Dans l’expérimentation engagée par Alloula, le plaisir du spectateur est auditif. Le dramaturge transpose de la halqa ce qui en est le plus spectaculaire : la magie du verbe.
Pour lui, le spectacle doit être vu « avec les oreilles », ce qui se traduit par une subornation de la mise en scène par rapport au texte, celle-ci portant sur le jeu de l’acteur. Les comédiens y travaillent les intonations, les registres et les couleurs de la voix.
Par ailleurs, les échanges entre les personnages ne sont pas ordinairement des répliques courtes mais des soliloques et plus franchement des monologues, parfois portés par plusieurs voix. Son œuvre la plus marquante, Lajouad30 (1985), illustre de façon aboutie l’impact de cette démarche, au point que le spectacle fonctionne mieux sans le décor et les costumes initiaux du spectacle, lorsqu’il passe dans des salles non conventionnelles.
Les pratiques théâtrales de Kaki et Alloula se sont généralisées à tout le pays dans les années 1970 et 80, avec le renfort du théâtre d’agit-prop de Kateb Yacine qui avait lui aussi investi le patrimoine populaire et les techniques brechtiennes.
Une décennie après, celle des années 1990, la question des langues connaît un début de dénouement. L’Algérie a sociologiquement et culturellement changé. Une nouvelle génération d’artistes s’impose ; tous les langages dans l’écriture scénique regagnent leurs droits ; tous les genres retrouvent le terrain perdu durant les décennies 1970-1980. La langue, ou plus justement le texte dramatique qui lui donne corps, n’est plus considérée comme l’élément central dans l’expression scénique. Le théâtre s’exprime désormais sans tabous dans les langues du pays.
Même le théâtre en arabe classique prend racine, l’école ayant formé des générations comprenant ce registre de langue. La première troupe à investir le terrain est une association dénommée Mustapha Kateb. Créée au centre culturel de la Wilaya d’Alger, elle a pour animateur Makhlouf Boukrouh, un universitaire qui devient directeur du TNA en 1993. Elle monte quatre pièces : Statues de l’égyptien Mahmoud Diab en 1986, Le roi c’est le roi du syrien Saadallah Wannous en 1987, Le pêcheur et le palais d’après le roman éponyme de Tahar Ouettar en 1991 et Rijel Lahoum Rou’ous de l’Égyptien Mahmoud Diab (1992). En fait, la démarche se hasarde à demi dans la fus'ha : Les textes sont réécrits dans une langue qui tient de l’arabe classique tout en prenant des libertés avec la rigueur de sa syntaxe de façon à être accessible au large public : « Je voulais qu’on soit compris tout autant en Algérie que dans le monde arabe où l’on ignore notre darja » assure Boukrouh.
Abdelhalim Zreiby, un des chefs de file d’un théâtre totalement en fus'ha, se défend de toute considération d’ordre idéologique dans son option pour ce registre de langue : « Mes camarades et moi avons fait du théâtre scolaire dans ce registre. En outre, nous étions les premières classes dont le cursus a été entièrement arabisé depuis le milieu des années 1970. Ce n’était donc pas pour nous un choix mais une évidence.
Ensuite, ma conviction est qu’un amateur comme je l’étais, qu’il soit metteur en scène ou acteur, ne peut se former sûrement qu’en travaillant sur des textes solidement charpentés avec des personnages bien dessinés, ce qui nous oriente sur de grands auteurs et adaptateurs du Moyen-Orient. Enfin, utiliser la langue classique oblige à travailler la phonétique articulatoire et les registres de la voix avec plus d’exigence parce qu’elle n’est pas une langue parlée et que, oralisée, il faut la rendre crédible à l’oreille du spectateur31 ».
La darja, langue mosaïque
Le théâtre étrenné au Sahara et sur les hauts plateaux alfatiers, par les Boulghiti et Okbaoui à Adrar ainsi que par Haroun Kilani à Laghouat, pour ne citer que ceux-là, relève de la même approche scénique que celle développée par un Haïder Benhassine, le principal chef de file de ce théâtre fus'haphone au nord du pays, même si ce sont les artistes du sud qui ont le plus contribué à imposer en Algérie un théâtre en arabe classique aux thématiques fortes. À cet égard, le théâtre au et/ou du Sahara n’a pu conquérir de visibilité nationale que lorsqu’il s’est engagé dans cette voie et ce, dès le moment où il a cessé de singer ce qui se faisait au nord du pays.
Durant la période des années 1990, Khaled Belhadj32 s’est engagé dans une singulière tentative sur la question de la langue en investissant les langages au plan visuel (l’expression corporelle, la lumière, la musique, décor, projection vidéo, etc.).
Il initie ainsi divers spectacles parodiques qui rencontrent un énorme succès auprès du public. Il écrit et monte également le deuxième mimodrame33 du théâtre algérien, Morstane (1996) d’après Les méfaits du tabac d’Anton Tchekhov. Mais il n’y a pas que la mutité du spectacle qui est frappante, c’est de nouveau le recours à la scène nue. En fait, elle ne l’est pas vraiment. Elle est traversée à l’avant par un long ruban adhésif transparent, large de 5 cm. Sa présence énigmatique ajoute en densité dramatique au jeu. En outre, des rayons latéraux de découpe, surgissent en coulisses, côté jardin. Ils barrent de leur blancheur écarlate l’arrière-scène, marquent les entrées par l’arrière des personnages, soulignant la profondeur de champ de l’espace scénique. Cependant, entre le ruban et les lumières, les évolutions et les actions des personnages suggèrent la présence d’une réalité invisible : un bus qu’on prend, une rue, des arbres, etc. C’était tout à fait nouveau. Le spectacle a glané de nombreux prix.
Il reste que l’expérience n’a pas entraîné l’adhésion d’autres praticiens en faveur de l’affranchissement par rapport à la domination du langage verbal dans le contexte d’un mouvement théâtral plus préoccupé à explorer tous les genres et à se gorger d’une classique esthétique de la séduction en s’ouvrant à la chorégraphie, la scénographie, la création de lumière et aux arts audiovisuels. Morstane arrivait en avance de plus de deux décennies.
Interviewé, Belhadj nous explique : « Si j’ai cultivé le silence c’est parce que chez nous le théâtre s’est réduit à de la diarrhée verbale. Il n’y avait plus que cela sur scène ! Pas de corps, ni image, ni esthétique, les autres mouvements de la beauté, quoi ! On dirait qu’on était dans les années 1920 où la parole était la denrée principale. On en faisait des tonnes sans se douter qu’il y avait autre chose et d’autres possibles ».
Le constat est le même que celui fait vingt ans plus tard par Mohamed Charchal. Relancé sur cette question puisqu’après Morstane Khaled s’est lui-même remis à un théâtre où la parole est présente en force, il nuance notre remarque : « Sauf que ma troupe, formée solidement à la pantomime, ne s’appuie pas que sur le verbe. Mes comédiens le respirent autrement. Pas seulement par la voix mais par l’expression corporelle également. En ce sens, je considère que la pantomime est une grammaire dans le fondement d’un langage. J’ai voulu promouvoir un autre type de jeu ».
Par la suite, d’autres tentatives explorent des voies entre dramaturgies postdramatiques, théâtre de l’absurde et performances théâtrales. Cette démarche se situe dans le droit fil de leurs parcours artistiques pour avoir durablement investi le théâtre de l’absurde où le discours didascalique souligne dans le texte ce qui échappe au verbal.
En outre, une orientation du théâtre algérien s’est fortement marquée après 2014 avec la fin brutale de l’embellie financière que l’Algérie connaissait depuis 2000 en raison du prix élevé des hydrocarbures dont l’économie algérienne est dépendante. En effet, entre 2000 et 2014, l’État a déboursé à outrance pour maintenir la paix sociale et éviter la contagion des « printemps arabes ». La dépense en question permet également de domestiquer le monde artistique.
Pour ce faire, une gabegie institutionnalisée s’installe à travers la mise en place de deux faramineux budgets34