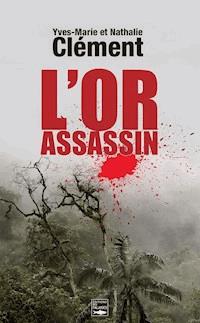
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions des Falaises
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un serial killer poursuit son cycle macabre... Les enquêteurs pourront-ils l'arrêter ?
Minuit. Quand le capitaine Dumoulin entre dans la petite villa d'un quartier paisible d'Orléans, il découvre une mise en scène macabre évoquant un meurtre rituel. Aucun doute, encore une victime de celui qu'on nomme déjà l’équarrisseur. Cette fois, les enquêteurs en ont la certitude, un fil ténu relie les assassinats : la Guyane. Appelée en renfort, l’offi cier de gendarmerie Adriana Wayakalin, amérindienne d’origine, s'envole pour Cayenne et la jungle des garimpeiros dans l'espoir d'empêcher d'autres crimes annoncés. Une enquête qui va la mener dans une spirale infernale.
Ce thriller signé Yves-Marie et Nathalie Clément entraîne leur héroïne fétiche dans une nouvelle enquête sous le ciel de Guyane.
EXTRAIT
Déstabilisé, Jalabert jeta un coup d’oeil par-dessus la tête de l’Indien.
L’autre restait impassible, les yeux dans les yeux de Jalabert, la main gauche fermement accrochée à la sangle d’un sac à dos bleu.
Un éclat métallique le long de sa jambe attira son regard : une machette. Belkacem, Gauthier… lui, Lucas Jalabert, se trouvait aussi sur la liste…
— Je tue, dit calmement l’Indien.
Lucas Jalabert voulut refermer la porte. Trop tard. La foudre le transperça. Souffle coupé. Douleur fulgurante.
Une violence sans égale.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Yves-Marie et Nathalie Clément connaissent la Guyane pour y avoir vécu une dizaine d'années. Dans ce polar, ils font vivre une deuxième aventure à leur héroïne déjà mise en scène dans
Terminal 2A.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pour Assmyda, Jacqueset Yohann, nos amis du Geai.
Combegrand, mars 2018
L’Or assassin est un roman inspiré de la réalité guyanaise, dont les protagonistes, les événements mis en scène, et les situations, appartiennent tous à la fiction.
Rivière Itany, Guyane
Les insectes tournent autour des lampes à pétrole accrochées aux poteaux du carbet. La jeune femme se repose dans le hamac, les yeux tournés vers le ciel de case. Son ventre la brûle. L’enfant vient de naître. La taille disproportionnée de sa tête lui a déchiré les chairs au passage.
Un cri.
Comme un cri de toucan. Bref, répété. Ce n’est pas le cri d’un bébé. La vieille accoucheuse tient le petit à bout de bras. Son visage se ferme. Son constat est sans appel :
— Ce garçon ne portera jamais de nom !
Un monstre !
C’est un monstre comme il en sort parfois du ventre des femmes wayanas. La jeune mère le lit dans le regard de la vieille. Silence. Puis un long gémissement de douleur jaillit de sa bouche. Un flot de larmes sur ses joues.
Il fait encore nuit. Le ciel est clair, étoilé, et la lune monte au-dessus de la jungle. La jungle vivante, vibrante, demande qu’on lui rende l’enfant.
On appelle le père.
La jeune femme sait maintenant qu’elle ne tiendra jamais ce bébé dans ses bras. Il ne tétera jamais son sein. Il ne boira jamais son lait. Elle ne l’endormira jamais en berçant le hamac.
Ce bébé sans nom, son père va le rendre à la Mère-Forêt.
Le père marche sur le sentier qui mène aux abattis. Il s’arrête en chemin. L’enfant geint dans le katali1. Il ne crie pas. Il gémit, c’est tout. Il siffle et grogne comme un agouti fléché. C’est l’appel d’un animal, rauque, une plainte brève. L’agonie d’un chat ou celle d’un petit singe. Ce bébé n’a rien d’humain.
Le père marche et compte ses pas. Puis il quitte le sentier. Il va au hasard, guidé par les Esprits de la Forêt.
Le père choisit l’endroit.
C’est entre les racines d’un vieux wacapou qu’il décide d’abandonner l’enfant. Ce vieil arbre se trouvait là bien avant l’arrivée des Wayanas.
Un genou à terre, il sort l’enfant du katali. Il pose le corps sur un lit de feuilles. Ses gestes sont lents. Il l’observe un moment. Il se relève. Ce n’est déjà plus son fils.
Il n’a jamais été son fils.
Les fourmis viendront les premières. Très vite. Elles découperont des petits morceaux de la peau. Le bébé criera. Mais les fourmis n’ont pas d’oreille, elles ne craignent pas les cris. Alors elles entreront dans la bouche et dans les narines, boiront les larmes de ses yeux, entreront dans les oreilles pour y creuser un chemin. D’abord quelques-unes d’entre elles. Puis une poignée, puis une colonie. Toute la fourmilière. Les cris s’étoufferont. Les bras et les jambes seront agités de mouvements secs, désordonnés.
Au petit matin, les mouches seront du festin. Et le puma, peut-être. Et l’ocelot. Au soir, les urubus nettoieront les os fragiles.
Les morceaux retourneront à la terre des Ancêtres.
Ce n’est pas au père de donner la mort.
C’est à la Mère-Forêt de reprendre la vie et de libérer l’akuwalï2.
1. Hotte pour transporter le manioc, le bois, etc.
2. Principe vital.
Samedi
Fleury-les-Aubrais, dix-huit heures.
La chambre que son frère lui avait louée sentait encore le sexe. Les draps étaient tachés.
Mulokot vérifia que sa porte était bien fermée. Il tira le rideau devant la fenêtre. Dehors, c’était déjà la nuit noire de l’hiver.
Mulokot posa son sac sur le lit. Il l’ouvrit. Sortit tout ce qui allait lui servir lundi soir à Orléans pour son troisième passage à l’acte. Il posa la main sur le manche de la machette. Il caressa le bois. Son index passa sur la lame aiguisée. Il avait été obligé d’en couper la pointe à l’aide d’une disqueuse pour qu’elle pénètre plus facilement le ventre.
Mulokot resta longtemps immobile. Le visage fermé. Il se repassait les images des deux premiers meurtres. Sa respiration s’accéléra. Sa main droite tremblait. Il s’efforça de contrôler ce corps qui ne lui obéissait plus. Mais c’était difficile.
Il ferma les yeux, et répéta dans sa tête les gestes qu’il allait accomplir une fois de plus. C’était une révision, une projection mentale, comme les grands sportifs avant la compétition. Le prochain s’appelait Lucas Jalabert. Mulokot s’était rendu plusieurs fois à son domicile. Il connaissait la moindre de ses habitudes. Pourtant, quelque chose lui disait que cela n’allait pas se passer comme il l’avait prévu.
Mulokot se déshabilla. Dans la minuscule salle d’eau, il écarta le rideau poisseux de la douche et fit couler l’eau froide. Il entra dans le bac. Il fut d’abord surpris par la température très basse de l’eau. Ses longs cheveux noirs se mouillèrent, ses épaules, son ventre. Son sexe, ses cuisses. L’eau glacée le purifiait. L’eau glacée chassait les mauvais Esprits qui tentaient de pénétrer son corps et son âme. L’eau glacée le rendait invincible.
Sans ouvrir la bouche, il entama une mélopée ancienne du peuple wayana pour se donner la force de continuer. Le rideau de douche lui colla à la peau. Il imagina la forêt. Sa forêt. Les grands arbres de la Terre-Mère. Et ce n’était plus la faïence blanche et crasseuse de la douche qui l’entourait, mais la jungle protectrice.
Il entonna alors un chant de guerre :
— S’alë ta kene kaikusi me ïtë kë ë ja3 !
Nantes, dix-neuf heures trente.
Adriana Wayakalin marchait seule sur la promenade de la rue Camille Bryen. Paupières mi-closes, elle inspirait longuement l’air frais des bords de Loire. Le vent glacé de février traversait les mailles fines de sa tenue de sport, se coulait dans son cou, lui piquait les narines, giflait son visage mat, ses joues rondes, son grand front sur lequel jouaient de fines mèches de ses cheveux noirs qui avaient échappé à sa queue de cheval. Une petite bruine tombait doucement du ciel. Adriana Wayakalin s’arrêta et offrit son visage à la fraîcheur des fines gouttes. Un flash. La pluie à Terre-Rouge, le village amérindien où elle avait vu le jour.
Dès qu’il pleuvait, les enfants se retrouvaient sur la petite plage de sable où se mêlaient les eaux du fleuve et celles du ciel. Elle essaya de se remémorer le parfum terreux de l’air à la saison des pluies. Mais ce fut impossible. Elle sourit. C’était loin tout ça…
Chaque fois qu’elle rentrait de son cours de gym, elle passait par l’île de Nantes, stationnait sa voiture sur le parking près du Parc de Beaulieu. Et marchait. C’était sa manière à elle de faire retomber les tensions accumulées pendant la leçon.
D’un geste machinal, elle resserra le chouchou qui maintenait sa queue de cheval, posa les mains sur ses hanches, se contorsionna pour faire craquer une vertèbre dorsale. Puis elle leva la jambe, posa le talon sur le muret de pierre face à la Loire, et commença une série d’étirements devant le fleuve dont la surface frissonnait au vent.
Un couple passa auprès d’elle. Ils discutaient du « Monstre », celui que la presse surnommait déjà « l’Équarrisseur », celui dont tout le monde parlait… Le second homicide avait eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. La victime, un certain David Gauthier, à son domicile parisien.
Adriana ne put s’empêcher de penser à l’affaire.
Comme pour le premier meurtre, l’homme à la machette venait de frapper une deuxième fois, et les photos du corps démembré avaient aussitôt été diffusées sur Internet. Impossible d’y échapper. Les partages sur les réseaux sociaux avaient fait de ces homicides un événement de niveau international. L’évocation d’un tueur en série affolait la presse et régalait le public.
Une voiture passa à la hauteur d’Adriana. Une petite bagnole cabossée dont le pot d’échappement devait être percé de toutes parts. Fiat Panda bleue, ancien modèle. Devant, la vitre du passager s’ouvrit.
— Eh, Lara Croft, tu suces ?
— Connard !
Adriana se fendit d’un doigt d’honneur. Quatre pauvres types dans une bagnole de beauf. Qu’ils aillent se faire foutre.
Elle consulta l’heure sur son portable. Il était temps de rentrer. Elle avait faim, et cette journée avait été plutôt longue.
Tout en marchant, elle pensait à ce deuxième homicide. Intérieurement, elle regrettait un peu d’avoir quitté la gendarmerie. Courant 2014, suite à la fin tragique de l’affaire Nelson, Adriana avait écopé d’un blâme pour mauvaise gestion de l’enquête. Pour elle, la sanction était injuste et elle avait préféré se mettre au vert et poser une disponibilité de longue durée pour convenance personnelle. En s’installant à Nantes, elle s’était rapprochée de sa petite sœur Lucile et de ses neveux, qui vivaient à Montaigu.
Elle avait trouvé un poste de consultante dans une entreprise d’import-export, ce qui lui avait permis de rendre deux fois visite à sa mère en Guyane. Elle ne pataugeait plus dans le sordide mais le manque d’action lui pesait. Elle vivait une sorte de train-train sans intérêt. Une vie morose, rythmée par les saisons. C’était comme si sa vie lui avait glissé entre les doigts. Et maintenant, elle lui échappait. Adriana n’en tenait plus les rênes.
Elle s’imposait des séances de sport pour tenir la forme et ne pas sombrer.
Ce double homicide l’intéressait. Il réveillait en elle l’âme de l’enquêtrice. C’était plus fort qu’elle, elle ne pouvait s’empêcher d’analyser l’événement. Qui était ce tueur ? Quel genre d’assassin ? Psychopathe ? Impulsif ? Déficient psychoaffectif ? Quels étaient ses mobiles, ses motifs ? Agissait-il par vengeance, par dépit ? Crime de haine ? L’agression avait-elle un caractère sexuel ? Allait-il encore frapper et entrer définitivement dans la sinistre catégorie des serial killers ?
Sûr que Rémy Tracol n’allait pas tarder à la contacter. À cette idée, elle se sentit toute joyeuse. Rémy, c’était ce jeune élève-officier qu’on lui avait collé sur l’affaire Nelson. Intelligent, sérieux et prometteur, elle avait continué à correspondre régulièrement avec lui. Par mail, par SMS. Chaque fois qu’une enquête le tracassait, il lui demandait conseil. Au fil des mois, leurs liens s’étaient renforcés. Ils avaient même prévu de se revoir bientôt.
Le vent redoubla de vigueur. De longues bourrasques obligèrent Adriana à se courber pour résister à la poussée des rafales. L’air sifflait dans les branches des arbres dénudés qui bordaient le fleuve. Elle aimait ça, cette violence des éléments.
Elle descendit la volée de marches qui menait au parking.
Un serial killer choisit sa victime. Il s’agit souvent d’un sadique sexuel d’intelligence moyenne qui ne frappe jamais au hasard. Il s’arrange pour ne jamais opérer deux fois au même endroit. Il est capable de faire des centaines de kilomètres pour échapper aux mailles du filet tendu par la police. Le serial killer se croit insaisissable. Adriana Wayakalin brûlait d’envie de connaître le dossier. À quoi ressemblait donc l’Équarrisseur ? Quelle sorte de reconnaissance attendait-il en diffusant les scènes de crime sur Internet ? Que cherchait-il ?
Il n’allait pas s’arrêter là. C’était sa seule certitude.
Tout en ruminant ces pensées, Adriana monta dans sa voiture, une Ford Focus, claqua la portière. Elle passa les mains dans ses longs cheveux noirs pour les ramener en arrière et resserra de nouveau le chouchou. Dégagea son beau visage aux traits fins, à la peau caramel, aux yeux légèrement bridés. Elle pensa à Sami, ce GAV de la brigade de Roissy qui la surnommait « Pocahontas ». Ce soir, en se regardant dans le rétroviseur intérieur, Adriana hésita. « Lara Croft » ou « Pocahontas », décide-toi pour le choix du look.
Nantes, vingt heures quinze.
Adriana poussa la porte de la petite maison qu’elle louait boulevard des Poilus. Elle jeta son sac de sport dans l’entrée, ôta sa veste, enleva ses chaussures sans défaire ses lacets, monta les escaliers et se dirigea vers la salle de bains, retira son tee-shirt, son soutien-gorge, son jogging et sa petite culotte, les semant sur le sol au fur et à mesure qu’elle les ôtait. Elle termina par ses chaussettes qu’elle jeta dans le panier en osier débordant de linge sale. Elle ouvrit le robinet de la douche. Eau glacée. Elle se regarda un instant dans le miroir en attendant que l’eau soit à la bonne température. Elle aurait aimé avoir un peu plus de seins. Mais peut-être pas autant que Lara Croft… Et sa peau mate d’Amérindienne avait un peu perdu de ses couleurs. Mais pas si mal quand même, elle pouvait encore plaire. Elle défit sa queue de cheval. Ses longs cheveux noirs roulèrent sur ses épaules.
Sous la douche, elle ferma les yeux. Les images des corps mutilés lui revenaient sans cesse.
La police avait semble-t-il écarté la piste terroriste. Les deux hommes avaient été assassinés dans leur sommeil, chez eux. D’un coup de machette. Éventrés. Adriana frissonna.
À Terre-Rouge, son village près de Saint-Laurent-du-Maroni, les hommes n’allaient jamais en forêt sans leur machette. Quand sa mère se rendait à l’abattis pour cueillir des bananes ou déterrer quelques racines de manioc, elle emportait toujours son sabre dans un katouri, sorte de panier en fibres tressées que confectionnait sa grand-mère. C’étaient des images de l’enfance. Mais là, la machette avait été utilisée pour des crimes. Ce n’était plus un objet du quotidien. Elle était tachée de sang humain.
Adriana ouvrit la porte de son réfrigérateur. Presque vide. Elle détestait les frigos qui débordaient de victuailles. Dans le sien, juste l’essentiel pour éviter de mourir de faim. Elle sortit le bocal de cornichons, la plaquette de beurre et un paquet de viande fumée dont elle vérifia la date de péremption. Elle fit un rapide calcul :
— Dépassée de dix-huit jours, murmura-t-elle, ça devrait aller. Elle prit des olives noires, une crème au chocolat. Elle posa le tout sur un plateau sur lequel elle ajouta un couteau, une cuiller, et quatre tranches de pain de mie complet presque sec qui traînaient dans le fond d’un placard. Elle ne serait jamais élue Miss France de l’équilibre alimentaire. Peu importait ce qu’elle avalait, elle avait faim, c’était tout, et elle détestait faire la cuisine. Elle ouvrit une canette de bière et compta combien il en restait au frais. Assez pour le weekend.
Son portable sonna. Elle se précipita dans le salon.
« Rémy Tracol » s’affichait sur l’écran. Elle se laissa tomber sur le canapé et glissa son doigt sur l’écran tactile.
— Rémy ?
— Adriana. Je ne te dérange pas ?
Le cœur d’Adriana battit un peu plus fort. Comme si elle se posait après un sprint. Elle n’avait jamais vraiment su ce qu’elle éprouvait pour ce garçon. Elle lui demanda :
— Alors ta mut, tu as une réponse ?
— Oui. Je viens d’obtenir mon affectation.
— Et ?
— J’ai été envoyé dans le Nord-Est. Un bled dont je tairai le nom.
— Bon.
— Non, sans blague, je déteste. J’avais demandé l’Outremer et rien d’autre. Le Nord-Est, tu imagines ? Et le commandant est un sale con de carriériste. Ça aussi tu l’imagines ?
— Plutôt bien, j’en ai croisé pas mal…
— Je donnerais n’importe quoi pour fuir cet endroit. Tu n’as pas une idée ?
— Je peux y réfléchir, dit Adriana. Et ton général de papa, il ne peut pas te pistonner ?
— On est fâchés. Et surtout, il veut être irréprochable. Alors la famille…
— Pas d’chance !
— Je t’appelle… je pensais à toi, dit Tracol avec une voix hésitante et suave. Je…
— J’étais sûre que tu allais m’appeler.
Adriana s’allongea dans le canapé. Elle frissonna. Il ne faisait pas très chaud dans la maison. Elle attrapa un coussin et le posa sur sa poitrine. Elle n’avait pas revu Rémy. Mais elle l’imaginait parfaitement. Chaque fois, c’était la même vision qui remontait. Il se tenait assis sur une table, immobile, dans son bureau de la brigade de Roissy. Il portait sa veste de cuir, un sweat à capuche. Il regardait Adriana, installée à l’ordi. Le visage détendu. Avec un léger sourire qui faisait remonter ses pommettes.
— À propos de l’Équarrisseur ? demanda Tracol.
— Oui. C’est pour ce genre de traque que l’uniforme me manque.
— Ce malade à la machette. Toi aussi, tu trouves ça excitant ?
— Plutôt.
— Mais moi tu sais, j’ai ce qu’il me faut, pour des petites poussées d’adrénaline. Figure-toi que je suis sur l’affaire Rosita.
— Rosita ? Pas entendu parler…
Tracol toussota et continua :
— C’est une vache qui a été découpée à la tronçonneuse dans un pré de ma circo la semaine dernière. On recherche des types qui revendent de la viande sous le manteau. Même registre mais en moins jouissif quand même, tu ne crois pas ? Je préfèrerais nettement enquêter sur ce psychopathe.
— Je ne suis pas sûre qu’il s’agisse d’un psychopathe, dit Adriana. Vraiment. Mais c’est bizarre…
— Quoi ?
Adriana hésita puis reprit la conversation :
— Je n’arrête pas d’y penser. Je savais qu’il y aurait un deuxième homicide. Et je crois que ce n’est pas terminé. Et puis...
— Et puis ?
— Je te le dis à toi parce que je sais que tu comprendras. Je me sens concernée.
— Le fameux sixième sens d’Adriana Wayakalin ?
— Peut-être bien. On en reparlera autour d’un verre. Alors, on se fixe un rendez-vous quand tu en auras terminé avec ta belle Rosita ?
Minuit.
Adriana ouvrit les yeux. Un cauchemar l’avait réveillée, une fois de plus. Ou peut-être était-ce la lueur des lampadaires dans la rue, ou le vent qui soufflait en rafales. Elle avait le sommeil de plus en plus fragile. Elle se retourna dans son lit, attrapa le traversin tombé à terre, le serra contre elle et repoussa ses cheveux en arrière. Elle ferma les yeux, décidée à se rendormir. Mais elle savait très bien que cette fois, ça ne marcherait pas. Adriana était devenue insomniaque. Et elle finirait bientôt par l’admettre. Elle passait des nuits entières éveillée, à penser. À se demander qu’est-ce qu’elle était bien venue faire dans cette vie de merde. Dans ce grand taudis de l’humanité. Chaque jour, des nouvelles de plus en plus sordides entachaient le monde, obscurcissait son envie de se battre.
Insomniaque…
Elle avait tout essayé, la lecture, un bain chaud, avaler quelque chose, regarder l’ordi et se recoucher, appeler sa famille en Guyane quand le décalage horaire le permettait... Rien n’y faisait. Et c’était encore pire les nuits de pleine lune. Quelque chose la taraudait de l’intérieur.
Dans la journée, il y avait les collègues de travail. Il y avait ces gens qu’elle croisait quand elle faisait ses courses, quand elle se trouvait dans la rue, dans les transports en commun, dans les cafés où elle buvait sa bière. Mais la nuit, elle se retrouvait seule. Seule dans sa tête. Seule dans son lit. Des hommes, elle en avait parfois. Mais seulement pour quelques jours, ou quelques semaines. Elle ne les gardait pas. Et bien souvent, ils appartenaient à une autre.
Adriana alluma sa lampe de chevet, repoussa la couette et se leva. Elle enfila un tee-shirt. Elle traversa sa chambre encombrée de fringues, de cartons, de sacs qu’elle n’avait jamais vidés. Elle shoota dans un petit monticule de jeans et de chemisettes qui étaient tombés là les soirs de flemme et qu’elle n’avait jamais ramassés.
Elle se dirigea vers la cuisine, ouvrit le frigo, en sortit une bière forte. Elle prit une boîte de biscuits apéritifs entamée et s’installa à sa table, alluma son ordinateur portable et avala une gorgée du liquide frais. La webcam était restée allumée et son visage apparut sur l’écran. Elle recula la tête d’un coup, comme si elle avait eu une apparition. Mais c’était bien elle, Adriana Wayakalin. Jolie fille, la trentaine. Un visage où de petites rides commençaient sournoisement à se dessiner. La trentaine, pas de mec, pas de gosse. Elle déconnecta la webcam et lança Internet. Des gosses, de toute façon, elle n’en voulait pas. Elle était seule le soir, quand elle rentrait chez elle. C’était vrai. Elle était seule. Mais au moins, elle était libre.
Adriana se connecta sur un site de rencontre. Elle commença à naviguer tranquillement, tout en buvant sa bière. Elle cherchait des mecs un peu plus âgés qu’elle. Des types qui habitaient pas trop loin. Elle plaisait aux hommes mariés et les hommes mariés lui plaisaient. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-être avait-elle l’impression de vivre un défi. Peut-être se sentait-elle rassurée dans les bras d’un époux. Rassurée, surtout parce que ça ne durait jamais longtemps et que ça ne l’engageait à rien. Les hommes mariés ne tardaient pas à distiller leurs relents de lâcheté. Ils n’allaient jamais au bout de leurs promesses. Il ne fallait jamais les appeler, éviter les textos trop explicites. Ils posaient des lapins. Ils ne gardaient jamais l’odeur d’Adriana sur eux. Ils inventaient des mensonges, des trains manqués, des rendez-vous de travail. Ils mentaient à leur femme. Ils mentaient à leur maîtresse.
Adriana fit défiler les photos, lut les pédigrées, les inventaires de qualités, comme autant d’ingrédients pour une recette réussie. Chaque fois, ça lui faisait oublier sa solitude. D’habitude, elle se mettait à bâiller une fois, deux fois. Elle se frottait les yeux. Alors, elle se levait, ouvrait un placard, sortait une petite boîte, avalait un cachet pour dormir et retournait au lit. Parfois, elle se rendormait.
Mais ce soir-là, étrangement, la magie des sites de rencontre ne fonctionna pas. Elle pensait à Rémy, à ces assassinats épouvantables qui défrayaient la chronique. Elle quitta Internet et ouvrit le dossier qu’elle avait créé pour classer les photos des scènes de crime avant qu’elles ne soient censurées. Le besoin irrépressible de les voir encore une fois la dominait.
Elle fit défiler les clichés, agrandissant des détails. L’angoisse monta en elle, lui écrasa la poitrine, l’empêchant presque de respirer. Une angoisse de mort comme elle en souffrait parfois. Elle se leva d’un bloc, rabattit sèchement le dessus de son ordi, retourna dans sa chambre, s’habilla chaudement et sortit de chez elle.
Elle marchait sur le trottoir bordé de platanes. Le vent glacé lui brûlait les joues, lui tirait des larmes. Elle avançait à pas pressés, comme si cela suffirait à la débarrasser de ces angoisses qui la rongeaient. De ces cauchemars qui lui revenaient souvent en pleine figure. De ce mal de vivre qui la hantait depuis la fin de l’affaire Nelson. Pourquoi avait-elle quitté la gendarmerie ? Non, cela n’avait pas été une très bonne idée. C’est ce qu’elle se disait ce soir. C’est ce qu’elle se disait, chaque fois qu’elle avait le vague à l’âme.
Elle fouilla dans le fond de sa poche. Il lui restait une vingtaine d’euros. Il y avait un bistrot dans le quartier, le « Carioca », une petite salle où se produisaient souvent des musiciens jusque tard dans la nuit. On y faisait aussi des rencontres.
Une voiture s’arrêta à sa hauteur. Le conducteur baissa la vitre passager. Adriana se pencha. L’homme avait la quarantaine, visage doux, cheveux courts, poivre et sel, costume, la cravate un peu défaite, col de chemise ouvert, le genre qui sort d’un dîner d’affaires. Il écoutait de la bossa.
— Je vous dépose quelque part ?
Adriana ne répondit pas aussitôt.
— En toute honnêteté, continua l’homme.
— Je veux bien.
3. Allez comme le jaguar, ë ja !
Lundi
Orléans, vingt heures dix.
Mulokot sortit sans faire de bruit de l’appartement de Lucas Jalabert et referma la porte. Sa main se mit à trembler. Il essaya d’empêcher ce tremblement. Mais rien n’y fit. Il grogna. Ces crises devenaient de plus en plus fréquentes, de plus en plus rapprochées. Il n’y pouvait rien.
Mulokot était venu ici pour tuer. Mais sa victime n’était pas au rendez-vous.
La pluie se mit à tambouriner sur le toit de l’immeuble. Il leva la tête. De grosses gouttes s’écrasaient sur le verre du puits de lumière qui se trouvait juste au-dessus du palier.
Désemparé, l’homme ouvrit la poche de son sac à dos bleu pour prendre son téléphone. Il composa le numéro de son frère.
— Walisimë ?
— Oui. C’est fait ?
— Non, il n’est pas chez lui.
Un silence. Mulokot attendit. Son frère saurait quelle décision prendre. Il le guiderait. Habituellement, Jalabert rentrait tôt le lundi. Il arrivait en train, prenait le taxi jusque chez lui. Peut-être que Jalabert allait rentrer plus tard ce soir-là ? Peut-être que le train de Paris avait eu du retard ? Mulokot devait-il retourner dans l’appartement pour l’y attendre ? Son frère saurait. Son frère savait où se trouvait Jalabert. Il le traquait où qu’il se trouve grâce à son téléphone portable.
— Il faut terminer ce travail avant de partir, dit Walisimë d’une voix très calme. Je vais voir où se trouve Jalabert. Et je te rappelle.
Orléans, vingt et une heures.
Lucas Jalabert ne parvenait pas à chasser les images de ces corps atrocement mutilés qui avaient circulé sur les réseaux sociaux. Quelques heures avaient suffi pour qu’elles fassent le tour du monde, partagées, capturées, commentées. Lui connaissait ces deux malheureux : Sophiane Belkacem et David Gauthier. Il avait eu l’occasion de les rencontrer dans le cadre de son travail. Ils s’étaient vus très souvent. Devait-il alerter la police d’un lien possible ? Mais Lucas Jalabert ne voulait pas non plus remuer le passé. Il préféra penser que c’était l’œuvre d’un dément, d’un fou furieux, assurément.
Lucas Jalabert ne prenait jamais sa voiture quand il se rendait chez Manon, mais plutôt les transports en commun. C’était un homme public, alors pour l’instant, il préférait que ses escapades nocturnes chez sa nouvelle compagne restent les plus discrètes possible. Il ne vivait plus avec sa femme depuis quelques mois mais tous les deux, ils n’avaient pas encore pris la décision de divorcer.
Les freins du bus crissèrent. Les portes à soufflet s’ouvrirent en claquant. L’air glacé entra dans la cabine. Deux hommes descendirent. Une femme avec une poussette monta. Les portes se refermèrent. Clignotants. Démarrage en douceur. Les lumières de la ville comme autant de lampions. Un soir comme les autres.
Lucas Jalabert desserra un peu son nœud de cravate, et reboutonna son trench-coat. Il se leva, et se dirigea vers la plate forme médiane.
Il descendit à l’arrêt suivant, regarda le bus s’éloigner, et marcha.
Le quartier était calme. Pas à cause de l’hiver. Il était calme, quelle que soit la saison. Manon avait toujours vécu ici, dans cet alignement de villas sans caractère. Au cœur de ces pâtés de maisons qui se ressemblaient à pleurer. Lucas Jalabert détestait les cités pavillonnaires. Il n’aimait guère Orléans non plus, cette ville où il avait été parachuté pour des raisons politiques et où il avait acheté un appartement. Mais il y avait eu la rencontre avec Manon un soir à un vernissage dans cette galerie d’art, et depuis, il passait beaucoup de temps dans cette grande ville du centre de la France. À quarante-sept ans, ce haut fonctionnaire vivait une seconde adolescence.
C’était rare qu’il se rende chez elle en semaine. Mais depuis le meurtre de David Gauthier, il avait communiqué avec Manon et partagé son inquiétude. Elle lui avait proposé de venir directement chez elle dès ce lundi. Toutes les polices de France étaient sur le qui-vive. Le meurtrier allait être arrêté. Après, il verrait. Il pourrait retourner chez lui. Devant l’insistance de Manon, Lucas Jalabert n’avait pas hésité trop longtemps. Il avait fini par céder et accepter la proposition de Manon : il passerait la nuit de lundi chez elle. Et peut-être les nuits suivantes… après tout. C’était bon de sentir que quelqu’un s’inquiétait pour vous.
Il lui avait expliqué comment il connaissait Sophiane Belkacem, ce richissime Canadien assassiné lui aussi à son domicile parisien. Il l’avait rencontré à plusieurs reprises dans le cadre de la création du Parc amazonien de Guyane. Avec David Gauthier, il avait participé à de nombreuses commissions au sujet de l’attribution de mines d’or à l’ouest du département. Sophiane Belkacem, David Gauthier et lui s’étaient même retrouvés tous les trois en territoire indien pour chasser les fauves. Lucas Jalabert aurait mieux fait de se taire. Maintenant, Manon savait qu’un faisceau de fils le reliait aux deux victimes de ce taré et elle n’en dormait plus.
Elle avait vu elle aussi les images des deux corps massacrés, les membres désarticulés.
Lucas Jalabert tourna à droite. Une bourrasque d’air frais lui balaya les jambes. Il fut parcouru d’un frisson. Une camionnette de la police municipale passa à sa hauteur. Le quartier avait la réputation d’être plutôt tranquille. Mais il y avait eu un cambriolage la semaine précédente, à quelques rues de chez Manon. Alors ces derniers jours, les uniformes montraient un peu plus le bout de leur nez.
2 rue des Saules.
L’homme poussa la petite barrière métallique et entra dans le jardin. Il marcha sur les dalles de calcaire blanc qui dessinaient un chemin jusqu’à l’entrée de la petite villa.
Manon laissait toujours un jeu de clés sous un des pots de fleurs du jardin, au cas où. Lucas ouvrit la porte du pavillon, et replaça la clé sous le pot.
Il se frotta les pieds sur le paillasson et entra.
Il faisait bon à l’intérieur. Et le parfum de Manon flottait dans l’air. Patchouli. Elle avait laissé une lampe allumée dans le salon. Il retira son imper, l’accrocha au porte-manteau perroquet de métal noir. Il se regarda un instant dans le miroir Art déco fixé à droite du porte-manteau. Il avait les traits tirés, les yeux fatigués. Il frotta sa barbe rase d’un geste lent de la main droite et ramena ses cheveux raides, grisonnants et mi-courts derrière les oreilles. Puis il entra dans le salon qui se trouvait sur la gauche.
À cet instant, il eut un doute. Il n’était plus certain d’avoir pris la bonne décision. L’envie de rebrousser chemin lui serra la gorge. Il ne savait plus trop où il en était. Entre deux vies, entre deux femmes. Et ces deux meurtres lui taraudaient l’esprit. Il eut soudain l’impression de rentrer chez une étrangère. Chez une inconnue. Ces meubles, ces petites affaires, ce parfum qui flottait dans l’air mêlé de l’odeur de cendrier froid, ces magazines posés sur la table basse, ces murs colorés, cette déco. Cette chambre. Cette salle de bains de femme. Manon envahissait complètement son espace, le submergeait de sa forte personnalité, de son tempérament, de sa présence. Lucas Jalabert n’était pas chez lui. Il se trouvait projeté dans l’intimité d’une autre qu’il ne connaissait pas encore très bien. Et il se demanda si leur idylle durerait encore très longtemps. N’était-ce pas qu’une bulle qui allait bientôt éclater ? Lui péter en pleine figure ? Et devait-il mêler Manon à son passé ?
Il monta dans la chambre, en laissant glisser sa main sur le mur de l’escalier. Comme une longue caresse. C’était la première fois qu’il se retrouvait seul ici sans Manon, maîtresse des lieux. Il entra dans la chambre. Il s’assit sur le bord du lit, posa la main sur la couette. Il ouvrit le premier tiroir de la commode en face de lui. Les sous-vêtements de Manon. Il le referma doucement. Se regarda de nouveau dans le miroir fixé au mur. L’inquiétude se lisait sur son visage fatigué. L’hiver. Le froid. Les allers-retours entre Paris et Orléans. Trop de pression au boulot. Ce sentiment étrange de ne pas être libre, mais dirigé comme une vulgaire marionnette.
Lucas Jalabert chassa toutes ces pensées. Il était fatigué. Mais il aimait Manon. Et il voulait oublier son passé. Il se leva, redescendit les marches et pénétra de nouveau dans le salon.
Il se laissa tomber dans le canapé de cuir noir.
Sa journée avait été plutôt difficile. Réunion politique à Paris, au QG du parti. Accrochages au sujet des investitures pour les prochaines élections. Discussions houleuses au sujet de la création d’un poste de haut fonctionnaire pour un député en fin de mandat.
Désormais, il détestait la politique et tous ses petits arrangements, ces réunions à n’en plus finir. Il jeta un coup d’œil vers l’écran plat, saisit la télécommande posée sur la table basse devant le canapé et alluma la télé.
Son portable sonna. Il répondit sans regarder le nom qui s’affichait sur l’écran.
— Jalabert.
— C’est Manon. Alors, tu es à la maison ?
L’homme sourit. Cette voix grave et sensuelle était du baume au cœur. Non, il ne regrettait pas.
— Oui, je suis chez toi.
— C’est bien. J’ai hâte de te retrouver. Je ne rentre pas avant minuit, une heure du matin, je finis mon service. Tu m’attends ?
— C’est promis. Je me sens bien ici, tu sais.
— Tu ne vas pas t’endormir ?
— Tu veux rire.
— Bois un verre, mon bébé. Le frigo est plein. Fais-toi une assiette. Je t’aime.
— Je t’aime.
Et elle ajouta plus bas :
— Faut que je te laisse.
Elle raccrocha.
Lucas Jalabert se leva. Il fit quelques pas vers la cuisine séparée du salon par une verrière façon atelier. Ouvrit un placard. Choisit un verre. Sa bouteille de whisky : Laphroaig dix ans d’âge. Un rien tourbé, torréfié, parfum de réglisse. Manon et lui partageaient cette même passion : le whisky. Il se servit. Il prit le bac à glaçons dans le congélateur. Le retourna. Força sur le revers du bac. Un gros glaçon tomba sur le plan de travail. Il le glissa dans le verre et s’installa de nouveau devant la télé. Il fit tourner le whisky dans le verre, ferma les yeux, avala une gorgée.
Vingt-deux heures trente.
La porte d’entrée s’ouvrit. Un courant d’air glacial envahit le couloir, pénétra le salon. Le pouls de Jalabert s’accéléra. Il s’était assoupi devant la télé. Il eut du mal à retrouver ses esprits.
Quelle heure était-il ? Manon, déjà ? Il jeta un coup d’œil sur l’horloge du salon. Vingt-deux heures trente. Impossible. Il avait sans doute mal refermé.
Il se leva et se dirigea tranquillement vers l’entrée. Ouvrit en grand pour humer un peu d’air frais et se réveiller. Le détecteur de mouvement avait allumé la lumière. Sur le perron, face à lui, un petit homme au visage impavide. Torse nu, la peau enduite de roucou, ici, en plein hiver. Regard noir. Longs cheveux noirs, le visage maquillé.
Un Amérindien !
En même temps qu’une montée de panique, des images se télescopèrent dans sa tête. Des images toutes bêtes comme celle de Raoni, le chef des Kayapos, ou encore celle de l’Indien dans le film Le Jaguar, Wanu, l’âme sœur de Patrick Bruel, un film que ses enfants avaient adoré. Les visages de Sophiane Belkacem, de David Gauthier, de la forêt guyanaise.
Le temps semblait ralenti. L’homme le fixait sans bouger. Lucas Jalabert tenait le montant de la porte de la main gauche. Il aurait presque eu le temps de la claquer brutalement et de s’enfermer à double-tour. Mais il était comme paralysé par le regard noir qui le transperçait.
Déstabilisé, Jalabert jeta un coup d’œil par-dessus la tête de l’Indien.
L’autre restait impassible, les yeux dans les yeux de Jalabert, la main gauche fermement accrochée à la sangle d’un sac à dos bleu.
Un éclat métallique le long de sa jambe attira son regard : une machette. Belkacem, Gauthier… lui, Lucas Jalabert, se trouvait aussi sur la liste…
— Je tue, dit calmement l’Indien.
Lucas Jalabert voulut refermer la porte. Trop tard. La foudre le transperça. Souffle coupé. Douleur fulgurante.
Une violence sans égale.
Les images de Guyane furent chassées.
Remplacées par le visage de Manon, son regard, ses grands yeux bleus. Le sourire de sa femme. Ses trois enfants. Un chant, des cris. Une balançoire. Une plage et de jeunes hommes jouant au ballon. Une partie de volley. Les couloirs du ministère. Un tourbillon de flashs exhumés de sa mémoire. Sa première conférence de presse. Sa grand-mère morte sur un lit d’hôpital.
Défilé de souvenirs.
L’arme s’était enfoncée d’un coup au milieu de son ventre. La violence du choc avait chassé l’air de ses poumons.
Et la douleur qui s’estompe.
Le souffle de plus en plus court. Les poumons, la gorge, la bouche qui cherchent l’oxygène. Le manque d’air.
Soudain.
Jalabert posa ses mains tremblantes sur son ventre. Ses doigts rencontrèrent une substance poisseuse et tiède. Et l’acier froid d’une lame. Il s’essuya les mains sur ses flancs, mécaniquement.
Sa vessie se vida. Le liquide chaud dégoulina sur ses cuisses, ses jambes, mouilla ses chaussettes.
Il voulut dire : « Pourquoi ? », sa bouche cracha le sang. Il ne s’en sortirait pas. Conscience bloquée, raisonnement figé.
Le petit homme serrait maintenant les mâchoires. Les muscles de son visage se contractaient. Jalabert aperçut une lueur fugace dans ses pupilles. Il baissa la tête, regarda son propre ventre, le sabre enfoncé en lui jusqu’à la garde, sa chemise imbibée de son propre sang. La lame tourna à l’intérieur de son ventre. Lui arracha des cris de douleur étouffés.
Maintenant, Jalabert se sentait envahi par le froid. Un froid intense, immense. Des vertiges, par vagues. Des étoiles, un trou noir qui envahit la tête. Le big bang. La machette ressortit toute seule de l’abdomen. Des bouts d’intestins et de fèces puantes, mêlées de sang et de bile, glissèrent lentement sur le bord aiguisé de la lame. La douleur fut encore plus vive.
Jalabert eut la force de se retourner comme pour aller se réfugier à l’intérieur de la maison. Son corps pesait une tonne. Ses jambes ne lui obéissaient plus.
Manon.
Son crâne devint un immense bourdonnement. Ses jambes s’effacèrent sous le poids d’un corps exsangue.
Il s’effondra face contre terre.
Mulokot resta un instant indécis.
Ses épaules furent agitées de soubresauts, à cause du geste qu’il venait d’accomplir. Une fois de plus, il avait ôté la vie. Il se rappela ses premières chasses sur les rives de la rivière Inini. Le premier animal qu’il avait tué d’une seule flèche. C’était un agouti. Le gros rongeur était en train de boire l’eau de la rivière. Son pelage rouge et soyeux luisait dans la flaque de lumière d’un rai de soleil qui avait traversé les frondaisons. Mulokot s’était approché lentement. Il avait placé l’encoche de sa flèche dans la corde de l’arc. Il avait visé le cœur, tendu la corde, et lâché la flèche dans une expiration.
L’animal était tombé d’un coup, foudroyé.
Aujourd’hui, le chasseur wayana tuait ses semblables. C’était mal mais c’était comme ça.
Il n’était pas né assassin. Mais Kunawaluna, le jaguar mythique, lui avait ordonné de tuer cet homme. Et comme pour les autres, Kunawaluna avait guidé sa main au moment de donner la mort. Ce soir-là, les Esprits avaient encore été avec lui.
Son cœur cognait plus fort, aussi. Il venait d’abattre ce chien de Jalabert. Son frère serait fier de lui. C’était son frère qui planifiait tout. Pour Belkacem et Gauthier, ça avait été facile. Ils étaient chez eux, et ils dormaient tous les deux à poings fermés. Mulokot était entré dans la chambre de Belkacem. Quelques jours plus tard, ça avait été au tour de Gauthier. Il les avait tués dans leur sommeil. Pour Jalabert, il avait fallu un peu improviser. Son appartement du centre-ville d’Orléans était vide. Ce fils de chienne galeuse. Il n’était pas là ! Au dernier moment, il avait appris qu’il devait se rendre chez cette fille.
Il avait fallu faire vite. Son frère avait repéré la maison en espérant que Jalabert soit vraiment chez elle et pas ailleurs. Parti au cinéma, au restaurant. Ou bien resté sur Paris. Walisimë et Mulokot avaient bien failli tout rater ce soir. Heureusement, Kunawaluna, l’Esprit du jaguar, avait guidé leurs pas.
Pas de temps à perdre. Dans cinq jours, si tout se passait comme prévu, ce serait le temps du massacre ! Tout un placer4 de garimpeiros ! Et « l’ultimatum lancé à la face des Palasisis5, les Blancs de ce pays », comme disait Walisimë. Le monde entier parlerait d’eux, et sans doute les frères parviendraient-ils ainsi à faire entendre leur cause.
Le massacre... Mulokot appréhendait ce jour fatal depuis longtemps. Mais Kunawaluna en avait décidé ainsi. Et il ne pourrait pas se dérober. Avec son frère, ils avaient déjà repéré les lieux. Calculé le temps qu’il leur faudrait pour arriver jusqu’au placer et surprendre les victimes dans leur sommeil. Parfois, quand il s’endormait, Mulokot répétait la scène dans sa tête. Le massacre…
Mulokot avait bien failli se perdre dans les rues d’Orléans. Il avait eu peur de tout rater. Cette idée l’obsédait. Il n’était pas aussi intelligent que Walisimë. Mulokot était le moins intelligent des frères. Il en était conscient. Il ne comprenait pas toujours tout. Mais il savait conduire, il savait tuer. Il était doté d’une force incroyable malgré sa petite taille. Et surtout, il avait une mémoire infaillible. Il se souvenait de tout ce qu’on lui disait. Et quand Walisimë lui expliquait les routes à prendre, Mulokot enregistrait tout dans sa tête. Pas besoin de GPS !
Souvent, son frère lui disait : « Tu es un vrai ordinateur ! ». Cette fois-là, il avait quand même failli se perdre dans ce quartier pourri, avec toutes ces rues et toutes ces maisons qui se ressemblaient !
Walisimë attendait Mulokot à quelques kilomètres à la sortie d’Orléans, sur une petite route, dans un endroit bien caché. Comme ça, il pourrait se débarrasser de la Twingo et changer de voiture. Dès qu’il aurait fini son travail, Mulokot le rejoindrait.
L’Indien se passa la main gauche sur le visage, se frotta les yeux. Il resta un instant au-dessus du cadavre. Jalabert comme un serpent, face contre terre. Le sang qui s’épanchait sur le carrelage. Mulokot donna un coup de pied dans la jambe inerte. Maintenant, c’était fait. Le cœur de ce chien de Blanc avait cessé de battre une fois pour toutes.
Mulokot grogna entre ses dents :
— Ëjam6 !
L’homme gisait, les trois quarts du corps dans le couloir, les pieds sur le paillasson, visage contre le sol. Mulokot se redressa. Coup d’œil circulaire. Le quartier dormait. Pas de voiture dans cette rue paisible à cette heure. Il pourrait continuer son travail en toute tranquillité. Il tira Jalabert par les bras pour pouvoir refermer la porte.
Puis il abandonna sa victime un instant pour inspecter cette maison qu’il ne connaissait pas.
Il traversa le couloir, entra dans le salon. La télé était allumée. Il saisit la télécommande et l’éteignit. Une lampe éclairait la table basse sur laquelle s’entassaient pêle-mêle des magazines. Un cendrier plein. Un verre avec un fond de liquide. Mulokot le saisit, renifla. Grimaça. Whisky. Il n’aimait pas le whisky. Il buvait rarement. Seulement avant de tuer. Il avalait une bonne rasade de rhum et il fumait cette plante des Ancêtres qui donnait force et courage aux guerriers wayanas. Alors, il devenait plus puissant et plus rusé que le jaguar. Sa force décuplée le rendait invincible. Sa peau restait chaude malgré le froid de l’hiver. Et il se transformait en un être invisible, comme Kunawaluna.
Silencieux, il fixa un instant l’espace devant lui. Il n’avait fait que la moitié du travail.
D’un revers du bras, il débarrassa la table basse. Le verre roula jusqu’à la fenêtre. Les magazines jonchèrent le sol. C’est là qu’il poserait les membres découpés de sa victime. Sa langue, son cœur et son foie. Sacrifice rituel.
Une voiture passa dans la rue. Mulokot se figea. Ses pupilles se dilatèrent. La maîtresse de Jalabert pouvait arriver d’un instant à l’autre. Et Mulokot devait accomplir son œuvre, terminer le boulot. Si cette femme rentrait maintenant, il n’hésiterait pas à lui trancher la gorge.
Il posa son sac à dos sur la table basse, retourna dans le couloir, s’agenouilla devant le corps. Le sang continuait à s’échapper de la plaie béante. L’odeur du sang. Métallique, ferreuse, mêlée de puanteur. L’Amérindien grimaça.
Il attrapa Jalabert par les poignets et le tira jusque dans le salon. D’un mouvement brusque, il le retourna. Mulokot sortit son poignard et commença à dépecer le corps. La lame glissa sur la peau, s’enfonça, tailla dans la chair. Le ventre s’ouvrit, les côtes craquèrent. Les gestes étaient précis et mécaniques.
Quelques instants plus tard, Mulokot se redressa. Il était allé vite. Plus vite que les autres fois. Le sang avait giclé sur son torse, sur son visage. Mulokot posa le cœur de Jalabert sur la table basse. Recula de trois pas. La main ensanglantée, regard vide, il resta quelques instants immobile devant sa victime. Puis il termina la mise en scène.
Le devoir accompli, Mulokot se lava abondamment les mains dans l’évier de la cuisine. L’eau rougie par le sang s’évacuait dans le tourbillon. Il frotta ses paumes, ses doigts, le dos de ses mains, les secoua. Puis il s’essuya sur un torchon à vaisselle. Sa peau sentait le fer et la viande fraîche de la bête qu’on vient d’abattre et vider de ses viscères. Rien ne pouvait ôter cette odeur tenace.
Il ouvrit la fermeture Éclair de son sac à dos. Sa main tremblait encore. Il alluma son portable.
C’était la troisième fois qu’il découpait le corps d’un homme. Et c’était toujours aussi difficile. Il prit quelques photos et composa le numéro de Citizen Snake pour les lui envoyer.
Il sortit ensuite un tee-shirt et une veste de toile de son sac, et se rhabilla. Un dernier coup d’œil au salon. Un silence angoissant et palpable avait envahi la pièce. Le silence de la mort. Tout était figé. Mulokot sortit de la petite villa aussi discrètement qu’il y était entré. Et très rapidement s’éloigna de la maison. Il se dirigea vers la Twingo noire qu’il avait garée dans une rue transversale. Il ouvrit la portière, s’installa au volant et démarra. Il traversa la ville endormie puis s’engagea sur une petite route de campagne.
Kunawaluna, le jaguar mythique, totem des Ancêtres, le protégeait. Grâce à lui, les frères ne craignaient rien ni personne. La force de Kunawaluna coulait dans leurs veines.
« Citizen Snake », c’était son pseudo de hacker.
Il ne l’avait pas choisi. Son maître l’avait baptisé ainsi. Citizen Snake était peut-être le pirate informatique le plus doué de sa génération. Désormais, il agissait seul. Il n’avait jamais opéré au sein d’un groupe ni travaillé pour aucun gouvernement. Il vivait et se déplaçait sous plusieurs identités. Alors, personne ne connaissait vraiment son existence. Même dans l’underground très fermé et secret des cyber-pirates.
Citizen Snake maîtrisait parfaitement tous les canaux de communication. Il avait pénétré des sites réputés inviolables. Et il avait fini par devenir un activiste de la cause amérindienne. Il se battait contre les injustices dont souffraient les peuples autochtones. Chaque fois que Mulokot tuait, Citizen Snake mettait en ligne les photos des scènes de crime.





























