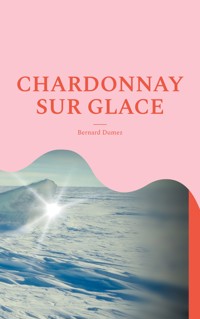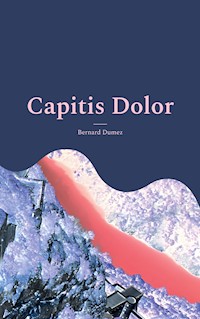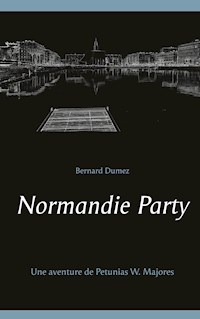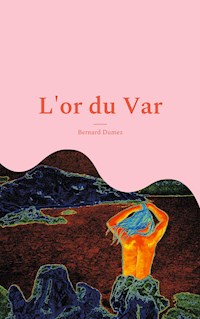
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Les aventures de Petunias W. Majores
- Sprache: Französisch
Petunias, héros bien malgré lui, est à nouveau entraîné dans une étrange aventure, où le passé et le présent se télescopent. Quel est le lien entre la disparition, dans le même périmètre, de deux sous-marins, d'un avion de ligne et de cent tonnes d'or ? Qu'est-ce qui tourmente tant les autorités ? Et pourquoi cette affaire implique-t-elle Petunias Walter Majores ? Il ne lui reste plus que 72 heures avant un terrible drame.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DU MÊME AUTEUR
Normandie Party, Éditions BoD-Books on Demand, 2021
Toute ressemblance avec des situations réelles ou avec des personnes existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite.
Sommaire
Prologue 1
Prologue 2
Prologue 3
Prologue 4
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
Chapitre XX
Chapitre XXI
Chapitre XXII
Chapitre XXIII
Chapitre XXIV
Chapitre XXV
Chapitre XXVI
Chapitre XXVII
Chapitre XXVIII
Chapitre XXIX
Chapitre XXX
ÉPILOGUE
Prologue 1
Le 17 août 1944, 6 heures du matin, au large de la baie de Cavalaire, dans le Var
Louis Schenk ne peut détacher son regard du ballet des barges d’assaut faisant la navette entre les transports de troupe ou les cargos, et la côte. Les navires déversent en un flot continu des soldats alourdis par 40 kg de matériel. Les caisses de munitions et les fûts de carburant s’entassent sur les plages en attendant d’abreuver les premiers véhicules débarqués, qui se lancent aussitôt à l’assaut des collines du massif des Maures.
Depuis le 15 août à 20 heures, l’opération Dragoon a débuté, et la 1re Division Française Libre débarque sur l’immense plage en arc de cercle de la baie de Cavalaire. Le jour précédent, une division aéroportée avait été parachutée dans l’arrière-pays Varois entre Draguignan et Fréjus pour prendre à revers les troupes allemandes. Puis un millier de bombardiers avait arrosé les défenses côtières entre Saint-Tropez et Saint-Raphaël, pas loin d’où se trouve Louis, juste de l’autre côté de la presqu’île qui sépare la baie de Cavalaire de celle de Saint-Tropez.
Du pont du navire de guerre surmonté d’un immense drapeau tricolore flanqué de la croix de Lorraine, le jeune lieutenant observe l’embarquement des renforts de troupes du général de division Brosset. Les 15 000 soldats surentraînés sont impatients de fouler le sable de leur patrie, comme tous les combattants de l’armée B, dont fait partie la 1re Division.
C’est la revanche tant attendue par le Général de Gaulle, qui n’a toujours pas digéré sa mise à l’écart de l’opération Neptune, le débarquement sur les plages normandes commencé le 6 juin précédent. En effet, lors de cet évènement majeur qui signa le début de la reconquête de la France par les troupes alliées, les soldats français étaient étrangement absents, seuls ou presque, les 177 commandos du 1er bataillon de fusiliers marins du capitaine de corvette Philippe Kieffer avaient participé à la première vague d’invasion, au milieu d’une armée d’Anglo-Saxons. Et encore, ces Français étaient sous commandement anglais !
Seulement là, en ce mois d’août 1944, sur les côtes de Provence, les 230 000 Français représentent les deux tiers des troupes d’invasion. Le 6e corps US et l’armée B du Général français Jean de Lattre de Tassigny débarquent entre le Cap Nègre et Saint-Raphaël. Une trentaine de navires de guerre français dont un cuirassé et neuf croiseurs accompagnent les troupes d’assaut. Et même si quatre-vingt-dix pour cent de ces hommes de moins de vingt ans à plus de quarante arrivent en métropole pour la première fois de leurs vies car ils sont originaires de l’empire colonial français d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Asie et d’Océanie, tous ont la gorge nouée lorsqu’ils posent le pied sur le sable chaud. Beaucoup en enfournent une poignée dans leur poche, les plus avisés ont même prévu une bouteille de bière vide comme contenant.
Lors des toutes premières vagues d’assaut, les sous-officiers leur hurlaient de ne pas s’arrêter et de courir se mettre à l’abri des tirs allemands, mais en ce troisième jour du débarquement, peu de points d’appui ennemis sont encore opérationnels et les tirs se font plus sporadiques. D’ailleurs, dès qu’un canon ou une mitrailleuse ennemis se dévoile en tirant, le feu des bateaux de guerre présents dans la baie s’abat sur lui.
Du troisième pont du croiseur Renom, juste sous la passerelle de commandement, Louis éclate d’un rire quasi hystérique à chaque fois que les neuf canons de 152 mm projettent leurs 3 900 kg de métal à deux fois la vitesse du son sur les batteries encore tenues par les Allemands, dans les collines qui bordent la plage. Le lieutenant Schenk a refusé de mettre les bouchons d’oreille que lui tendait un marin, ne voulant pas passer pour un bleu auprès de son ami Gaston. C’est vrai que le capitaine de corvette Gaston Faure, de quatre ans son aîné, est un militaire professionnel aguerri, qui a déjà à son actif la campagne d’Afrique du Nord et qui s’est couvert de gloire lors de la libération de la Corse.
Louis Schenk, frêle jeune homme à l’allure juvénile est excité comme jamais. Âgé de vingt-deux ans, il vient tout juste de finir ses études de commerce. Bien sûr, il aurait préféré embarquer dans l’une des péniches de débarquement pour se battre avec la première vague des troupes d’assaut. Il sait que c’est impossible, car en ces instants critiques, sa vie est trop précieuse : il a un projet à mener à terme. C’est une idée géniale qui l’a conduit jusqu’au pont de ce navire de guerre, aujourd’hui et à cet endroit.
Avant d’en arriver là, Louis a d’abord dû batailler ferme pour faire accepter son plan et accéder jusqu’à la plus haute autorité militaire, le Général de Gaulle. Il y a maintenant plusieurs mois, le chef de la France libre, après l’avoir rencontré et longuement écouté, l’a chargé d’organiser et de conduire cette mission, baptisée MIDAS. Depuis le mois de décembre 1943, Louis s’attelle à sa tâche dans le plus grand secret. Transporter 100 t d’or avec un maximum de sécurité nécessite une préparation sans faille.
Prologue 2
Le 30 mai 1940, 1 place Franklin Roosevelt à Périgueux
Louis est en stage depuis seulement un mois dans cette succursale de la Banque de France de la préfecture de la Dordogne. Le sachant gêné par son caractère réservé, son père a pensé que réaliser le premier stage de son cursus en école de commerce au sein de cette institution réputée pour son sérieux lui serait bénéfique, d’autant plus que le directeur est un de ses plus proches amis. Avec son physique d’adolescent et son jeune âge, dix-huit ans dans quatorze jours, Louis n’est pas intrinsèquement légitime dans l’habit d’un cadre de la finance. Pour être crédible auprès de tous ces banquiers à l’allure martiale, dans cet ancien hôtel particulier situé à l’ouest de la vieille ville médiévale, le directeur Jacques Delaunay lui a conseillé de porter une tenue austère, en l’occurrence un complet trois pièces de couleur sombre qu’il tient de son frère aîné.
Quelques années auparavant, M. Delaunay faisait sauter le petit Louis sur ses genoux pour son baptême dans la cathédrale Saint-Front, le splendide édifice aux allures d’église Byzantine, avec son plan en croix et ses cinq coupoles. Cependant, pour respecter l’étiquette, M. le Directeur ne lui donne plus que du « Monsieur Schenk » et le vouvoie lorsqu’il le croise dans les couloirs de cette vénérable institution napoléonienne.
Alors, en ce matin ensoleillé de la fin du printemps, Louis se demande ce qui peut bien pousser ce vieil ami de la famille à envoyer sa secrétaire particulière le chercher de toute urgence dans le petit bureau de l’annexe qu’il occupe avec son maître de stage, un vieil employé aussi gris que les murs de pierre. Serait-ce encore une mauvaise nouvelle du front ? Une angoisse le prend soudain, il craint qu’il s’agisse de Gérard, son frère aîné, chef de char au 507e Régiment de Chars de Combat, commandé un temps par un illustre inconnu, un certain colonel de Gaulle.
***
Il est vrai qu’après la période euphorique qui avait suivi l’obtention de son baccalauréat en juin 1939, et son admission à l’école supérieure de commerce de Bordeaux, Louis, à peine âgé de dix-sept ans, envisageait son futur sous de radieux auspices. Pourtant, dès le mois de septembre et la déclaration de guerre avec l’Allemagne, le monde, et par conséquent son avenir, semblaient se déliter. Maintenant qu’il était presque un homme avec son bac tout chaud en poche, il était autorisé à assister aux discussions qui suivaient invariablement les repas dominicaux, dans le fumoir de la résidence familiale. Entre son père, grossiste en foie gras et truffes de la blanche cité périgourdine, et ses amis, dont M. Delaunay, les conversations tournaient dorénavant plus rarement autour de sujets légers. La guerre, même qualifiée de « drôle », prenait le pas sur le cours du marché au gras ou les rivalités avec la grande voisine Brive-la-Gaillarde. Même les volutes de leurs Corona et l’eau-de-vie de prune ne parvenaient plus à les dérider. Louis voyait l’inquiétude poindre, semaine après semaine, sur les visages de ce petit groupe de notables influents, malgré la traditionnelle séance de blagues qui clôturait implicitement ces agapes, toujours les mêmes plaisanteries, racontées invariablement en patois languedocien.
Cette guerre sans combat, du moins sur le front Ouest, c’était une illusion à destination du peuple français, pensaient-ils. Ils étaient conscients de l’avance prise par l’Allemagne dans la préparation des hostilités et savaient que les efforts de réarmement récents mis en œuvre par le nouveau ministre de la guerre français ne suffiraient clairement pas à combler le retard pris sur le régime nazi. Le seul espoir en cas d’attaque soudaine était la supériorité toute relative de la Royal Air Force de notre allié d’outre-Manche.
Le déclenchement de l’attaque allemande le 10 mai avait été si efficace, la percée des lignes alliées tellement rapide, que même le quartier général allemand avait été surpris de son propre succès. La Dordogne était loin des combats et les actualités à la radio, soumises à la censure militaire, minimisaient la gravité de l’invasion. Toutefois, lorsque le 20 mai les premières colonnes de réfugiés hagards venant de Belgique et du nord de la France traversèrent Périgueux, la terrible réalité de la guerre envahit le quotidien des habitants du Périgord. L’affolement s’empara des banquiers. M. Delaunay, qui avait ses entrées auprès du colonel Jussieu, commandant adjoint de la région militaire, décida d’informer ses employés tous les matins de la situation, sans rien leur cacher de la gravité. C’est ainsi que Louis apprit que son frère avait retrouvé son ancien chef, le colonel de Gaulle, au sein d’une nouvelle force blindée créée dans l’urgence, « la plus puissante de l’armée française ». Puis, plus tard, que le régiment dont faisait partie Gérard avait été détruit par des bombardements de Stukas et que les restes de cette unité se dirigeaient avec l’armée anglaise vers les côtes de la Manche. Et enfin, il y a deux jours, que toutes ces troupes réfugiées dans le Pas-de-Calais étaient encerclées du côté de Dunkerque.
***
— Madeleine, veuillez nous laisser s’il vous plaît, demanda courtoisement le directeur à sa secrétaire.
Il désigna un siège à Louis, de l’autre côté de son bureau. M. Delaunay se tortillait dans son fauteuil de direction et Louis le trouva embarrassé.
— Assieds-toi, mon garçon.
Louis tressaillit. Cette familiarité, taboue au sein de la banque, ne présageait rien de bon, même si le jeune garçon refusait de croire qu’il était arrivé malheur à son frère. Puis il prit conscience que deux autres personnes se trouvaient également dans la pièce, assises contre la cloison à gauche du bureau du directeur, sous le portrait de Napoléon 1er, le fondateur de la Banque de France. L’un des deux hommes était le sous-directeur de la succursale de Périgueux, le bras droit de M. Delaunay en quelque sorte, M. Justin, que mystérieusement les employés de la banque appelaient entre eux, l’homme aux clés. Le deuxième personnage était par contre totalement inconnu de Louis. Il portait un uniforme, réalité banale dans les rues de la ville depuis quelques mois. Mais comme Louis n’avait pas été mobilisé car trop jeune pour être incorporé, il ne reconnut pas les insignes de colonel de l’armée de terre.
— Ça va ? Un verre d’eau peut-être, tu me parais bien pâle ce matin.
Louis fit non de la tête à M. Delaunay.
Le colonel se tourna vers le directeur de la banque en fronçant les sourcils. M. Delaunay fit semblant de ne pas remarquer ce signe d’inquiétude du militaire et continua :
— Louis, ce que je vais te dire maintenant doit rester un secret absolu. Même ton père ne doit rien en savoir. Es-tu prêt à jurer sur la tête de ce que tu as de plus cher que tu respecteras ce secret ?
— Oui, bredouilla le jeune homme, qui ne comprenait désormais plus rien.
— Louis, la situation militaire de la France est grave. L’armée anglaise est en cours de réembarquement à Dunkerque. L’avancée des troupes allemandes est stoppée depuis quelques jours sur une ligne Abbeville Sarreguemines, cependant le Deuxième bureau, le service de renseignement, prévoit une reprise de l’offensive dès que la poche de Dunkerque sera éliminée.
— Mais la Royal Air Force va nous aider, clama Louis avec la candeur de ses dix-huit ans. J’ai appris que Churchill, le vieux lion, était maintenant Premier ministre du Royaume-Uni, il va se battre, c’est évident !
Le colonel Jussieu, puisqu’il s’agissait de lui, sourit en mesurant l’enthousiasme dont Louis faisait preuve. Il semblait rassuré par ce soudain changement d’attitude :
— Louis, tu sais, la politique est parfois plus complexe que ça. Nous ne pouvons plus compter sur nos alliés anglais qui veulent maintenant consacrer toutes leurs forces militaires à protéger leur île d’une tentative d’invasion des boches.
— Voyons monsieur ! Nous avons encore la meilleure armée du monde, et puis un empire pour nous soutenir, gémit le jeune garçon.
— J’apprécie ton enthousiasme, et si plus d’hommes politiques avaient eu la même attitude depuis 1936, on n’en serait pas là, soupira l’officier.
— Et plus de hauts responsables militaires aussi, mon Colonel ! ajouta ironiquement M. Delaunay.
Le colonel Jussieu approuva de la tête :
— Louis, crois-moi, et j’en suis le premier effondré, dès que les divisions de panzers de Guderian et Rommel reprendront leur offensive, nous serons balayés comme des fétus de paille. Nous n’avons plus de divisions blindées, presque plus d’aviation et les convois de réfugiés encombrent les routes. Un véritable exode, asséna l’officier supérieur.
— Voilà Louis, tu connais la véritable situation de nos armées, aussi bien que le Conseil des ministres, reprit solennellement l’ami de son père. Il est temps que je te révèle le véritable secret.
Le jeune Schenk ne put s’empêcher d’écarquiller les yeux. Le colonel s’appuya sur le dossier de sa chaise Louis XV, comme soulagé de s’être exprimé. Le sous-directeur, au contraire, se redressa et tira sur les manches de sa veste, il savait que son tour d’intervenir arrivait. M. Delaunay poursuivit :
— Louis, j’ai, nous avons besoin de toi pour une mission de la plus grande importance.
Il se tourna vers son bras droit :
— Charles, veuillez expliquer à Louis ce dont il s’agit.
Le petit fonctionnaire sans âge, vêtu d’un costume encore plus austère que celui du jeune stagiaire, plaça son poing semi-fermé devant sa bouche, comme pour s’éclaircir la voix :
— Hum ! Voilà… Avant le déclenchement des hostilités, nos réserves d’or stockées à Paris ont été réparties entre des dizaines de lieux, et transportées par convois routiers et bateaux vers des succursales de la Banque de France, en Métropole ainsi que dans nos colonies. Dans le secret le plus absolu, précisa l’homme aux clés, comme si cette évidence le nécessitait.
Et, hochant la tête comme pour appuyer son propos, il ajouta :
— L’expérience de l’invasion du nord de la France en 1914 a rendu notre direction générale prudente. On n’organise pas un tel transfert sous des bombardements.
Observant le regard interrogateur du jeune homme, il continua :
— Et maintenant, devant l’avancée des troupes allemandes, le moment est venu d’évacuer les réserves qui se trouvent encore sur le sol de la métropole. Nous sommes chargés, vous et moi – il prononça le « vous » comme à regret – d’organiser le transfert d’une partie de ces réserves vers un lieu encore tenu secret.
Le directeur et le colonel acquiescèrent.
— Où se trouve cet or ? demanda Louis.
— Ici, affirma le sous-directeur, juste en dessous, et il désigna de son index droit le sous-sol de l’hôtel particulier. Et aussi à Tulle, Brive, Libourne, Rodez et Villefranche.
— Et comment allons-nous transporter cet or jusqu’à, j’imagine, un port de mer ?
— Par camions, fournis par le Colonel, avec une escorte armée bien entendu, expliqua le Directeur en se tournant vers le Commandant Adjoint de la région militaire.
Louis ne posa évidemment pas la question « pourquoi moi ? », comprenant que M. Delaunay avait toute confiance en lui et que le simple fait de poser la question détruirait l’argumentation que le directeur avait manifestement développée auprès du colonel et aussi auprès de son adjoint, pour les convaincre de confier cette mission capitale à un si jeune garçon.
— Votre travail, si vous l’acceptez, à partir de maintenant, est d’organiser ce transfert sous la responsabilité de M. Justin.
— Bien entendu je l’accepte Monsieur ! bafouilla Louis en se levant à moitié de son siège.
— Bien, c’est parfait ! Je vous quitte mes amis, rendez-vous pour le chargement, conclu le colonel en saluant ses hôtes.
— Suivez-nous Louis, nous allons maintenant vous faire visiter notre sous-sol.
Et le directeur retira d’un coffre discrètement placé dans le pied de son bureau une clé aux dentures complexes. Il fit signe de la tête à son adjoint qui lui montra une clé semblable attachée par une chaînette à sa ceinture et qu’il venait de sortir de sa poche de pantalon.
Qui aurait deviné que, cinq mètres plus bas, l’intégralité du sous-sol de cette belle demeure du XVIIIe siècle avait été transformé en coffre-fort de banque, aux murs de béton recouverts de cinq centimètres d’acier ? Une première salle, fermée par une grille, abritait les coffres des particuliers. Que de secrets devaient se cacher derrière ces petites boîtes blindées tapissant les deux murs opposés de la salle forte. Au fond, une porte circulaire monumentale occupait la plus grande partie du mur. Monsieur Justin engagea sa clé dans une première serrure et la tourna d’un quart de tour vers la gauche. Un discret clic se fit entendre. M. Delaunay procéda de la même manière avec la sienne. Puis le Directeur fit tourner quatre molettes graduées de un à neuf pendant que Louis et même M. Justin détournaient leur regard.
Les dirigeants de la banque durent s’y mettre à deux pour rabattre le long levier qui servait de poignée et débloquer les pennes du système de verrouillage. Puis ils tirèrent sur cette barre en geignant, tant la porte était lourde. Louis se retenait bien de leur proposer son aide : l’ouverture d’un coffre de la Banque de France étant une opération quasi liturgique. Sans bruit, la lourde porte épaisse de 30 cm d’acier spécial pivota sur ses gonds et fit place à une obscure ouverture circulaire de deux mètres de diamètre. Le sous-directeur passa sa main sur un interrupteur et illumina le trésor.
Louis ne respirait plus. Jamais il n’aurait imaginé voir tant de métal précieux. Laissant le sous-directeur procéder à l’inventaire, Louis et M. Delaunay retournèrent dans le bureau.
— Une question encore, Monsieur, si je peux me permettre.
— Bien sûr, Louis.
— Pourquoi moi ?
Le directeur sourit doucement.
— Parce que j’ai autant confiance en toi qu’en moi-même, Louis. Je te connais depuis le berceau, je sais que tu es droit et foncièrement honnête. Et puis, tu es intelligent, tu iras loin mon garçon. Même si tu es confronté à des difficultés imprévues, et je crains que tu en rencontres, tu sauras t’en sortir. Alors que ce brave M. Justin, son honnêteté n’est pas en cause, néanmoins je ne sais pas si, sorti de sa zone de confort, il aurait la même force de caractère que toi…
— Alors pourquoi ne venez-vous pas avec moi ? clama Louis.
— Un Directeur Régional de la Banque de France qui disparaît soudainement en pleine crise nationale, ce ne serait pas pour conforter la confiance de la population, tu ne crois pas ?
— Il ne s’agit que d’un voyage de quelques jours, jusqu’au port et puis on revient ?
— Non, Louis, vous suivez l’or jusqu’à sa destination finale. Et peut-être ne reviendrez-vous qu’une fois la guerre terminée, avec l’or !
— Dans ce cas, bredouilla Louis, que vais-je dire à mes parents, à ma mère ?
M. Delaunay le dévisagea avec gravité :
— Rien du tout mon jeune ami, rien du tout. Rappelle-toi, tu as promis de garder le secret.
Louis pâlit, il balbutia :
— Je ne sais pas si je pourrai maîtriser mon émotion devant ma mère, elle risquera de lire dans mes pensées et lui mentir me sera… difficile.
— Tu n’en auras pas besoin.
Le Directeur se tourna vers un angle de son bureau et montra un grand sac de voyage en cuir que Louis reconnut au premier coup d’œil. C’était le sien.
— À ma demande, ton père a accepté de préparer un sac pour toi et de le faire porter ici, sans me poser de question. Tu vois Louis, c’est ça un véritable ami, car je lui annonce que son fils part, qu’il ne le reverra peut-être jamais, et il accepte de me faire confiance sans poser une seule question.
Jacques Delaunay sourit pour la deuxième fois en quelques minutes. Il fit la question et la réponse :
— Ou plus exactement il m’en a posé une seule. Était-ce pour la France que je lui demandais ce sacrifice ?
Louis était troublé, tout allait changer pour lui maintenant.
— Eh oui, Louis, car il n’y a pas de temps à perdre. Vous partez cette nuit.
Prologue 3
Le 12 janvier 1944, siège du Comité Français de Libération Nationale, Alger
Le lieutenant Louis Schenk se dandine imperceptiblement sur sa chaise. Ses épaules se sont étoffées depuis quatre ans, ses cheveux courts et son uniforme lui confèrent une allure tout à la fois virile et fragile qui donne aux femmes l’envie de le protéger. La jeune sergente à l’insigne du CVF, Corps féminin des Volontaires Françaises, autrement dit les « Demoiselles de Gaulle » remarque l’impatience mêlée de trac du beau jeune officier. Coutumière de ce type d’émotion, particulièrement chez les jeunes gaullistes impressionnés de rencontrer le Général, elle décide de lui apporter une carafe d’eau et un verre, qu’elle pose sur un petit guéridon contre le mur. Elle accompagne le tout d’un grand sourire et d’un petit mot d’encouragement :
— Ne vous inquiétez pas ! Le Général ne va pas vous manger, je lui ai apporté son déjeuner il n’y a pas une demi-heure.
— Oh, mais ce n’est pas de Gaulle qui m’impressionne, répond Louis maladroitement. Je l’ai déjà rencontré en novembre dernier, ici même. J’espère juste qu’il va accepter le projet que je dois lui présenter. Il désigne une serviette en cuir rouge posée sur ses genoux et dont la poignée est reliée par des menottes à son propre poignet gauche.
— Eh bien tâchez d’être convaincant ! réplique la CVF, les mains sur les hanches.
En rougissant, Louis bredouille :
— J’ai tout retourné des centaines de fois dans ma tête, ça doit réussir. Ça va réussir !
Il se souvint de cette première entrevue avec le chef de la France Libre comme si c’était hier. C’était le 12 novembre 1943, et le jeune homme, fraîchement nommé lieutenant, était dans ce même salon d’attente. Et déjà il se morfondait, avant que ne s’ouvre la lourde porte à double battant, derrière laquelle travaillait, protégé par deux gaillards des FFL, le tout nouveau chef unique et tout-puissant du Comité Français de Libération Nationale. Depuis l’éviction éminemment politique quelques jours auparavant du chouchou de Roosevelt, le Général d’Armée Henri Giraud, Charles de Gaulle, le chef de la France Libre, était seul aux commandes des forces françaises unifiées dans la lutte contre l’occupant allemand.
***
Beaucoup d’évènements avaient occupé la vie de Louis depuis son arrivée début juin 1940 à Casablanca sur le croiseur auxiliaire Ville d’Oran. Ses bagages étaient encombrants. Non pas le sac de cuir qui constituait le seul lien avec son ancienne vie de fils de notable périgourdin, mais les 200 t d’or dont il avait accepté d’assumer le transport.
Le transfert en camion, sous forte escorte militaire, des barres du précieux métal de douze kilogrammes chacune, ne prit que quelques jours ; depuis le port de Casablanca vers une base militaire française marocaine, puis vers les coffres de la succursale de la Banque de France d’Alger. Lorsque M. Justin remit officiellement le chargement d’or à son collègue d’Alger, la mission du sous-directeur de la Banque de France de Périgueux et de son adjoint le jeune Louis, prit officiellement fin.
Ce fut un grand soulagement pour les deux hommes qui avaient traversé la Dordogne et la Gironde jusqu’au port du Verdon, croisant des convois sans fin de réfugiés civils fuyant l’avancée des troupes allemandes sous les bombardements. Une réalité avait obsédé Louis durant ce périple, malgré son jeune âge et son inexpérience de la chose militaire. Il ne pouvait tolérer ces milliers de soldats français, la plupart sans leurs armes ni leurs insignes de grades et d’unités, se mêlant au flot des réfugiés pour fuir la zone des combats. Puis ce fut le départ de nuit sur cet ancien paquebot transformé en croiseur auxiliaire et le contournement de l’Espagne franquiste, pour arriver en Afrique du Nord française.
Nous étions le 17 juin 1940 et Louis était soulagé d’avoir accompli la mission confiée par M. Delaunay. Il murmura à l’oreille de M. Justin :
— Nous allons pouvoir retourner à Périgueux et retrouver nos familles, n’est-ce pas Monsieur ?
Le Directeur de la Banque algéroise, M. Bensimon, entendit la timide requête et fit non de la tête :
— Mes pauvres amis, j’ai appris par mes collègues de la rue Croix des Petits Champs1, qu’avant-hier des émissaires allemands sont entrés à la Banque de France de Paris pour réquisitionner nos réserves d’or. Ils étaient furieux d’avoir trouvé les coffres vides. Le directeur a été emprisonné. Et, tout comme les autres équipes qui ont organisé le sauvetage de nos dépôts, vous serez considérés comme complices de cette… évasion.
Stupéfaits, Louis et Charles Justin étaient tout ouïe.
— Vous n’êtes pas au courant de la situation ? C’est vrai que durant les quinze derniers jours vous n’avez pas dû avoir l’occasion de vous tenir informés. Notre nouveau Chef de Gouvernement, le grand Maréchal Pétain, vient de demander l’armistice. Malin comme il est, il va embobiner le petit caporal autrichien et nous obtenir une « paix des braves ». En attendant, je vous conseille d’attendre ici à Alger quelques semaines que les choses se tassent.
M. Justin, prudent, acquiesça.
L’armistice ! Louis bouillait intérieurement pourtant il garda ses pensées combatives pour lui, face à ces deux hommes trop contents de voir le vainqueur de Verdun prendre le destin de la France en mains. Alors il se rangea à leur avis, du moins en apparence. Quelques semaines tout au plus, c’était l’occasion de faire un peu de tourisme en Afrique !
Le lendemain 18 juin, dans le salon du petit hôtel de Bab El Oued où il logeait, Louis demanda à écouter la BBC pour se tenir informé. Il entendit une brève allocution d’un officier français qui, comme lui, n’acceptait pas l’armistice. Il écouta avec d’autant plus d’attention qu’il lui sembla que l’orateur portait le nom du chef de régiment de son frère Gérard, un nom facilement mémorisable, de Gaulle.
L’été passa, la fière Albion gagna la Bataille d’Angleterre, mais en Algérie le vieux Maréchal déçut les espoirs du pourtant Pétainiste Directeur de la Banque de France d’Alger et la situation n’évolua pas comme il l’avait annoncé à Louis. La France métropolitaine vivait sous l’occupation du régime nazi, directement pour les deux tiers nord et ouest du territoire, et indirectement pour le sud-est au travers du régime fantoche du gouvernement de Vichy. La France s’enfonçait tranquillement et paisiblement dans la collaboration. Les premiers actes de résistance étaient brutalement réprimés, le déshonneur battait son plein avec son lot de dénonciations anonymes, et l’idée même du retour à Périgueux fut abandonnée. M. Justin fut embauché à la succursale d’Alger.
La femme du directeur de la Banque, qui s’était prise d’affection pour le jeune Schenk, fit jouer ses relations pour qu’il puisse intégrer l’école supérieure de commerce d’Alger. Louis put ainsi poursuivre ses études jusqu’à leur terme en 1942. Il refusa poliment l’offre que lui fit Madame Bensimon de venir habiter dans leur grande villa des hauteurs d’Alger, mais promis de venir y déjeuner tous les dimanches.
Ce fut une étrange période dans la vie de Louis, partagé entre la douceur de vivre de l’Algérie Française, à l’écart des combats qui se déroulaient de l’Atlantique à l’Asie, et l’absence de sa famille, qui lui manquait cruellement. La femme du directeur redoublait d’attentions, compensant à travers Louis l’absence de son fils unique parti travailler à Wall Street avant la guerre.
Bien qu’il ait trouvé un travail de livreur le soir et le samedi lui permettant de vivre, Estelle, comme elle lui demanda bientôt de l’appeler, le couvrait de petits cadeaux, utilitaires pour la plupart, en général à l’insu de son mari. Ainsi, elle l’aida à aménager la petite chambre de l’hôtel-pension de Bab El Oued où il continua de loger. Tous les dimanches après-midi, après avoir salué ses hôtes, il ne quittait jamais la grande demeure blanche des Bensimon sans que la cuisinière ne lui remette un grand panier d’osier, invariablement recouvert d’un linge à carreaux rouges et blancs, contenant suffisamment de petits plats préparés dans des bocaux « Le Parfait » pour le nourrir tous les soirs de la semaine. Estelle avait même réussi à connaître sa date d’anniversaire et lui fit, officiellement et devant son mari cette fois-ci, le cadeau d’un poste de TSF lors d’un repas où elle avait convié M. Justin, seul lien entre Louis et sa Dordogne chérie. L’attention que lui portait Estelle avec ce cadeau, aussi bien que la mélancolie due à l’éloignement de sa famille, avait embué ses yeux de larmes.
En effet Louis rêvait de ce poste de TSF depuis son arrivée en Afrique du Nord : nullement pour écouter Radio Alger, organe de communication du pouvoir Pétainiste, mais pour capter Radio Londres. Lors des premières semaines, il avait demandé au propriétaire du petit hôtel de Bab El Oued d’écouter la BBC, seulement ce dernier lui avait fait comprendre que des résidents, des marins de la Royale traumatisés par l’attaque de la flotte française par la Royal Navy à Mers El-Kébir, s’offusquaient de l’écoute de cette radio « ennemie ». Pour Louis, la radio britannique était le seul lien avec le reste du monde. Avec ce poste dont Estelle n’était pas dupe de l’utilisation, Louis put suivre l’évolution de la guerre mondiale comme l’entrée en guerre des États-Unis d’Amérique puis l’attaque allemande contre la Russie Soviétique.
Entre-temps, avant de posséder ce poste, avec l’inconscience de sa jeunesse, il avait fréquenté des cafés du centre-ville à la recherche d’un possesseur de poste de TSF plus ouvert à l’écoute de Radio Londres que le gérant de son hôtel. Il s’adressait à demi-mot aux jeunes étudiants qui fréquentaient ces cafés, plutôt qu’aux hommes plus âgés, davantage susceptibles de soutenir le régime de Vichy, dans son esprit. C’est ainsi qu’il s’était retrouvé à fréquenter un groupe de jeunes Gaullistes. Ses nouveaux amis, pourchassés par la milice pétainiste, lui avaient intimé de ne parler à personne de ses rencontres. Il respecta à la lettre cette consigne de prudence élémentaire et n’en parla même pas à Madame Bensimon, de peur de la compromettre.
En juin 1942, il obtint brillamment son diplôme d’économie en tant que vice-major de sa promotion, faisant la fierté de sa « marraine », Estelle Bensimon, qui n’eut aucun mal à convaincre son époux de l’embaucher comme attaché de direction de la Banque.
Vécue à Alger, la guerre prenait un tour surréaliste. La vie semblait continuer son cours en dehors des désordres du monde. Bien sûr, les combats faisaient rage en Lybie et en Égypte entre Britanniques et Italiens, bientôt soutenus par le corps expéditionnaire allemand, l’Afrikakorps, commandé par le général rendu célèbre par ses attaques de chars lors de la bataille de France, Erwin Rommel. Par contre, la vie restait relativement douce en Algérie.
Le plus difficile pour Louis était l’éloignement de sa famille restée en Dordogne. La vie semblait moins difficile au sud de la Loire, en zone libre, du moins c’est ce que lui disait sa mère dans les rares courriers qui lui parvenaient. Était-ce vrai ou disait-elle cela pour rassurer son fils ? Lorsqu’il avait demandé des nouvelles de son frère Gérard, la réponse de sa famille avait été évasive. Grâce à Radio Londres, Louis savait que des mouvements de résistance commençaient à s’organiser. Connaissant le patriotisme de son frère aîné, il comprit ce qui se passait et ne posa plus jamais de questions à son sujet par crainte de la censure.
Tout changea lorsque les Anglo-Américains de l’opération « TORCH » débarquèrent à Alger le 8 novembre 1942. Louis avait appris par la BBC et les émissions de Radio Londres le débarquement des forces américaines en Afrique du Nord. Il se précipita au petit café faisant office de QG des étudiants Gaullistes. Ils firent ouvertement la fête au mépris des patrouilles de la milice qui quadrillaient les rues le soir. Ses amis du groupe de Bab El Oued participèrent à la libération d’Alger alors que Louis fut consigné au sein de la banque pendant la durée de la bataille, sans doute sur demande d’Estelle, soucieuse que son protégé n’aille pas faire le coup de feu.
Quelques jours plus tard, dans le petit café, alors que les esprits s’étaient calmés et qu’un petit groupe de jeunes femmes et hommes, dont Louis, échafaudait des hypothèses sur la suite des combats, un homme d’âge mûr entra discrètement et se dirigea tout droit vers l’arrière-salle. Celui que Louis avait toujours considéré comme le leader de ce groupe de jeunes Gaullistes malgré son allure juvénile, Daniel, un petit étudiant en sociologie rouquin au visage couvert de taches de rousseur, se leva et suivit l’individu en faisant signe à ses camarades de continuer comme si de rien n’était. Après quelques instants, Daniel passa la tête au travers du rideau de perles de buis qui barrait l’ouverture de l’arrière-salle et fit signe à Louis de le rejoindre. Il ne comprit pas que le geste de la main s’adressait à lui. La jeune fille de l’autre côté de la table en zinc dut lui envoyer un signe affirmé de la tête pour que Louis se lève enfin et rejoigne la petite pièce qui servait de réserve. L’inconnu était assis, une bière à la main, à une petite table faite d’un fût recouvert de quelques planches. Il regarda intensément Louis dans les yeux, jusqu’à l’effrayer. Le patron du bar, un solide gaillard aux cheveux blancs contrastant avec son visage au teint cuivré, se tenait debout derrière lui, les bras croisés. L’homme fit signe à Louis de s’asseoir sur l’unique siège libre, en face de lui. Le « capitaine », en tout cas c’est ainsi que le patron du bar et Daniel le baptisèrent durant l’entretien, expliqua à Louis ce qu’il attendait de lui. Manifestement, Daniel avait dû présenter le jeune périgourdin comme étant de toute confiance. Le capitaine n’attendait rien de moins de Louis qu’il espionne M. Bensimon et fasse régulièrement un rapport sur les relations que le Directeur de la Banque de France serait susceptible d’entretenir avec les proches de l’Amiral Darlan, véritable primat de Vichy à Alger. Louis se leva brusquement, outré qu’on puisse lui demander une telle infamie vis-à-vis de la famille qui l’avait si chaleureusement recueilli depuis son exil en Afrique. Daniel sourit, ému par cet élan de sincérité et de loyauté, alors que le patron du bar appuyait gentiment mais fermement sur l’épaule de Louis pour le forcer à se rasseoir. Le capitaine prit un air sombre, plongea sa main dans la poche de son veston et en ressortit une enveloppe jaune qu’il posa devant Louis :
— Voilà ce que les vichystes font à tes camarades qui soutiennent les Forces Françaises Libres. Alors tu comprendras qu’au moment où nos alliés américains vont nous débarrasser de cette racaille collaborationniste, nous devons nous assurer de la, comment dire, future loyauté d’un des personnages les plus influents d’Algérie. Et tu es le mieux placé pour nous le démontrer et ainsi permettre à ton ami M. Bensimon de garder son poste à la libération d’Alger.
Comprenant la forme de chantage émotionnel que sous-entendait cette proposition, Louis ouvrit l’enveloppe en se demandant bien ce qu’elle pouvait contenir. Il s’agissait de trois photos et la main de Louis se mit à trembler lorsqu’il réalisa ce qu’elles représentaient : les corps tuméfiés de deux jeunes hommes et d’une jeune fille, allongés sur une dalle de béton. Il reconnut immédiatement la jeune fille, malgré le visage déformé par les coups, car il l’avait rencontrée plusieurs fois dans ce même café. Livide, Louis se tourna vers Daniel debout derrière lui.
— La milice, confirma ce dernier.
C’est ainsi que Louis se trouva à travailler, sans le savoir, pour le BCRA, également appelé deuxième bureau, autrement dit le service de renseignement de la France Libre.
Rapidement, grâce aux discussions des repas du dimanche chez la famille Bensimon, Louis comprit que les jeux politiques faisaient des Américains et des ex-pétainistes comme le général Giraud des alliés objectifs contre le Général de Gaulle.
Lorsque la situation se régularisa après le « putsch du 8 novembre2 », impatient de participer aux combats futurs pour la libération de la France, Louis demanda la permission à sa marraine d’intégrer une préparation militaire. Étonnamment, celle-ci ne s’y opposa pas. M. Bensimon lui-même, trouva que c’était une excellente idée. Perspicace, Louis comprit que pour le haut fonctionnaire, c’était une manière de se racheter par procuration de sa collaboration active avec le gouvernement de Vichy durant les deux précédentes années. Au sein de cette préparation se trouvaient beaucoup de jeunes gaullistes, encadrés par des soldats de métier souvent pétainistes. La cohabitation était explosive jusqu’à ce que progressivement des officiers gaullistes intègrent l’école.
Louis faisait son rapport hebdomadaire au BCRA. Après quelques semaines, alors que les Gaullistes avaient pris le pouvoir aux pétainistes, le BCRA lui confia une nouvelle mission. Louis était maintenant chargé de surveiller les cadres de la Banque de France d’Alger soupçonnés de miser sur le cheval Giraud, lui-même soutenu en sous-main par les Américains et leur représentant en Afrique du Nord, le Général Eisenhower.
Louis, qui maîtrisait dorénavant les techniques d’espionnage, réussit à intégrer un groupe de fonctionnaires qu’il soupçonnait d’avoir des contacts avec les Américains. C’est de cette manière qu’il entendit pour la première fois parler de AMGOT.
***
Perdu dans ses souvenirs, assis dans cette salle d’attente du bureau du Général de Gaulle, Louis Schenk repensa à sa première visite. L’entretien avait duré 15 minutes, pas une de plus, mais un mot, un seul, qu’il avait prononcé devant le Général avait changé la vie du jeune périgourdin : AMGOT.
Il ne remarqua pas tout de suite l’arrivée d’un gaillard en uniforme des fusiliers marins, à l’allure imposante et au gabarit de rugbyman. C’est le salut que lui rendirent les deux FFL qui fit réaliser à Louis que le capitaine de corvette Gaston Faure venait de rentrer dans le vestibule. L’un des battants de la double porte s’ouvrit brusquement et le secrétaire du Général annonça :
— Capitaine Faure, Lieutenant Schenk, entrez !
Louis détourna une seconde son regard vers la jeune CVF qui croisa ses doigts en signe de chance. Il inspira profondément et suivit le capitaine Faure dans l’antre du chef de la France libre.
1 Siège de BdF dans le 1er arrondissement de Paris.
2 Actions coordonnées de la résistance française pour faciliter le débarquement des troupes Alliées à Alger
Prologue 4
Le 13 juin 1960, 5 heures du matin, chantier naval de Nantes
Le conducteur de la Simca Aronde noire met son clignotant à gauche et quitte le quai de la Fosse pour s’engager sur le pont Anne de Bretagne. Seul véhicule automobile à cette heure matinale, il double uniquement quelques ouvriers à vélo en bleu de travail et béret, gamelle sanglée sur le porte-bagages. L’homme redresse nerveusement son nœud de cravate, puis baisse sa vitre. L’air est si doux en Bretagne en cette toute fin de printemps. C’est à peine s’il jette un coup d’œil sur sa gauche, au-delà du parapet du pont, où les eaux sablonneuses de la Loire rosissent dans le petit matin. Il inspire puis expire profondément. Trois cents mètres après avoir abordé l’île de Nantes, il quitte le boulevard et s’engage sous le porche de pierre dont l’inscription Chantier Naval, encadrée de deux drapeaux français, est faiblement éclairée par un projecteur à la lumière jaunâtre. Il stoppe devant la barrière baissée et, encore une fois, saisit son nœud de cravate nerveusement en attendant que le vigile sorte de sa guérite. Cet étourdi l’éblouit en lui dirigeant sa lampe torche directement vers le visage :
— S’cusez moi m’sieur l’ingénieur. J’vous avais pas r’connu ; faut dire que vous êtes bien matinal. Cinq heures du mat’ c’est plutôt l’heure des cols-bleus !
L’homme murmure qu’il a beaucoup de travail en retard et que le programme n’attend pas, sans même jeter un regard au gardien.
La barrière se lève, la herse antieffraction rentre dans le sol et libère le passage. L’Aronde file entre des hangars gris souris et des immeubles de bureaux d’avant-guerre pour venir s’arrêter sur un dock. L’homme en descend, saisit un lourd sac de cuir sur la banquette arrière et se dirige vers un immense bâtiment qui jouxte le quai de la Loire. Le gendarme qui occupe la guérite devant l’entrée le salue, l’homme lui rend son salut, bien qu’il soit en civil, réflexe d’ancien militaire. La sentinelle vérifie son laissez-passer, puis lui ouvre la porte blindée surmontée d’un écriteau « Zone Militaire » barré de bleu-blanc-rouge.
L’homme traverse rapidement une longue pièce dont les murs sont occupés par une double rangée de vestiaires métalliques et pénètre dans une immense salle rectangulaire deux fois plus longue que large, haute comme un immeuble de quatre étages. Une forme de radoub surmontée de plusieurs ponts roulants occupe les deux tiers de ce hangar. Dans la forme, un grand sous-marin de croisière en cale sèche, maintenu par des tins et des bers, domine de son massif ce hall de montage rempli de matériels d’essais et de contrôles.
L’homme n’allume pas les rampes au néon qui illuminent d’ordinaire le hangar durant les heures de travail. Il saisit une lampe torche dans son sac, enfile ce dernier sur ses épaules comme un sac à dos et s’approche du massif du sous-marin en regardant attentivement où il met ses pieds, entre les câbles, chaînes, chariots et autres servantes