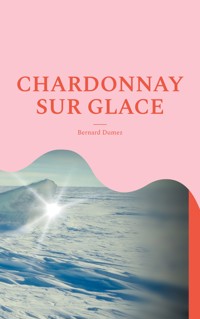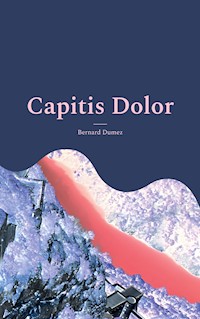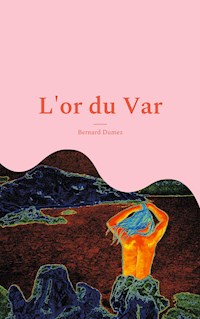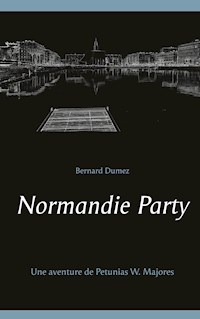
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Une organisation mafieuse s'empare de plusieurs milliers d'oeuvres d'art des grands Musées Nationaux européens. Petunias Walter Majorès, tranquille quadragénaire, se trouve embarqué malgré lui dans une course-poursuite lancée par les services secrets pour récupérer ces oeuvres et éviter qu'elles ne soient troquées contre une arme de destruction massive. Mais quelle est la véritable cible des terroristes ?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Sommaire
Chapitre I
Chapitre I1/2
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
Chapitre XX
Chapitre XXI
Chapitre XXII
Chapitre XXIII
Chapitre XXIV
Chapitre XXV
Chapitre XXVI
Chapitre I
J’aurais dû le savoir que ça ne marcherait pas. Écouter ma raison plutôt que mon cœur et… ma mélancolie ?
Non pas ma mélancolie, elle ne mène pas ma vie, je joue avec, je la manipule en quelque sorte mais elle ne mène pas ma vie.
Pourtant je n’arrive pas à me sortir Clara de la tête. Préférer aller soigner les petits africains au Burkina plutôt que de s’installer avec moi, je n’arrive pas à l’admettre. Et dans un orphelinat catho de surcroît ! Moi qui boufferais du curé tous les matins si j’en avais dans le frigo. En plus, je me les caille, à pinces sous cette averse vicelarde. Pourquoi je ne me rachète pas une nouvelle parka, merde !
Économies à la con… Celle-là date d’au moins dix ans. Pas usée, non, c’était de la qualité, mais cette fichue pluie me rentre dans le cou. J’ai pas besoin d’attraper la crève en plus, avec tout le boulot qu’on a en ce moment. Oh, et puis je m’en fous ! Sonia, mon assistante adorée, peut très bien se débrouiller sans moi. D’ailleurs, elle serait soulagée que je lui lâche la grappe, un peu. Elle n’a plus besoin de m’avoir sur le dos toute la sainte journée, tout le monde sait qu’elle gère l’entreprise aussi bien que moi, quand je suis en voyage.
Et puis je pouvais prendre la ligne 4 plutôt que de me taper l’avenue à pied, comme un con, en plein mai pluvieux.
Ça fera marrer Pascal, c’est déjà ça. J’aurai fait ma bonne action. Depuis le drame, fini les sourires en coin, l’œil qui pétille et les fous rires complices. Merde, qu’est-ce qu’on a pu s’en payer des fous rires, avant.
Tiens ! La boutique du 33 a encore changé, terminé les jeux vidéo, vive l’agence immobilière. Depuis quinze ans, les épiceries ont été vendues à des marchands de parapluies chinois, qui les ont rétrocédées à des Gamecenters, et désormais, une pléthore d’agences immobilières réquisitionne nos pas-de-porte. Comment vivent-elles ? Elles sont au moins quinze sur le boulevard ! Elles pourront au moins revendre leurs propres locaux !
J’ai peur de craquer devant Pascal, de lui laisser paraître que moi aussi, je suis effondré. Je n’ai pas les mots pour le réconforter, ou du moins le rassurer, lui montrer que je suis avec lui, toujours, et encore plus maintenant. J’ai la tête qui tourne, l’impression de flotter, de marcher sur un tapis mousse. Déjà aux obsèques je n’en menais pas large. Pascal devait attendre mieux de son plus vieux copain.
Ah, j’arrive, le grand porche avec sur le fronton « Grand Garage Citroën » gravé dans la pierre. J’adore cette architecture industrielle de l’entre-deux-guerres, avantgardiste, aux prémices de l’art déco. La mairie de Paris, plus deux ou trois fondations sponsorisées par nos grands patrons du CAC 40, ont déjà essayé de lui racheter, sans succès : quatre mille mètres carrés sur trois niveaux, en plein 14e arrondissement. Pascal ne veut pas quitter les lieux, pourtant, financièrement, il ferait une excellente affaire et pourrait installer son entreprise de transport en proche banlieue, dans des locaux plus fonctionnels, moins exigus. Mais il sait que la plupart de ses employés habitent Paris, viennent à pied ou en transports en commun. Ils préfèrent tous travailler à l’étroit dans des locaux de 1922 pas climatisés, plutôt que de quitter ce bâtiment classé.
Du temps du garage Citroën, le plus grand de France à l’époque, même les Américains étaient venus visiter et admirer sa structure métallique Eiffel recouverte de stuc Art déco, ses rampes d’accès automobiles aux étages supérieurs. Son grand salon, digne d’un palais de Saint-Pétersbourg, recevait les clients. Les nouveaux modèles d’automobiles y étaient présentés, avec leur panel de couleurs, trois au choix jusqu’en 1949 (noir ou noir ou bien noir).
Juste à droite après le porche, dans l’ancienne maison du gardien, Marcel le chef d’atelier. Il fallait gardienner, car les vols et l’espionnage industriel étaient déjà monnaie courante.
Est-ce que je m’arrête ou bien je fais semblant de ne pas le voir ? Jamais il ne me croira. Vingt ans que je viens, et pas une seule fois je n’ai dérogé à mon circuit à étapes, d’abord s’arrêter dire bonjour à Marcel, prendre des nouvelles de sa famille, de ses fils, même âge que moi. On jouait ensemble dans l’atelier de révision des moteurs ou dans le magasin de pièces détachées.
Notre préférence allait au magasin de pneumatiques. Les piles de pneus de camion faisaient des cachettes extraordinaires. Marcel, soucieux de voir des tores de caoutchouc de cent cinquante kilos nous tomber sur la tête, nous interdisait formellement de jouer dans ce local. Et si en plus nous entraînions Julia, la cadette, sa fille adorée, l’enfant de l’amour comme il disait, plus jeune de dix ans que ses frères, alors là … il pouvait entrer dans une colère noire.
Je m’arrête, c’est la seule option. Mais que lui dire ? C’est encore plus difficile qu’avec Pascal.
Je reste sur le pas de la porte métallique. Il lève la tête de son bureau, doucement, comme s’il lui en coûtait, le regard en dessous.
— Ben rentre toubib !
Jamais vraiment compris pourquoi Marcel m’appelait ainsi. Ou plutôt si, j’imagine que comme j’avais eu l’opportunité de faire des études, contrairement à ses fils, et qu’à l’adolescence, j’avais tendance, plus par bêtise que véritable arrogance, à « étaler ma science », je parlais de faire un doctorat. Certainement que dans l’esprit de Marcel, doctorat signifiait médecine… Alors que moi, c’était d’astrophysique dont je rêvais.
— B’jour Marcel… Comment tu vas ?
Un silence long comme un jour sans pain.
— Comment veux-tu que j’aille ? Je préférerais être mort à l’heure qu’il est.
— Ne dis pas ça, tu te fais du mal pour rien. C’est un accident, un terrible accident.
Marcel me regarde enfin, droit dans les yeux, de cet œil sombre qui suffisait à nous glacer, comme lorsque nous étions adolescents et qu’il se préparait à nous engueuler dans ce hangar à pneus. S’il avait su, il n’aurait même pas eu besoin d’élever la voix, son regard suffisait à nous faire rentrer sous terre. Ce regard incongru sur son visage rondouillard de natif de Provence.
— Ne me baratine pas Walter.
Marcel m’appelle rarement par mon prénom. Il replie le journal, qu’il ne lisait pas de toute façon :
— Accident ou pas accident, je l’ai tué. Le fils unique de mon patron, le petit-fils de mon ami, Louis, qui m’a recueilli quand j’avais quinze ans. Jamais je ne me le pardonnerai, jamais Pascal ne me pardonnera. Jamais Louis, paix à son âme, ne me l’aurait pardonné, et jamais toi, tu ne me le pardonneras.
Je ne sais pas comment lui dire qu’il se trompe, que la douleur l’égare, que la culpabilité prend le dessus en vain. Je ne sais pas, parce qu’après tout, il a peut-être raison. Alors je me défile, comme souvent :
— Bon, écoute, je monte voir Pascal et je repasse te voir après.
— Ça tombe mal, j’ai un rendez-vous qui doit arriver d’une minute à l’autre, reste plutôt auprès de Pascal et passe me voir dans une heure.
— Ou demain si tu veux ? Je n’attends pas sa réponse, pressé d’en finir avec ce tête à tête embarrassant.
Il jette un œil à sa montre, son regard a changé, il a retrouvé son visage de chef d’atelier très occupé, pas la peine d’insister.
Le bureau de Pascal est au fond du couloir vitré, sur la mezzanine.
Ce n’est pas le plus grand bureau, il l’a laissé à son directeur commercial pour recevoir les clients, avec un grand canapé rouge, comme dans certaines émissions de télé. Certains soupçonnent Julien Mage, directeur marketing et ventes s’il vous plaît, d’utiliser aussi ce sofa pour les entretiens d’embauches de ses nombreuses stagiaires, toutes issues de l’ESSEC et de HEC ! D’autant plus qu’il s’est fait aménager un cabinet de toilette avec douche ainsi qu’un accessoire très daté années soixante-dix, un bar camouflé dans un tonneau, avec ouverture commandée à distance.
Moi, je me fous des commérages. Ce qui est factuel, c’est le doublement du chiffre d’affaires depuis que Pascal l’a embauché, et une dynamique que l’entreprise n’avait pas connue depuis que Louis Schenk, le père fondateur, était à sa tête.
Après le bureau/garçonnière de Julien, le bureau d’Isabelle, l’assistante de Pascal. Une femme indispensable autant qu’efficace. Pendant la dépression de Pascal consécutive à son divorce, son black dog1, comme il aimait à ironiser, Isabelle a tenu la boutique, des semaines durant, sans aucune consigne de Pascal, comme s’il était simplement absent, en congé ou en voyage d’affaires. Et toute l’entreprise a trouvé naturel de recevoir des directives de cette grande femme brune et élégante, au charme discret. D’ailleurs, auparavant, elle rédigeait quotidiennement les notes de service pour Pascal et elle signait à sa place avec son autorisation, d’un graphe PS pour Pascal Schenk. Maintenant, elle continue à les rédiger, en signant simplement Isabelle.
Au bout de la mezzanine, le bureau de Pascal, avec son minuscule balcon de fer forgé donnant sur un angle du parc Montsouris. Un endroit si exigu qu’il est à peine suffisant pour trois chaises, deux pour poser nos culs et une faisant office de table. Un cendrier, les Montecristo n° 4 et des verres pour l’anisette Bardouin l’été ou le rhum Bologne l’hiver complètent le tableau.
Pascal est assis derrière son bureau de lycéen ramené de chez ses parents, dos au petit balcon et face à la porte, car on doit toujours être face à ses visiteurs pour les accueillir. Il est d’une pâleur extrême, les veines de son visage se dévoilent sous une peau devenue translucide. Plus aucune trace de hâle, alors que son unique loisir était de passer deux semaines tous les hivers sous les tropiques. J’ai peine à le reconnaître, pâle comme un mort, c’est bien l’expression qui convient à Pascal. Il a gardé ses lunettes de soleil, mais de près, elles ne dissimulent pas ses yeux bouffis par le chagrin. Il se lève, contourne son bureau et sans hésitation me serre dans ses bras.
— Reste avec moi, s’il te plaît.
Alors moi aussi, je le serre, fort, très fort.
— Oui, oui, bien sûr.
Il pleure sur mon épaule, sans bruit, je ressens juste les tressautements de ses sanglots, puis l’humidité de ses larmes sur mon cou. Puis soudain il se redresse, me prend par les épaules, plonge son regard émeraude dans le mien.
— On va chez Tonio, ça nous changera les idées.
Je hausse les épaules et esquisse un sourire :
— Oui, si tu veux, si ça te fait plaisir.
— Tu es venu à pied, comme d’hab’ ?
J’acquiesce.
— Donne-moi cinq minutes que je laisse quelques consignes à Isabelle, je te rejoins en bas.
Dans la cour, je décide de retourner voir Marcel. Par la grande baie latérale de son bureau, je l’entrevois en grande discussion, avec une femme qui fait les cent pas devant son bureau. D’ordinaire, le chef d’atelier fait asseoir les clientes, mais celle-ci semble très agitée. De dos, la silhouette est à mon goût, plutôt grande, un cul pommelé mis en valeur par une jupe mi-longue et une veste courte, très, « libération de Paris 1944 ». J’aurais bien aimé voir son visage ou du moins sa chevelure, mais elle a conservé son béret de laine.
Marcel se lève également, de l’autre côté du bureau, je comprends qu’il est nerveux à ses mains qui s’agitent. Comme tout bon latin, lorsqu’il s’emporte, il appuie son discours sur sa gestuelle. Professionnellement, c’est très inhabituel de sa part, lui qui conserve son calme, même devant un client de mauvaise foi. Il a le don de redonner le sourire à un chauffeur de poids lourd, de l’entreprise Schenk ou d’une entreprise de transport extérieure pour lesquelles l’atelier travaille également, après lui avoir annoncé que son véhicule ne sera pas prêt comme prévu, et que le quidam repart comme piéton. Je comprends que cet état de nervosité insolite chez lui est une conséquence du drame que nous vivons.
Depuis la dalle pavée de la grande cour, j’observe ce dialogue animé sans en comprendre la teneur, car Marcel a fermé sa porte.
Il jette soudain un coup d’œil dans ma direction, m’aperçoit, dit encore quelques mots à la femme, la prend par le bras et la pousse littéralement vers la porte côté cour. À peine sur le pas de la porte, il referme derrière elle et se précipite vers l’autre porte de son bureau, celle qui donne directement sur l’atelier. La femme détale vers le porche et tourne à droite sur le boulevard.
Sans motif, je me précipite pour la suivre, mais je n’ai que le temps de la voir s’engouffrer dans un taxi qui devait l’attendre sur la contre-allée. Je ne pense même pas à relever le numéro. Quel mauvais enquêteur je ferais. J’ai l’air con, tout seul sur le trottoir, incapable de m’auto-justifier ce sprint de vingt mètres. Je fais demi-tour, contourne le bureau de Marcel et rentre dans l’atelier en poussant le rideau de lames plastique.
Un mécano jovial, dont le bleu de travail devrait être rebaptisé un marron cambouis, vient à ma rencontre :
— Tiens, le toubib ! Qu’est ce qui veut ?
Décidément ils commencent à m’agacer dans cet atelier, j’ai un prénom, merde ! Marcel, j’admets, mais ce gamin d’à peine vingt-cinq ans, comment se permet-il ?
Je réplique sèchement, le visage fermé :
— Je cherche Marcel.
Mon ton a dû le décourager, car c’est sur un timbre beaucoup moins péremptoire qu’il me répond que Marcel vient de traverser l’atelier comme s’il avait « le feu au cul », a pris le Kangoo de service et vient de sortir par le petit portail, donnant sur l’impasse Reille.
— C’est même pour ça qu’on se marrait, m’sieur Majorès, c’est pas contre vous.
Après une justification aussi scolaire, le mécano me paraît tout à coup plus jeune que vingt-cinq ans. C’est le cambouis qui doit le vieillir.
— Bon, on y va ? me fait Pascal.
Je ne l’avais même pas entendu arriver. Il a mis son cuir de moto et porte un casque sur l’avant-bras. Je le trouve moins pâle que dans son bureau tout à l’heure.
— Tu as vu Marcel ? me demande-t-il.
— Euh …non. Justement je le cherchais.
— Il n’ose plus m’approcher, tu sais, depuis… l’accident…
— Peut-être qu’il culpabilise ?
— Ça, il peut… Enfin je veux dire, je comprends. Mais ce n’est pas une raison. Au moins professionnellement, il faut qu’on communique. Depuis deux jours, tous les collaborateurs se demandent ce qu’il se passe entre nous. Je sais que ça discute ferme pendant les pauses, et le patron du bar le Balto m’a rapporté que le midi, les discussions allaient bon train. Tiens, prends ton casque !
Pascal sourit en voyant ma mine déconfite.
— Ne me dis pas que tu as encore la trouille de faire de la moto ?
— J’ai pas la trouille de la moto, mais de ta moto, ou plutôt d’être sur ta moto, avec toi comme pilote.
— Sérieux, ça fait vingt ans ! Et c’est grâce à ça qu’on est devenus amis.
***
À la fac, nous étions dans le même amphi, mais on ne travaillait pas dans le même sous-groupe de Travaux Dirigés. Je voyais bien que Pascal m’adressait des sourires de loin, mais il était solitaire, jamais à suivre une croupe féminine, ou déjeuner au restau U avec les gazelles de BTS secrétariat trilingue. Alors comme d’autres, je doutais du caractère hétéro de ses orientations sexuelles.
Arrive le jour de la visite médicale, évidemment à dix kilomètres de Jussieu, en banlieue, et loin de tout RER ou métro. Comme je n’étais pas un fan de bus, je cherchais un moyen de me faire véhiculer, dans une des rares voitures dont disposaient les tout aussi rares possesseurs du petit triptyque rose.
Étonnant, mais les filles devaient avoir une carte de priorité, aussi je commençais à galérer, quand Pascal me proposa gentiment de m’emmener sur sa moto.
— Merci, mais je n’ai pas de casque.
— J’en ai deux, pas de blème.
— Super, dis-je. Pour essayer de me convaincre.
Je m’attendais à une Trail125, comme la plupart des deux-roues accessibles aux étudiants à l’époque. La moto en question était une 1 100 GSX Suzuki, un dragster homologué pour la route, de 100 CV, voire plus, si le bridage était passé à la poubelle en sortant de chez le concessionnaire. Une version exclusive, sans concession au confort du passager, c’est-à-dire qu’à part une paire de cale-pieds, rien n’était prévu pour s’accrocher. Je grimpe sur cet engin tout droit sorti du film Mad Max, le cul en équilibre au bout de la selle, soi-disant biplace, mais plutôt prévue pour un solo, une moto d’égoïste, quoi !
— Je vais y aller doucement, mais je te conseille de t’accrocher à ma taille par sécurité, me recommande-t-il, en enfourchant sa monture.
Faisant semblant de ne pas comprendre, je serre comme je peux les flancs du carénage sur les côtés de la selle. Première accélération, première glissade vers l’extrémité de la selle, première frayeur. Je serre maintenant de toutes mes forces les minces tôles de métal, mon fil d’Ariane. Les accélérations se succèdent entre les feux de la N20. D’ailleurs je ne devrais pas dire accélération car la sensation n’a rien de progressif, c’est binaire : arrêt-120km/h-arrêt.
Je distingue parfois, au travers de la buée qui envahit mon casque, des formes vertes arrêtées que nous doublons, que nous figeons. Je comprendrai plus tard qu’il s’agit de bus RATP, qui roulent sur la file de droite.
Enfin arrivé au centre médico-social, vivant et entier ! Au retour, j’étais toujours convaincu de ma méthode d’accrochage sans contact avec mon conducteur, malgré les conseils réitérés par Pascal de me cramponner à lui. Peut-être un peu moins concentré qu’à l’aller, je profite d’une accélération légèrement plus appuyée (si, si c’est possible avec une 1 100 GSX), pour abandonner mon conducteur et sa monture, et je me retrouve le cul par terre, en pleine place Denfert-Rochereau.
Le pavé des paveurs de Montrouge est dur, auraient dit les manifestants de mai 1968. Le bitume n’est pas plus confortable.
Pascal freine, dérape, fait demi-tour et vient placer sa moto de manière à me protéger de la circulation. Comme les manœuvres imposées d’un homme à la mer au permis bateau. D’ailleurs, ne suis-je pas comme un homme à la mer, au milieu de ce carrefour, entouré des requins voraces que sont les automobilistes qui me frôlent ?
Vu du sol, même les proues des voitures ressemblent à des faciès de requins.
Pascal soulève la visière de son casque intégral, il est tout pâle :
— Ça va ?
Je me frotte la fesse gauche, celle qui a pris contact avec le sol en premier :
— Sauf mon amour-propre, ça peut aller.
Mais en me relevant, je boite.
— Viens, on va chez mes parents, ma mère est médecin.
***
C’est comme ça que j’ai connu ses parents, adorable couple atypique. Papa : entrepreneur self-made-man, ancien de la marine nationale. Maman : médecin, fille et petite-fille de médecins. Tout de suite adopté, choyé comme leur propre fils, qui n’était d’ailleurs pas du tout intéressé par les hommes, mais simplement un garçon timide, un peu agoraphobe et surtout motard dans l’âme.
— C’est vrai qu’on est devenus amis grâce à ta moto, mais qu’est-ce que mon cul a pris ! (private joke depuis que je lui avais fait part de mes doutes sur ses mœurs). Bon OK pour la moto mais vas-y doucement.
Pascal a un sourire, son premier depuis l’accident :
— T’inquiète, j’ai une surprise pour toi…
— Surprise ? Hum…
— Bonne surprise !
— Tu as ajouté deux roues et une carrosserie à ta moto ?
— Mieux !
— Six roues ?
— T’es con, mais tu ne seras pas déçu.
Nous sommes sur le boulevard, remontant la contreallée où il stationne habituellement son vieux GSX. Il sort une télécommande de son cuir et, beep-beep ! Une Honda Goldwing 1800, en robe cerise sexy, nous fait des appels de tous ses feux.
— Depuis le temps que tu te plaignais du confort de la place arrière de ma Suzuk’, maintenant, je veux plus t’entendre ronchonner.
— Ouah, elle est superbe, vraiment, et c’est un spécialiste motophobe qui te le dit ! Mais tu l’as achetée quand ?
— Lundi, j’étais chez Honda quand, quand le… l’accident s’est produit…
1 Churchill nommait ses dépressions à répétition Black Dog : chien noir.
Chapitre I1/2
Pas la meilleure soirée passée chez Tonio. Le nez dans sa bière, Pascal n’a strictement rien dit, répondant juste aux saluts des habitués qui entraient, ou sortaient, esquissant une timide mimique de reconnaissance à ceux qui, ayant eu connaissance du drame, lui posaient affectueusement la main sur l’épaule, sans rien oser dire.
Un bistrot de quartier est un monde plein d’humanité, ceux qui sont malheureux au-dehors, viennent chercher le long du comptoir de la chaleur, et pas seulement celle procurée par l’alcool. Coluche et Jean-Marie Gourio l’avaient bien compris, qui collectaient les bons mots de ces Robinson, naufragés involontaires de la cité.
Avant de se quitter, Pascal m’a posé cette étrange question.
— Et pourquoi as-tu quitté Dassault Aviation alors que l’aéronautique a toujours été ta passion ?
— Parce que je ne supportais plus de ne pas être mon propre patron. Et puis d’ailleurs, la technologie je suis toujours dedans. Mais au lieu de mettre au point des armes, je travaille pour la science.
Pourquoi me demande-t-il ça ? Il doit être vraiment mal, et s’interroger sur sa propre vie pour me poser cette question.
Je remonte la rue du Moulin Vert depuis l’église Saint Pierre de Montrouge, et je tourne dans la rue Hippolyte-Maindron, direction mon petit pavillon. Je flotte un peu sur le pavé, l’India Pale-Ale me cotonne un peu les genoux, mais aucune euphorie ni aucune mélancolie, juste une difficulté à poser les pieds par terre, comme si la gravité s’était soudainement inversée.
La serrure s’est encore décalée dans son coffre, et le cylindre n’est plus dans l’axe, la clé rentre mal. Et comme je n’ai toujours pas remplacé la lampe du perron, je n’y vois rien. La porte n’est pas verrouillée, décidément ! Je distingue une lueur venant de la chambre, j’ai en plus, dû oublier d’éteindre la lumière, en partant ce matin.
Je rentre dans la cuisine sans allumer.
Je ne vais pas faire long feu ce soir, allez, une visite au frigo ! Je sors une bière, la regarde à la lumière pâle du réfrigérateur et je la repose. Assez bu pour aujourd’hui !
Tiens, j’avais acheté du rôti de porc, super, je vais m’en faire un sandwich de célibataire avec cornichons… Si je trouve un bout de pain.
Deux baguettes bien cuites sur la table, odeur de pain frais et chaud, comme j’aime. Mais là ça va plus, je l’aurais acheté quand ce pain ? Ce matin, je suis allé directement au bureau… Et je rentre à l’instant !
Serrure, frigo, pain, et la lumière là-bas au bout du couloir. J’ai l’esprit embrumé par l’alcool mais tout de même…
J’avance vers la lueur, dans la pénombre du vestibule. Ma chambre est au bout du couloir. Dans ces vieilles bâtisses du 14e Arrondissement, les architectes adoraient distribuer les pièces en enfilade, le long de couloirs rectilignes. La démarche hésitante, je frotte un peu le mur avec mon épaule. Décidément je n’aurais pas dû boire la dernière. Comme disait je ne sais plus quel humoriste américain, un verre me saoule, mais je me souviens jamais si c’est le 13e ou le 14e.
La lumière ne vient pas de la chambre mais de la salle de bains attenante, suite parentale avec salle d’eau, s’il vous plaît ! La porte est entrouverte, je sens qu’il y a quelqu’un. Elle s’ouvre brusquement, la lumière m’éblouit, une forme en contre-jour apparaît et s’écrie.
— Tu m’as fait peur idiot !
Je porte ma main devant les yeux, aveuglé. Le spectre ajoute :
Et qu’est-ce que tu fais dans le noir ?
Mais, vous êtes qui ?
La forme avance dans la pièce, se fait plus nette, pleine de courbes. S’avance encore, c’est une femme, jeune, couverte simplement d’une serviette, ma serviette. Comme un crétin, j’ai gardé la main en casquette au-dessus de mes yeux.
Elle me sourit.
— Tu ne me reconnais pas ?
Elle me prend la main et l’éloigne de mes yeux, plonge un regard vert d’eau, soudainement grave, dans le mien.
Tout s’éclaire soudain dans mon esprit embrumé :
— Julia ?
— Ouiii !
Un large sourire envahit son visage. Mais oui, bien sûr, Julia ! Mais Julia avec dix ans de plus.
J’en bafouille :
— Mais, qu’est-ce que tu fais là ? Enfin je veux dire, je suis tellement heureux de te voir.
Elle s’esclaffe franchement, comme il y a dix ans durant nos jeux avec ses frères, lorsque avec l’effronterie de ses dix-sept ans, elle se moquait de Pascal et moi, alors que chacun des garçons voulait se mettre en valeur à ses yeux.
Julia !
Je n’en reviens pas.
Elle me prend par le bras, comme un couple partant en promenade et m’entraîne vers le lit ou nous nous asseyons.
Je ne la quitte plus des yeux. Je dois avoir l’air un peu bête :
— J’ai tellement de questions, je ne sais pas par quoi commencer.
— Vas-y, je t’écoute, dit-elle en baissant légèrement les yeux.
— Déjà, comment es-tu rentrée chez moi ?
Elle relève les yeux et s’exclame, mi-ironique, mi-agacée.
— C’est ça la chose la plus importante que tu as à me demander ?
— Non, mais c’est la première qui me vient à l’esprit.
— Avec les clés.
— Quelles clés ?
— Celles que tu m’avais données, il y a dix ans.
Chapitre II
Après quelques instants d’hésitation, tout m'était revenu en mémoire. Lorsque Julia était brusquement partie de chez ses parents, la première personne à qui elle avait demandé refuge, c’était moi.
J’en étais fier, mais inquiet aussi, car j’allais devoir mentir à Marcel et lui dire que non, je ne savais pas ce qu’était devenue sa fille chérie.
Les premiers jours, elle resta dans la chambre d’amis, à pleurer ou à lire, en particulier mon intégrale de San Antonio, cent soixante-quinze volumes, ce qui me laissait le temps de la convaincre de retourner chez ses parents. Je ne voulais pas mentir indéfiniment à Marcel, et si je lui ramenais sa fille, mes petits mensonges passeraient juste pour un stratagème. Et puis, elle n’avait que dix-sept ans après tout et je pouvais être accusé de détournement de mineure, d’enlèvement, ou de recel d’adolescente ! D’ailleurs, ses parents avaient déposé une main courante au commissariat de l’arrondissement.
Les premières semaines, je tentais de convaincre Julia, mais elle ne voulait rien entendre. Renouer le dialogue avec son père semblait impossible. Elle m’agaçait et on s’accrochait de plus en plus souvent, je lui reprochais de ne rien faire, comme si cette adolescente était ma fille. Je lui disais qu’elle ne pouvait pas rester éternellement enfermée dans mon petit pavillon, mais que si elle sortait et était reconnue, je risquais de gros ennuis judiciaires. Le dilemme !
Un jour, elle me déclara :
— Si tu me donnes des clés et de l’argent, je pourrai faire tes courses ? Promis je serai discrète, je me déguiserai.
Le lendemain soir, à mon retour, pas de Julia. Vingt minutes plus tard, j’entends la clé dans la serrure, qui hésite, rentre et sort, déjà à l’époque cette serrure était récalcitrante. Je vois entrer une femme entre deux âges, cheveux grisonnants, légèrement voûtée, un fichu sur la tête, le visage rond.
— Mais qu’est-ce que vous faites chez moi ?
Julia éclate de rire, se redresse, retrouve instantanément ses un mètre soixante-dix-huit, pose le filet à commissions sur la table, puis enlève des boules de coton de ses narines et les deux petites balles de mousse de ses bajoues. Un petit coup de fichu dans les cheveux pour enlever la farine qui les recouvrait, et comme par magie, sa teinte auburn réapparaît. Elle est absolument satisfaite de son petit stratagème.
— Tu devrais faire agent secret plus tard, Jamie Bond ?
— J’y penserai, j’y penserai. Tiens, voilà ta monnaie.
— Garde-la, pour les prochaines courses.
— Et je t’ai acheté des aliments plus équilibrés que tes tranches de porc et ta bibine. Poisson, fruits, légumes verts et jus de fruits bio.
— Merci, bon, on verra, mais faut le cuisiner tout ça ?
— Ah ! Parce qu’en plus tu ne sais pas cuisiner ?
— C’est un travail de femme, dis-je, en appuyant ma remarque misogyne d’un large sourire, pour éviter de me faire massacrer. Je me prends quand même un brie fermier au lait cru sur le coin du visage, mais agréablement accompagné d’un éclat de rire.
— Jouer avec la nourriture, alors ça, non !
Je me précipite sur elle, elle esquive, souple comme une panthère, passe derrière moi et court dans le vestibule, puis le couloir. Je réussis à saisir la manche de son t-shirt quand elle passe la porte de la chambre, mais elle continue sur son élan, le coton se déchire, la bretelle de son soutien-gorge apparaît.
— Oups, désolé pour le t-shirt.
Plutôt que de m’engueuler, elle s’arrête, se tourne vers moi et me sourit. Légèrement essoufflée par ce sprint, elle fixe son regard dans le mien et lentement, prend les deux pans de son t-shirt et le déchire de haut en bas.
Elle empoigne alors ses seins à deux mains avec le soutien-gorge de dentelle bleu pâle, comme une offrande, et s’approche de moi. Je ressens sa respiration légèrement accélérée sur mon visage et mon cou. Je me fige, ému par ce brusque changement d’attitude, mon cœur aussi s’est emballé dans ce jeu de course-poursuite.
Sa main droite lâche le sein pour me prendre par le cou, elle approche ses lèvres des miennes, je ne ressens aucune impudeur à me laisser faire par cette fille de dix-sept ans.
Nous basculons sur le lit, elle me chevauche. Je l’enlace, lui caresse le dos, je suis bien. Puis elle se redresse, et d’un geste naturel, elle dégrafe son DIM et laisse tomber sur mon abdomen le frêle morceau de tissu. Elle est belle, elle s’offre à moi.
— Allez ça suffit maintenant, rhabille-toi, fini de jouer !
Je m’entends prononcer ces mots sans avoir conscience d’avoir voulu les dire. Julia me regarde en rougissant, se lève brusquement et part en courant vers sa chambre.
Quelle réaction idiote j’ai eue ! Je suis allé par trois fois frapper à la porte de sa chambre, sans oser entrer.
Je ne l’ai revue qu’à l’heure du dîner. Elle est pâle, ses yeux rougis sont la preuve de ma muflerie. J’aurais pu lui dire autrement, en douceur ou avec un peu d’ironie, mais pas en la jetant comme si ce jeu n’avait pas d’importance pour elle.
— Je suis désolé mais tu comprends, ce n’était pas…
Elle ne lève pas le nez de son assiette et me répond sèchement :
— C’est bon, c’était une connerie, n’en parlons plus.
— Tu es sûre ? Bon tant mieux si tu le prends… bien. Mais tu sais, si tu n’étais pas la fille de Marcel, la sœur de mes potes et que tu n’avais pas dix-sept ans, tu es très attirante et…
— C’est bon je t’ai dit, on passe à autre chose ?
Je cherche à me rassurer en pensant qu’elle a vraiment l’air de bien le prendre. À la fin du dîner, elle rompt le silence qui s’est installé :
— Dis-moi plutôt ce que tu veux pour dîner demain ?
— Eh ben, on va se faire un repas de fête. Foie gras, prends-le à Monoprix, du canard, celui entier, du sud-ouest. Puis une pintade, des morilles et une boîte de truffes. Un fromage de brebis truffé et à l’huile d’olive, au fromager de la rue d’Alésia. Le dessert, je laisse ça à ton feeling.
Julia me regarde en écarquillant ses grands yeux verts. J’ajoute :
— Et un champagne aussi, chez le fromager ils ont un Pommery délicieux. Tiens prends 300 euros.
— Ouah ! C’est la fête alors ?
— Je te dois bien ça, pour me faire pardonner.
Ça me vaut une bise sur la joue et un regard malicieux.
— Je vais te dresser une table de fête et te préparer le repas. Je suis une excellente cuisinière tu sais.
Comme pour me dire : « tu vas voir comme tu vas regretter de m’avoir rejetée ». Puis elle prononça une phrase qui me sembla anodine :
— Mais ne rentre pas avant vingt heures !
***