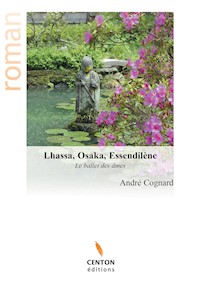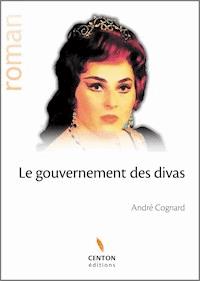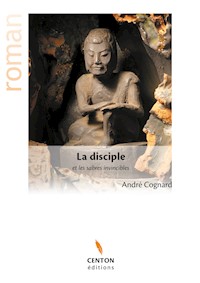
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Centon éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
A travers le récit d'une aventure intérieure, partez à la découverte de la philosophie particulière qui accompagne la pratique de l’aïkido et des arts martiaux.
Dans cet ouvrage, André Cognard prête vie à Alan Vilfort, son double imaginaire, pour inviter le lecteur à découvrir la philosophie particulière qui accompagne la pratique de l’aïkido et des arts martiaux. Le parcours de la jeune Akiko, qu’Alan a pris sous son aile, en devient l’emblème : parviendra-t-elle à surmonter la douleur mortifère de ses ancêtres, celle qui ronge son âme et son envie de vivre ? Les arts martiaux lui ouvriront-ils la porte de la guérison et de l’harmonie ?
La disciple et les sabres invincibles d'André Cognard, nous transporte dans une aventure intérieure où le corps et l'esprit ne font plus qu'un et où les préceptes bouddhistes sont mis en avant. Ce roman, qui est aussi une ode au Japon et à sa culture, se lit comme un manifeste en faveur de la conscience du monde et du passé. Les souffrances morales survivent bien après la disparition physique des êtres et se transmettent de génération en génération. Un long chemin vers la compréhension et l’acceptation fera naître la délivrance, et avec elle la promesse d’une vie meilleure. Un message profond et fort d’espoir.
Plongez dans ce roman fort et profond et suivez le parcours d'Alan Vilfort : un long chemin vers la compréhension et l’acceptation qui fera naître la délivrance, et avec elle la promesse d’une vie meilleure.
À PROPOS DE L'AUTEUR
André Cognard est né le 25 mars 1954 à Feurs (Loire). Il débute dès l'enfance la pratique quotidienne du Judo, de l’Aïkido et du Karaté. Encore adolescent, il enseigne l’Aïkido à plusieurs groupes d’adultes. Sa passion pour les arts martiaux est néanmoins restée insatisfaite jusqu’à la rencontre, en 1973, avec son maître, Kobayashi Hirokazu. Ce dernier fut disciple du fondateur de l’aikido moderne, Ueshiba Morihei. André Cognard suit l’enseignement de l’homme qu’il reconnaît comme son maître jusqu’à la mort de celui-ci, en 1998. Conformément à la tradition martiale japonaise, l’aikido lui est transmis du corps au corps, de l’esprit à l’esprit. “…Ce qui m’a donné l’envie de pratiquer chez cet homme, c’est sa cohérence. Il incarnait ce qu’il disait. Il vivait l’harmonie de l’aikido au quotidien. Sa gestuelle était d’une esthétique extraordinaire qui rendait compte d’une éthique profondément humaniste. Ce qui de l’enseignement n’était pas donné par le geste passait par le silence. C’était ce que je recherchais depuis si longtemps. Je n’avais aucun doute sur ma décision ”. André Cognard s’imprègne très vite de la culture japonaise : il en apprend, au cours de ses nombreux voyages, très rapidement la langue, les usages. Dix années de pratiques incessantes auprès de Kobayashi Hirokazu lui permettent de devenir son élève, dix autres font de lui son disciple et encore cinq, son successeur.
Il a fondé un dojo à Bourg-Argental qui est le centre de formation des enseignants de Kobayashi Ryu Aikido pour l’Europe. Ce dojo est reconnu par l’État japonais, non seulement en tant que dojo officiel, par la Dai Nippon Butoku Kai (organisation mondiale des arts martiaux traditionnels japonais sous l’égide de la famille impériale), mais aussi comme centre interculturel franco-japonais par l’intermédiaire de l’Ambassade du Japon. La Dai Nippon Butoku Kai a délivré à André Cognard le titre de Hanshi, le titre le plus élevé dans la hiérarchie des samouraïs.
Auteur de nombreux livres édités chez Albin Michel, Dervy, Varianti Editore (Italie), il contribue régulièrement à la rédaction d'articles pour diverses revues.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La disciple et les sabres invincibles
A Thibault, Doriane et Mélisande,
pour qu’ils sentent que rien ne peut conditionner l’amour d’un père.
Un immense merci à Hélène Pico pour la précieuse attention et l'infinie
bienveillance avec laquelle elle s'est penchée sur ce texte.
Merci aussi à mon épouse pour sa présence indispensable et si encourageante.
Avertissement
Vouloir dire la réalité, c’est vouloir imposer son point de vue. La réalité se trouve dans ce partage entre la scène de nos représentations et celles des autres.
Croire qu’il existe une seule réalité, c’est se perdre dans son imaginaire. Le roman, parce qu’il s’inscrit d’emblée dans la fiction, mêle les scènes communément acceptées comme vraies et d’autres plus personnelles. Il est donc le plus à même de dire la réalité parce qu’il laisse chacun libre de définir ce qui est vrai dans le récit, et qu’en ce sens, il autorise l’auteur à une sincérité inaccessible avec toute forme d’exposé didactique.
Il ne faut cependant pas oublier que son premier but est la récréation. C’est pourquoi le romancier doit faire de la vérité une allégorie et de la réalité une image.
Les armes et les larmes
Les bombardements n’avaient pas cessé depuis quatre jours. Chaque nuit était venu un moment de terreur puis de désolation. Il y avait le bruit des avions qui annonçait que l’horreur allait reprendre, les sirènes et les cris de peur, les explosions et les effondrements, puis le silence percé de temps à autre par des pleurs retenus. La population était épuisée par la faim, par la mort qui rodait et frappait n’importe où, par l’impossibilité d’espérer un quelconque changement si ce n’est pour pire encore.
Ichikawa Sayori avait passé sa journée à chercher un moyen de se procurer de la nourriture pour ses deux enfants. Depuis qu’elle avait appris que son mari avait été tué, elle ne vivait plus que pour eux. Yukiko était une petite fille de huit ans, mignonne, intelligente et elle arrivait encore à manifester de la gaieté malgré la faim et la peur qui ne leur laissaient jamais de répit. Le petit Kasuo s’était renfermé. Il souffrait trop et rien ne parvenait à le dérider, pas même les incessantes tentatives de sa grande sœur pour l’entraîner dans des jeux auxquels il ne parvenait plus à s’intéresser. Il avait trois ans, trois années vécues sans jamais avoir vu son père, trois années avec une mère terrassée par l’angoisse et le chagrin, trois années de tristesse et d’errance. Leur maison avait été détruite par un incendie provoqué par le bombardement du quartier. Ils étaient alors partis habiter chez leur grand-mère et celle-ci était morte peu après leur arrivée.
Kasuo sentait confusément qu’elle était morte de chagrin et d’épuisement.
Sayori s’apprêtait à partager entre les deux enfants le peu de riz qu’elle avait pu trouver quand le vrombissement des moteurs se fit entendre. Ils devaient encore être loin, probablement entre Kyushu et Hiroshima. Ils arrivaient toujours par le sud. Les sirènes ne tardèrent pas à retentir. Elle prépara quelques vêtements chauds et demanda aux enfants de se dépêcher. Ils avalèrent à toute vitesse les boulettes de riz qu’elle venait de leur donner puis sortirent pour se rendre à l’abri. Sayori comprit soudain que quelque chose venait de changer dans le rituel de chaque soir. Les avions étaient déjà là et commençaient leur sinistre besogne. Elle songea que le vent soufflait du nord au sud et qu’il était particulièrement fort. Elle avait eu tort de croire qu’ils étaient loin. Le vacarme infernal avait déjà pris possession du ciel, de la ville et de leurs consciences.
Kasuo marchait aussi vite que ses petites jambes le lui permettaient, tiré par Yukiko. Leur mère les exhortait à aller plus vite. Des gens couraient partout autour d’eux, affolés. On entendait des voix dire des phrases qui n’arrivaient que par bribes, comme si elles avaient été brisées par les explosions. Yukiko entendit vaguement qu’il y avait le feu mais elle ne sut pas où. Elle comprit en tournant au coin de la rue où se trouvait l’abri qu’ils ne pourraient pas y aller. Tout le quartier brûlait. Sayori fit demi-tour, entraînant ses enfants avec elle. Ils virent les restes du grand magasin où ils allaient autrefois, quand la vie le permettait encore, acheter de quoi s’habiller ou aménager leur maison. Sayori pensa qu’il devait y avoir un sous-sol et tenta d’y entrer. Kasuo était terrorisé. Elle se rendit vite compte que même si ce sous-sol existait, ils n’en trouveraient pas l’accès au milieu de ces décombres.
Elle voulut repartir au moment même ou une bombe finit de déchiqueter les quelques murs qui étaient restés debout. Yukiko hurla. Kasuo était tombé, écrasé par une montagne de béton. Sayori se précipita, tentant de soulever des blocs qui pesaient des tonnes, Yukiko criait sa détresse. Elles appelèrent à l’aide en vain. Elles ne voyaient pas où se trouvait le petit garçon. Elles l’appelaient mais n’obtenaient pas de réponse.
Après une heure d’efforts surhumains, Sayori tomba d’épuisement et se mit à sangloter. C’est alors qu’une deuxième vague de bombardiers se mit à pilonner le secteur. Sayori eut un sursaut et prit Yukiko par la main et la tira malgré sa résistance. Elle ne voulait pas partir sans Kasuo. Mais Sayori voulait à présent tenter de mettre sa fille à l’abri. Si elle avait été seule, elle serait restée là, espérant être tuée au plus vite. Yukiko sanglotait, appelait désespérément son petit frère, grattant furieusement le sol avec ses pauvres mains. Sayori l’arracha à cette tâche insurmontable et la tira encore. Yukiko marchait à reculons, tendant la main vers le lieu où elle pensait que Kasuo était prisonnier. Sayori lui dit qu’il n’y avait plus rien à faire, qu’il était forcément mort, écrasé par l’effondrement. Yukiko se battit encore, criant qu’il ne pouvait pas être mort.
Kasuo ne sentait plus ses membres. Il voulait mais ne pouvait pas appeler. Son visage était couvert de poussière et sa bouche ne s’ouvrait pas. Il apercevait sa sœur et sa mère par un interstice. Il les vit abandonner et partir, Yukiko tendant vers lui une main tordue par la douleur. Il ferma les yeux et sentit son corps flotter au-dessus de la ville ravagée. Quand les bombardements eurent cessé, on organisa des recherches qui furent infructueuses. On manquait de moyens. On ne pouvait pas déblayer les tonnes de gravats. Dès le lendemain, on abandonna. Les avions allaient revenir et il fallait tenter de garder en vie ceux qui n’étaient pas morts cette fois là. Chacun se sentait en sursis .
Après la guerre, Yukiko réussit à louer une petite maison, juste en face de l’endroit où elle avait vu son petit frère pour la dernière fois. Elle ne se maria pas. Elle ne pouvait pas s’autoriser à vivre. Elle fut hantée constamment par la vision de ce moment d’horreur jusqu’à sa propre mort. Elle ferma enfin les yeux peu après le départ de sa mère et pour la première fois, ne vit plus ce trou vers lequel sa main était restée tendue toute sa vie.
Alan Vilfort n’avait jamais cessé d’aller au Japon après la mort de son maître. Dix ans étaient passés, rythmés par des allers-retours constants entre la France et ce pays où reposait désormais Omori Sensei.
Passé le premier choc, il avait vécu cette disparition avec une relative distance, du moins le croyait-il. Puis, il avait eu le sentiment que le Japon s’éloignait de lui et il en avait profondément souffert. Il se sentait amputé d’une partie de lui-même et il ne pensait son « je » que comme handicapé, boiteux, incomplet. Toute cette période passée avec Omori Sensei ne lui avait guère laissé loisir de faire autre chose que suivre le maître, être son disciple avec la fougue qui le caractérisait, avec cet enthousiasme qui lui avait permis de passer maintes épreuves, avec cette passion qui avait fait de cette relation initiatique l’unique but de sa vie. Le maître mort, il avait compris qu’il n’avait tissé aucun lien véritable avec les élèves japonais, que tout son Japon passait par le maître et qu’il se trouvait là-bas comme un étranger. Il avait compris aussi que le lien avec ce pays, son pays disait-il parfois intérieurement, lui était absolument indispensable. Cette part de Japon en lui était vitale. Dès qu’il restait quinze jours sans parler Japonais, il souffrait d’une sensation de manque, il en concevait une véritable angoisse. Et puis cette mort avait laissé ce vide béant que rien ne pouvait emplir. La relation avec le maître avait duré vingt-cinq années pendant lesquelles elle avait occupé tout son temps. Il lui avait fallu réapprendre à vivre seul, retrouver cette solitude qui avait été l’histoire de toute son enfance, quand nul ne comprenait ses aspirations ni ses projets à tel point qu’il avait dû les taire.
Il avait tardé à prendre conscience de cela et avait failli y laisser sa vie. Un accident de voiture, terrible fracas de bruit de feu et d’os, avait fait de sa jambe un pense-bête, un « souviens-toi » impitoyable qui l’avait rendu conforme à ce je bancal qui lui servait d’identité. L’abîme schizoïde s’était refermé au fur et à mesure que les fractures se réparaient. Tous les jours de sa vie, il enseignait et chaque geste était devenu un curieux mélange de souffrance, de défi et de mémoire.
Les règles de la vie étaient strictes et l’on ne pouvait faire appel aux mémoires karmiques autant qu’Alan et son maître l’avaient fait ensemble sans en payer le prix. Ce prix, c’était de faire vivre en soi l’autre intérieur, et coupé des moyens nécessaires, malgré tous ses efforts pour s’unir au Japon par le peu de relations qui lui restaient, Alan avait dû payer le prix dans son corps. Il y avait bien longtemps que le maître l’avait prévenu. Il lui disait souvent : « Nous allons trop vite mais je suis pressé. Un jour viendra où vous connaîtrez un retour d’énergie et ce jour là, vous vous souviendrez de ce que signifie survivre. Je n’ai ni le temps ni la vocation de vous apprendre à vivre. Je ne peux que vous enseigner à survivre. Vous devrez faire le reste seul. » Les paroles du maître lui paraissaient alors bien mystérieuses mais aujourd’hui, il comprenait que le maître avait déjà vu bien au-delà de sa mort et qu’il savait que son disciple devrait recréer une autre fois les liens indispensables à sa vie.
Il enseignait à présent ce que signifie survivre à sa conception et la manière dont on importe les souvenirs du lointain passé pour se préserver, pour vivre malgré une conception manquant de conscience spirituelle. Il savait comment cet apport était chargé de ce que l’on ne voudrait pas amener avec soi, et il voyait chacun portant son lot de bonno, ces fantômes qui engendraient autant de devoirs spirituels. La douleur de sa jambe l’obligeait à cette modération dont il n’avait jamais été capable auparavant, qui manquait terriblement dans l’enseignement de son maître, l’homme qui était déjà mort à l’adolescence. Il savait qu’il avait inconsciemment emprunté à son maître ce pied avec lequel il marchait à présent, que c’était là une manière de retenir son cadavre et de prolonger ce corps à corps qui avait été leur relation. Une partie du maître mort restait avec lui et faisait vivre son autre intérieur.
A présent, il était plus à l’écoute de la souffrance des autres, il était mieux compris par les élèves, et, en particulier, par les élèves japonais. Il était peu affecté par ses douleurs. Il mesurait à quel point le maître avait eu raison de dire qu’un jour il y aurait retour d’énergie et à quel point, Omori Sensei avait été intransigeant et follement exigeant de le conduire jusque-là. Alan Vilfort ne savait encore quel adjectif attribuer à cet aspect de leur relation. Il arrivait parfois à se réjouir d’avoir en lui cet instrument de mesure de la souffrance des autres, et ce rappel à l’ordre constant sans lequel il aurait été lui aussi un maître sans limite.
Le Japon lui avait tant donné et l’avait tant aidé à entendre son vrai moi qu’il ne se souciait à présent que d’accomplir son devoir. Et il n’y avait qu’une manière de le faire : utiliser son savoir pour aider les autres, et répondre à cette injonction d’Omori Sensei, la seule qu’il lui ait jamais faite : « Si vous n’allez pas au Japon enseigner mon aikido, il y disparaîtra. Vous verrez un jour les Japonais qui voudront apprendre mon aikido venir le faire en France ». Alan Vilfort avait longtemps écouté ces paroles comme une flatterie et s’en était méfié. Le maître ne disait-il pas : « Si tu veux affaiblir ton ennemi, fais son éloge, si tu veux le tuer flatte-le ». Alan Vilfort n’avait jamais pensé que son maître lui voulait du mal mais il avait imaginé qu’il y avait là un de ces fameux pièges dont il était coutumier et qu’il y avait lieu d’être très prudent. Jamais il n’avait été en mesure d’imaginer ce qui se passait aujourd’hui.
L’avion avait commencé la procédure d’approche du Kansai Kuko et Alan Vilfort suivait de manière automatique le déroulement de celle-ci. Il comprit que le pilote avait intercepté le glide et que l’atterrissage était imminent. Pour suivre son maître au delà de la mort, pour se rapprocher de lui, il était devenu pilote. Le maître était un ancien pilote. A présent il ne quittait plus le ciel et en volant à son tour, Alan Vilfort avait le sentiment de retrouver des sensations, des impressions que le maître avait vécues. Il explorait ce monde que le maître connaissait et puis, il compensait, il palliait ce qui lui manquait terriblement depuis la mort d’Omori Sensei, les chutes. Les chutes permettaient de voler, d’être en l’air, de se remémorer dans l’intimité de la conscience profonde ce vol qui conduit d’une vie à une autre. Monter en avion, c’était refaire l’expérience du bardo, de la vie désincarnée et cela lui était nécessaire. Il voulait se remémorer toutes ses expériences pour comprendre comment lui et le maître étaient liés de manière à être en mesure de tenir sa promesse, le retrouver dans sa prochaine incarnation. Les chutes lui avaient fait cruellement défaut jusqu’à ce qu’il monte aux commandes d’un avion. Puis, il avait pris conscience de l’aspect sombre de cette recherche, de son ambiguïté. Il avait saisi son désir enfoui de remplir la mission que son maître n’avait pas pu accomplir. Tout au long de leur relation, il avait entendu ce récit du départ tant attendu. Et puis la nouvelle était tombée. Il n’y avait plus aucun avion. Il ne partirait pas. Suivait alors toujours le même récit du retour dépité, la guerre finie et du désespoir qui l’avait suivi. Toute sa vie, le maître avait vécu cela comme une humiliation. Il avait donné sa vie pour le Japon et le Japon ne l’avait pas prise. Et puis un jour, Alan Vilfort projeté pour la troisième fois contre la verrière du Cirrus avec une violence inouïe, comprit ce qu’il faisait à proximité de ce cumulonimbus, pourquoi il était venu là sciemment au beau milieu d’un orage, là où personne ne songerait à voler. Il se vit kamikaze anachronique exerçant une loyauté excessive, plongeant vers la mort pour ne plus entendre ces cris de souffrance que le maître avait poussés dans son sommeil chaque nuit pendant tout le reste de ce qui n’était que sa survie.
Le maître était un enseignant d’outre-tombe et cela lui conférait une force exceptionnelle. Il n’avait jamais peur. Il ne risquait rien car il était déjà mort en 1945 dans une de ces missions qu’il avait vues en rêve des milliers de fois. Alan Vilfort avait alors pensé aux siens, à son fils tout petit et il avait fait prudemment demi-tour et rejoint, non sans peine la base. Il avait posé le Cirrus malgré les turbulences infernales en finale et il n’avait repris son souffle qu’au parking, moteur arrêté. Il avait revu alors les nombreux vols qu’il avait effectués au cours desquels aucun risque n’était de trop. Les éléments déchaînés s’entendaient alors pour démontrer que seule la fatalité avait raison des hommes et de leur vie. Et puis, il avait aussi revu ces moments où sans raison objective, il s’accrochait aux commandes comme s’il y avait un danger imminent alors que rien ne perturbait objectivement la manœuvre d’atterrissage. Le danger était bien là, tapi en lui. Le danger, c’était lui et son désir morbide. Il décida alors de voler pour son plaisir, pour ce bonheur d’être là-haut et de contempler la vie, pour la liberté, pour l’amour de la vie. Plus jamais, il ne poursuivrait Omori Sensei dans la tombe. Et il prit ainsi conscience de ce que ce partage de gestes quotidiens, ce corps à corps qu’imposait la pratique avait mêlé les chairs, avait créé des espaces de signes et de sentiments communs et que le maître s’était en allé avec une partie du corps du disciple. Bien sûr la séparation des consciences s’était faite. Ils avaient parlé ensemble de sa mort, ils avaient envisagé le futur en son absence, ils avaient commencé le deuil mais ils n’avaient pas eu le temps de défaire certains de ces liens si profonds, si intenses et si inconscients. Alan Vilfort n’avait pas vu partir la moitié de soi avec le cadavre du maître réduit en cendres et il avait souffert de ce manque, de ce vide, plus qu’il ne l’aurait jamais imaginé.
Il savait maintenant que son accident avait eu pour objet de recréer avec le Japon les relations spirituelles mais aussi matérielles qui étaient indispensables à sa survie. Le maître était parti avec sa moitié japonaise et Alan Vilfort avait dû se reconcevoir, et cela imposait bien sûr de faire l’expérience de sa propre mort. A présent, il savait lire sur le corps des autres ces deuils qui n’en finissent jamais, ces épaules qui partent derrière le corps pour suivre un parent mort et il éprouvait une forte compassion pour ces êtres dont il connaissait les souffrances. Et puis les promesses du maître se réalisaient. Un jour, celui-ci avait demandé à Alan : « Que ferez-vous quand je serai mort ? » Sans hésiter, Alan avait répondu qu’il continuerait le travail seul. Omori Sensei avait alors demandé : « N’aurez-vous pas besoin d’un autre maître ? » Et Alan s’était entendu répondre : « Si vous mourez, cela signifiera que je n’ai plus besoin de maître. Certes j’ai l’impression de ne pas avoir tout ce dont j’ai besoin pour assumer seul l’enseignement mais je ne peux envisager les choses autrement. » Alors le maître avait dit cette phrase qui aujourd’hui s’avérait : « Il ne vous manquera rien. Ce que vous ne savez pas encore, je l’ai déjà mis à l’intérieur de vous et quand vous en aurez besoin, vous le trouverez là, prêt à servir. »
L’airbus A340 de la Lufthansa venait de toucher la piste du Kansai Kuko. Son pays était là, sous le ventre de l’avion. Il allait bientôt retrouver cette heureuse sensation de revenir chez les siens, ce peuple merveilleux empreint de politesse, d’attention aux autres. Il allait revoir ses élèves japonais, enthousiastes, passionnés par l’étude de ce qui était leur tradition et qu’ils disaient avoir presque perdue. Alan Vilfort s’interrogeait encore sur sa position qui consistait à enseigner à des gens ce qui constituait de leur point de vue comme du sien la substance de leur identité, l’âme japonaise comme il se plaisait à dire.
Cette fois, à sa mission d’enseignement s’en ajoutait une autre passionnante. Il se l’était assignée lui-même. Trente années étaient passées depuis le jour où Omori Sensei lui avait offert un boken en chêne blanc, une arme exceptionnelle, légère et équilibrée. Cette arme, il l‘avait utilisée constamment et les sensations qu’elle lui avait procurées avaient peu à peu remodelé sa pratique du sabre. Aujourd’hui, il ressentait le besoin de faire partager à ses disciples ce monde de sensations exceptionnel où les champs spatiotemporels s’interpénètrent, où l’impossible à croire se produit couramment, où l’invisible rencontre la rationalité. Mais, eux ne possédaient pas l’arme adaptée et les vulgaires sabres de bois qu’ils utilisaient ne leur permettaient pas d’accéder à cette gestuelle complexe qu’était l’aikiken d’Omori Sensei. Il s’était donc mis en tête de retrouver celui qui avait conçu cette arme et de lui demander d’en fabriquer d’identiques pour ses disciples. Ne possédant aucune information sur la provenance de l’arme, la recherche pouvait être longue et infructueuse, mais, comme pour tout ce qu’il entreprenait, il était déterminé à aller jusqu’au bout.
Les contrôles de passeport allaient vite, malgré les nouvelles dispositions antiterroristes. Alan Vilfort détestait cette façon qu’avait encore le gouvernement japonais de faire allégeance aux Etats-Unis et d’adopter leurs méthodes. Cela détruisait ce qu’il y avait de mieux au Japon. Tout le pays en devenait malade, de mauvaise nourriture, de mauvaises attitudes, de modes vestimentaires hideuses. Le Japon se détruisait en s’américanisant. La culpabilité cultivée, inculquée après la guerre , conduisait à cette autodestruction lente. Alan Vilfort voulait lutter contre cela. Tous ses efforts pour témoigner aux Japonais de la valeur, de la légitimité de leur culture d’avant, celle qu’il avait reçue directement d’Omori Sensei, celle que celui-ci avait reçue d’Aki no Kure Sensei, l’homme de Meiji, lui semblaient vains devant cette machine à obéir aux Américains.
Il pestait intérieurement quand il sortit de l’aéroport. Il se dirigea vers un taxi. Il aimait ce moment où il allait en taxi jusqu’à Izumisano pour prendre une voiture de location. Le taxi s’engageait sur le pont qui reliait le Kansai Kuko à la terre ferme. La vue sur la mer et la terre était splendide et puis, il y avait cette sensation de n’être ni sur l’une ni sur l’autre. Cela évoquait le Yurerubashi, le pont flottant à partir duquel les kami avaient créé le monde. C’était aussi pour Alan Vilfort une passerelle jetée entre ses deux mondes. Le soleil éclairait cet espace avec soin, l’eau reflétait sa lumière à l’infini, comme si celle-ci n’éclairait rien qu’elle-même. Alan Vilfort regardait les collines qui encerclaient Izumisano et limitaient l’expansion d’Osaka vers l’est et le sud. Il connaissait très bien ces régions du Nara - ken, du Mie - ken et du Wakayama - ken. Il les avait souvent parcourues avec Omori Sensei, allant d’un gashoku à un autre puis il s’était résolu à les parcourir seul et enfin à y conduire ses élèves.
A présent, il n’éprouvait plus de tristesse à l’évocation de ces moments partagés avec le maître. Il avait même un certain plaisir à se remémorer leurs passages ici ou là et à raconter les anecdotes liées aux lieux visités.
Il aurait probablement gagné du temps en prenant la kenawa mais il aimait bien suivre la wangan. Cette autoroute entièrement construite sur des ponts posés dans la mer offrait un point de vue étonnant sur la baie d’Osaka. Il allait devoir traverser toute la zone industrielle, le port pétrolier. C’était aussi laid que le sont toutes ces zones dans le monde. Cependant, celle-là traduisait bien cette manière propre aux Japonais de ne pas cacher la laideur mais de lui opposer de la beauté par le soin des moindres détails. Les ponts jetés par-dessus ces horreurs étaient beaux, tous différents, et les voitures et les camions les empruntant, tous rutilants, étincelaient, participant à la beauté en mêlant leurs reflets à ceux de la mer.
C’était une forme d’humilité pour Alan Vilfort que d’arriver par là, une façon de dire : « D’accord, je vous le concède, tout le Japon n’est pas que ce joyau, cette merveille devant laquelle tous tombent en extase, mais … presque . » Le Japon était tellement sien qu’il sentait devoir s’associer à l’humilité des Japonais pour en parler. Il y avait peu de circulation et il eut tôt fait de rejoindre le centre d’Osaka.
Son premier objectif était de trouver l’ancien atelier d’un ami d’Omori Sensei. Il se souvenait un peu des lieux, un bâtiment bas au fond d’une courette près de la gare de Tennōji. Il n’avait aucune idée de l’adresse et était bien conscient que son souvenir de la seule visite faite trente ans avant pouvait différer singulièrement de la réalité d’aujourd’hui. Et puis il y avait le risque que le lieu ait été détruit, remplacé par un immeuble de trente étages. Mais il avait confiance dans ses intuitions. Il croyait vaguement que cet atelier n’était pas bien loin de la route 26 par laquelle ils allaient fréquemment à Wakayama. « Oui, c’est cela, une parallèle de la 26 » se dit-il alors qu’il passait devant la gare de Tennōji.
Osaka évoluait très vite mais une partie de la ville semblait immuable. Il aimait retrouver des lieux qui lui étaient chers parce qu’ils évoquaient immanquablement pour lui ces moments de partage avec Omori Sensei. Ainsi, il avait toujours un plaisir certain à s’engager dans Honmachi, à passer par Tondayabashi, à s’engager dans le Sakai suji ou à retrouver Osaka Shinmichi. Ce qu’il aimait, c’était ce qui ne changeait pas, le squelette de la ville autour duquel tout semblait en mouvement.
Il avait largement dépassé le quartier dans lequel il croyait trouver ce fameux atelier. Il décida de faire demi-tour. Après une heure de vaines recherches, il aperçut soudain un kisaten et ce fut le flash-back immédiat. Il se revit avec Sensei, prenant un café à cet endroit en attendant cet homme qu’il cherchait à présent. En même temps, il se souvint de son visage et prit conscience de ce qu’à cette époque, il était déjà âgé, probablement septuagénaire. Il aurait cent ans aujourd’hui. Alan Vilfort gara la voiture et rejoignit le kisaten.
Ces lieux étaient tous semblables. Chaque fois qu’il en poussait la porte, il était transporté trente ans en arrière. C’était inchangé, vieillot, désuet et le clinquant de l’époque qui consistait à imiter ce que les Japonais des années soixante-dix croyaient être l’occident vieillissait très mal. Les cafetières à siphon trônaient sur le comptoir, exposant au regard des clients un café douteux à la robe claire, « un café branlant aurait-on dit chez lui, en Forez » pensa Alan Vilfort. Et puis il y avait l’odeur de café bouilli. Les Japonais avaient dû s’habituer à ce goût infâme avant de savoir ce qu’était le café, avant d’avoir les moyens de venir en Europe. Et quand ils le purent, quand en groupes nombreux, ils se mirent en marche vers les capitales européennes, le mal était fait. Il était trop tard pour rectifier le tir, le mauvais goût était installé, inspiré de l’Amérique, mémoire surannée de l’immédiat après-guerre où ces établissements étaient nés pour servir les occupants, répondre à leurs mauvaises manières. Ces kisaten étaient des cicatrices de cette douloureuse période qui ne disparaîtraient jamais complètement.
La patronne illustrait parfaitement l’ambiance de ces lieux, un visage renfrogné portant les marques d’un long parcours éthylique, avec des airs de tenancière de bordel, une mama-san à la voix éraillée par le terrible mélange alcool - tabac. Elle le salua avec un sourire carnivore, le dévisageant ostensiblement. Elle incarnait cette infime partie du Japon qu’Alan Vilfort avait toujours détestée, une vulgarité qui se voulait, qui s’imaginait occidentale. Oublié le raffinement extrême de la culture japonaise, réduite à néant la politesse attentionnée, l’objectif était d’être vulgaire pour avoir l’air d’appartenir à ce monde moderne qui était arrivé par effraction. Ces attitudes validaient, légitimaient la bombe et ses atrocités et cela Alan Vilfort ne pouvait pas le supporter. Il songea avec attendrissement au fameux proverbe que son maître citait chaque fois qu’il en avait l’occasion : « Il n’y a que les mauvaises femmes qui font du bon café . » Oui, les Japonais avaient découvert le café dans ces lieux destinés aux soldats américains, à l’occupant. Il répondit sèchement, en dialecte de Shinsaibashi, à la tentative de la mama-san d’utiliser l’anglais et demanda un café. Il savait déjà qu’il serait mauvais mais ce qu’il voulait goûter, c’était le passé. Le patron sortit du réduit dans lequel il préparait les commandes de jus de fruits ou de pâtisseries occidentales. Alan Vilfort décida de le questionner. « Sauriez-vous s’il vous plaît me dire si l’atelier de monsieur Meijin existe encore ? »
L’homme hésita avant de répondre. Bien sûr, voyant la couleur de peau de son interlocuteur, il tenta de répondre dans un anglais incompréhensible.
C’était un vrai drame, cette idée que les Américains avaient ancrée dans les têtes japonaises. Ne pas parler américain, c’est être un inculte, un moins que rien, un paria. Car il existe deux cultures au monde, la culture américaine et la sous-culture japonaise. Le monde entier parle américain. Combien de fois Alan Vilfort avait - il entendu que les langues européennes étaient des dialectes de l’américain. Cela l’exaspérait vraiment, d’une part parce qu’il parlait japonais sans la moindre hésitation, d’autre part parce que son maître avait toujours lutté contre cette hégémonie culturelle qui signifiait la défaite et l’humiliation qui l’avait suivie. Enfin, il venait au Japon par amour de ce pays et de son peuple, mais il avait envie de le voir fier et droit, libéré de toute culpabilité. Il aimait profondément la langue japonaise, si belle, si raffinée. Elle lui était nécessaire autant que l’air qu’il respirait. Quand le maître était mort, il avait été très vigilant pour ne pas perdre son vocabulaire. Il avait travaillé pour progresser par fidélité au maître. Parler japonais, c’était toujours parler avec lui.
Il avait l’habitude quand les Japonais lui parlaient américain de répondre en chinois, une manière de dire que si tout blanc parle américain, est américain, tout jaune est a priori chinois. Mais comme il était demandeur, il s’abstint et répéta sa question en japonais. Le tenancier reprit dans cette langue et lui dit que l’atelier était toujours là, dans la ruelle derrière, sous la direction du fils de monsieur Meijin. L’entreprise avait prospéré et l’actuel propriétaire avait ouvert des boutiques dans plusieurs quartiers d’Osaka et même à Tokyo.
Il paya son café et quitta l’établissement aussi vite que sa patte folle le lui permettait. Il eut tôt fait de retrouver l’atelier. Il reconnut les lieux qui avaient peu changé. Il fit coulisser la porte vitrée et salua poliment. Les employés, au nombre de quatre lui répondirent et l’un d’eux vint au devant de lui et s’inclina : « Bienvenue monsieur, puis-je vous être utile ? » Alan s’inclina à son tour : « Je voudrais rencontrer monsieur Meijin s’il vous plaît . » « Qui dois-je annoncer ? » « Alan Vilfort : je suis un disciple de feu Omori Sensei. » « Je vais vous annoncer . » Il se dirigea vers un bureau situé au fond de l’atelier. Alan Vilfort éprouvait un sentiment de satisfaction à voir que rien n’avait changé dans l’atelier. Les employés travaillaient comme autrefois à coudre des hakama à la main. Il s’attendait à voir sortir le vieil ami d’Omori Sensei mais l’homme qui s’avançait vers lui avait tout au plus soixante ans. Il s’inclina poliment en demandant : « En quoi puis-je vous être utile ? »
Alan raconta sa première visite avec Omori Sensei et expliqua la raison de sa venue. L’homme se souvenait très bien d’Omori Sensei qui était l’ami de son père. Puis il réfléchit et dit : « Je ne sais pas car mon père avait à l’époque plusieurs fournisseurs mais beaucoup ont disparu. On ne fabrique plus beaucoup de boken. Cela n’intéresse plus grand monde. Mais, si c’était un boken de grande qualité faisant l’objet d’une commande spéciale, il est probable que mon père se soit adressé à notre meilleur fabricant. Si tel est le cas, vous le retrouverez sans peine car nous ne travaillons aujourd’hui qu’avec lui. Puis-je voir l’arme ? » Alan Vilfort ouvrit l’étui qu’il portait et tendit le sabre à son interlocuteur. Celui-ci le prit en main et le manipula avec précaution : « Il est exceptionnel. Parfaitement droit, ce qui est rare. Les boken finissent toujours par se tordre. Enfin, cela dépend de la manière dont on les utilise. Et puis ce chêne est extraordinaire. Je vous dis tout de suite que l’on ne trouve plus de bois comme cela. Et cette manière de fabriquer ! On prend le cœur d’un arbre, il faut un arbre pour faire un seul boken. Cela ne se fait quasiment plus. Trop cher. Il est à vous ? » Alan Vilfort répondit affirmativement.
L’homme dit alors avec l’air admiratif : « Alors, vous êtes vraiment un disciple d’Omori Sensei. Je vais vous donner le numéro de téléphone de la personne la plus apte à vous aider. Il est un des derniers grands facteurs de boken. Il vient d’être distingué comme trésor national vivant et l’Empereur est venu chez lui en personne pour le décorer, voici trois mois. J’espère qu’il vous recevra. » Alan se confondit en remerciements. L’homme ajouta : « Il habite dans le Miyazaki-ken. C’est très loin d’ici. Vous comptez y aller ? » Alan Vilfort confia qu’il allait s’y rendre au plus tôt. « N’hésitez pas à dire que c’est moi qui vous ai envoyé vers lui. Cela facilitera probablement votre entrevue. » Alan remercia encore.
Quand il quitta l’atelier, il avait envie de chanter tellement il était heureux. Puis il douta. Le recevrait-il ? N’était-ce pas trop facile pour aboutir vraiment ? Trouver du premier coup ce qui semblait a priori introuvable, n’était-ce pas trop de chance ?
Il décida de faire la visite qu’il avait projetée à Yagyu-mura le jour même puis de se mettre en route pour le Miyazaki-ken dès le lendemain.
Alan Vilfort avait pris l’habitude de rendre visite à l’école de Yagyu Ryu depuis le jour où il y était allé avec Omori Sensei. Ce lieu l’attirait à plus d’un titre. Tout d’abord, il semblait fasciner Omori Sensei, ce qui était très important pour Alan. Le maître avait toujours des airs un peu mystérieux quand ils se rendaient là-bas. Aki no Kure Sensei avait appris le sabre dans cette école. Il avait fréquenté ce dojo si beau, chargé de l’histoire de la plus illustre famille de sabreurs du Japon. Le temple zen qui appartenait au dojo avait été fondé par Takuan lui-même, ce qui était déjà en soi un motif d’intérêt considérable. Et puis, Alan Vilfort ne pouvait s’empêcher de penser à ceux qu’il nommait les trois compères, Yagyu Munenori, Takuan et le shogun Tokugawa Iemitsu , complotant dans ce lieu et décidant en secret de la politique du Japon de l’époque. Enfin, les Yagyu avaient fourni tous les maîtres d’arme des shogun Tokugawa , presque trois cents ans d’instruction du sabre aux hommes les plus puissants du Japon. Pour un passionné de sabre comme lui, c’était là une raison suffisante pour y faire un pèlerinage régulier.
Il avait donc, dix années auparavant, décidé d’appliquer la vieille méthode japonaise, espérant qu’un jour les portes de ce lieu mythique s’ouvriraient devant sa détermination. Il s’y rendait deux fois par an pour saluer les gens qui habitaient le lieu, et s’incliner devant l’autel dédié à Munenori que le shinto et le bouddhisme avaient canonisé sous le nom de Tajima no Kami. Il se montrait très poli, respectueux du lieu, discret, ne demandait rien. Il venait pour saluer et ne faisait que cela.
C’était donc une de ces visites rituelles qu’il avait projetée de faire le jour de son arrivée au Japon. Il rejoignit sa voiture et partit vers le centre d’Osaka. Il allait prendre le temps de manger un kaiseki.
C’était là aussi un vrai rituel qui signifiait pour lui : « Je suis vraiment arrivé au Japon », une manière que son âme japonaise avait de souhaiter la bienvenue à son âme forézienne, une manière que l’adulte qu’il était devenu avait de reconnaître le bien fondé des rêves de Japon de l’enfant qu’il avait été. Cette nourriture lui manquait tellement quand il était en Europe. Aucun des restaurants dits japonais en Europe n’était capable de donner cette fraîcheur, cette élégance raffinée, cette sophistication à laquelle il s’était autrefois habitué en compagnie de son maître. Il allait communier avec lui et nourrir son âme comme celui-ci l’avait toujours préconisé. Il allait manger comme on fait une offrande.
Il pensa à un restaurant qu’il connaissait bien, dans le quartier d’Umeda. Il aimait passer par Umeda qui lui rappelait sa première arrivée au Japon. Il avait alors erré à la recherche d’un train partant pour Wakayama avant qu’on lui explique que cette destination était desservie depuis la gare de Tennōji. Repasser par Umeda, c’était refaire symboliquement le chemin du début, c’était marcher volontairement sur les traces de son errance.
Le kaiseki était excellent et il sortit de table avec la sensation attendue d’être enfin au Japon. La route jusqu’à Nara était facile, la circulation fluide. La petite route vers Yagyu-mura était peu fréquentée. Elle était bordée de cultures, de rizières, de jardins de thé et partout ailleurs, des forêts mêlaient épineux et bambous donnant un caractère sauvage à ce paysage qui contrastait violemment avec la mégalopole toute proche.
Il gara sa voiture comme à l’accoutumée, sur le petit parking au pied de la colline sur laquelle étaient implantés le temple et le dojo. C’était exactement l‘endroit où s’élevait autrefois la forteresse médiévale des Yagyu. Il emprunta l’escalier de pierre qui conduisait à la première plateforme. Le dojo était là. Il lui semblait immense et petit, élancé et ramassé sur lui-même, vieux et neuf à la fois. La toiture se tendait vers le ciel, inspirant un sentiment de solidité indestructible et d’élégance. Le toit d’un gris quasiment métallique contrastait avec les murs blancs et les volets à la peinture passée semblaient être dans cet état pour dire l’humilité, pour prévenir toute arrogance.
Alan ne voulait pas faire de démonstration ostentatoire mais il ne pouvait s’empêcher de s’incliner discrètement en passant devant le mur qui constituait l’arrière du dojo, et qui sur l’autre face, il le savait, portait le kamiza avec tous ses symboles. Il fit le geste discret qu’il avait l’habitude de faire, marchant avec la tête légèrement courbée puis entreprit de gravir l’escalier qui conduisait au temple. La cour était splendide, flanquée de pierres dressées et gravées évoquant les moments importants de l’histoire familiale. Des érables, un biwa, des cerisiers et des espèces végétales qu’Alan ne pouvait identifier embellissaient le lieu et contribuaient à créer une ambiance de recueillement qui frappait même le visiteur le moins attentif.
Comme chaque fois, Alan utilisait la cloche posée sur le bureau de l’entrée pour prévenir de sa présence. La préposée apparaissait alors et saluait. Alan répondant au salut demandait de manière rituelle l’autorisation d’entrer, formule qu’il faudrait traduire littéralement : « Puis-je monter vers l’intérieur ? » Ce à quoi l’employée le reconnaissant répondait favorablement avec le sourire et un « dozo » « je vous en prie » cordial.
Alan allait s’incliner devant les autels dédiés à Tajima no Kami, à Takuan et Tokugawa Iemitsu. Puis il passait quelques instants en méditation devant le jardin et repartait discrètement.
Chaque fois, en redescendant, il contournait le dojo pour venir devant l’entrée principale de celui-ci, puis faisant face au mur d’honneur qu’il imaginait à l’intérieur, s’inclinait. Il n’était jamais entré. Ensuite, il prenait l’escalier côté vallée pour rejoindre le chemin et quitter le lieu.
Ce jour là, arrivant presque au bas de l’escalier, il remarqua la présence d’une femme en train de balayer les feuilles devant un bâtiment destiné aux toilettes. Il fut frappé par la posture de cette personne. Son corps était puissant, plein d’énergie. Elle se mouvait souplement, faisant des gestes harmonieux et précis. Tout laissait voir une longue pratique des arts martiaux et un haut degré de maîtrise. Alan se dit qu’il n’avait jamais vu cette personne auparavant et se demanda les raisons de sa présence ici. Il était évident que ce n’était pas une femme de ménage comme les autres, puis se souvenant d’avoir rencontré une femme de ménage sur le chemin de l’école qui jouxte le temple, il fit le lien entre celle-là et la personne qu’il avait devant lui. Il comprit que la différence qui lui était apparue, et qui l’avait induit à croire qu’il voyait cette femme pour la première fois, tenait à ce qu’elle ne se savait pas observée.
Il en eut confirmation quand, se rendant compte soudain de sa présence, elle se redressa et reprit cette apparence qui faisait d’elle une femme de ménage anonyme. Elle demanda en souriant : « Puis-je vous aider ? »
Alan ne sut quoi dire. Il bredouilla des excuses, gêné de l’avoir observée à son insu. Elle sourit, d’un sourire qu’il qualifia de béat, mais d’une béatitude sans naïveté, une béatitude intelligente. Il se dit qu’il comprenait enfin le sens de ce mot. Cette femme portait tous les signes de la vivacité d’esprit, de la force et de la compassion. Alan se dit que si un humain pouvait incarner la bouddhéité, il venait de le rencontrer. Alors, il s’entendit dire une chose énorme, absolument inconvenante, comme si ses paroles lui échappaient : « Excusez-moi mais vous n’êtes pas une femme de ménage. Vous êtes une pratiquante d’arts martiaux chevronnée et vous descendez d’une grande famille très consciente de sa noblesse. »
Elle sembla étonnée puis répondit : « Voulez-vous visiter le dojo ? » Alan ne mit pas plus d’une seconde pour répondre avec un enthousiasme qu’il jugea aussitôt indécent : « Bien sûr ! J’aimerais beaucoup ! »
En silence, elle commença à gravir l’escalier, prenant en main un trousseau de clefs qui pendait à sa ceinture. Elle eut alors quelques paroles pour dire avec une déroutante simplicité qu’elle était bien ce qu’Alan avait vu.
Ils furent bientôt devant l’entrée du dojo et, c’est là qu’elle le regarda fixement dans les yeux en demandant : « Qu’est-ce qui vous a permis de voir que je ne suis pas réellement ce que je semble être ? » Alan hésita un instant sur la manière appropriée de répondre. Puis il dit : « Mon maître m’a enseigné comment observer les postures et comment les interpréter. Il m’a appris à y lire les traces des souffrances présentes et passées mais aussi à voir le karma. »