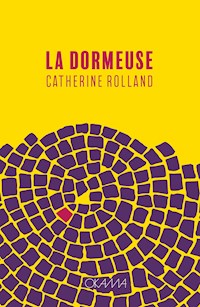
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Okama
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
En 1949, Marie, une fillette de cinq ans, échappe à la vigilance de ses parents et disparaît dans les ruines de Pompéi. Retrouvée six longues années plus tard, muette et choquée, elle ne racontera jamais ce qui lui est arrivé. À sa majorité, elle revient à Pompéi. Alors qu’elle explore une mystérieuse galerie, elle perd sans s’en rendre compte une de ses boucles d’oreille dans une bousculade... et la redécouvre avec ébahissement le lendemain, dans une des vitrines du musée archéologique de Naples, parmi d’autres antiquités vieilles de près de deux mille ans...
C’est le début d’un étourdissant voyage qui la conduira à Pompéi en l’an 79, à quelques jours de l’éruption du Vésuve. En 2017, après une carrière de romancière à succès, Marie s’est retirée du monde avec son mari Tiago, désorienté et excentrique. Devenue aveugle, elle engage Sofia afin qu’elle l’aide à écrire son ultime roman, dont l’intrigue se déroule étrangement en l’an 79 à Pompéi. Passé et présent s’entremêlent, pour dénouer le fil de destinées étrangement liées, à près de deux millénaires de distance...
À PROPOS DE L'AUTEURE
Médecin urgentiste à la ville, Catherine Rolland a écrit cinq romans : sagas familiales (Ceux d’en haut, Après l’estive), drames psychologiques (La solitude du pianiste, Sans lui) ou fiction aux frontières de l’imaginaire et du fantastique (Le cas singulier de Benjamin T., sélectionné pour le Prix Lettres frontière et pour le Prix Rosine Perrier en 2019). Elle a participé à l’anthologie de novellas L’étrange Nöel de Sir Thomas paru l’année passée.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Pour Guillaume, mon fils.
Septembre 2017
1
– Comment vous appelez-vous ?
– Sofia Loison.
– Quel âge avez-vous ?
– Quarante-neuf ans.
– Votre adresse ?
Docile, Sofia répondait, le ton aussi neutre que possible. Elle avait du mal à se contenir, pourtant, du mal à s’empêcher de lui crier à la figure qu’il n’avait qu’à lire son CV, posé en évidence sous son nez.
Son interlocuteur avait dans les vingt-deux, vingt-trois ans, au grand maximum. Brun, des yeux sombres, les cheveux disciplinés à grand renfort de gel sans contrôler pleinement les épis qui pointaient, seule exception à l’ordre parfait de l’ensemble. Costume impeccable et peau bronzée d’un séjour qu’elle imaginait lointain, les Maldives ou la Crète, destinations de carte postale qu’elle était bien sûre de ne jamais pouvoir s’offrir. Elle se concentra sur ses mains, son vernis à ongles posé à la va-vite pour cacher qu’elle les rongeait, le sillon de l’alliance trop longtemps portée, marque indélébile dont elle ignorait si un jour elle disparaîtrait. Il reportait sur son ordinateur des données mystérieuses, mais l’orientation de l’écran empêchait Sofia de lire ce qu’il écrivait. Il était appliqué, consciencieux. Je pourrais être sa mère, songea-t-elle. Sa mère, ou sa nounou, à l’époque où c’était encore son métier. Crisper les mâchoires, bloquer l’angoisse. Ce n’était pas le moment d’y penser.
Il ne disait plus rien. Finalement, elle aimait autant quand il lui posait des questions, même idiotes. Mal à l’aise, elle porta l’index à sa bouche et attaqua l’ongle, s’interrompant au goût du vernis sur sa langue. Sur son bureau, rangé avec soin, un petit panneau en laiton indiquait son nom, monsieur L. Jullien. Sofia se demandait à quoi le « L » correspondait. Louis, peut-être, ou Laurent. À l’évidence un prénom vieillot, passé de mode, celui d’un grand-oncle ou d’un ancêtre quelconque. Cela se faisait, dans les milieux bourgeois. Si elle avait osé, elle aurait posé la question, mais son regard un peu froid, au moment où il levait enfin le nez de son écran, lui rappela que c’était elle qui était là pour répondre aux siennes.
– Je lis ici que vous avez essentiellement une expérience professionnelle auprès de jeunes enfants, dit-il en tapotant le CV du bout de son index.
Elle acquiesça, consciente d’être sur la défensive.
– Je suis assistante maternelle depuis plus de quinze ans.
Louis – Laurent ? – baissa la feuille et l’observa un moment, sans rien dire. Des lunettes traînaient sur le bureau mais il ne les mettait pas, même pour lire. Elle se demanda si c’était par coquetterie, alors que manifestement il en avait besoin, les yeux plissés pour parcourir les quelques lignes qui résumaient sa banale petite vie. L’idée qu’il se soucie de ce que Sofia pourrait penser de son physique l’amusait, tempérant un peu le sentiment d’humiliation dont elle ne pouvait se défaire. Dans trois mois, elle aurait cinquante ans. Cinquante ans, bon sang ! Ménopause, cheveux blancs, métamorphose annoncée d’un corps qui se déféminise, fin d’un nouveau cycle, déjà, et l’impression tenace d’avoir laissé passer son tour.
Si c’était à refaire… Elle observait avec un peu d’amertume les deux lignes qui résumaient maintenant sa formation, brevet des collèges et CAP Petite Enfance pour seuls titres de gloire. Exposer la vérité de son parcours, avouer le bac avec mention, la maîtrise de lettres modernes et la thèse sur l’œuvre de Verlaine – même si elle n’avait pas eu le temps de la soutenir avant de se marier – c’était s’entendre répondre à coup sûr qu’elle était trop qualifiée pour obtenir le poste. Elle connaissait la chanson. En France, pour les boulots subalternes, il fallait revendiquer une intelligence médiocre et une inculture de bon ton, préférer à Verlaine les romans à l’eau de rose, à Mozart et Beethoven les beuglantes insupportables des ados prépubères des émissions de téléréalité. Elle voulait bien admettre que, pour changer une couche remplie de merde, il n’était pas nécessaire de connaître par cœur les Fêtes galantes, mais le constat était tout de même attristant.
Enfin… Qu’importait, dans le fond ? Elle avait une fille, qu’elle n’avait pas vue depuis quinze ans. Plus de mari, quelques amitiés sans profondeur, de celles qu’on accepte par facilité géographique, parce qu’il vaut toujours mieux être en bons termes avec ses voisins. Bien sûr, tous étaient restés en Bourgogne, et d’ici deux ou trois ans, au plus tard, ils auraient oublié jusqu’à son existence. Ici ou ailleurs, de toute façon… Décidément, son tour était passé. Elle se sentait vieille, finie, flétrie, elle ne savait même pas ce qu’elle faisait ici. Elle serra les poings, s’obligea à penser à Verlaine, aux désillusions cruelles et aux souffrances dont il avait tiré ses vers les plus sublimes. Mais bon, Verlaine était un génie, et elle, elle n’était que Sofia Loison, candidate sans conviction à un poste d’aide-ménagère au fin fond de la Touraine. Clairement, leurs deux parcours n’avaient rien à voir, le seul point en sa faveur étant que, contrairement à Verlaine, pour le moment elle était encore en vie.
Éphémère avantage.
– Nous avons une crèche, sur la commune, et une halte-garderie. Pourquoi ne pas avoir postulé chez eux ? demanda Laurent-Louis.
– J’en avais assez des gosses. Les cris et les caprices, les repas donnés à la cuillère où ils en foutent partout, les couches pleines, le vomi.
– Excusez-moi de vous le dire, mais les vieux, c’est souvent la même chose.
– Alors, on peut considérer que j’ai déjà une solide expérience. Cela doit jouer en ma faveur, non ?
Il consentit un demi-sourire.
– Il y aurait bien quelque chose. Une situation un peu particulière. C’est un couple, les Montès. Ils habitent à l’écart, une maison troglodyte dans un hameau presque en ruines, pas très loin d’Azay.
– Montès, c’est un nom à consonance espagnole, non ?
– Monsieur est né à Séville. Vous parlez la langue ?
– Quelques mots. Ma grand-mère était madrilène. Elle s’appelait Sofia, comme moi, précisa-t-elle avant de s’interrompre, déconcertée.
Quelle idée de livrer ce genre de détails à un parfait étranger ? Mécontente d’elle-même, elle s’enfonça dans son siège, son sac à main étroitement serré contre son ventre.
– Mais je ne saurais pas tenir une conversation, acheva-t-elle, presque menaçante.
Louis-Laurent acquiesça, sans émotion.
– Il est probable que vous n’aurez pas à le faire. M. Montès souffre d’une démence assez avancée. D’après les auxiliaires de vie qui vous ont précédée, la plupart du temps son discours est totalement incohérent.
Sofia hocha la tête à son tour, se demandant si ces précisions impliquaient qu’elle allait décrocher le poste. Ce n’était pas que tenir compagnie à un couple d’ancêtres désorientés la réjouisse particulièrement, mais elle avait besoin de travail. S’interdisant de crier victoire trop vite, elle demanda :
– Et sa femme ? Elle perd la tête, elle aussi ?
– On ne peut pas dire cela.
Elle attendait qu’il en révèle davantage, mais il referma brusquement le dossier, se pencha en avant comme pour lui parler sur le ton de la confidence :
– En l’espace d’une année, nous leur avons attribué six auxiliaires de vie. Celle qui a tenu le plus longtemps est restée trois semaines.
– Trois semaines ? Ils sont si désagréables que ça ?
– Ce ne sont pas nos salariées qui sont parties. Ce sont les Montès qui les ont remerciées.
Sofia lui coula un regard interrogateur, pensant à nouveau qu’il allait développer, mais il se contenta de reprendre, après quelques secondes :
– Marie Montès. Le nom ne vous dit rien ?
– Je ne crois pas.
– Et si je vous parle de « L’Esclave et l’empereur fou » ?
Cette fois, Sofia réagit, la surprise chassant toute retenue. Si elle connaissait « L’Esclave et l’empereur fou », cette saga contant l’histoire d’une esclave romaine sous le règne despotique de l’infâme empereur Néron ? Évidemment ! Elle avait dévoré avec passion cette incroyable fresque littéraire et s’était même inspirée du prénom de l’héroïne, Fausta, pour baptiser sa propre fille Faustine.
– Qui ne connaît pas ce chef-d’œuvre ? s’exclama-t-elle avant d’ajouter, perplexe : Mais je ne vois pas le rapport avec la vieille dame dont vous me parlez.
– Le drame des écrivains, dont trop souvent on ne retient que l’œuvre, et pas le nom. M. J. Montès, articula-t-il, détachant exagérément chaque syllabe. Marie Montès est l’auteure de cette série-culte, Madame Loison. Elle sera sans doute heureuse d’apprendre que vous appréciez sa plume. Espérons que cela l’incite à vous garder.
Eberluée, Sofia porta la main à sa bouche comme si elle voulait étouffer un cri. Louis-Laurent la contemplait, franchement amusé.
– Nous pouvons considérer que vous acceptez ce poste, je suppose ?
Elle approuva de la tête, encore mal remise de son étonnement.
– J’ai toujours cru que M. J. Montès était un homme, souffla-t-elle.
– Comme la plupart des gens. Marie Montès a toujours tenu à préserver leur tranquillité, à son mari et à elle. C’est sans doute pour cela qu’elle n’a jamais voulu apparaître en public ni répondre aux sollicitations des journalistes. Et la raison pour laquelle elle a choisi de s’établir dans ce « troglo » loin de tout.
– Ils vivent vraiment dans une de ces cavernes préhistoriques creusées dans la roche ? Je ne pensais pas que ça existait encore. Je croyais que ce n’étaient que des attractions pour touristes !
– Détrompez-vous, c’est une pratique courante chez nombre de Tourangeaux… Bien sûr, il s’agit plus souvent d’une cave ou d’un appentis, creusés dans la falaise en tuffeau au fond du jardin, mais il n’est pas rare que le logis tout entier soit enchâssé dans la roche, avec un niveau de confort tout à fait conventionnel. De toute façon, vous jugerez par vous-même, les Montès fournissent le logement.
– Hébergée chez eux ? Je ne suis pas sûre…
– Ne vous inquiétez pas. Vous ne serez pas importunée par la promiscuité, vous aurez une maison rien que pour vous. « L’Esclave et l’empereur fou » a caracolé en tête des ventes de romans durant plusieurs mois à l’époque de sa parution, ne l’oubliez pas. Mme Montès et son mari possèdent les onze habitations du hameau. Elles sont pour la plupart dans un état de délabrement avancé, inutile de rêver. Mais pour ce qui est du calme, vous serez servie.
Elle opina vaguement, encore troublée. Elle allait rencontrer M. J. Montès. La perspective était aussi improbable qu’excitante, et Sofia avait tout oublié de sa première réticence à accepter un tel travail.
Louis – Laurent ? – la regardait avec bienveillance et, un peu euphorique, elle se fit la réflexion qu’il était beau garçon. Pas son type, vraiment, elle préférait les blonds plutôt sportifs, pas les premiers de la classe, sans parler du fait qu’il aurait pu être son fils. Mais enfin, il était agréable à regarder.
Elle lui rendit son sourire, tandis qu’il poursuivait :
– Mme Montès n’est pas du genre à solliciter de l’aide à tout bout de champ. Si ce n’était son handicap, elle serait parfaitement autonome.
– Son handicap ? Quel handicap ?
– Je ne vous l’ai pas dit ? Elle souffre d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge. Une atrophie irréversible de la rétine. Pour ainsi dire, elle est aveugle.
2
Il se présenta, alors qu’ils montaient en voiture. Elle n’aurait pas pensé qu’il l’accompagnerait, pas plus qu’elle n’aurait imaginé ce prénom qu’il lui livrait avec une spontanéité déconcertante.
Léo.
– En réalité, je m’appelle Léonard. Un hommage de mon père au génie de Da Vinci. Vous savez, bien sûr, qu’il a fini ses jours au Clos Lucé, pas très loin d’ici ? Amboise et les environs constituent une agréable destination de promenade. Je pourrais vous servir de guide, si vous voulez. J’ai toujours vécu en Touraine, j’en connais chaque recoin, et jusqu’au plus petit de ces innombrables châteaux.
Il continua de parler tandis qu’il s’engageait sur une route de campagne, bordée à perte de vue de champs de luzerne et d’orge. Sa familiarité joyeuse contrastait radicalement avec son accueil, très formel, plutôt froid. Qu’elle ait accepté ce poste difficile le soulageait-il donc au point d’en oublier qu’il était désormais son patron ?
C’était la fin d’après-midi, et le soleil de septembre déclinait déjà, nimbant d’or les étendues céréalières, les collines et les prés. Ils traversaient des villages aux façades d’un blanc crayeux, uniformes, peu fleuries. La plupart des maisons avaient les volets clos, personne ne marchait dans les rues. De temps à autre, dans un jardin, on devinait la silhouette fugitive d’un chat ou d’un chien, dont la présence timide ne suffisait pas à animer le décor. À l’arrivée de l’hiver, de la neige et du froid, le paysage s’abîmerait sans doute dans une gangue de tristesse infinie. Sofia n’était pas certaine de pouvoir le supporter. C’était par hasard qu’elle avait atterri ici, estimant que la Touraine était assez loin de la Bourgogne et de Perpignan pour que personne ici ne risque de la reconnaître.
Léo pérorait toujours, décrivant avec enthousiasme un tournebroche automatique du XVIe siècle, dans un château dont elle n’avait pas essayé de retenir le nom. Son exaltation pour un jeu d’engrenages vieux de cinq cents ans était touchante, sans être communicative. Sofia était tendue, comme un soldat rompu au qui-vive par des années de combats et qui, en temps de paix, cherche encore les signes d’une présence ennemie.
– Il faudra, bien sûr, commencer par les incontournables. Chambord et Chenonceau, Azay-le-rideau, un joyau à taille humaine, vous verrez, c’est à deux pas, et puis Loches et Amboise, Cherverny et Blois… Il y a, en Val de Loire, des centaines d’édifices à découvrir, une vie n’y suffirait pas…
– Vous semblez passionné par les vieilles pierres.
– Je trouve surtout fascinant d’imaginer le quotidien de ceux qui y ont vécu avant nous. J’aurais voulu avoir le talent de Mme Montès et savoir raconter le passé, les intrigues de la Cour, mais surtout la petite histoire dans la grande, celle des hommes et des femmes qui gravitaient dans l’ombre des personnages célèbres et dont personne n’a retenu le nom. Écrire doit procurer une extraordinaire sensation de toute-puissance, vous ne pensez pas ?
– Et de frustration, surtout, quand les idées refusent d’accoucher des mots !
Il lui sourit, tandis qu’il tournait dans un chemin de terre. Ils s’enfoncèrent dans un sous-bois. La futaie était sombre, le feuillage des chênes et des ormes, si dense que Léo alluma les phares.
– C’est entendu, alors ?
– Qu’est-ce qui est entendu ?
– Nous nous voyons dimanche ? En partant tôt, nous pourrions visiter Azay, puis filer au Clos Lucé. Je connais un merveilleux petit bistrot, sur les remparts d’Amboise. J’avais dit à Marie que nous arriverions vers quatorze heures, ajouta-t-il sans lui laisser le temps de protester. Elle va être en rogne.
Il la précéda sur un chemin sablonneux, au milieu des broussailles, puis ils débouchèrent dans une vaste carrière à l’abandon. La pierre très blanche du tuffeau était recouverte de mousses, de lierre et même d’arbustes, poussant à l’horizontale dans les failles de la falaise. La paroi rocheuse, drapée de sa végétation anarchique, les surplombait d’une bonne trentaine de mètres, l’impression d’écrasement aggravée par la relative obscurité du lieu. Sur la droite, on entendait le chant d’un ruisseau invisible. Des années durant, on avait dû extraire ici les pierres destinées à la construction des chers châteaux de Léo, les ouvriers aménageant sur place, pour eux et leur famille, des caves et des galeries selon la tradition des Anciens. Les arêtes acérées, les décrochements brutaux dans la muraille en bouleversaient l’harmonie naturelle, et Sofia éprouvait l’impression vague d’un sacrilège, d’une intrusion dans un territoire où elle n’était pas la bienvenue. Elle ralentit d’instinct, et d’un geste très naturel, alors, il lui prit la main. Il ne l’avait même pas regardée, mais soudain ses doigts étaient là, dans les siens, comme en signe de compréhension muette. Déboussolée, elle serra sa main et se laissa entraîner tandis qu’il désignait le fond de la carrière, quelque huit cents mètres plus loin.
– C’est là-bas, vous voyez ?
Sofia plissa les yeux, sans comprendre ce qu’elle devait regarder. Il lui fallut quelques secondes pour repérer une fenêtre, puis une autre, et sa vision enfin accoutumée, les dizaines d’ouvertures plus ou moins grandes, creusées dans l’épaisseur de la roche.
– Allons, pressons-nous, Marie ne nous voit pas mais elle sait sûrement que nous sommes là, elle a l’ouïe plus fine qu’un oiseau de nuit.
Il l’entraîna de nouveau, enjambant les broussailles en direction de l’étrange habitat camouflé à l’intérieur de la falaise. Les premiers signes d’occupation humaine remontaient au Moyen-Âge, expliquait Léo. Le village le plus proche était à six kilomètres, une bagatelle en voiture ou même en bus, mais un périple qu’à pied, on ne devait pas entreprendre de gaieté de cœur, et certainement pas tous les jours. Y avait-il eu des enfants, ici, et quelqu’un pour leur enseigner la nature, les arbres, les plantes qui guérissent, celles que l’on peut manger et celles qui tuent ? Sofia imaginait une communauté solidaire et autonome, ignorante du monde extérieur et partageant tout, une vision très idéalisée qui n’avait rien à voir avec ce décor austère que peu à peu la végétation phagocytait.
Aucune lampe ne brillait dans les profondeurs du rocher, mais Léo se dirigea sans hésiter vers une porte peinte d’un gris à peine plus foncé que la roche. Il frappa avec énergie.
– Marie ! Tu es là ?
Il la tutoie ? songea Sofia.
Puis Marie Montès apparut, et son étonnement s’évapora. Face à elle se tenait une petite femme, svelte et étonnamment vive pour quatre-vingts ans. Elle était habillée d’un corsage en dentelle et d’une jupe en lin beiges. Ses cheveux très blancs étaient noués en chignon. Elle ne portait pas de lunettes noires et lorsqu’elle braqua sur Sofia ses yeux bleus, recouverts d’une sorte de taie opaque, la jeune femme recula d’un pas, oubliant face à la fixité pénétrante de son regard, que la vieille dame ne la voyait pas.
– Vous êtes en retard, fit-elle observer en guise de bonjour, effleurant machinalement le cadran de sa montre, dont la bulle de verre avait été retirée pour donner l’heure au toucher.
– Ne commence pas ! répliqua Léo sans s’émouvoir, avant d’ajouter, content de lui : J’ai ta perle rare.
– C’est ce que tu m’avais affirmé des précédentes. Et le résultat…
La maison était plongée dans l’obscurité, et Léo entreprit d’éclairer chaque lampe, aussi à l’aise que s’il était chez lui. Peu à peu, Sofia découvrit avec curiosité le mobilier en bois sombre, la cheminée noircie de fumée et les innombrables étagères creusées dans la roche, remplies de livres désormais inutiles, ceux qui jadis les avaient lus n’ayant plus l’usage de la vue pour l’une, et de la raison pour l’autre. Malgré le handicap de la vieille femme, chaque guéridon, chaque console étaient encombrés de fausses statuettes antiques, des reproductions miniatures d’amphores ou de bustes anciens, quantités de bibelots qu’un geste maladroit de l’aveugle aurait suffi à faire tomber. Mme Montès se déplaçait pourtant dans son musée miniature avec une agilité déconcertante, sans même le secours d’une canne blanche, le souvenir du chemin gravé au millimètre dans son esprit. Avec aisance, elle contourna la table ronde, où le couvert du soir était déjà dressé pour deux, puis évita sans ralentir le piège d’un tapis au coin corné. D’un geste, elle dirigea ses hôtes vers le canapé, déclinant l’aide que Léo lui proposait d’un borborygme bougon, puis elle disparut dans la cuisine.
– Elle n’a pas l’air commode, murmura Sofia.
– Elle va chercher à vous tester. Ne vous laissez pas démonter, souffla-t-il en retour.
– Me tester ? Mais pourquoi ? Il ne s’agit que d’un travail d’auxiliaire de vie ! Du ménage, la préparation des repas, une présence et une compagnie… n’est-ce pas ?
Il ne répondit pas. Il caressait, distrait, un gros chat angora familièrement grimpé sur ses genoux. Maintenant qu’elle le voyait de près, elle se rendait compte qu’il n’était pas aussi jeune qu’elle l’avait d’abord cru. Il avait quelques rides au coin des yeux, et des fils d’argent dans sa chevelure brune. Cependant, il avait toujours l’âge d’être son fils, conclut-elle, mal à l’aise sans savoir pourquoi. Mme Montès revenait et elle se leva pour l’aider, la débarrassant d’autorité de son plateau chargé. La vieille dame ne protesta pas, se contentant de la suivre à petits pas jusqu’au salon où elle s’installa, avec un soupir de satisfaction, dans un fauteuil Voltaire aux accoudoirs élimés.
– Alors, Léo, cette perle rare ? attaqua-t-elle, tandis que Sofia servait le thé dans des tasses dépareillées. T’es-tu au moins assuré, avant de me l’amener, qu’elle n’avait pas les chats en horreur comme la précédente, ou qu’elle n’allait pas nous faire en pleine nuit des attaques de panique parce qu’elle entendait du bruit dans les galeries ? Il faut que tu saches, enchaîna-t-elle, braquant ses yeux morts sur Sofia, que la falaise est percée de part en part, d’un enchevêtrement de couloirs souterrains au plan si compliqué que personne ne le connaît vraiment. Il y traîne, à la nuit tombée, toutes sortes de créatures plus ou moins vivantes, cela produit, bien sûr, quelques désagréments sonores auxquels très vite on s’habitue, pour peu qu’on ne soit ni poltron ni lâche.
Sofia avala sa salive, se retenant de demander ce qu’étaient des créatures plus ou moins vivantes, exactement.
– Du sucre, dans votre thé, madame ?
– Ne m’appelle pas madame, j’ai horreur de ça ! Je ne suis pas sûre de ton choix, ajouta-t-elle, sévère, à l’adresse de Léo.
Piquée au vif, Sofia ne laissa pas au jeune homme le temps de répliquer :
– Vos jugements sont bien hâtifs, pour une femme de votre âge.
– Et toi, tu es bien naïve de croire que le seul fait de vieillir apporte à l’être humain sagesse et clairvoyance. Des foutaises, crois-moi, pour faire passer la pilule et donner quelque attrait au grand âge ! Je ne sucre jamais mon thé, continua-t-elle sèchement. Le sucre est un poison, au même titre que le tabac et l’alcool. Tu ne bois pas, j’espère ? La première fille que Léo nous a ramenée buvait comme un trou, elle cachait dans sa chambre des litres de whisky qu’elle lampait du matin au soir, elle n’était pas capable d’aligner trois mots sans bafouiller.
– Marie, tu exagères !
– Pas du tout, et tu le sais. Je me demande bien pourquoi je te fais encore confiance ! Entre les hystériques, les alcooliques et les voleuses, il y a de quoi désespérer !
– Hélène ne vous a rien volé du tout.
– Ma broche n’a pas disparu toute seule. Et puis je ne l’aimais pas.
– Tu ne l’aimais pas, surtout ! Je ne serais pas étonné, en fouillant tes affaires, de retrouver la fameuse broche bien à sa place dans ton coffre à bijoux.
Un peu désorientée par leur familiarité, Sofia plongea le nez dans son thé, suivant l’échange en silence jusqu’à ce que Marie se rappelle enfin sa présence :
– De fait, tu ne sens pas le tabac froid, c’est au moins ça ! Fumeuse, je te virais aussi sec !
– Tu l’as déjà dit, Marie.
– Quel est le sens de cette remarque, Léo ? Je radote, c’est ce que tu sous-entends ?
Elle marqua un temps, comme plongée dans une brusque réflexion, puis elle reprit, le débit plus lent :
– Tu as peut-être raison, au fond. Il me semble, quelquefois, que je perds la tête. Certains matins, au printemps, j’entends pépier les oiseaux, des fauvettes qui nichent dans la grosse faille, juste sous ma fenêtre, et brusquement je ne sais plus où je suis, ici ou toujours là-bas. Ces jours-là, tu sais, mon pays me manque…
Elle avait parlé bas, étonnamment vulnérable, soudain, mais aussitôt elle se reprit, se redressant brusquement pour toiser Sofia :
– Tu sais écrire, au moins ? Sans faute d’orthographe ou de grammaire ? Les fautes imbéciles de participes, les mauvaises tournures de phrases et les compléments qui perdent leur objet, voilà qui est rédhibitoire, je te préviens ! Où est le H de « rédhibitoire » ? enchaîna-t-elle, sans transition aucune.
Sofia reposa sa tasse sur la table basse, s’obligeant à ne pas baisser les yeux. Il lui semblait, contre toute évidence, que la vieille dame le saurait et elle ne voulait pas lui donner cette satisfaction.
– Après le D.
– Et le mot veut dire ?
– Il veut dire, Madame Montès, répliqua-t-elle, insistant sur le « madame », que vous n’avez aucune tolérance pour les faiblesses de forme. J’espère que votre intransigeance ne vous aveugle pas au point de négliger le fond.
– Qu’elle ne m’aveugle pas… répéta Marie, caustique. Tu ne m’avais pas prévenue, Léo, que ta candidate avait des talents comiques ! Tu connais les langues anciennes ? Le latin, le grec ?
– Je vous demande pardon ?
– M. Montès, Léo a dû te le dire, n’a plus toute sa raison. Il s’exprime en latin, la plupart du temps, expliqua-t-elle, comme s’il s’agissait de la chose la plus banale qui soit.
– En latin… répéta Sofia.
Elle envisagea brièvement de mentir, de répondre à Mme Montès ce qu’elle voulait entendre, mais elle se morigéna aussitôt, horripilée. Léo l’observait, l’expression tendue. Quel rôle jouait-il dans cette mascarade, ce simulacre d’entretien d’embauche qui, elle le sentait, ne déboucherait sur rien de concret ? Marie, malgré sa cécité, ne semblait pas avoir besoin d’aide pour prendre soin d’elle-même et de sa maison, et Sofia n’avait aucune intention d’essuyer ses sarcasmes à longueur de journée, même en étant payée. Quant au mari latiniste, elle commençait à se demander s’il existait vraiment.
Ça suffisait !
– Je ne parle pas latin, Madame Montès. Ni aucune autre langue morte, j’en ai peur. Pendant que nous y sommes, je dois vous avouer que je cuisine assez mal, que je ne raffole pas du ménage et que j’ai horreur de repasser. Quant à mon expérience professionnelle, elle s’est limitée pendant quinze ans à m’occuper d’enfants d’âge préscolaire qui étaient mieux élevés et bien plus agréables que vous ! Je pense que nous en avons fini. Si vous pouvez me ramener à mon hôtel, poursuivit-elle à l’adresse de Léo tandis qu’elle se levait, j’apprécierais beaucoup. Autrement je prendrai le bus, j’ai vu l’arrêt, sur la route principale en sortant d’ici.
Elle se glissa prestement entre le rebord de la table et les genoux de Léo, et il se mit debout à son tour, embarrassé. Marie, calée dans son fauteuil, se frottait le menton d’un geste pensif.
– Il n’est guère visible, dit-elle.
Sofia, qui se dirigeait vers la porte, se retourna et la fixa, interrogatrice.
– Quoi donc ?
– L’arrêt de bus. Il est toujours utile, avant de pénétrer en territoire ennemi, d’avoir au préalable repéré toutes les issues possibles. Veille à la ramener à son hôtel avant la nuit, ajouta-t-elle à l’adresse de Léo, et donne-lui un coup de main pour rassembler ses affaires. Soyez ici demain, à huit heures. La petite maison est prête, tu sais où sont les clés. Tu l’aideras à s’installer, et tu en profiteras pour rapporter les courses de la semaine.
Puis, sans un merci ni un au revoir, elle se leva et disparut dans les profondeurs de sa maison souterraine.
3
En descendant de sa chambre d’hôtel à sept heures le matin suivant, Sofia trouva Léo installé dans l’entrée. Paisible, il lisait son journal en sirotant un café. Il avait abandonné le costume pour un blazer ocre, porté sur une chemise d’un jaune très foncé, une association plutôt osée mais qui lui allait bien. Contrairement à la veille, il avait renoncé au gel pour dompter sa tignasse rebelle, et ses cheveux ébouriffés accentuaient son allure juvénile. Lorsqu’elle s’approcha, il replia vivement la Touraine Républicaine, se leva. Faisant mine de ne pas remarquer la main qu’elle lui tendait, il se pencha et l’embrassa sur les deux joues, quatre bises sonores qui la laissèrent sans voix.
– Dans le Maine-et-Loire, c’est quatre, justifia-t-il, solennel et indifférent au fait que ce n’était pas dans ce département qu’ils se trouvaient. Vous avez bien dormi ?
Elle haussa les épaules, éludant la question. Elle avait passé cette nuit, comme toutes les autres, à se tourner et à se retourner dans son lit. Elle n’avait pas fermé l’œil, mais alors que d’ordinaire, elle résistait plutôt bien au manque chronique de sommeil, elle se sentait fatiguée, énervée. Elle lui lança un regard noir, jalousant son teint frais et son air reposé.
Il s’occupa de charger les valises dans le coffre de la voiture pendant qu’elle avalait, au comptoir, une tasse de café serré en réglant la note de son séjour. Elle y laissait ses dernières économies, songea-t-elle, anxieuse. Léo n’avait parlé ni de contrat ni de salaire. Elle ne comprenait toujours pas ce qu’il lui faudrait faire pour justifier sa paye. Qu’exigerait ce couple étrange, dont elle ne connaissait encore que la tyrannique épouse ? La rencontre prochaine du mari invisible, fou, agressif peut-être, l’angoissait plus que de raison. Et s’il était violent ? S’il était sujet à des crises, comme elle avait entendu dire que les malades d’Alzheimer en avaient, lors desquelles ils se mettaient à hurler et dévastaient tout ? Elle n’était ni psy, ni infirmière, elle mesurait un mètre soixante-deux et ne se sentait pas la force, ni physique ni mentale, de s’opposer à un vieillard en proie à un accès de démence aiguë.
Qu’est-ce qui lui avait pris d’accepter ? Elle ne serait jamais à la hauteur.
– Nous y allons ?
Elle sursauta tandis que Léo se matérialisait à ses côtés, les joues rosies par la fraîcheur du dehors, son éternel sourire aux lèvres. Il paraissait animé d’une bonne humeur perpétuelle, persuadé contre toute évidence qu’un verre ne peut être qu’à moitié plein et jamais vide, que la vie est belle et vaut la peine d’être vécue, qu’il faut voir en chacun seulement ce qu’il y a de meilleur, entre autres naïvetés béates extraites du même tonneau. Elle se contenta d’un hochement de tête, réprimant mal sa contrariété. Elle se méfiait des gens heureux.
Ils reprirent le même chemin que la veille, à travers une campagne déserte que le givre blanchissait. Léo avait pris la parole et meublait, l’assommant à nouveau avec ses châteaux de la Loire, décrivant sans fin le quotidien à la Cour de François Ier, les intrigues et les affaires d’État. Elle ne savait pas si Léo cherchait à l’impressionner en étalant sa culture, ou s’il voulait tout simplement la décourager de lui poser des questions, mais son agacement allait croissant.
Ils arrivèrent enfin. Il avait dû pleuvoir pendant la nuit, la terre était molle, et les talons de Sofia s’y enfonçaient. Elle portait encore son ensemble élégant de la veille, tailleur-jupe, bas, escarpins. Comme si une telle tenue était de mise pour récurer les toilettes d’une vieille femme aveugle ! De plus en plus tendue, elle suivit Léo, slalomant entre les trous d’eau boueuse. Il s’était enfin tu, économisant son souffle pour transporter ses deux énormes valises, et ce fut avec un soulagement visible qu’il les posa enfin devant la porte du troglodyte adjacent à celui des Montès, fouillant sa poche à la recherche de la clé.
Elle fut surprise par la fraîcheur des lieux, plus nette que dans la maison voisine.
– Le poêle est au minimum, observa Léo comme s’il lisait ses pensées. N’hésitez pas à le pousser à fond si vous êtes de nature frileuse, ce n’est pas le combustible qui manque aux alentours !
– Dois-je comprendre que je devrais aussi m’occuper de couper du bois à mes heures perdues ?
– Bien sûr que non. Martial est là pour ça.
Elle hocha la tête, soulagée tout de même, renonçant à demander qui était Martial.
– Et pour les courses ? Il y a un supermarché quelque part, accessible par le bus ?
– En dépannage, vous trouverez une épicerie dans le village voisin, mais pour le gros des courses de la semaine, il vaut mieux l’hyper. Je vous conduirai en voiture.
Elle arqua un sourcil.
– Vous ?
Comme la veille, il fit en propriétaire le tour de la petite maison, vérifia que le frigo marchait, rebrancha les lampes, tapota les coussins du canapé. À gauche du salon-salle à manger, petit mais douillet une minuscule cuisine équipée avait été aménagée. Au fond, trois marches descendaient vers une salle d’eau munie d’une étonnante baignoire sabot, creusée dans la roche. On accédait à l’unique chambre de l’étage par un étroit escalier en colimaçon. Léo avait repris son bavardage, détaillant l’origine de chaque meuble.
Sofia le coupa, sans s’embarrasser de formule de courtoisie :
– Maintenant, Monsieur Jullien, vous me devez des explications.
Il s’interrompit net puis la dévisagea, faussement contrit :
– Vous ne voulez vraiment pas m’appeler Léo ?
– Si vous ne vous décidez pas à être un peu honnête avec moi, alors n’y comptez pas. Les Montès n’ont manifestement pas besoin d’une auxiliaire de vie. Par ailleurs, vous ne m’avez fait signer aucun contrat. Vous proposez le logement, certes, mais la disponibilité que vous exigez en retour me semble bien supérieure au mi-temps dont parlait l’annonce. Je ne suis pas corvéable à merci !
– Nous vous l’avons dit, ça ne sera pas le cas, affirma-t-il avec flegme. Jamais les Montès ne vous dérangeront la nuit, soyez-en sûre. Quant aux horaires, ils seront aménagés à votre convenance. Mais je pense que Marie saura vous expliquer mieux que moi ce qu’elle attend de vous.
– Et le contrat ? Je vois avec elle, aussi ? persifla Sofia.
– Effectivement. De même que le salaire.
Saisie, elle mit quelques secondes à réagir.
– Je ne serai pas du tout embauchée par la commune, en fin de compte ?
– Je pense que non, sourit Léo.
– Ce n’est pas un petit peu illégal, Monsieur Jullien, de débaucher une candidate à un entretien de la mairie pour lui proposer un emploi privé ?
Il marqua un temps, comme s’il étudiait la question, puis son sourire s’accentua :
– Je vous laisse toute liberté. Si vous estimez qu’un poste d’auxiliaire de vie, disons plus classique, correspond davantage à ce que vous recherchez, vous pouvez commencer lundi. Ils ont besoin de quelqu’un à la maison de retraite.
– Je croyais que toutes les places étaient prises ?
– Je n’ai pas exactement dit cela, répliqua Léo, sans se démonter. Et puis, si j’avais joué cartes sur table, vous ne seriez jamais venue jusqu’ici.
– Parlons-en, de vos cartes sur table ! Je ne sais toujours rien, je vous rappelle, en dehors du fait que le directeur de l’ADMR1 propose de me servir de chauffeur pour les courses du samedi à l’hypermarché du coin !
– Vous devriez être contente. C’est un honneur que je n’accorde pas à tout le monde, remarqua-t-il, avant de préciser, comme s’il s’agissait d’un détail auquel il venait juste de songer : À propos, Marie Montès est ma grand-tante. La sœur de mon grand-père Jean.
Sofia leva les yeux au ciel.
– Vous auriez pu commencer par cela !
– C’est vrai, reconnut-il. Pour me faire pardonner, acceptez mon invitation à déjeuner dimanche. De toute façon, vous n’avez pas le choix, j’ai déjà réservé, vous savez, ce restaurant du chemin de ronde dont je vous ai parlé, à Amboise.
Elle le dévisagea, interloquée.
– Vous ne renoncez jamais, vous ?
– C’est une sorte d’habitude familiale, répliqua-t-il calmement, tandis qu’il jetait un coup d’œil à sa montre. Marie va vous attendre, vous devriez y aller.
– Vous ne m’accompagnez pas ?
Curieusement, comprendre enfin le lien qui unissait Mme Montès et Léo l’avait rassurée, mais la perspective de devoir affronter seule la vieille dame faisait rejaillir l’angoisse contre laquelle elle luttait depuis la veille.
– Je suis déjà en retard, mon équipe m’attend. Je dois trouver une auxiliaire de vie pour la maison de retraite, le poste est vacant, vous vous souvenez ?
Il sortait, et elle le suivit, éteignant les lampes au passage, puis verrouilla la porte avec la clé qu’il lui avait remise. Elle ne s’était pas changée. Tant pis. Inutile de courroucer le dragon d’entrée de jeu par un nouveau retard. Elle frissonna sur le seuil de la maisonnette, frigorifiée dans son tailleur léger.
– Vos vêtements ne sont guère adaptés, ni à la saison ni à l’endroit, observa Léo.
– Vraiment, vous croyez ? railla-t-elle.
Il sourit de nouveau. Lui-même n’était pas habillé beaucoup plus chaudement qu’elle, mais il semblait souverainement indifférent à la bise glacée qui tourbillonnait dans la carrière. Ses yeux sombres fixés sur elle la mettaient mal à l’aise. Elle toussota, s’écarta légèrement au moment où il se penchait pour l’embrasser, et au lieu de sa joue, ce furent ses lèvres qu’il effleura. À peine un baiser, une caresse, plutôt, chaste et, l’espérait-elle, dénuée d’intention. Qu’un homme de vingt ans son cadet puisse éprouver pour elle une quelconque attirance était si inconcevable qu’elle refusait tout à fait de l’envisager.
– Vous allez très bien vous en sortir, Sofia. Marie et vous allez parfaitement vous entendre.
– Nous verrons.
– Je passerai vous prendre dimanche, vers onze heures. Et j’espère que vous porterez à nouveau ce tailleur, ajouta-t-il gravement. Il vous va à ravir.
1 Service d’Aide à la personne, intervenant essentiellement auprès des personnes âgées en milieu rural. (Toutes les notes sont de l’auteure.)
4
Le dragon avait laissé la porte de l’antre entrouverte.
– Bonjour !
Du fond de la maison, Sofia entendit de la vaisselle qu’une main malhabile entrechoquait. Quittant à regret ses chaussures boueuses, elle se dirigea vers la cuisine et y trouva Mme Montès debout sur un tabouret, fouillant un placard à tâtons.
– Vous allez tomber ! s’alarma-t-elle en se précipitant.
De fait, la vieille dame eut un sursaut qui manqua la précipiter au sol, retenue au dernier moment par Sofia qui, par réflexe, l’avait empoignée à la taille.
– On n’a pas idée de grimper sur un tabouret à votre âge ! gronda-t-elle en aidant Mme Montès à descendre, le cœur battant d’angoisse rétrospective.
– Ni de débouler brusquement chez les gens en poussant des hurlements ! C’est toi qui m’as fait peur !
– La porte était ouverte. Je suis entrée, j’ai dit « Bonjour », et personne ne m’a répondu. Léo disait que vous aviez l’ouïe fine, mais si en plus d’être aveugle, voilà que vous êtes sourde par-dessus le marché, je vais exiger une augmentation !
– Commence déjà par mériter ton salaire. De mon temps, les jeunes filles ne se montraient pas si effrontées avec les gens âgés.
– Je ne suis plus une jeune fille, vous savez, remarqua Sofia, le ton radouci. Qu’est-ce que vous cherchiez, dans ce placard ?
– Du thé noir. Ne touche à rien, tu vas tout déranger et je ne m’y retrouverai plus !
– De toute façon, il est hors de question que nous continuions à stocker quoi que ce soit en hauteur, contra Sofia, se perchant elle-même sur le tabouret et récupérant le paquet de thé. Nous nous en occuperons ensemble tout à l’heure, comme cela, vous rangerez à votre façon.
Tout en parlant, elle avait contourné la chaise où Mme Montès s’était assise, très digne dans sa robe de chambre rose bonbon. Elle prépara la boisson, prenant ses marques, veillant effectivement à ne pas changer les choses de place. Elle s’étonnait que Mme Montès lui ait laissé la direction des opérations. Certes, il s’agissait de préparer le thé et c’était le genre de tâches qu’on attendait d’une auxiliaire de vie… Pourquoi gardait-elle l’impression persistante que ce n’était pas à cela que Mme Montès voulait vraiment l’employer ?
La bouilloire sifflait, et elle versa l’eau chaude, recouvrant la théière de son manchon. Elle trouva les tasses et les petites cuillères, du sucre et des biscottes, récupéra du beurre et de la confiture dans le frigo et rapporta à table son chargement.
– M. Montès prend aussi du thé ?
– Quand il déjeune, oui. Mais la plupart du temps, il fonctionne à l’heure espagnole. Il se lève rarement avant midi et il se couche à trois heures du matin. Cela nous laisse tout de même un créneau en commun… quand il ne fait pas la sieste, ajouta-t-elle, résignée.
– Vous ne faites pas la sieste, vous ?
– Jamais de la vie ! La sieste, c’est bon pour les vieux ! Quel âge as-tu ? questionna-t-elle, passant du coq à l’âne avec une facilité que Sofia avait déjà remarquée.
– Bientôt cinquante.
– Cinquante ! Une gamine, quoi ! Si je les avais toujours, mes cinquante ans…
– Je ne sais pas à quoi je ressemblerai à quatre-vingts ans, Madame Montès, mais je vous assure que mes cinquante me pèsent déjà bien assez…
– Balivernes ! La cinquantaine, c’est un bel âge pour une femme. Tu es jolie, au moins ? Léo m’a dit que oui.
Interloquée, Sofia rougit jusqu’aux oreilles tandis que Mme Montès éclatait de rire.
– Es-tu sotte ! Léo est parti en même temps que toi hier, je ne vois pas quand il m’aurait vanté tes charmes… Ne fais pas cette tête ! ordonna-t-elle, hilare.
– Vous ne la voyez pas, ma tête, bougonna Sofia, vexée de se sentir aussi embarrassée.
– Alors approche ! répliqua la vieille dame, tandis qu’elle levait les mains pour les plaquer sur le visage de Sofia, avec une douceur surprenante.
Dans les minutes qui suivirent, elle inspecta ses traits, palpant avec soin chaque relief et chaque creux, étudiant au toucher la forme de ses yeux, la taille de son nez, l’épaisseur de ses lèvres. Attentive, elle suivit l’arête de ses mâchoires de la pulpe de l’index, puis de la même façon le contour de ses oreilles, ses sourcils, la racine de ses cheveux. Sofia se laissait faire, troublée par une impression de vulnérabilité extrême, de totale mise à nu. Enfin, la caresse des doigts sur sa peau se fit plus légère, et les vieilles mains retombèrent sur la table.
Marie déclara alors, définitive :
– Oui. Tu es jolie.
Et de façon sans doute un peu ridicule, Sofia en fut ravie.
De ce premier petit déjeuner pris ensemble, plus tard, elle retiendrait le tonitruant rire de Mme Montès et ses piques, émaillées çà et là. La plupart étaient acérées et auraient pu blesser, mais Sofia se gardait de prendre l’humour caustique de la vieille dame au premier degré. Il s’agissait, elle l’avait compris grâce à Léo, d’un moyen à peine déguisé de la tester. À quelles fins, elle l’ignorait encore, mais l’exercice l’amusait et elle prenait plaisir à répondre avec toute l’insolence dont elle était capable. Ce rapport insolite était très éloigné de l’idée qu’elle s’était faite de leur première vraie rencontre.
Des années durant, elle avait été environnée d’enfants en bas âge ou de ses collègues nourrices à domicile, qui ne savaient parler que de réunions Tupperware, de recettes de cuisine et des performances comparées de leurs poussettes à trois places. Le soir, elle se retrouvait en tête-à-tête avec un mari silencieux et hostile à qui, les derniers temps, elle n’osait plus vraiment adresser la parole. Quant à sa fille, sa Faustine, elle vivait en internat, et lorsqu’elle revenait à la maison, elle passait tout son temps enfermée dans sa chambre. Sofia avait vécu sa vie d’adulte en recluse, sans personne avec qui partager quoi que ce soit. Dieu merci, elle avait eu les livres, sans quoi son cerveau aurait fini atrophié et tout à fait inutilisable, comme une plante dépérit quand on ne l’arrose pas. Auprès de Mme Montès, elle sentait son esprit s’éveiller comme au terme d’un très long sommeil, elle sentait monter en elle une vigueur nouvelle, une singulière joie d’enfant.
Le petit déjeuner s’éternisait. M. Montès n’avait toujours pas donné signe de vie. Sofia venait d’évoquer « L’Esclave et l’empereur fou » et disait à quel point elle l’avait aimé. Le visage détendu de Mme Montès s’assombrit d’un coup.
– Ce machin… lâcha-t-elle, le ton méprisant. Je n’ai jamais compris l’engouement du public pour ce mélo… Les personnages étaient d’un mièvre ! Guère plus qu’un roman de gare à deux sous, je m’étonne vraiment que tu aies pu l’apprécier. Je t’aurais cru plus exigeante dans le choix de tes lectures…
– Vous êtes dure ! On dirait que vous parlez du roman d’une autre. Auriez-vous oublié que c’est vous qui l’avez écrit ?
– J’étais jeune… J’ai écrit, par la suite, beaucoup d’autres choses, de bien meilleure tenue, je te le dis sans fausse modestie. Mes éditeurs, ces ânes, n’en ont jamais voulu. Ils restaient bloqués sur l’histoire de Fausta et ce cinglé de Néron, ils voulaient du romanesque, du commercial, ils disaient qu’en achetant du « M. J. Montès », le public voulait relire à l’infini le même livre, péripéties rocambolesques et coucheries à gogo à la sauce antique… Je trouvais ça totalement crétin et je le leur ai dit, mais ils n’ont jamais voulu en démordre. Du coup, j’ai claqué la porte.
– Vous auriez pu démarcher d’autres éditeurs.
– Ou écrire sous pseudonyme… Je sais. C’est ce que Léo m’a souvent répété. Que veux-tu, j’étais déçue, vexée, je n’ai pas eu l’énergie… Je n’ai plus écrit une ligne, pendant près de vingt ans, refusant d’admettre que c’était moi, surtout, que je punissais. Et puis il y a eu cette maladie ridicule, cette foutue DMLA, comme si ce n’était pas déjà assez, d’être vieux, de perdre la tête, de ne plus pouvoir courir, sauter, danser… Comme s’il fallait décidément que Dieu s’acharne et qu’il nous ôte aussi la grâce de pouvoir regarder le monde, à nous qui avons déjà perdu celle de bouger, et quelquefois de penser… Profite de ta jeunesse, Sofia, profites-en bien ! Dieu, crois-moi, déteste tant les vieux que dans la déchéance, par une ultime cruauté, il les maintient en vie.
Elle soupira, mélancolique. Sans préméditer son geste, Sofia tendit aussitôt la main pour la poser sur la sienne.
– Il ne faut pas regretter. Vous avez fait rêver des milliers de personnes, avec vos personnages mièvres et vos histoires d’amour à deux sous. Vous m’avez fait rêver, moi, vous m’avez apporté du bonheur à une époque où, dans ma vie, il n’y en avait pas.
Le regard mort de l’aveugle était posé sur elle et, de nouveau, Sofia eut le sentiment absurde qu’elle pouvait la voir. Elle se força pourtant à ne pas baisser les yeux, écoutant l’écrivaine qui reprenait, la voix raffermie :
– Regarde-moi… De quoi est-ce que j’ai l’air, à m’apitoyer et à sangloter sur moi-même ? Si ça continue, tu vas me prendre en pitié et tu deviendras gentille, sans même t’en être aperçue ! Il faut nous reprendre, ma petite ! Nous endurcir un peu, ajouta-t-elle, tapant résolument du plat de la main sur la table, faisant tressauter toute la vaisselle et renversant une tasse. Pas de pleurnicheries entre nous, j’ai assez soupé des prévenances infantilisantes de toutes les godiches que Léo a fait défiler ici ! À croire qu’il fait exprès de me dégoter systématiquement les filles les plus niaises, le pauvre garçon !
– Très bien. Je prendrai donc garde à l’avenir à me montrer aussi méchante que possible. Vu votre fichu caractère, je n’aurai pas à me forcer beaucoup !
– Ne t’inquiète pas, si ce n’est pas le cas, je te flanque à la porte.
– C’est entendu ! conclut Sofia, et comme pour sceller le pacte, elle chercha de nouveau les doigts de la vieille femme, et les serra en une franche poignée de main.
L’une aidant l’autre, elles débarrassèrent la table, puis passèrent le reste de la matinée à modifier l’ordre de la cuisine, ramenant à hauteur humaine tous les objets et ingrédients d’usage courant, afin que Mme Montès n’ait plus à jouer les funambules pour préparer son thé.
– De toute façon, je suis là, maintenant. Si vous voulez du thé ou n’importe quoi d’autre, vous n’aurez qu’à me demander. C’est pour cela que vous m’avez engagée, non ?
Elles en avaient fini. Fatiguée, la vieille dame se laissa choir dans son fauteuil, et le chat vint aussitôt s’installer sur ses genoux en ronronnant, quémandant des caresses. Sofia relança le feu moribond, calant trois bûches en pyramide dans l’âtre de la cheminée, puis s’assit à son tour dans le canapé, se demandant si un jour elle verrait Martial, le mystérieux bûcheron, aussi invisible pour le moment que le maître de maison. L’ambiance était bizarre, un peu vaporeuse. Sans réussir à se faire vraiment peur, elle songeait qu’autour d’elle, il était fort possible qu’il n’y ait que des fantômes. Peut-être que ni M. Montès, ni l’homme à tout faire, ni Marie, ni elle-même, en fin de compte, n’existaient. Cette idée l’amusait, beaucoup plus que de raison.
– Cette fois, dit Mme Montès, cette fois je crois que nous y sommes.
Il y avait dans sa voix une lassitude, une nostalgie, et aussi un espoir très ténu. Avec lenteur, Sofia se redressa sur le canapé et entoura ses genoux de ses deux mains nouées, dans l’expectative, l’attitude d’une petite fille qui ne savait pas encore si elle serait félicitée ou sermonnée.
Les bûches encore froides craquaient dans l’âtre et projetaient des braises qui, pour certaines, franchissaient le pare-feu. Elles atterrissaient, rougeoyantes, sur le tapis dont elles devaient roussir quelques mèches, invisibles à l’œil nu. Il n’y avait pas de risque réel d’incendie… mais rien n’interdisait de se le faire croire.
– Sofia, demanda Mme Montès, est-ce qu’un jour, dans ta vie, tu es déjà allée à Pompéi ?
Août 79
I
Gaius Plinius Secundus avait trop chaud.
Il s’était installé à sa place de travail habituelle, une petite pièce retirée de la riche demeure où il séjournait lorsqu’il était à Pompéi. Un esclave silencieux, debout à ses côtés, brassait l’air chaud au-dessus de sa tête à l’aide d’un éventail monté au bout d’une perche. Cette pauvre ventilation ne suffisait pourtant pas à le rafraîchir. Tout à l’heure, il irait aux cuisines, chercher une coupe du vin que Marcus, son hôte, cultivait sur les pentes du mont Vesuvio. La terre là-bas était riche et fertile, et la plupart des nobles Romains établis à Pompéi y possédaient vignes et vergers.
Jusqu’à des temps récents, Gaius avait parcouru le monde au service de l’empereur Vespasien, dont il était l’un des plus proches conseillers et surtout l’ami. Il était revenu en Campanie pour y rester, sa santé ne lui permettant plus les ambitieux périples d’antan, et sa charge de préfet de la flotte romaine de Misène ne l’accaparait guère. À cinquante-six ans, il était célèbre dans tout l’Empire romain pour ses éminents traités de grammaire et de rhétorique. On le traitait avec déférence, on louait sa morale inébranlable et sa volonté de fer. Comme son mentor Sénèque, il se disait l’ennemi des passions, qui affaiblissent l’esprit et avilissent l’homme. Néanmoins, l’âge venant, il dédaignait de moins en moins les plaisirs du corps et la bonne chère, et ne refusait jamais une invitation à un banquet. Son embonpoint certain le trahissait d’ailleurs assez.
Pour se donner bonne conscience autant que pour plaire à son empereur, il s’était imposé une mission titanesque : consigner par écrit l’ensemble des lois régissant l’ordre du monde. Son Historia naturalis2, dont il venait de terminer le trente-septième tome, serait assurément son chef-d’œuvre. Rufus, son esclave préféré, lui lisait à voix haute les écrits des savants reconnus de son temps, et Gaius prenait des notes. Il ne doutait pas que son traité deviendrait une référence scientifique majeure pour tous les hommes qui viendraient après lui. Face au doute et à la peur de l’avenir, cette pérennité le rassurait un peu.
La chaleur s’amplifiait, devenait étouffante. Ces derniers jours, il respirait mal, comme si l’air brusquement s’était fait plus épais. Les étés pompéiens, d’ordinaire, étaient moins caniculaires qu’à Rome, et beaucoup de citoyens se réfugiaient dans leurs somptueuses villas dès les ides de mai. Celle de Gaius surplombait Misène, de l’autre côté de la baie de Naples. Pourtant, ces derniers temps, il la délaissait fréquemment pour la vaste demeure de Marcus, son ami sénateur établi à Rome.
Fatigué, il repoussa sa tablette et se laissa aller contre le dossier de sa banquette. Sa tunique était mouillée de sueur, ses cheveux, humides de transpiration glacée. En soupirant, il s’essuya le front puis se leva péniblement.
– Tout va bien, Maître ? questionna Rufus, interrompant sa lecture pour observer Gaius d’un air anxieux.
– Je crois que nous allons en rester là pour ce matin. Je ne me sens pas très bien.
– Veux-tu que je fasse quérir Stavros ? s’enquit l’esclave, abandonnant aussitôt son volumineux ouvrage pour venir soutenir Gaius.
L’érudit vacillait, très pâle. Il épongea de nouveau son front moite, puis repoussa le jeune homme avec un peu d’humeur. Ce n’était pas la première fois qu’il éprouvait ce type de malaise. Au début de l’été et des fortes chaleurs, il avait souffert de crises d’étourdissement, accompagnées de brèves et violentes oppressions qui l’avaient contraint à demeurer alité durant deux jours. Stavros, un esclave né en Grèce qui connaissait l’art de la médecine, l’avait veillé tout le temps qu’avait duré cet étrange état de faiblesse, lui administrant des tisanes de saule pour clarifier le sang, et de la poudre de digitale pour calmer l’irrégularité de son cœur. Gaius avait pu retourner à son étude le troisième jour. Il gardait cependant une certaine tendance aux vertiges quand il se mettait trop rapidement debout et était sujet à des périodes d’essoufflement aigu dont il n’avait pas parlé à Stavros. S’il avait su, le Grec se serait empressé d’aller rapporter la nouvelle à Plinia, sa sœur, si prompte comme beaucoup de femmes à s’affoler d’un rien. Quant à Rectina, Gaius ne voulait surtout pas passer à ses yeux pour un être faible et fragile.
Mieux valait ne rien dire, ne rien laisser paraître. D’ailleurs, le malaise s’estompait.
– C’est inutile, Rufus, reprit-il, retrouvant un ton ferme auquel le jeune esclave réagit aussitôt, se raidissant avant de s’écarter. Sais-tu où est Cæcilius ? Je ne l’ai pas encore vu ce matin.
– Ton neveu est sorti très tôt, Maître. Je l’ai vu partir en direction du temple d’Apollon.
Gaius esquissa une mimique contrariée.
– En direction du thermopolium3, tu veux dire…
– Maître… Il est encore jeune. Il est normal qu’il ait envie de s’amuser…
– Traîner à la taverne, c’est un divertissement tout juste bon pour les esclaves ! répliqua Gaius, contrarié.
La remarque n’était pas faite pour blesser Rufus qui, d’ailleurs, approuva d’un hochement de tête indulgent.
– Ce n’est pas un amusement digne de notre famille, insista Gaius. Après la mort de son père, quand je les ai recueillis, Plinia et lui, j’espérais faire de Cæcilius un héritier digne de remplacer le fils que je n’avais jamais eu… Je lui ai fait lire Plaute, et Tite-Live, et Homère, je lui ai même fait donner des cours de grec… Et cela, Rufus, tout cela en pure perte ! Ce garçon ne pense qu’à jouer et à boire, on m’a même rapporté de source tristement sûre qu’on l’avait vu rôder autour du lupanar4… S’il n’était pas le fils de ma chère sœur… ajouta-t-il sombrement, laissant sa menace en suspens.
L’esclave s’abstint de renchérir, suivant son maître comme celui-ci sortait de la salle d’étude. D’un pas lent, ils traversèrent le plus petit des deux péristyles5, où des jardiniers s’affairaient à tailler les buis. Gaius évita de s’attarder, la chaleur plus insupportable encore en plein soleil. Il s’était arrangé pour passer au large du gynaeceum, l’appartement des femmes, d’où s’échappaient les voix aiguës de Plinia et de ses amies. Comme d’habitude, sa sœur devait être en train de regretter Rome et de se plaindre de l’ennui de la vie en province. Elle avait toujours été mondaine, superficielle, mais pouvait-on raisonnablement attendre d’une femme autre chose qu’un esprit futile et vain ?
Comme il se posait la question, le visage de Rectina s’immisça dans ses pensées, et il se sentit penaud et coupable. Assurément, Rectina n’était ni vaine ni futile et, aux yeux de Gaïus, elle était la plus désirable de toutes. Il se jugeait pourtant bien supérieur au commun, et un esprit aussi brillant que le sien n’aurait jamais dû se soumettre aux lois d’une femme. Les maris gouvernés par leur épouse étaient méprisables, il disait les plaindre, mais il ne valait pas mieux. La douce Rectina avait volé son cœur, bien des années plus tôt, et jamais il n’avait tenté de le lui reprendre. Si seulement elle n’avait pas été mariée à un autre, Gaius l’aurait épousée depuis longtemps ! Rectina aurait été sa récompense, au terme de ses harassantes journées passées à retranscrire le monde et à tenter de lui donner un sens. Si elle n’avait pas été l’épouse de son vieil ami Lucius, Rectina lui aurait apporté la lumière qui manquait à son existence. Elle ne l’aurait pas choisi parce qu’il était Pline, le célèbre Naturaliste connu jusqu’en Orient… mais parce qu’il était Gaius, un homme sans cesse assailli par le doute, terrifié par ses échecs et ses imperfections, un homme qui, finalement, ne demandait qu’à aimer et à être aimé en retour.
Était-il passé à côté de son chemin ? S’était-il fourvoyé, poursuivant sans relâche une vérité qui n’était qu’illusion ? Était-il bon pour l’homme de chercher à comprendre, de vouloir tout connaître ? N’y avait-il pas des secrets dont seuls les dieux devaient posséder les clés ?
Confronté à la preuve de leur toute-puissance, l’homme ne pouvait que trembler et supplier.
2Histoire Naturelle. Monumentale encyclopédie qui servit de référence aux communautés scientifiques pendant plusieurs siècles. C’est la seule œuvre de Pline l’Ancien qui soit parvenue jusqu’à l’époque contemporaine.
3 Auberge.
4 Maison close.
5 Galerie de colonnes délimitant un espace extérieur typique de la Domus, la maison de famille du IVe siècle avant J.-C. au Ie siècle après J.-C. Le plus souvent, le péristyle entoure un jardin richement orné de fontaines, de statues, de petits canaux et d’arbustes taillés.
II
Sur le Forum, il y avait déjà foule, et Julia peinait à suivre Rectina. Sa mère marchait vite, s’intéressant à peine aux étals des marchands disposés à même le sol. Alba, son esclave, entassait dans un panier d’osier les denrées choisies par sa maîtresse, se chargeant aussi de payer les commerçants. Du garum, une sauce salée à base de poisson fermenté qui était très prisée, des olives et du pain, la nature des achats variait peu d’un jour à l’autre, et quand Rectina était pressée comme aujourd’hui, le déplacement n’avait pas beaucoup d’intérêt pour une petite fille de dix ans.
Elle aurait largement préféré accompagner son père, son oncle et sa sœur Fausta qui, comme tous les jours, vendaient les étoffes de leurs foulonneries6 à l’Eumachia, la bourse de la laine. Comme Stephanus n’avait pas d’enfant et Lucius, uniquement deux filles, celui-ci avait résolu d’apprendre à l’aînée tous les rudiments nécessaires à la tenue d’une manufacture de tissus. Indifférent à la critique et faisant preuve d’une ouverture d’esprit remarquable, il prétendait qu’une femme dans ce rôle était tout aussi légitime qu’un homme. Fausta, du haut de ses seize ans, lui donnait déjà raison. Elle se montrait capable des négociations les plus âpres avec les drapiers, usant autant de fermeté que de charme, elle savait trouver le ton juste pour se faire obéir de leurs employés et, plus difficile, s’en faire apprécier. Julia, encore trop jeune, rongeait son frein et espérait que son père, le moment venu, aurait pour elle la même considération.





























