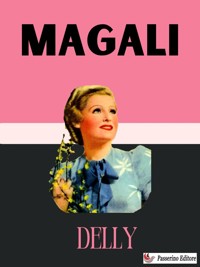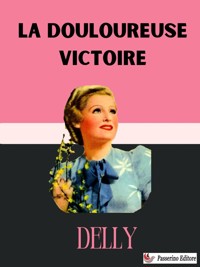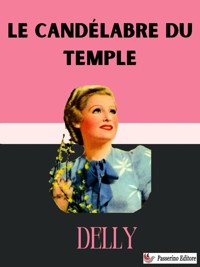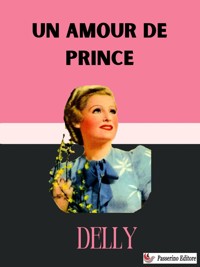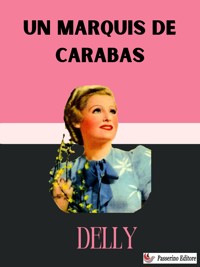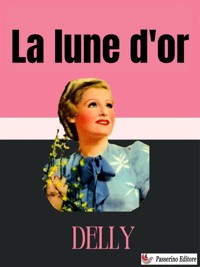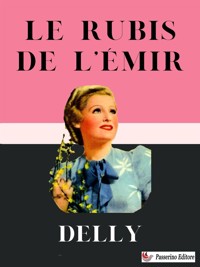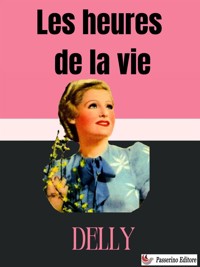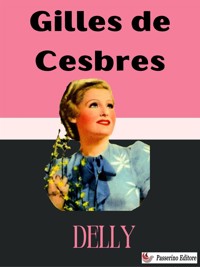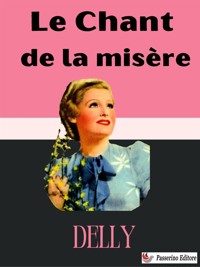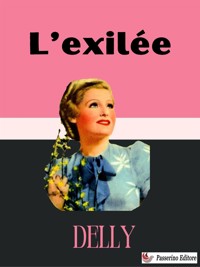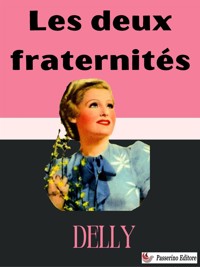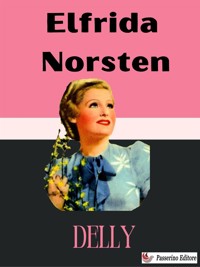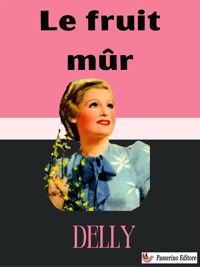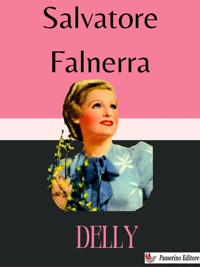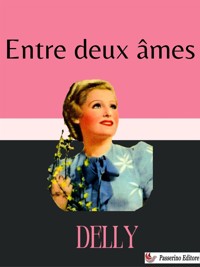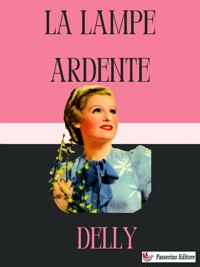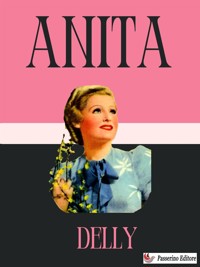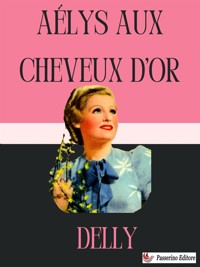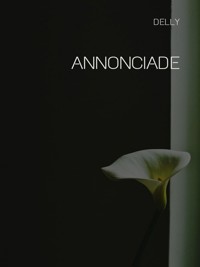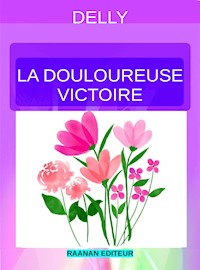
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait
| I
La chaude brise de juin entrait par les trois portes-fenêtres dans la grande salle longue qu’assombrissaient un peu les marronniers proches. L’ombre mouvante des feuillages dansait sur le bois verni des placards, sur la table couverte de morceaux d’étoffes, de ciseaux, de boîtes à fil, sur les visages des travailleuses et les cheveux bruns, blonds, grisonnants. Elles étaient là douze – quelques-unes âgées, comme Mme Augé qui atteignait quatre-vingts ans ; d’autres très jeunes, telle Claire Fervières, dont la légère chevelure châtain clair entourait une ronde et rieuse figure qui n’accusait pas plus de dix-huit ans. Veuves, femmes mariées, jeunes et vieilles filles se réunissaient ici, chaque samedi, et travaillaient pour les pauvres sous la présidence de Mme Fervières, la femme du notaire.
Elle était assise au bout de la table. La cinquantaine proche n’altérait qu’à peine ses traits délicats et laissait à la taille toute sa finesse, toute sa juvénile souplesse. Élisabeth Fervières possédait ce charme discret, tout en demi-teintes, qui fait de certains automnes de femmes la revanche d’une jeunesse au cours de laquelle elles ont passé inaperçues, ignorées, près d’autres plus brillantes dont l’âge, ensuite, ternira l’attrait. Rien en elle ne forçait l’attention, tout la retenait : la grâce tranquille des mouvements, le pli de bonté douce que la bouche gardait à demeure, la sérénité pensive des yeux couleur de noisette, le sourire fugitif qui, des lèvres, montait jusqu’au regard, et la voix pure, doucement vibrante.
Cet extérieur ne trompait pas sur la valeur morale. L’intelligence affinée s’unissait, chez Mme Fervières, à une bonté que rien ne lassait et à la plus discrète charité. Sur cette réunion hebdomadaire qui se tenait au rez-de-chaussée d’un pavillon dépendant de la maison notariale, elle exerçait, par son tact et ses vertus, une influence dont la réputation du prochain retirait maints avantages. Car elle ne laissait passer aucun propos qui eût allure de médisance et, avec une fermeté tranquille, coupait net le commérage. Toutes ces dames de l’ouvroir Sainte-Clotilde le savaient. Aussi les incorrigibles gardaient-elles pour une meilleure occasion les racontars abhorrés de leur présidente...|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
SOMMMAIRE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
DELLY
LA DOULOUREUSE VICTOIRE
roman
Raanan Editeur
Livre 573 | édition 1
Il a suffi d’un jour de trouble et de folie
Pour que mon cœur s’éloigne et que je
vous oublie.
Robert Vallery-Radot.
I
La chaude brise de juin entrait par les trois portes-fenêtres dans la grande salle longue qu’assombrissaient un peu les marronniers proches. L’ombre mouvante des feuillages dansait sur le bois verni des placards, sur la table couverte de morceaux d’étoffes, de ciseaux, de boîtes à fil, sur les visages des travailleuses et les cheveux bruns, blonds, grisonnants. Elles étaient là douze – quelques-unes âgées, comme Mme Augé qui atteignait quatre-vingts ans ; d’autres très jeunes, telle Claire Fervières, dont la légère chevelure châtain clair entourait une ronde et rieuse figure qui n’accusait pas plus de dix-huit ans. Veuves, femmes mariées, jeunes et vieilles filles se réunissaient ici, chaque samedi, et travaillaient pour les pauvres sous la présidence de Mme Fervières, la femme du notaire.
Elle était assise au bout de la table. La cinquantaine proche n’altérait qu’à peine ses traits délicats et laissait à la taille toute sa finesse, toute sa juvénile souplesse. Élisabeth Fervières possédait ce charme discret, tout en demi-teintes, qui fait de certains automnes de femmes la revanche d’une jeunesse au cours de laquelle elles ont passé inaperçues, ignorées, près d’autres plus brillantes dont l’âge, ensuite, ternira l’attrait. Rien en elle ne forçait l’attention, tout la retenait : la grâce tranquille des mouvements, le pli de bonté douce que la bouche gardait à demeure, la sérénité pensive des yeux couleur de noisette, le sourire fugitif qui, des lèvres, montait jusqu’au regard, et la voix pure, doucement vibrante.
Cet extérieur ne trompait pas sur la valeur morale. L’intelligence affinée s’unissait, chez Mme Fervières, à une bonté que rien ne lassait et à la plus discrète charité. Sur cette réunion hebdomadaire qui se tenait au rez-de-chaussée d’un pavillon dépendant de la maison notariale, elle exerçait, par son tact et ses vertus, une influence dont la réputation du prochain retirait maints avantages. Car elle ne laissait passer aucun propos qui eût allure de médisance et, avec une fermeté tranquille, coupait net le commérage. Toutes ces dames de l’ouvroir Sainte-Clotilde le savaient. Aussi les incorrigibles gardaient-elles pour une meilleure occasion les racontars abhorrés de leur présidente.
Une jeune femme venait de terminer la lecture spirituelle faite à chaque réunion et choisie par Mme Fervières dans les œuvres maîtresses de la littérature catholique. De nouveau, les conversations reprenaient : des réflexions sur la lecture d’abord, puis des échanges d’idées plus profanes.
– La Hermellière va être habitée. Le saviez-vous, chère amie ? demanda Mme Augé à une de ses voisines.
– Mais non ! Par les héritiers de ce bon M. de Glamont ?
– Oui, des Parisiens, les Jarlier. Cela va faire du mouvement dans la contrée. On les dit très mondains.
La voix fraîche de Claire Fervières s’éleva :
– M. Jarlier a écrit à papa qu’ils arriveraient dans huit jours.
– Tout est-il donc en état à la Hermellière ?
– Mais oui. Papa avait été chargé par M. Jarlier des quelques arrangements nécessaires.
La jeune femme qui venait de faire la lecture déclara :
– Une de mes amies a vu quelquefois les Jarlier à Paris, chez des relations communes. D’après elle, ils n’ont qu’une fortune médiocre, mais dépensent beaucoup. Les jeunes filles se font remarquer par des allures très libres...
Mme Fervières interrompit un moment l’agile mouvement de ses doigts fins pour diriger son calme regard vers celle qui parlait.
– Attendons de les voir pour en juger, ma chère Louise. Et même alors, ne nous pressons pas.
Mme Augé, tout en se penchant pour choisir un peloton de fil dans une boîte posée devant elle, fit observer :
– Vous serez une des premières à recevoir leur visite, Élisabeth, comme femme de leur notaire.
– Probablement. Je voudrais qu’ils ne se pressent pas trop, car les nouvelles connaissances ne m’enthousiasment guère. Celles-ci, d’ailleurs, seront vraisemblablement des connaissances de passage.
– En effet, il est peu probable que cette jeunesse s’enterre l’hiver à la Hermellière. À moins que ce soit par économie...
– M. de Glamont a laissé une assez jolie fortune, dit une petite brune vive et alerte – Mme Harte, la femme du principal médecin de Sargé. Près d’un million, prétend-on ?
– Oui, l’excellent homme ne dépensait guère et a fait des économies pour ces cousins qui devaient peu se soucier de lui, car ils ne sont jamais venus à la Hermellière.
Mme Fervières faisait de nouveau courir l’aiguille dans la percale noire d’un tablier d’enfant. Les feuillages, en se déplaçant sous un coup de brise plus vif, mirent un instant en pleine lumière son teint légèrement mat, qui prit sous cette subite clarté une nuance ambrée. Les cheveux châtains, sans éclat, furent parsemés de points d’or. Et dans les yeux qui se levèrent une seconde, toute cette lumière parut se réfugier.
À 5 heures, les travailleuses abandonnèrent leur ouvrage et prirent congé de Mme Fervières. Une grande jeune fille blonde, un peu forte, partit la dernière après avoir embrassé affectueusement Mme Fervières et Claire. C’était Marthe Loberel, la fiancée de Louis Fervières, fils aîné et futur successeur du notaire.
La mère et la fille, dans la grande salle d’où le soleil se retirait, s’attardèrent à ranger au fond des placards profonds les pièces d’étoffe et les fournitures de mercerie. Mme Fervières avait des mouvements précis et doux, sans lenteur. De temps à autre, pour mieux voir une étoffe, elle penchait un peu la tête et son profil se découpait, jeune encore et très fin, sur le bois jaune foncé de l’armoire.
– Je crains que ce lainage ne soit pas solide, Claire.
– Vous croyez, maman ?
Claire s’approchait, regardait de près à son tour. Les deux visages se trouvaient tout proches. Près des traits un peu forts et du teint brun de la jeune fille, la figure de la mère semblait plus affinée encore, et d’une plus délicate pâleur. Claire ne tenait de Mme Fervières que la nuance des yeux. Mais la différence d’expression effaçait presque cette ressemblance. Claire, vive et gaie, très remuante, n’avait rien de la nature pondérée de sa mère, et tous les sentiments s’exprimaient chez elle, par le regard ou la parole, avec une intensité que tempéraient seulement une éducation sérieuse et une distinction naturelle.
Des pas firent grincer le gravier, une ombre s’interposa entre la lumière du dehors et les deux femmes.
– Ah ! c’est Bruno ! dit Claire.
Une voix masculine au timbre sonore et doux répliqua :
– Mais oui, c’est Bruno, petite sœur.
Mme Fervières sourit à l’arrivant. Il vint à elle, lui prit la main et la porta à ses lèvres. Il y avait, dans ce geste, bien mieux qu’une déférence conventionnelle. L’affection profonde s’y affirmait – comme elle se lisait dans le regard que le jeune homme attachait sur Mme Fervières.
– Je ne pensais pas que tu aurais fini si vite toutes tes courses à Angers, mon cher enfant.
– Mais si, maman. J’ai été vite, pour rentrer plus tôt.
Le regard de Mme Fervières l’enveloppait d’un rayonnement de tendresse grave. Sur ce visage de jeune homme, elle retrouvait ses propres traits, à peine un peu virilisés, et dans toute la personne de Bruno, ce charme fin qui la distinguait elle-même. Toutefois, lui non plus n’avait pas son regard. Dans les yeux bleus, très beaux, où se reflétait une âme sérieuse, pure et bonne, un peu de rêve flottait toujours, et l’on n’y retrouvait pas la profondeur lumineuse qui éclairait ceux de Mme Fervières.
– Vous avez bien travaillé, je vois cela, dit-il, souriant à sa mère et à sa sœur, en désignant les vêtements et le linge soigneusement pliés sur la table.
– N’est-ce pas ? Tes pauvres ont-ils besoin de quelque chose ?
– Ils ont toujours besoin, ma bonne Claire.
– Alors, tu m’indiqueras ce qu’il faut, j’irai le leur porter.
Mme Fervières avait ouvert un autre placard. Les étagères en étaient garnies de pots de confitures, de bouteilles de vin, de petits paquets étiquetés. Bruno s’approcha.
– Chère mère, je voudrais bien des confitures pour ma vieille Margerine.
– Je lui en porterai demain, mon enfant.
Mme Fervières ferma le placard et glissa la clef dans un petit sac posé sur la table. Claire, avec des mouvements alertes, rangeait les sièges. Mme Fervières prit le bras de son fils et tous deux se dirigèrent vers une des portes-fenêtres.
– J’ai ramené Jacques d’Angers. Nous nous sommes croisés devant l’évêché d’où il sortait. Vous recevrez sa visite tout à l’heure, maman.
– Tant mieux. J’ai un renseignement à lui demander au sujet de cet homme à qui s’intéresse M. de Marges.
Ils descendaient lentement les deux degrés de pierre qui, du rez-de-chaussée, menaient au jardin. La mère et le fils avaient la même taille, à peine au-dessus de la moyenne, mais qui semblait plus élevée parce qu’elle était svelte, très souple, et bien mise en valeur par la coupe simple mais sans défaut de la robe de voile marron, chez Mme Fervières, et du complet gris foncé de Bruno. Ils avaient aussi la même allure élégante, la même absence de mouvements trop vifs et cette pareille façon de pencher la tête, quand ils restaient silencieux et quand ils pensaient.
Le pavillon était proche de la maison. Jusqu’au seuil de celle-ci, les marronniers formaient voûte. M. Fervières avait dit plus d’une fois : « Il faudra abattre ceux qui sont trop près. » Mais il ne pouvait s’y décider, et ses enfants le suppliaient de ne pas toucher aux arbres superbes qu’ils appelaient « les ancêtres ».
Mme Fervières s’arrêta pour montrer à son fils un rosier grimpant, le long de la façade.
– Vois, il jaunit, il s’étiole. Cette ombre le tue.
– Il faut sacrifier le rosier ou les arbres, maman.
Mme Fervières dit pensivement :
– Il faut toujours sacrifier quelque chose, dans la vie.
Et elle ajouta, avec une nuance de fermeté tranquille dans la voix :
– Le devoir seul ne doit jamais l’être.
Une femme de chambre apparut au seuil de la maison. Elle annonça :
– M. et Mme de Marges attendent Madame au salon.
Mme Fervières regarda son fils.
– Viens-tu, Bruno ?
– Mais oui. Je n’ai pas de travail particulièrement pressé pour le moment.
Ils se dirigèrent vers une des portes vitrées du rez-de-chaussée, que Mme Fervières ouvrit. Dans le petit salon où l’on ne recevait que les intimes, Henry de Marges et sa femme, assis sur un canapé, causaient à mi-voix. Lui, âgé d’une trentaine d’années, offrait le type accompli du gentilhomme de vieille race, ayant su se conserver sain d’âme et de corps et gardant intactes les traditions d’énergie, de distinction physique et morale, de foi profonde léguées par les ancêtres, ces nobles angevins qui, aux jours de la Révolution, s’étaient mêlés à leurs paysans pour la défense de leur religion et de leur roi. Elle, fille d’un Français et d’une Grecque, avait à peine vingt ans. De beaux yeux noirs, voilés de cils blonds comme les cheveux, répandaient un doux éclat sur le visage délicat, d’une fine blancheur. Élevée par des parents irréligieux, elle avait été convertie par M. de Marges. Leur parfaite union pouvait se résumer en cette phrase dite un jour par Henry : « Nous n’avons qu’une pensée et qu’une âme. »
Tandis que M. de Marges s’entretenait avec Mme Fervières, Bruno causait littérature avec la jeune femme. Celle-ci, esprit fin et ouvert, avait profité des conseils de son mari et les hommes les plus intelligents trouvaient en elle une interlocutrice très cultivée, qui savait réfléchir et observer.
Elle parlait à Bruno de l’ouvrage qu’il venait de faire paraître. Brillant élève de la Faculté d’Angers, récemment reçu docteur ès lettres, il se sentait très attiré par la carrière littéraire. Son père le poussait à opter pour le professorat. Cependant, le succès de cette première œuvre, L’ombre qui vient, roman mystique d’une grande délicatesse de style et d’une observation très pénétrante, semblait changer quelque peu sur ce point les idées de M. Fervières, ainsi que Bruno l’expliquait à Mme de Marges.
La jeune femme dit en souriant :
– Oui, monsieur votre père prévoit de ce côté une illustration pour sa famille. Je crois qu’il n’a pas tort. Cet ouvrage annonce un beau talent que l’étude et l’expérience fortifieront. Ainsi, nous compterons parmi nos écrivains catholiques un grand nom de plus.
Bruno resta un instant songeur, puis dit pensivement :
– C’est un très bel apostolat que celui-là.
– Un des plus beaux, de nos jours.
– Vous pensez que je pourrais y réussir ?
– Je le crois. C’est aussi l’avis de mon mari. Mme Fervières vous y encourage-t-elle ?
– Oui, de même que l’abbé. Ils disent comme vous, madame, que les bonnes plumes ne doivent pas se rouiller dans l’écritoire et que chacun est tenu de combattre selon ses moyens.
Claire entra, apportant des rafraîchissements. La conversation devint générale. Puis apparut l’abbé Jacques Rivors, un neveu de Mme Fervières, depuis un an vicaire à Sainte-Cécile, la principale paroisse de Sargé. M. de Marges l’emmena à l’écart pour lui demander des renseignements sur un de ses protégés. La tête de l’abbé arrivait à peine à l’épaule d’Henry, son ancien camarade de collège, auquel l’unissait toujours une ferme amitié. Dans le visage au teint brun, les yeux foncés pétillaient de vie et de fine intelligence. Ce petit homme, sec et alerte, semblait toujours infatigable. Rien n’arrêtait son zèle et ne lassait sa patience. Il savait, avec un tact extrême, discerner et retenir ce qui, dans les méthodes adverses, pouvait être utilisé avec fruit dans son ministère. Son vieux curé disait : « Moi, je ne puis plus changer. Mais l’abbé Rivors est le prêtre du moment. Il a l’audace et la jeunesse. Le dogme, la morale sont immuables, mais la manière de les prêcher aux foules varie. Aux temps nouveaux, il faut des hommes nouveaux. »
Bruno se rapprocha de l’abbé et d’Henry. Plus jeune qu’eux, il se disait leur disciple. De fait, Jacques et M. de Marges avaient orienté son âme, dès l’adolescence, vers les œuvres de charité et l’apostolat des humbles. Il allait visiter les pauvres, faisait des conférences aux grands jeunes gens du patronage, menait une vie exemplaire et se montrait peu dans le monde. On disait de lui : « Il entrera au séminaire. » Mais il venait d’atteindre vingt-cinq ans sans que cet événement se fût produit.
– On ne te voit plus beaucoup à Varlaumont, Bruno, fit observer M. de Marges.
– J’ai été fort occupé par des recherches dans les archives pour le nouvel ouvrage que je projette.
– Un ouvrage historique ?
– Oui, des épisodes se rattachant à l’histoire de notre Anjou.
– Très bien, cela ! Que chacun fasse connaître sa province, chante les vieilles gloires de notre France et défende nos traditions. Tu seras un de ces chevaliers de la plume, mon cher Bruno.
La belle physionomie virile de M. de Marges s’éclairait d’un sourire. Bruno dit, avec une nuance d’enthousiasme dans la voix :
– C’est mon rêve !
L’abbé lui frappa sur l’épaule.
– Tu peux le réaliser, cousin. Tu as assez de talent pour cela. Emploie-le pour le bien, car autrement, mieux vaudrait que tu sois Jeannet l’idiot.
Bruno dit gravement :
– Tu sais qu’il n’y a rien à craindre de ce côté.
– Oui, nous le savons, mon ami. La vieille moelle de la race est en toi ; tu as puisé à leur source notre morale catholique, nos traditions françaises. De tout ce patrimoine, tu seras le champion.
Les trois dames parlaient de la Hermellière. Hélène de Marges disait son ennui de voir habitée par des étrangers cette demeure si proche de Varlaumont, la propriété de M. de Marges.
– ... Le bon M. de Glamont était un si agréable voisin ! Avez-vous, chère amie, quelques renseignements sur ces Jarlier ?
– Bien peu. Le père occupait une assez belle situation dans l’industrie. Pris de neurasthénie grave, il a dû tout abandonner pour se soigner. Il y a deux jeunes filles, dont l’une de santé délicate, et un fils, avocat à Paris. On dit ces dames mondaines. Mais je n’en sais pas plus long sur ce sujet.
– Nous verrons donc par nous-mêmes, quand le moment sera venu... Henry, il serait temps de regagner Varlaumont. Notre petit Robert doit attendre sa maman avec impatience.
L’abbé Rivors fit observer en souriant :
– Vous aussi avez grande hâte de le retrouver, madame. Vous êtes tout dévouement maternel, nous le savons.
Hélène dit avec une sorte de ferveur :
– Il est si doux de donner tout ce qu’on peut de soi-même à son enfant !
– Oui, c’est doux. C’est un de nos bonheurs.
Le clair regard de Mme Fervières se posait sur Claire, s’arrêtait plus longuement sur Bruno. Celui-ci avait été longtemps de santé délicate et sa mère lui avait donné davantage d’elle-même, de son temps, de sa santé – peut-être aussi de son cœur.
Claire et Bruno reconduisirent leurs hôtes jusqu’à la voiture qui les attendait à la porte de la maison notariale. Bruno rentra seul dans le salon où sa mère causait avec l’abbé Rivors, prêt à partir, lui aussi.
– Toujours charmants, nos jeunes châtelains, dit le prêtre avec un sourire. Mme de Marges, si attachée à ses devoirs d’épouse et de mère, fait par son exemple le plus grand bien dans le pays.
Mme Fervières eut un geste approbateur, en ajoutant :
– Oui, elle est un vivant exemple pour toutes nos jeunes femmes.
Bruno dit pensivement :
– C’est une tâche magnifique, pour un homme, d’amener ainsi son épouse à la connaissance de la vérité.
L’abbé secoua la tête.
– En effet, mais elle n’est pas sans danger. Il y faut des natures d’exception, telles que les leurs. Il faut la confiance, la droiture, la pureté du cœur chez la jeune femme, et, chez l’homme, la foi profonde, réfléchie, pratiquante, avec du tact et une énergie morale qui lui permette de s’élever au-dessus des faiblesses du cœur pour voir avant tout dans sa compagne l’âme dont il est responsable. Henry et sa femme réalisent toutes ces conditions. Mais en thèse générale, je ne connais guère d’apostolat plus périlleux que celui-là.
Mme Fervières, d’une main légère, rangeait des verres sur un plateau. Le soleil, s’insinuant entre les volets demi-clos, frappait le cristal, faisait étinceler l’argent des petites cuillers, enveloppait de clarté les roses blanches qui s’alanguissaient dans un vase à long col. Mme Fervières se pencha pour atteindre une carafe de vin d’Espagne. Ses cheveux, son fin visage se trouvèrent un instant en pleine lumière. Bruno, qui la regardait, dit vivement :
– Oui, il est beaucoup plus sûr, pour un croyant, de rechercher une femme ayant mêmes convictions que lui, une femme comme vous, maman.
Elle se détourna et le considéra, debout devant elle, jeune et charmant, avec son beau regard sans ombre. Les yeux de la mère s’éclairèrent d’un sourire tendre, qui parut se refléter dans ceux de Bruno.
– Désires-tu te marier, mon enfant ?
– Mais non, je n’y songe pas. Je ne sais même si j’y songerai jamais.
– Tu n’as que vingt-cinq ans. Tu as le temps.
Bruno répéta avec un tranquille sourire :
– Oh ! oui, j’ai le temps !
II
5 heures sonnèrent à l’horloge de Sainte-Cécile. Maintenant que le soleil s’abaissait, l’ombre envahissait le petit bois de hêtres et la clarté du jour s’adoucissait dans le sentier où Bruno marchait d’un pas vif, en causant avec un de ses protégés rencontré tout à l’heure. Celui-ci était un grand garçon déhanché, à la face rousselée. Les paupières molles laissaient voir, en se soulevant, des yeux sans nuance précise, très mobiles. Bruno l’admonestait, d’un ton de sévérité patiente. L’autre mâchonnait :
– Je ne dis pas, monsieur Fervières... je ne dis pas...
Mais un pli d’obstination barrait son front sur lequel tombaient des mèches de cheveux roux.
– Promets-moi de t’amender, Pierre ? Sans quoi, nous ne pourrons te garder au patronage.
Le garçon eut un balancement de son grand corps maigre et ses paupières demi-closes clignèrent.
– Le patronage, monsieur Fervières, c’est plus pour moi. J’aurai vingt ans à la Saint-Michel.
– Qu’importe ! Nous vous gardons tous jusqu’à votre mariage, maintenant que nous avons fondé le cercle des anciens.
Un léger rictus souleva la lèvre épaisse de Pierre. Mais il ne répliqua rien. Sous le silence sournois, Bruno comprit cependant. Il retint un geste découragé. Celui-là encore désertait ! Il avait tant soigné, pourtant, si bien entouré de son zèle le jardin en friche que lui représentait cette âme d’adolescent ! Et l’herbe maudite étouffait de nouveau les pâles fleurs si difficilement écloses.
Le sentier, en sortant du bois, se continuait entre des jardins fruitiers, puis, s’élargissant, devenait un chemin étroit encore que bordaient les premières maisons de Sargé, petites villas claires essaimées dans la verdure et les fleurs des enclos. Pierre, en arrivant là, prit congé de Bruno, gauchement, avec une précipitation où il essayait de mettre de l’insolence. Bruno dit avec calme, tentant de rencontrer les yeux qui se dérobaient sous les paupières sans cils :
– Au revoir, Pierre. Si tu as besoin de moi, tu me trouveras toujours prêt à t’aider.
Le garçon murmura un vague « adieu », enfonça sur ses rudes cheveux roux le chapeau qu’il venait de soulever d’une main molle et s’éloigna dans un sentier transversal.
Bruno continua sa route entre les villas blanches. Des bruits de voix, des rires venaient des jardins et derrière les grilles passaient des silhouettes d’enfants et de femmes. Dans l’air chaud flottaient des parfums de fleurs. Le soleil caressait maintenant la cime des arbres et sa lumière arrivait un peu pâlie sur les pelouses, les corbeilles de géraniums et d’héliotropes, les façades claires des maisons.
Bruno ne regardait rien. Il songeait à l’âme de ce jeune homme, naguère enlevée au vice, et qui y retournait. Il se disait : « J’ai lu de la défiance, presque de la haine dans ses yeux. »
Son cœur impressionnable éprouvait une souffrance subtile. Il apportait dans son œuvre d’apostolat un enthousiasme fervent, donnait sans compter son temps et les forces de son âme ; mais l’insuccès le blessait cruellement.
Absorbé dans ses pensées, il atteignit la place de l’Église. L’ombre la gagnait, se glissait sous les arcades de pierre qui longeaient la vieille maison du Dr Harte, envahissait la façade ogivale de Sainte-Cécile. Le fin clocher, seul, plongeait dans la lumière du soleil couchant.
Bruno gravit les trois degrés de pierre noircie. Sous le porche, la grand-porte, ouverte, laissait voir le vaisseau obscur au fond duquel étincelaient les vitraux du XVe siècle, la merveille de Sainte-Cécile. Bruno entra. Il s’engagea dans une des nefs latérales, longea les chapelles qui s’enfonçaient dans l’ombre. Une silhouette de statue, la longue forme blanche d’un mausolée s’estompaient dans cette demi-ténèbres. En ces fins d’après-midi, l’obscurité prenait possession de ce collatéral et l’on ne distinguait plus aucun détail des sculptures, ni des peintures anciennes placées au-dessus des autels. Mais la lumière déclinante, par les trois verrières de l’abside, se répandait dans le chœur en une clarté somptueusement voilée de pourpre, de safran, de vert profond. Le maître-autel de marbre rose, le tabernacle ouvragé par la main pieuse d’un artiste d’autrefois, le dallage du sanctuaire semblaient recevoir le rayonnement d’énormes gemmes ardentes. La mystérieuse et magnifique lumière se glissait jusqu’à la nef, jusqu’au sommet des piliers, jusqu’aux chapiteaux où un imagier inconnu avait ciselé dans la pierre d’étranges petites figures au regard d’extase. Mais son voisinage laissait plus enténébrées les chapelles profondes, sous la voûte abaissée des collatéraux, derrière les larges colonnes supportant un triforium à la balustrade évidée de si délicate manière qu’elle semblait quelque merveilleuse dentelle de pierre tendue au-dessus des arcades en ogive.
Plus douce, plus mystique était la clarté qui, du haut de la verrière représentant sainte Cécile et son époux Valérius, tombait sur la chapelle de la Vierge occupant le fond du transept septentrional. Elle s’harmonisait avec les vieux ors des boiseries, mettait discrètement en valeur les sculptures naïves et charmantes du retable et de l’autel de bois, tous deux du XIe siècle. Dans cette lumière presque céleste se dressait une Vierge au mince visage, aux yeux d’enfant – une Vierge de bois tenant dans ses bras un Enfant-Jésus menu et grave, au geste bénisseur, vieille œuvre d’une beauté primitive, naïvement délicieuse, dont l’auteur demeurait inconnu. Un reflet azuré teintait une partie de la robe de la Mère, dont les siècles avaient patiné la nuance brune. L’Enfant, lui, semblait plongé dans un bain de pourpre – la pourpre sanglante du Calvaire. La tête de la Vierge restait dans l’ombre. On la distinguait cependant, si fine, d’une teinte de vieil ivoire très jauni, avec ses grands yeux de candide innocence un peu baissés vers la terre, pour voir les pauvres de ce monde qui venaient implorer l’Avocate toute-puissante.
Bruno s’arrêta là. Il n’entra pas dans la chapelle, mais s’agenouilla contre la balustrade. Ces haltes dans la paix du sanctuaire, ces minutes de plus intime recueillement étaient une habitude chez lui. Mais jamais il n’en éprouvait autant le besoin qu’à l’instant où une désillusion venait de l’atteindre. C’était chose fréquente dans le genre d’apostolat auquel il s’adonnait. Ces âmes d’adolescents, entre les sollicitations de la rue, l’ambiance trop souvent hostile, en tout cas si indifférente du foyer familial et les mille influences venant battre en brèche leur mince acquis moral et religieux, vacillaient, tombaient souvent. L’abbé Rivors, avec son énergique bonté, en relevait un certain nombre. Mais quelques-uns s’enfonçaient dans la chute. Pierre Milon était de ceux-là.
Près de l’autel, quelques cierges se consumaient avec un léger grésillement. Leur flamme tremblait et jetait des clartés mouvantes sur le visage aux traits fins, au teint d’ambre pâle, sur les yeux qui priaient. Bruno, en ces instants de recueillement, interrogeait le ciel sur l’orientation qu’il devait donner à sa vie. Enfant, adolescent, il n’avait jamais, en ses moments de plus grande ferveur, songé au sacerdoce. Il se contentait d’être un enfant très pieux, très bon, le modèle de sa paroisse. Mais depuis deux ans, il lui semblait entendre l’appel divin. Rien, dans sa vie, ni autour de lui, ne s’opposerait à cette vocation. Son père l’approuverait, sa mère dirait avec allégresse : « Dieu m’a mille fois bénie en un de mes fils. » L’initiation à l’existence nouvelle serait facile. Déjà, il vivait presque en dehors de toutes contingences mondaines. Les labeurs de l’apostolat lui étaient familiers, et sa parole facile, la science acquise à la Faculté trouveraient une prompte utilisation. Son talent d’écrivain lui-même ne serait pas sacrifié ; il s’épanouirait au souffle ardent de la religion dont Bruno serait un des ministres.
Ainsi songeait le jeune homme sous les yeux candides de la Vierge de bois. Son âme se soulevait en un élan mystique vers le Dieu dont il aspirait à devenir l’apôtre. Comme André, comme Simon, les pêcheurs galiléens, il se sentait prêt à tout quitter pour suivre le Christ. Dans le cœur resté pur, l’appel s’était fait entendre. Mais parce qu’il ne le trouvait pas assez distinct, parce qu’il craignait de se tromper, Bruno interrogeait encore.
Quand il sortit de l’église, l’ombre avait envahi toute la place. Le soleil caressait les vieux toits et les étages supérieurs des maisons. La tranquillité de l’après-midi chaud prenait fin, un semblant de fraîcheur faisait sortir les habitants des logis où les fenêtres, une à une, s’ouvraient toutes grandes sous leurs stores relevés. Le vieux curé, qui s’en allait à l’église, donna au passage une amicale chiquenaude sur le bras de Bruno.
– Ça va, chez toi, mon petit ?
– Ça va, merci, monsieur le curé. Et vos rhumatismes ?
– Ah ! les scélérats ! Ne m’en parle pas, tiens ! Si je les tenais !
La bonne figure essayait de prendre un air terrible et s’épanouissait dans un sourire. Il pardonnait toujours, le cher abbé Mimont, même à ses rhumatismes, dénommés souvent par lui ses pires ennemis.
Le petit Dr Harte, qui rentrait chez lui, serra au passage la main de Bruno. Celui-ci demanda :
– Avez-vous été voir ma vieille Margerine, docteur ?
– Oui, oui. Mais il n’y a rien à faire, c’est la vieillesse qui la tient, mon ami. Contre cette maladie-là, je ne puis rien.
Il eut son petit rire narquois qui relevait si drôlement les deux coins de la bouche. Puis, secouant de nouveau la main de Bruno, il s’engouffra sous les arcades de sa demeure.