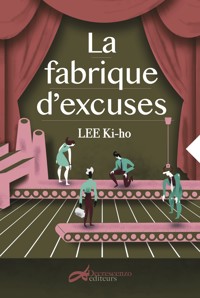
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Decrescenzo
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Quand un centre social devient un centre d’excuses, c’est la terre qui tourne à l’envers ! Deux pensionnaires sont régulièrement chargés de présenter des excuses pour les fautes qu’ils n’ont pas commises. Peu à peu, l’habitude aidant, ils présentent leurs excuses pour les fautes commises par les autres résidents. Lorsque les pouvoirs publics vont fermer ce centre insolite, les deux compères sans travail vont ouvrir une agence spécialisée dans la fabrication d’excuses. Mais c’est compter sans la vengeance des anciens éducateurs… Avec La fabrique d’excuses, LEE Ki-ho tourne en dérision la société coréenne moderne au travers de personnages souvent pathétiques ou marginaux.
À PROPOS DE L'AUTEUR
LEE Ki-ho, né en 1972, possède un doctorat en littérature. Il est actuellement professeur à l’université de Gwangju. Il a fait son entrée sur la scène littéraire en 1999 et a remporté de nombreux prix littéraires, le dernier en date étant le prix Hwang Sun-won, obtenu en 2017. C’est un écrivain connu pour son inventivité narrative.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Contents
I
TROUVER LA FAUTE
1. Les piliers de l’Institut
2. La maison
3. Les éducateurs
4. L’Institut
5. Nos fautes
6. L’aveu, puis la faute
7. Antécédent médical
8. Première rencontre avec Siyeon
9. L’emballage
10. L’homme aux grosses lunettes
11. À la recherche d’un emploi
12. À la recherche des médicaments
13. La faute de la vieille dame
14. Le devoir des représentants
15. Ce qu’on avait oublié
19. Le cas de l’homme aux grosses lunettes
22. La grosse dispute
23. Enseigner la faute
24. Les morts
26. Les choses qui restent après les excuses
II
CRÉER LA FAUTE
1. La visite au parloir
2. Ce que je voulais savoir
3. Les prospectus
4. Le secrétaire général et la vieille cuisinière
6. Le petit oiseau
7. Le client
8. La mère et le fils
9. Un problème de posture
10. L’absence de faute
11. Créer la faute
12. Ce qu’on n’a pas pu dire
13. Des excuses impossibles
14. Le père et le fils
17. Protéger les excuses
18. Des excuses, encore des excuses
19. Les revoilà
III
CULTIVER LA FAUTE
1. Les retrouvailles
2. Une faute en chair et en os
3. Déterrer les fautes
4. Je quitte Sibon
5. Mensonge
6. Personne
7. Des excuses dont j’ignorais tout
8. Cultiver la faute
Landmarks
Cover
LEE Ki-ho
La fabrique
d’excuses
Roman
Traduit du coréen par
Rémi DELMAS
Ouvrage publié sous la direction de
Julien PAOLUCCI
Ouvrage traduit et publié avec le concours del’Institut coréen pour la traduction littéraire (LTI Korea)
Titre original : 사과는 잘해요 [sagwaneun jalhaeyo]LEE Ki-hoCopyright © 2009 Lee Ki-hoÉdition originale publiée en Coréepar Hyundae Munhak Publishing Co., Ltd.
Tous droits réservés
© Édition française publiée avec l’accord de Hyundae Munhak Publishing Co., Ltd.© Decrescenzo éditeurs, 2023pour la traduction françaiseISBN 978-2-36727-123-1
Nos livres, nos auteurs :www.decrescenzo-editeurs.comLa couverture deLa fabrique d’excusesa été réalisée par Thomas GILLANT
I
TROUVER LA FAUTE
1. Les piliers de l’Institut
Sibon et moi, on s’est rencontrés pour la première fois à l’Institut. J’y étais déjà depuis une semaine quand il est arrivé. On a toujours partagé la même chambre. On ne sait pas exactement combien d’années on y a passé ensemble. Parce qu’on ne s’en souvient pas. Je sais que j’ai grandi de six centimètres là-bas. Sibon a pris huit kilos. Il a d’ailleurs atteint la barre des quatre-vingt-quatre y a pas si longtemps que ça. C’est le seul pensionnaire de l’Institut à avoir grossi. Les éducateurs nous demandaient toujours de les remercier. Ils disaient que tout ça c’était grâce aux pilules qu’ils nous donnaient. Sibon et moi on en avalait sans faute quatre, matin et soir. La première fois, on avait eu mal au ventre et la tête qui tournait, comme si on marchait sur une balançoire ; mais après, c’est quand on n’en prenait pas qu’on ne se sentait pas bien. C’est pour ça qu’on attendait toujours l’heure de leur distribution. Quand on entendait les gros pas des éducateurs s’approcher de notre chambre, on volait vers la porte pour s’agenouiller, les mains tendues. On n’a jamais avalé de travers ; les médicaments disparaissaient en un clin d’œil au fond de nos corps.
Quand on ne mangeait pas des pilules, on emballait des chaussettes ou on mettait des étiquettes sur du savon. Sur les boîtes des premières, on collait une photo de tous les membres de l’Institut. Quand elle a été prise, Sibon et moi on se tenait chacun à une des extrémités du dernier rang droits comme des i. Cette photo nous plaisait. Parce qu’on avait l’air d’être les deux piliers de l’Institut. Chaque fois qu’on ne se sentait pas bien on la regardait. Puis on se remettait à emballer des chaussettes. Elles se vendaient bien, peut-être grâce à cette photo.
Les problèmes ont commencé avec l’arrivée dans notre chambre d’un homme assez âgé qui avait une grosse barbe. Il fourrait ses pilules dans sa bouche puis les recrachait dès que les éducateurs avaient disparu. Il disait qu’il n’était pas malade. Il nous a raconté qu’il s’était endormi sur la place de la gare et qu’il s’était réveillé à l’Institut. Sibon a répondu que lui aussi était monté dans une camionnette, place de la gare, et qu’il s’était retrouvé ici. J’ai rien dit.
« Vous voyez ! Vous êtes jeunes, en bonne santé, et vous êtes enfermés ici ! Faut qu’on s’évade le plus vite possible. Et surtout pas prendre ces médicaments ! », a dit l’homme à la grosse barbe en baissant la voix.
Sibon et moi on s’est regardés un instant. L’homme nous dévisageait.
« Mais monsieur, on est les piliers de l’Institut », a répondu Sibon en baissant la voix pour faire comme lui.
J’ai approuvé de la tête. L’homme nous a examinés un bon moment de son lit sans rien dire. Puis il s’est retourné contre le mur. Il ne nous a plus jamais rien demandé.
Chaque jour, l’homme ramenait dans la chambre un morceau de papier qu’il récupérait dans l’atelier et écrivait dessus :
Nous sommes retenus prisonniers. Si vous trouvez ce mot, contactez la police s’il vous plaît. Récompense promise.
Il signait toujours de son nom. Il collait ensuite son papier sur une pierre à l’aide d’un peu de riz qu’il avait d’abord mâché. Le matin, à l’heure du ménage, il jetait le tout par-dessus la clôture de l’Institut.
Il nous faisait de la peine à écrire jusqu’à tard dans la nuit. C’est pourquoi on a décidé de l’aider. Avant de mettre une boîte de chaussettes dans une caisse d’expédition, on ajoutait une note :
Nous sommes retenus prisonniers. Si vous trouvez ce mot, contactez la police s’il vous plaît. Le monsieur de notre chambre dit qu’il vous récompensera.
On signait toujours « Les piliers de l’Institut ». Pour ne pas embarrasser l’homme à la grosse barbe, on écrivait vite et en cachette. Les chaussettes se vendaient bien.
Un matin, exactement un mois après avoir commencé à écrire nos notes, l’Institut a été pris d’assaut par la police, des agents publics ainsi que des journalistes. On les a accueillis en tant que dignes piliers de l’Institut, droits comme des i.
2. La maison
Le directeur est sorti en premier de l’Institut. Il s’est dirigé vers une voiture noire, accompagné de deux policiers. Avant de monter, il s’est retourné pour jeter un coup d’œil aux bâtiments. Sibon et moi on se tenait toujours bien droits devant eux. Nos regards se sont croisés. Comme à notre habitude, on s’est inclinés pour le saluer.
Les deux éducateurs, le secrétaire général, puis la vieille cuisinière sont montés les uns après les autres dans un fourgon de police. Les policiers traînaient la dame de force par les bras. Elle criait : « Moi aussi j’suis une patiente, j’ai pas toute ma tête ! » Les policiers ne répondaient rien. Quelques journalistes se sont approchés pour nous demander :
« Qui sont les piliers de l’Institut ? »
Sibon et moi on a poliment répondu que c’était nous. Plein de gens se sont jetés sur nous. Ils nous posaient des questions d’une voix pressée.
« Comment vous êtes-vous retrouvés ici ?
— Avez-vous été victimes d’actes de maltraitance ?
— Que signifie l’expression les “piliers de l’Institut” ? »
Alors qu’on allait répondre, l’homme à la grosse barbe s’est approché en poussant tout le monde. Il a attrapé nos mains et s’est mis à les secouer. Il n’arrêtait pas de sourire. On ne souriait pas du tout. Il a répondu à notre place. On avait tous été ramassés à la gare, chaque jour les éducateurs et le directeur nous passaient à tabac, la cuisinière nous injuriait. Mais sans jamais dévoiler nos véritables intentions, on avait su gagner la confiance du directeur et on avait réussi à se retrouver en charge de l’emballage des chaussettes. Les « piliers de l’Institut », c’était notre code à nous pour dire qu’on allait faire tomber cette baraque... L’homme n’a pas lâché nos mains de tout son discours. On avait les paumes toutes mouillées de sueur.
Une fois les journalistes partis, des agents publics ont ramené un docteur. Les parents de certains pensionnaires ont commencé à arriver pour les récupérer. Les agents restaient debout à côté du docteur et demandaient :
« Vous voulez aller dans un autre établissement ou rentrer chez vous ? »
Le docteur, tapotant le bureau du bout de son stylo, fixait les pensionnaires du regard. Parfois il bâillait ou dessinait des arbres sur ses notes. Il sentait l’alcool. Les agents publics ne nous ont rien demandé, à Sibon et moi. Ils nous ont pointés du doigt en chuchotant : « Ce sont les lanceurs d’alerte. »
Une fois tout le monde interrogé, un des agents est venu vers nous pour nous donner une enveloppe :
« Vous pouvez rentrer maintenant. »
Dedans, y avait de l’argent pour le transport. L’homme à la grosse barbe est aussi venu nous voir :
« Rentrez bien les piliers. À la revoyure. Si vous voulez me voir, venez du côté de la place de la gare. »
On est sortis par la grille principale. En face de nous, y avait de basses collines avec encore un peu de neige par endroits, ainsi que des bois de pins et de sapins. Sibon et moi on a observé un moment les nuages. Comme des piliers, les arbres semblaient les soutenir.
« Tu vas rentrer chez toi maintenant ? a demandé Sibon.
— J’sais pas où j’habite, j’ai répondu franchement.
— Ah bon ? Moi j’sais où est ma maison », a dit Sibon sans détacher ses yeux des nuages.
En silence, j’examinais le chemin de terre qui rejoignait la grosse route. Dessus, les traces des voitures me rappelaient les barreaux des fenêtres de l’Institut.
« Si on allait d’abord chez moi, vu que j’sais où c’est ? », a dit Sibon en secouant son pantalon.
J’ai approuvé de la tête. On s’est mis doucement en route. Après avoir marché un moment, on s’est retournés pour contempler l’Institut. Vide de tous ses occupants, on aurait dit qu’il allait s’écrouler d’un instant à l’autre. J’étais un peu troublé. On avait passé tant d’années et on avait tant appris là-bas. Y avait vraiment de quoi être reconnaissants. Et voilà que Sibon et moi on quittait cet endroit.
3. Les éducateurs
Après mon arrivée à l’Institut, je me suis fait taper presque tous les jours. On me tapait le matin, on me tapait à midi, on me tapait avant de dormir. Parfois, on ne me tapait pas le matin mais deux fois le soir ; il est aussi arrivé qu’on me tape deux fois à midi puis trois fois le soir. J’ai reçu des coups de bâton, des coups de tuyau en fer, des claques, des coups de poing, des coups de botte militaire ou encore des coups de livre bien épais. On m’a tapé avec une chaise, avec une poubelle, avec des chaussettes et même avec une pelle. Je me suis fait taper comme ça un bon moment, et puis un jour, j’ai regardé à côté, et Sibon était là. Les bras enroulés autour de la tête, il se faisait taper. C’est comme ça qu’on s’est rencontrés. Après ça, on s’est fait taper ensemble tous les jours. On s’est fait taper ensemble sous nos lits, taper ensemble dans le couloir, taper ensemble quand on était appelés dans le bureau, taper ensemble dans l’atelier, taper ensemble sur la colline derrière l’Institut et aussi devant la porte principale. À la longue, on est devenus amis.
C’était les deux éducateurs qui nous frappaient. Deux cousins du même âge, les neveux du directeur. L’un était petit, l’autre grand. Le premier se promenait toujours avec une blouse blanche de docteur, l’autre portait un jean et des bottes militaires. Le petit glissait sa fourchette, sa cuillère ainsi que sa brosse à dents dans la poche gauche de sa blouse ; dans la droite, il gardait une paire de gants en latex. Il les enfilait chaque fois qu’il nous frappait ou qu’il nous donnait nos médicaments. Le grand n’avait presque plus de cheveux. Chaque matin, il lavait longuement ceux qui lui restaient, puis il rabattait les mèches de derrière sur le sommet du crâne et les aspergeait de laque. Il avait toujours un spray ainsi qu’un peigne dans la poche arrière de son jean. Après nous avoir frappés, il se repeignait avec soin. Quand on sentait une odeur de freesia dans l’air, on se disait : « Ah ! C’est fini pour cette fois ! »
Ils occupaient une chambre au premier étage, en face de la nôtre. Contrairement à nous, leur sol avait un parquet, ils avaient un frigo et une grande télé. Ils la regardaient jusqu’à tard dans la nuit – surtout des films avec plus de gémissements que de dialogues. Ensuite, il leur arrivait parfois de téléphoner quelque part. Ils parlaient tour à tour : « C’est bien la maison de la fille aux gros nibards qui a trompé son mari avec moi ? », « Est-ce que tu portes rien que des bas en ce moment ? » Ils raccrochaient en vitesse. On les entendait ensuite rire durant un moment. Sibon et moi on écoutait tout, mais on ne riait jamais. Parce que les éducateurs n’aimaient pas ça.
Il arrivait que le directeur vienne dans leur chambre. Surtout quand les éducateurs n’avaient pas pu nous donner nos pilules à temps parce qu’ils faisaient la grasse matinée. « Bande d’ordures ! », il leur disait. « Bons à rien ! », « Foutus délinquants sans cervelle ! », il disait aussi. Ces jours-là, les éducateurs nous frappaient avant même le petit déjeuner. Ils répétaient les mots du directeur : « Bande d’ordures ! », « Bons à rien ! », « Foutus délinquants sans cervelle ! »
Une fois, le petit a eu la grippe et a dû garder le lit pendant quatre jours. Le grand ne fermait plus l’œil de la nuit. Il trempait sans cesse la serviette du petit dans une bassine et n’arrêtait pas d’aller et venir dans le couloir. Sibon et moi on était réveillés, mais il ne nous donnait aucun ordre. Il allait lui-même demander de la bouillie de riz à la vieille cuisinière, il lavait la blouse blanche du petit et il l’attendait devant la porte des toilettes avec un rouleau de papier à la main. Quand le directeur a débarqué et s’est mis à les insulter à coup de « bande d’ordures ! », le grand s’est levé et lui a répondu en élevant la voix : « Ah, putain. Tu crois pas que t’exagères ? Tu vois bien qu’il va mal ! » Le directeur était furieux, il les a regardés un moment puis est reparti sans rien dire en claquant la porte.
La première chose qu’a faite le petit en se levant a été de nous frapper. Le grand, pour lui faciliter la tâche, nous tenait par les épaules, debout derrière nous.
« Te surmène pas. Faut que tu fasses gaffe pendant quelques jours encore, a dit le grand d’une voix inquiète.
— Ouais, d’accord », a répondu le petit en souriant légèrement tandis qu’il enfilait ses gants.
Sans trop se surmener, le petit nous a seulement donné quelques coups de poing sur la poitrine. Ils avaient la même force qu’avant. C’est comme ça que Sibon et moi on a su qu’il était complètement guéri. Tout ça grâce au grand, on a pensé.
4. L’Institut
L’Institut avait trois bâtiments. Le dos tourné à l’entrée, le premier qu’on voyait était le bâtiment principal où se trouvaient notre chambre et celles des autres pensionnaires. Un édifice blanc d’un étage. Le rez-de-chaussée était occupé par le secrétariat, le bureau du directeur, une salle de repos, une salle d’eau ainsi qu’une buanderie. À l’étage se trouvaient les chambres des pensionnaires et des deux éducateurs. Y avait d’épais barreaux aux fenêtres et les néons des couloirs étaient allumés nuit et jour.
Les chambres se ressemblaient toutes. Six lits en fer, un lavabo sur un des murs. C’est dans ce dernier que les pensionnaires faisaient leur toilette, se lavaient les cheveux, se brossaient les dents, faisaient leur lessive et buvaient. Dans la buanderie, y avait deux machines à laver que l’Institut avait reçues en donation, mais on n’a jamais lavé nos vêtements là-bas. Dans cette pièce, c’est surtout des coups de tuyaux qu’on a reçus.
À la gauche de ce bâtiment se trouvait le logement de fonction du directeur. Une petite maison avec trois chambres, un garage et un toit de tuiles rouges. Le directeur vivait tout seul. Même s’il était bien plus vieux que le secrétaire général et qu’il avait les cheveux tout blancs autour des oreilles, il disait qu’il ne s’était jamais marié. Il n’avait pas d’enfant non plus. En notre présence, et se fichant bien qu’on écoute ou non, les éducateurs disaient souvent au secrétaire général :
« C’est pour ça qu’on est ici. Si quelque chose arrive à notre oncle, ça sera à nous de reprendre l’entreprise familiale. »
Mais quand ils étaient entre eux, ils disaient :
« Ah putain ! Dès qu’il claque, j’construis un terrain de golf ici !
— Mais la dernière fois, t’as parlé d’un love hotel ?
— Ah bon ? Bah en tout cas, dès l’année prochaine faut qu’on rase tout et qu’on commence les constructions. »
À la droite du bâtiment principal, y avait un long hangar, dont une moitié servait de cantine et l’autre d’atelier. Il paraît qu’à l’origine c’était une étable pour vaches laitières, mais qu’elles avaient été toutes vendues bien avant notre arrivée à l’Institut. Les vaches étaient parties, mais le toit en ciment, le sol de béton craquelé ici et là ainsi que l’égout qu’elles avaient contemplés étaient toujours là. Le même long tuyau de fer traversait en largeur un des murs, à la base duquel se dressait la même pile de briques parfaitement entassées. On suspendait les chaussettes à emballer les unes à la suite des autres sur le tuyau. Il nous servait aussi d’appui pour les caisses d’expédition. Quand on avait le temps, on déjeunait assis sur le tas de pierres, en tenant nos plateaux-repas à la main. Lorsqu’on n’avait pas fini notre soupe, on la jetait dans l’égout. Parce que la vieille cuisinière détestait qu’on laisse de la nourriture. La première fois que ça nous était arrivé, elle s’était servie de nos plateaux-repas pour nous frapper à la tête. C’était pareil pour tous les pensionnaires. Que l’on soit âgé ou non, que l’on ait laissé beaucoup de nourriture ou non, peu importe : aucune distinction.
Derrière le bâtiment principal, y avait aussi une petite colline. Elle était couverte de pins, de sapins, et par endroits y avait de gros rochers, des fourrés ainsi que des massifs de mauvaise herbe. Un jour d’hiver où il avait beaucoup neigé, deux lapins étaient descendus de cette colline dans le jardin derrière l’Institut. Le secrétaire général et les deux éducateurs les avaient attrapés vivants, puis les avaient changés en ballons de foot. Parfois ils se faisaient des passes avec dans le jardin. Il arrivait souvent que le ballon termine sur la colline. Chaque fois qu’on assistait à cette scène, Sibon et moi on hochait la tête. Pour une chose venue de la colline, rien de plus normal que de vouloir y retourner, on se disait.
Une haute clôture de fils barbelés s’élevait sur le flanc de la colline. Elle dessinait un demi-cercle et rejoignait le mur d’enceinte de l’Institut. Sibon et moi on s’est rendus deux fois au pied de cette clôture. C’était lorsqu’il avait fallu enterrer des pensionnaires. Si on devait grimper jusque là-bas, c’est parce qu’autour de l’Institut, y avait pas de place convenable pour enterrer quelqu’un. Bien entendu, chaque fois les éducateurs nous avaient accompagnés, mais on était les seuls à creuser. Le sol était dur, plein de cailloux ; nos pelles n’arrêtaient pas de sonner. Les éducateurs se frottaient les mains et répétaient d’une voix agacée : « P’tin, fait froid à en crever. »
5. Nos fautes
Chaque fois que les éducateurs nous frappaient, ils demandaient la même chose :
« Tu sais ce que t’as fait de mal ?
— On te demande si tu sais quelle est ta faute ? »
Au début, je n’avais pas su quoi répondre. Parce que je ne comprenais pas ce que j’avais fait de mal. Tout en me donnant des coups de pied aux fesses ou en me collant des gifles, les éducateurs disaient : « Si on te frappe tous les jours, c’est justement parce que tu sais pas. »
Sibon avait répondu dès son premier jour à l’Institut :
« Oui, j’sais ce que j’ai fait de mal. »
Les éducateurs avaient desserré les poings et l’avaient dévisagé un instant. Moi aussi, je lui avais discrètement jeté un coup d’œil. Sibon avait continué en regardant les éducateurs bien en face :
« Ma faute... c’est que même si on me frappe j’arrive pas à mettre mes idées en ordre. »
Ce jour-là, il s’était fait battre longtemps, au point d’avoir les idées sens dessus dessous. Les éducateurs lui avaient même jeté la poubelle dessus tandis qu’il se protégeait la tête avec ses bras. Grâce à lui, je n’avais presque pas reçu de coups. Aujourd’hui encore, je lui en suis reconnaissant. Y a vraiment de quoi.
C’est aussi à cause de cette histoire de faute que Sibon m’avait adressé la parole. Une nuit noire, étendu sur son lit, il m’avait demandé :
« On a fait quelque chose de mal ? »
Nos lits étaient recouverts d’une fine pellicule de plastique. Sauf les jours où des agents publics visitaient l’Institut, car des draps blancs étaient alors étendus dessus. Tout en tripotant le plastique de mon lit, je réfléchissais à ce que j’avais pu faire de mal. J’avais bien l’impression d’avoir commis quelque chose de terrible, mais je n’arrivais pas du tout à m’en souvenir. C’est pour ça que j’avais gardé le silence.
« Moi j’déteste me faire taper », avait dit Sibon en se tournant vers moi. Son œil, légèrement éclairé par la lumière du couloir, était si enflé qu’il semblait fermé.
« On a beau me frapper, j’peux pas mettre mes idées en ordre », il avait ajouté.
Il va encore se faire tabasser demain, j’avais pensé. C’est pour ça que je ne disais toujours rien. Parce qu’après tout, c’était une chance de plus pour moi.
Pourtant, le lendemain, Sibon avait seulement reçu une paire de claques. Moi, j’avais eu droit à des coups à la poitrine, aux cuisses, aux flancs et sur les joues. Quand les éducateurs lui avaient à nouveau demandé ce qu’il avait fait de mal, Sibon avait répondu d’une voix forte :
« En vrai, j’ai dit des insultes ! »
Alors que le petit enfilait ses gants en latex, il s’était interrompu pour dévisager Sibon.





























