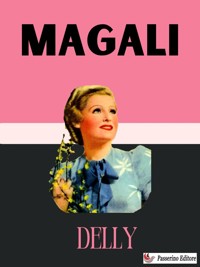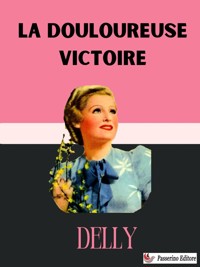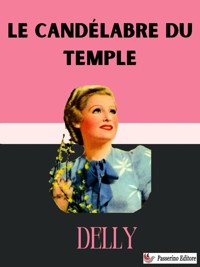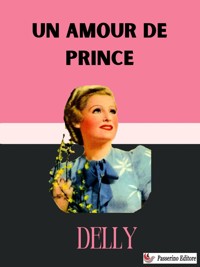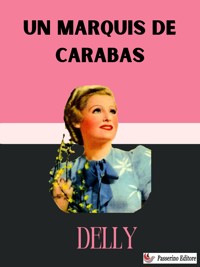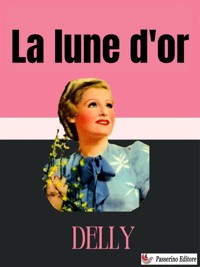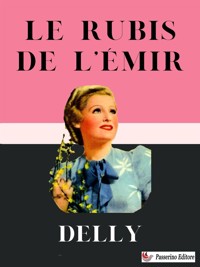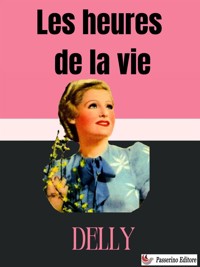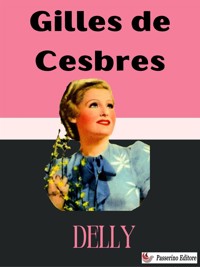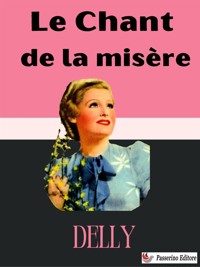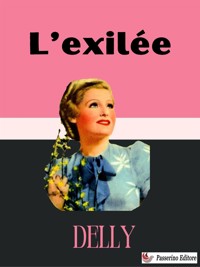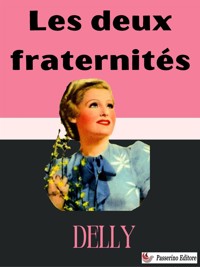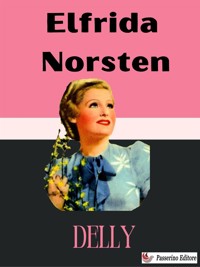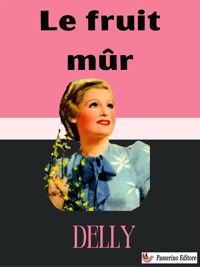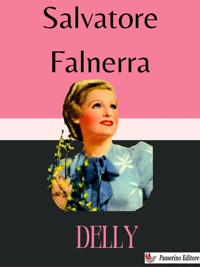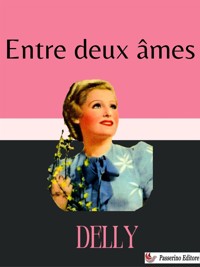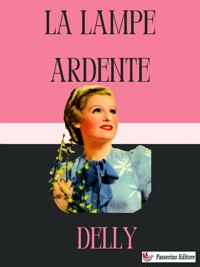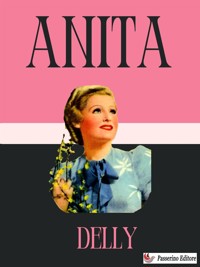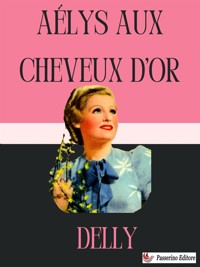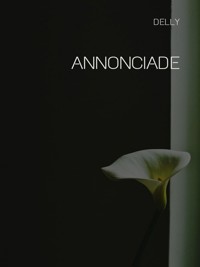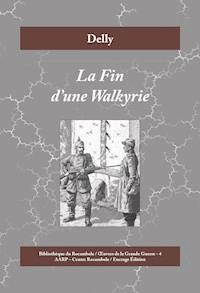
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encrage Édition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Œuvres de la Grande Guerre
- Sprache: Französisch
Une romance au temps de la Grande Guerre...
La Fin d’une Walkyrie — publié à partir de novembre 1915 dans l’
Echo de Paris, puis chez Plon en 1916 — est un « Delly » de facture « classique » qui comprend cependant des éléments insolites, dus à la période de rédaction et de publication, la Grande Guerre de 1914-1918.
Le conflit apparaît clairement comme un tournant et une rupture dans l’œuvre de Delly, le début d’une expansion thématique qui se développera dès le titre suivant,
Le Mystère de Ker-Even.
Une fiction historique captivante qui mêle habilement sentiments et conflit militaire.
EXTRAIT
Une lampe électrique, coiffée d’un abat-jour couleur de pourpre, éclairait le petit fumoir décoré avec un goût sobre. Dans la clarté douce, un peu rosée, se détachaient le visage énergique et froid du comte Boris Vlavesky, avec ses yeux songeurs, souvent ironiques, toujours énigmatiques, et près de lui la pâle et mince figure du comte Cyrille, son cousin germain.
Ils appartenaient tous deux à une race ancienne et très noble. Le père de Boris avait dilapidé au jeu une grande partie de sa fortune, et sa mère avait vu la sienne diminuée par de mauvais placements. La comtesse, veuve depuis une dizaine d’années, administrait le domaine de Klevna, dont elle versait à son fils les revenus. Ceux-ci, bien qu’assez considérables encore, semblaient peu de chose à un homme tel que le comte Boris, élevé dans le luxe, ayant reçu la plus brillante éducation et possédant tous les goûts du grand seigneur. Néanmoins, on ne lui avait jamais connu de dettes. Il détestait les cartes, ne pariait pas aux courses, et nul ne se souvenait de l’avoir vu prendre du champagne plus que de raison, au cours des parties fines entre jeunes officiers.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Avec
La Fin d'une Walkyrie, c'est un véritable roman russe, admirablement « senti » et documenté, qu'a écrit la célèbre romancière. -
Migdal, Babelio
À PROPOS DE L'AUTEUR
Derrière le nom de
Delly se cache en réalité un frère et une soeur, Jeanne-Marie et Frédéric Petitjean de la Rosière. Ayant connu un succès retentissant, ces deux écrivains sont emblématiques de la littérature populaire de la première moitié du XXe siècle. Adoptant une attitude moraliste dans leurs oeuvres, leurs romans revêtent pour la plupart un caractère sentimental.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage est proposé dans le cadre des ressources du Centre Rocambole accessible par Internet à l’adresse :
www.lerocambole.net
Edition électronique réalisée avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Picardie
Bibliothèque du Rocambole
Œuvres de la Grande Guerre - 4
collection dirigée par Alfu
Delly
La Fin d’une Walkyrie
1914
AARP — Centre Rocambole
Encrageédition
© 2012
ISBN 978-2-36058-909-8
Avertissement
de Philippe Nivet
Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Picardie
Directeur du Centre d’histoire des sociétés, des sciences et des conflits
Pendant la Première Guerre mondiale, la diffusion de la culture de guerre passe par différents vecteurs : la presse enfantine, à l’image du journalFillette, la presse illustrée, commeL’IllustrationouLe Miroir, ou les estampes, à l’exemple de celles de Jean-Louis Forain.
Le roman populaire, souvent publié d’abord en feuilleton, participe également de cette diffusion.
Exemple notoire : dans L’Eclat d’obus, roman de Maurice Leblanc, initialement publié dans les colonnes du Journal en 47 feuilletons quotidiens à l’automne 1915, on trouve ainsi de multiples dénonciations de la « guerre à l’allemande », marquée par les violations du droit des gens : « Assassiner et espionner, c’est pour [les Allemands] des formes naturelles et permises de guerre, et d’une guerre qu’ils avaient commencée en pleine période de paix ». Guillaume II y est présenté comme « le plus grand criminel qui se pût imaginer », tandis que les actes commis par les soldats allemands lors de l’invasion y sont résumés de manière saisissante : « Partout, c’était la dévastation stupide et l’anéantissement irraisonné. Partout, l’incendie et le pillage, et la mort. Otages fusillés, femmes assassinées bêtement, pour le plaisir. Eglises, châteaux, maisons de riches et masures de pauvres, il ne restait plus rien. Les ruines elles-mêmes avaient été détruites et les cadavres torturés ».
Si son insertion, en 1923, dans la série des Arsène Lupin a donné à ce roman une audience particulière, les thématiques qu’il développe se retrouvent dans d’autres textes de Maurice Leblanc et dans ceux de la plupart des auteurs populaires du temps, depuis Gaston Leroux jusqu’à Delly, en passant par Jules Chancel ou les auteurs des brochures de la collection « Patrie », tel Gustave Le Rouge ou Léon Groc.
Encrage Edition et le Centre Rocambole (centre de ressources international fondé par l’Association des Amis du Roman Populaire) ont la judicieuse idée d’exhumer ces documents et de les republier dans cette période marquée par la célébration du Centenaire de la Première Guerre mondiale. Le lecteur de ce début du XXIe siècle y verra comment étaient célébrés les soldats français, héroïques quels que soient leur âge et leur parcours antérieur, dénoncés les espions travaillant de longue date au profit de l’Allemagne et condamnées les atrocités de l’invasion. C’est toute une culture de guerre, assimilée par certains à un « bourrage de crâne », que l’on retrouve.
Préface
de Jean-Luc Buard
Quand Delly s’en va-t-en guerre…
S’inscrivant dans la suite du dossier paru dans la revue Le Rocambole1 en 2011, la réédition d’un roman de Delly — une première en France depuis 1984 — fait figure d’événement. Le dossier voulait montrer combien cet auteur a été emblématique du roman populaire au XXe siècle, exacerbant la tendance sentimentale du genre, tout en parcourant son entière gamme thématique au fil du déroulement d’une œuvre qui se révélait fort mal connue, bien que parmi les plus lues.
Nous souhaitons à présent proposer un choix de romans permettant d’approcher cette diversité thématique, et la faire découvrir aux amateurs. Le premier titre retenu est le 42e paru depuis 1903 — l’auteur est en pleine possession de son métier.
La Fin d’une Walkyrie — publié à partir de novembre 1915 dans l’Echo de Paris, puis chez Plon en 1916 — est un « Delly » de facture « classique » qui comprend cependant des éléments insolites, dus à la période de rédaction et de publication, la Grande Guerre de 1914-1918.
De fait, l’action est située d’abord en Russie — à Pétersbourg, au domaine de Marniew, celui de Klevna, au village de Drovno — puis en Prusse — château de Neidelberg, — pour se terminer dans un hôpital à Varsovie, ce qui est peu commun, avec un long passage sur la Riviera — à Cannes, — région où l’auteur a situé plusieurs de ses romans.
Par « Delly classique », il faut entendre un roman où les personnages ont ces caractères tranchés qui reviennent souvent chez l’auteur, un héros orgueilleux, riche, froid, supérieurement intelligent, le comte Boris Vlavesky — s’opposant à son poète de cousin, plus faible, Cyrille. Ce célibataire énergique accepte la tutelle d’une orpheline de 16 ans — autre type de situation classique chez Delly, — très sauvage et rebelle (« On ne peut en venir à bout »). Aniouta Ivanovna est « une enfant à transformer en jeune fille », une « plante sauvage » à qui pourtant on a inculqué quelques principes moraux et religieux. Ces deux personnages que tout éloigne sont destinés à se rapprocher, selon la logique romanesque dellyenne, à travers des indices semés à dessein — Boris remarquant d’emblée le charme d’Aniouta, tout en observant un scepticisme et une distance hautaine et dédaigneuse.
A ces éléments de base se superpose une intrigue mâtinée d’espionnage avec un groupe de personnages antipathiques, menés par le baron Wilhelm de Stretzbach, amateur d’« élucubrations pangermanistes » célébrant la puissante Allemagne à travers la poésie de Gerhard Hessling, « chantre des Walkyries guerrières ». Celles-ci s’incarnent en la personne de Brunhilde — Mlle de Halweg, « âme violente, passionnée, inquiétante », — femme fatale — autre archétype dellyen — qui séduira le jeune Cyrille, jusqu’au mariage, pour lui soutirer des renseignements militaires intéressant la défense nationale russe.
On notera la présence parmi les personnages secondaires d’un officier Français, Brégny, qui n’est pas dupe des manœuvres sournoises de la Walkyrie et y répond en l’intoxicant par des informations fantaisistes au sujet de « la valeur comparée des artilleries européennes » !
La deuxième partie se situe à Cannes, dont le centre-ville est évoqué avec quelque détail, car les personnages y circulent beaucoup à pied : la gare ; le Grand Hôtel, qui héberge la colonie russe ; la route de Fréjus, où se trouve la villa Flora de Mme Zernof ; la Croisette jusqu’à la Bocca, promenade du Midi ; la route d’Antibes, où se trouve la villa Xénia ; l’église russe de l’avenue Alexandre ; l’observatoire de Cannes ; le cap d’Antibes ; le salon de thé Rumpelmayer — lieu dellyen par excellence. Le grand-duc Paul (1860-1919) est signalé comme séjournant dans la ville à l’époque du récit.
Sur le plan musical, sont interprétés, au fil du texte, une sonate de Haydn, un adagio de Beethoven, et la Walkyrie est naturellement une idolâtre de Wagner…
Sur le plan social, diverses allusions montrent la prise en compte, par Delly, d’évolutions de comportement : la pratique du « flirt », de la photographie ou du tennis par les personnages, comme l’Anglaise miss Annabel Strumps, ou l’habitude de fumer des cigarettes chez les hommes.
Sur le plan historique enfin, ce roman est riche d’allusions : depuis la dépêche d’Ems déclenchant la guerre de 1870 jusqu’au changement de nom de Pétersbourg qui devient Petrograd en 1914, en passant par la défaite allemande de Prasnych sur le front russe, en juillet 1915, ou les Dardanelles.
En effet, dans la troisième partie, l’Histoire rejoint brutalement la fiction et tous ces personnages se retrouvent plongés dans la Grande Guerre. Le drame se précipite, comme s’il résultait des manœuvres évoquées auparavant par allusion. Ce qui pouvait paraître un simple batifolage sans conséquence en temps de paix de la part de Brunhilde — c’est-à-dire la trame sentimentale classique telle que Delly l’écrivait jusqu’alors, — révèle sa véritable nature — certes prévisible de par sa qualité de « Walkyrie », — et ses conséquences terrifiantes. Discrètement, l’espionnage a circonvenu le sentimental. Ce contraste saisissant est nouveau chez Delly.
La Grande Guerre apparaît clairement comme un tournant et une rupture dans son œuvre, le début d’une expansion thématique qui se développera dès le titre suivant, Le Mystère de Ker-Even.
1LireLe Rocambolen°55-56 (été-automne 2011).
Première partie
1.
Une lampe électrique, coiffée d’un abat-jour couleur de pourpre, éclairait le petit fumoir décoré avec un goût sobre. Dans la clarté douce, un peu rosée, se détachaient le visage énergique et froid du comte Boris Vlavesky, avec ses yeux songeurs, souvent ironiques, toujours énigmatiques, et près de lui la pâle et mince figure du comte Cyrille, son cousin germain.
Ils appartenaient tous deux à une race ancienne et très noble. Le père de Boris avait dilapidé au jeu une grande partie de sa fortune, et sa mère avait vu la sienne diminuée par de mauvais placements. La comtesse, veuve depuis une dizaine d’années, administrait le domaine de Klevna, dont elle versait à son fils les revenus. Ceux-ci, bien qu’assez considérables encore, semblaient peu de chose à un homme tel que le comte Boris, élevé dans le luxe, ayant reçu la plus brillante éducation et possédant tous les goûts du grand seigneur. Néanmoins, on ne lui avait jamais connu de dettes. Il détestait les cartes, ne pariait pas aux courses, et nul ne se souvenait de l’avoir vu prendre du champagne plus que de raison, au cours des parties fines entre jeunes officiers.
Un de ses camarades avait dit de lui : « Il n’y a pas d’homme qui soit plus parfaitement maître de soi, et qui apporte jusque dans le plaisir tant de clairvoyance, de scepticisme, avec la volonté de n’être jamais dominé ou enchaîné. »
Fort intelligent, doué d’une rare capacité de travail, le capitaine Vlavesky était noté comme le plus remarquable parmi les officiers des gardes à cheval. Nul mieux que lui, avec ce mélange de fougue et de froide autorité qui le caractérisait, ne savait entraîner ses hommes et s’en faire aveuglément obéir. Très estimé de ses chefs, possédant en outre la faveur impériale, il jouissait d’un fort grand prestige dans le corps d’élite dont il faisait partie.
Sa nature demeurait secrète, même pour ses meilleurs amis. Jamais il ne se livrait, et de ce fait, il avait une réputation de froideur, d’orgueilleuse réserve, qu’il semblait se plaire à entretenir. Mais on le tenait pour un camarade généreux, chevaleresque, et l’on cédait volontiers à son influence, à ce charme impérieux qui se dégageait de toute sa personne, de ses yeux surtout, bleus comme une eau profonde, mystérieux comme elle, ardents ou dédaigneux, selon les moments, et fréquemment songeurs.
Sa mère, nature froide et vaniteuse, s’était peu souciée de son éducation morale. Seuls lui importaient l’intelligence, les dons physiques très brillants, les succès mondains de ce fils unique, héritier de la vieille race. Elle l’avait élevé dans l’égoïsme, dans le culte de soi, elle s’était préoccupée d’en faire, avant toute chose, un grand seigneur très élégant, de goûts raffinés. Maintenant, elle n’avait plus qu’un désir, celui d’un opulent mariage qui redonnerait à Boris la situation d’autrefois.
Les occasions ne manquaient pas, le comte Vlavesky étant l’un des hommes les plus remarqués dans le monde de la cour et dans la haute société de Pétersbourg. Mais Boris demeurait complètement irréductible. Il entendait conserver, pendant quelques années encore, sa complète indépendance. Devant cette déclaration catégorique, la comtesse avait compris l’inutilité de l’insistance, sachant, mieux que personne, combien peu malléable était la volonté de son fils.
Tout autre, physiquement et moralement, était le comte Cyrille. Orphelin, de faible santé, de goûts simples, il se trouvait pourvu d’une énorme fortune dont il n’usait guère. Sa plus grande distraction était la poésie, dans laquelle il ne réussissait pas mal. Nature faible et sensible, ayant souffert dans son enfance du caractère atrabilaire de son père, il s’était profondément attaché à son cousin, dont la loyauté lui inspirait confiance, dont la vigueur physique et la volonté dominatrice le subjuguaient. Il l’admirait comme un être supérieur, lui demandait volontiers conseil et n’avait rien de caché pour lui. Boris, de son côté, lui témoignait une affection protectrice et prenait plaisir à le traiter en petit garçon, ce qui semblait à Cyrille tout naturel.
Ils fumaient tous deux, ce soir, après le dîner que Cyrille était venu prendre chez son cousin, en attendant de se rendre à une soirée où ils étaient invités. Quand la pendule sonna neuf heures, Boris fit observer nonchalamment :
— Il serait peut-être temps de songer à nous rendre là-bas, Cyrille ?
— Oh ! rien ne presse ! Nous sommes parfaitement bien ici… Beaucoup mieux que dans ces salons surchauffés.
Boris se mit à rire, en enveloppant d’un regard amusé le mince visage aux yeux clairs et rêveurs.
— Le monde ne t’attire toujours pas davantage, mon cher ? Tu lui préfères décidément les cieux étoilés de la poésie ?
— Certes, oui ! Si je ne craignais de froisser l’excellente Mme Sternof, je serais demeuré paisiblement au logis, où m’attend un poème commencé.
— Bah ! cela te fera du bien, mon petit ! Et puis, on en dira, des poèmes, chez Mme Sternof, car c’est une soirée littéraire, paraît-il.
— En effet, le baron de Stretzbach doit nous faire connaître les œuvres d’un nouveau génie surgi en son pays… Entre nous, Boris, ne trouves-tu pas qu’il y a un peu trop d’Allemands, chez notre vieille amie ?
— Sa mère était d’origine poméranienne, ne l’oublie pas. Mais j’ajoute aussi que, pour mon goût, l’élément germanique commence à dominer un peu trop, dans ces réunions. Je n’ai pas une particulière tendresse pour ces voisins entreprenants, déloyaux, dont on ne se défie pas assez, chez nous.
Une lourde et somptueuse portière orientale fut soulevée à ce moment, livrant passage à un domestique apportant le courrier du soir, qu’il posa sur la petite table de marqueterie, près de son maître.
Boris se pencha, y jeta un coup d’œil et prit sans empressement une enveloppe bordée d’un mince filet noir, en disant :
— Une lettre de ma mère.
Il la décacheta d’une main distraite et commença de la parcourir. Mais sa physionomie devint plus attentive, après les premières lignes…
« Une chose ennuyeuse nous arrive, mon cher Boris. Ainsi que tu l’as su par ma dernière lettre, mon cousin, le comte Verenof, est décédé presque subitement dans sa propriété de Marniew. Il laisse une petite fille, complètement orpheline, dont nous sommes les seuls parents, assez éloignés d’ailleurs. Or, son notaire vient de m’écrire que ses biens se trouvent entièrement grevés d’hypothèques — et de ce fait l’enfant est sans fortune. Si nous ne la recueillons, elle n’a d’autre ressource que de travailler pour vivre. C’est une fillette de seize ans — et qui ne paraît pas du tout son âge, ajoute le notaire. Elle a reçu, paraît-il, une éducation et une instruction assez fantaisistes — ce que je traduis ainsi : elle est fort mal élevée.
« Que veux-tu faire ? Car c’est à toi de décider, d’autant plus que tu devrais accepter la charge de la tutelle. Evidemment, nous pouvons avoir beaucoup d’ennuis avec cette enfant inconnue. En outre, nos revenus ne nous permettent plus les grandes générosités d’autrefois. Si tu juges néanmoins impossible de nous soustraire à ce devoir, je la ferai venir, et nous verrons ce qu’il est possible d’arranger à son sujet. Toute ma crainte est qu’elle ne soit par trop insupportable… »
Boris interrompit là sa lecture, en disant entre ses dents :
— Eh bien, ce serait intéressant, en effet !
Cyrille demanda, en jetant un coup d’œil étonné sur la physionomie contrariée de son cousin :
— Quoi donc ?
Boris lui tendit la lettre.
— Tiens, lis ! Un beau pavé qui me tombe sur le dos !
Pendant que Cyrille parcourait à son tour la lettre de la comtesse, l’officier s’enfonça dans son fauteuil, les sourcils froncés, les lèvres plissées par le mécontentement, sous l’élégante moustache blonde.
Accoutumé de tout rapporter à soi, de n’envisager toujours que sa propre satisfaction, il ne pouvait considérer sans déplaisir la perspective de cette tutelle et de cette charge pécuniaire.
En achevant sa lecture, Cyrille se mit à rire.
— Eh bien, mon ami, c’est une charge de père de famille qu’on t’offre là ! Evidemment, tu n’es pas tout à fait indiqué pour remplir ce rôle… Une pupille de cet âge-là, surtout… Comme tuteur, tu ne seras pas banal… Prends garde que la jeune personne ne devienne amoureuse de toi, en coup de foudre !
Boris leva les épaules. Il étendit la main et prit distraitement un des œillets jaunes qui trempaient dans un vase de cristal posé parmi les pièces d’un ancien et superbe nécessaire de fumeur.
Cyrille poursuivit, tout en mettant la lettre sur la table près de son cousin :
— Je comprends ton embarras… Refuser est difficile…
— Très difficile… Le degré de cousinage, il est vrai, remonte assez loin. Néanmoins, ma mère se trouve être la plus proche parente de cette orpheline. Or, chez nous, les membres appauvris de la famille ont toujours été secourus. Mais la chose était facile, autrefois, quand il s’agissait simplement de distraire une somme plus ou moins considérable de très gros revenus, qui ne s’en portaient pas plus mal. Il en va autrement, désormais, et une tutelle de ce genre représente une charge à la fois pécuniaire et morale. Cette enfant, nous ne la connaissons pas. D’après le peu qu’en dit le notaire, elle doit être ignorante, mal élevée, — en un mot, parfaitement insupportable. Perspective charmante, qu’en dis-tu ?
— En vérité, oui !… Si tu te décides à endosser tous ces ennuis, que ferez-vous d’elle ?… Car je doute que ta mère soit disposée à s’en occuper.
— Certainement non ! Nous la mettrons dans un institut où l’on se chargera de son instruction et de son éducation… Mais ensuite, il faudra songer à l’établir… Quel plaisir cela nous promet !
D’un geste impatient, il froissa entre ses doigts l’œillet jaune avec lequel sa main jouait machinalement.
Cyrille fit observer :
— Il me semble qu’à ta place, je ne me déciderais pas avant de connaître le sujet. Vous pourriez en avoir trop d’ennuis plus tard.
— Tu as raison. D’autant plus qu’il est également préférable de voir par moi-même, là-bas, quelle est vraiment la situation pécuniaire. Je demanderai une permission ces jours-ci, et dès demain j’écrirai à ma mère, afin qu’elle me donne les renseignements nécessaires pour atteindre le lieu où gîte ma future pupille… Je sais qu’il se trouve dans le gouvernement de Smolensk. Ce n’est pas au diable, heureusement. Mais le chemin de fer doit passer assez loin du domaine. Aussi est-il probable que j’irai en automobile.
— Le connaissais-tu, ce comte Verenof ?
—Je l’ai vu naguère, une fois, quand j’étais tout petit garçon. A cette époque, il avait encore une belle fortune. C’était une espèce d’original, prodigue, cerveau brûlé, rendant fort malheureux sa femme et son fils. Il n’existait aucune sympathie entre mes parents et lui, de telle sorte que le rapport de famille avaient peu à peu cessé… J’espère que la petite-fille ne ressemble pas, moralement, au grand-père ! Enfin, nous l’enfermerons en pension, et nous l’y laisserons le plus longtemps possible… Sur ce, mon petit, partons, car nous risquerions de manquer le plus beau de la soirée, c’est-à-dire la révélation de ce poète germanique, par mon ennemi intime, le baron de Stretzbach.
Il se leva, un sourire moqueur aux lèvres, et sonna pour qu’on lui apportât son manteau. Cyrille, avec un visible regret, quitta aussi son siège. Près de la haute stature à la fois élégante et vigoureuse de son cousin, il semblait encore plus mince, plus chétif, et la hautaine aisance de l’officier faisait mieux ressortir la gaucherie des mouvements, l’incertitude des manières et de l’allure, chez le jeune comte Vlavesky.
Cyrille dit d’un ton surpris :
— Ton ennemi ? J’ignorais qu’il le fût !
Boris eut un léger éclat de rire en regardant son cousin avec un amusement railleur :
— Tu es toujours dans les nuages, mon cher. Rien d’étonnant à ce que tu ignores l’antipathie dont m’honore M. de Stretzbach, jaloux de moi, paraît-il.
— Ah ! vraiment !… Jaloux ?… A propos de qui ?
L’officier rit de nouveau, tout en s’enveloppant dans le grand manteau de garde à cheval que son valet de chambre venait de poser sur ses épaules.
— Jaloux de moi en général, mon ami, parce qu’il voudrait accaparer pour lui toute l’attention ; jaloux aussi en particulier, car il avait commencé de faire la cour à la princesse Etschef, quand il s’est aperçu que je l’avais devancé. Ce sont des choses qu’on ne pardonne pas, surtout lorsqu’on a, comme lui, une si haute opinion de sa personne.
Avec un dédaigneux mouvement d’épaules, le comte acheva :
— C’est un imbécile…
Mme Sternof, chez qui se rendaient les deux cousins, était la veuve d’un éminent diplomate. Elle avait conservé des relations avec le personnel des différentes ambassades, qu’elle réunissait dans ses salons aux membres de l’aristocratie russe. On venait volontiers chez elle, certain de s’y amuser, cette vieille dame ayant conservé, sous ses cheveux blancs, beaucoup d’entrain et une réelle ingéniosité pour découvrir de nouveaux sujets de distraction. Quelques-uns de ses hôtes habituels l’aidaient dans cette tâche, et particulièrement le baron Wilhelm de Stretzbach. Les idées de celui-ci n’étaient pas toujours d’un goût parfait ; mais cette société mondaine où s’insinuait, nombreux, l’élément germanique, ne se montrait pas fort difficile, en dehors de quelques exceptions, telles que Boris Vlavesky et son cousin, appréciateurs d’un esprit plus fin.
Au moment où les deux jeunes gens entraient dans les salons, M. de Stretzbach commençait la récitation des poèmes annoncés comme une œuvre de génie. Leur auteur s’appelait Gerhard Hessing. Il avait trente ans, professait à l’Université d’Heidelberg, et venait d’épouser la fille d’un médecin de Breslau.
En vers durs, martelés, il célébrait la lutte pour l’empire du monde, les triomphes à venir de la glorieuse Allemagne. Il chantait les Walkyries guerrières passant, radieuses, parmi le sang et les ruines, en brandissant le glaive allemand. Les flammes des incendies s’élevaient, les cris des mourants déchiraient l’air… Et parmi les visions sanglantes, parmi tout ce drame complaisamment évoqué, voici qu’apparaissait la note sentimentale, sous la forme de strophes adressées à Rosa, la fiancée, « Rosa, blonde et forte Germaine, compagne de l’Allemand vainqueur ».
Le poème ne manquait pas de souffle, ni d’une certaine beauté brutale. Mais la persistance des évocations de meurtre et d’incendie, la complaisance un peu lourde et naïvement orgueilleuse avec laquelle l’auteur exaltait les vertus, les grandeurs et la gloire à venir de sa « colossale Germania », finissaient par impressionner désagréablement les auditeurs non Allemands — ou, tout au moins, certains d’entre eux, parmi lesquels le comte Boris Vlavesky.
Il était demeuré avec son cousin à l’entrée du salon où Wilhelm de Stretzbach, un grand blond raide et poseur, assez beau garçon, disait les strophes guerrières, dans sa rude langue allemande. Tout en écoutant, Boris laissait errer son regard sur la réunion. Un instant, il s’arrêta sur une jeune femme fort jolie, élégante et fine, qui l’avait aperçu et lui adressait un signe de bienvenue discret. C’était la princesse Catherine Etschef, dont la passion pour le comte Vlavesky était connue de tout Pétersbourg. Boris la salua de loin, puis continua d’examiner la salle remplie de femmes luxueusement parées.
Il connaissait toutes celles qui étaient là — toutes, sauf cette belle personne vêtue de soie jonquille, assise près de Mme Sternof.
De lourds cheveux bruns, massés en forme de casque, coiffaient une tête au port altier. Les traits étaient beaux, mais durs, tout au moins au repos, le teint d’une blancheur qui semblait marmoréenne. La taille devait être superbe, autant qu’on en pouvait juger en voyant assise l’étrangère. Et la toilette, en dépit de quelques fautes de goût qui frappaient le coup d’œil exercé du comte Vlavesky, était celle d’une grande dame.
Il pensa : Je parierais que c’est une Autrichienne ou une Allemande !
Son regard intéressé demeurait attaché à l’inconnue. Elle restait immobile, les paupières mi-closes, les mains croisées sur son éventail de plumes noires. De temps à autre, un frémissement agitait ses lèvres. C’était la seule marque visible d’émotion, chez elle, tandis qu’elle écoutait le poème sanguinaire qui faisait passer des frissons d’émoi sur les épaules des autres femmes.
Et le baron de Stretzbach acheva, en regardant cette fois la belle étrangère :
« Les Walkyries sont prêtes, les Walkyries viennent au secours de la Germanie. O Brunhilde, Freya, ô vous toutes, vierges farouches, accourez, venez étendre sur les guerriers vos mains triomphantes, et quand le glaive ennemi fauchera les fils d’Allemagne, emportez-les dans les demeures de Wotan, où ils boiront l’hydromel et le vin mousseux en contemplant la Germanie victorieuse, maîtresse du monde. »
A cette péroraison, Boris fronça les sourcils et se pencha vers l’oreille de son cousin.
— Voilà des élucubrations pangermanistes que ce Stretzbach aurait pu garder pour les servir en petit comité allemand. Ici, elles sont complètement déplacées, pour ne rien dire de plus… Mais j’aime beaucoup la mention du « vin mousseux ». C’est un petit rappel très savoureux du goût des Teutons pour le champagne de nos amis les Français. Evidemment, Wotan ne peut manquer d’en abreuver pour l’éternité ses bons guerriers allemands, saturés de bière sur la terre.
Il eut un léger rire moqueur, auquel fit écho un de ses camarades de la garde, Grégoire Milskof, qui se trouvait près de là et l’avait entendu.
Boris lui demanda :
— Savez-vous, Grégoire Paulovitch, qui est cette belle personne ?… tenez, là-bas, en robe jaune…
L’étrangère s’était levée, et allait vers M. de Stretzbach, qui descendait du petit théâtre aménagé à demeure dans ce salon. Sa taille souple et majestueuse s’accordait bien, comme l’avait pensé Boris, au caractère altier de sa physionomie.
— Oui, très belle, hein ?… C’est une Allemande, parente de M. de Stretzbach, Mlle de Halweg, dont le père est un ex-diplomate…
— Halweg ? J’ai en Allemagne des cousins de ce nom.
— Vous avez des cousins allemands, Boris Vladimirovitch ?
— Une sœur de ma trisaïeule paternelle avait épousé un baron de Halweg, en Prusse orientale. Depuis lors, les relations entre les deux familles se sont espacées, puis ont cessé complètement.
Cyrille fit observer :
— Ces Halweg-là peuvent appartenir à une autre branche.
— C’est possible. D’ailleurs, peu m’importe, car je ne me soucie guère de nouer des rapports avec cette parenté lointaine. Libre à toi, Cyrille, si le cœur t’en dit ?
Le jeune comte Vlavesky ne répondit pas. Il attachait un regard attentif sur la belle Allemande, qui écoutait avec indifférence M. de Stretzbach, très empressé près d’elle.
Boris, passant à travers les groupes en saluant les visages de connaissance, alla présenter ses hommages à la maîtresse du logis, fort affairée. Puis il rejoignit la princesse Etschef et s’assit près d’elle, en attendant que fût donné le signal des danses.
Un regard l’avait suivi, et ne le quittait plus. Mlle de Halweg, interrompant sans façon le baron de Stretzbach, lui demanda, en désignant Boris d’un mouvement de tête :
— Quel est ce jeune officier, là-bas ?
— Lequel ?
— Le grand, si élégant, qui cause avec cette jeune femme blonde, vêtue de rose ?
La physionomie de Wilhelm se durcit, tandis qu’il répondait brièvement :
— Le comte Boris Vlavesky, capitaine aux gardes à cheval.
— Le comte Vlavesky ?… Serait-ce un des cousins de mon père ?
— Vous êtes parente des Vlavesky, Brunhilde ?
— Oui, quelque peu… Il faudra que vous me présentiez ce beau garde à cheval, Wilhelm.
Une lueur d’irritation passa dans les prunelles claires du baron.
Il dit ironiquement :
— Vous aurait-il déjà tourné la tête ? Prenez garde, Brunhilde, car il est coutumier du fait.
Elle eut un sourire qui détendit ses lèvres un peu grandes, et ses yeux à la nuance indécise s’animèrent d’un éclat railleur.
— Je m’en doute ! Il n’y a qu’à le voir… Et je vous soupçonne, mon cher cousin, d’être horriblement jaloux des succès d’un pareil rival.
Wilhelm retint une grimace de colère, et riposta d’un ton rogue :
— Nous ne sommes pas rivaux. Les goûts du comte Vlavesky ne sont pas les miens.
— Vous avez tort, car je l’imagine bon connaisseur en matière d’élégance et de charme… Ainsi, cette jeune femme avec laquelle il s’entretient est délicieuse. Qui est-elle ?
— La princesse Etschef, dame d’honneur de l’impératrice. Fort gentille, en effet, et follement éprise du comte Vlavesky.
— Mariée ?
— Veuve — très consolée.
— Alors, c’est un mariage en perspective ?
— Que non pas ! La princesse n’a qu’une fortune médiocre, et le comte n’est pas beaucoup mieux nanti. Il ne voudra, naturellement, faire qu’un mariage riche.
— Qui sait ! L’amour l’emportera peut-être sur l’intérêt !
— L’amour ? Je ne crois pas le comte si emballé que ça. Il est positif, avant tout, et la beauté de la princesse ne pourrait compenser pour lui les ennuis d’une existence gênée.
— Je ne lui donne pas tort, car je sais par moi-même ce qu’il en coûte pour soutenir son rang, avec des revenus médiocres. Moi aussi, je ne puis épouser qu’un homme pourvu d’une grande fortune.
Les paupières de Wilhelm battirent. Il était amoureux de sa cousine, mais sans espoir, car il ne réalisait pas la condition exigée, ayant déjà dispersé, en folies de toutes sortes, les trois quarts des biens hérités de son père.
Avec un petit rire sec, le baron dit, en désignant Cyrille qui causait à quelques pas de là, dans un groupe d’hommes :
— Eh bien, voilà votre affaire Encore un comte Vlavesky, immensément riche celui-là. Il est le cousin germain de l’autre — donc votre parent aussi, peut-être ?
Une lueur d’intérêt s’alluma dans les yeux froids de Brunhilde. Pendant quelques secondes, ils s’attachèrent sur Cyrille. Puis la jeune fille dit de sa voix nette, impérative :
— Présentez-le-moi, Wilhelm.
Le baron s’éloigna, sans empressement. Tandis qu’il abordait le comte Cyrille, Brunhilde reportait son regard vers le groupe formé par Boris et la princesse Catherine. Celle-ci parlait avec une grâce nonchalante, et l’officier l’écoutait, attentif, en jouant distraitement avec l’éventail de plumes blanches qu’il avait pris des mains de la jeune femme.
— Ma cousine, voici le comte Cyrille Vlavesky, que vous avez désiré connaître…
Brunhilde tourna la tête et vit le jeune homme incliné devant elle.
— Ah ! comte, excusez-moi… Mais M. de Stretzbach ayant prononcé votre nom, j’ai souhaité savoir si vous n’étiez pas un des cousins de mon père…
Cyrille balbutia :
— Mais je crois… il me semble que ce doit être…
Il n’était jamais très à son aise devant les femmes qui l’intimidaient. Mais celle-ci lui imposait plus que toute autre, par sa beauté hautaine et l’impérieuse lueur du regard.
En quelques mots, il lui fut prouvé que la belle Brunhilde était bien sa cousine, descendante directe du baron Hugo de Halweg, époux d’une comtesse Vlavesky.
Après quoi, Mlle de Halweg l’emmena vers son père, qui accueillit fort aimablement ce parent surgi sur sa route.
Le baron de Halweg était un petit homme mince, au long visage blême, au sourire onctueux, et qui savait merveilleusement, selon les gens et les circonstances, se montrer rogue ou affable. Il avait eu des succès comme diplomate, puis, ayant déplu à son versatile souverain, il avait dû se retirer dans ses domaines de la Prusse orientale, où, disait-on, son autorité s’appesantissait lourdement sur ses vassaux.
Brunhilde, montrant du geste le capitaine Vlavesky, dit à Cyrille :
— Et maintenant, il faut que vous nous fassiez connaître cet autre cousin-là.
Mais les couples s’ébranlaient, aux premiers sons de l’orchestre, et Boris venait de se lever, emmenant à son bras la princesse Etschef.
Mlle de Halweg déclara :
— Ce sera pour plus tard. Je vous garde pour cette danse, mon cousin.
Cyrille n’osa se récuser. Mais il était piètre danseur, et Brunhilde s’en aperçut vite. Alors, prétextant la fatigue, elle alla s’asseoir avec lui dans la serre et se mit à causer, s’arrangeant fort habilement pour arriver à connaître les goûts et la nature de son interlocuteur.
Elle fut vite fixée, car cette nature était bien facile à pénétrer. Caractère bon et faible, vaniteux sur un seul point, son talent de poète, Cyrille apparaissait dès l’abord comme un être facilement influençable. Par ailleurs, le mélange de crainte et d’admiration qu’elle découvrait dans le regard du jeune homme renseignait suffisamment Brunhilde sur les sentiments inspirés par sa beauté. C’était une créature singulière : froide, en apparence, certainement orgueilleuse et dure, mais cependant douée d’une séduction altière, telle qu’on la peut imaginer chez les Walkyries farouches qui, dans le Walhalla, servent l’hydromel aux guerriers germains. Quand elle parlait, son visage ne s’animait pas, mais sous la blancheur de l’épiderme, on devinait le sang ardent, et dans les yeux au regard changeant des lueurs passaient, comme un éclair dans la nuit.
Elle se déclara désolée de ne pas connaître le russe, pour lire les poèmes de Cyrille. Sur quoi le jeune homme dit qu’il en avait composé quelques-uns en français, langue qui lui était beaucoup plus familière que l’allemand, et qu’il se permettrait de les faire porter au domicile de sa cousine, si elle voulait bien l’y autoriser. Brunhilde acquiesça de bonne grâce, en ajoutant :
— Venez demain prendre le thé avec nous. Ainsi, nous pourrons causer plus longuement.
Puis elle se leva, en rappelant à son interlocuteur qu’elle désirait faire connaissance avec son autre cousin, le capitaine Vlavesky.
Boris, la danse terminée, traversait le second salon après avoir reconduit la princesse Etschef à sa place, quand il vit venir à lui Cyrille et Mlle de Halweg. En quelques mots, il fut mis au courant. Courtoisement, il baisa la main que lui tendait Brunhilde, et exprima, sans chaleur, son plaisir de voir renouer ces rapports de parenté. Puis, avec sa politesse raffinée de grand seigneur, il invita la jeune fille pour la danse qui commençait.
Celui-là était autre chose, comme danseur, que le comte Cyrille ! Il était d’ailleurs renommé dans les salons de Pétersbourg, et les grandes-duchesses se le disputaient aux réceptions de la cour. Aujourd’hui, il trouvait en Brunhilde une partenaire de choix. Et ils formaient tous deux un couple superbe, que les spectateurs suivaient des yeux avec un vif intérêt.
Quand l’orchestre se tut, ils s’arrêtèrent, et Boris adressa un compliment à sa danseuse.
Elle riposta vivement :
— Je n’y ai pas de mérite, avec un cavalier tel que vous ! Je me sentais emportée, enlevée… Jamais je n’ai eu si parfait danseur !
Elle attachait sur lui ses yeux qu’une lueur d’enthousiasme éclairait.
Il pensa : Elle a un regard singulier. Ce doit être une nature curieuse !
Il lui offrit de la conduire au buffet, ce qu’elle accepta aussitôt. En prenant un sorbet, ils causèrent, passant d’un sujet à l’autre. Cette fois, c’était Boris qui faisait parler son interlocutrice, cherchant à se rendre compte de sa nature. Il avait déjà pu constater qu’elle était fort intelligente, très cultivée intellectuellement, et pas le moins du monde « petite fleur bleue » ou jeune fille aux yeux baissés, quand survint M. de Stretzbach, qui venait chercher sa cousine pour la danse suivante.
Elle lui déclara sans ambages :
— Vous auriez bien pu m’oublier, Wilhelm ! Je causais fort agréablement avec le comte Vlavesky, et vous nous interrompez mal à propos.
Il retint une grimace de colère, en glissant un coup d’œil furieux vers l’officier. Lourdement ironique, il riposta :
— Je ne doute pas de cet agrément, ma chère Brunhilde. Mais il ne faut pas cependant délaisser tout à fait les anciens cousins pour les nouveaux.
— Je vous connais depuis l’enfance, Wilhelm ; vous ne m’intéressez plus.
Sur cette déclaration, Brunhilde prit le bras du baron, en adressant au capitaine Vlavesky un sourire, accompagné de ces mots :
— A jeudi, voulez-vous, mon cousin ? Venez vers cinq heures, et amenez le comte Cyrille. Qu’il m’apporte ses poèmes français, je les lirai avec plaisir.
Dans le cours de la soirée, Boris se retrouva près de la princesse Etschef. Celle-ci, la mine inquiète, lui demanda :
— Est-ce vraie que cette Allemande est votre parente, Boris Vladimirovitch ?
— Très vrai… Une belle personne, n’est-ce pas ?
La jeune femme eut une moue de dédain.
— Oui, pas mal… Un peu trop grande… Et puis, quel goût dans sa toilette ! — pour une jeune fille surtout ! Cet éventail noir, cette robe jaune… est-ce assez allemand ?
— Je vous le concède. Néanmoins, Mlle de Halweg est très grande dame. Et c’est, en outre, une femme intelligente.
La princesse eut un rire forcé.
— Etes-vous donc déjà en admiration devant cette Walkyrie ?
— Une Walkyrie ?… Oui, c’est bien cela, en effet. Votre jalousie l’a parfaitement désignée, Catherine Pavlowna.
Elle essaya de protester :
— Je ne suis pas jalouse de cette Allemande !
— Non ! pas du tout ! Vous ne l’êtes jamais, d’ailleurs, n’est-ce pas, Catherine ?
Il souriait avec une raillerie légère, en attachant sur le fin visage de blonde ses yeux superbes dont le charme, fait d’énigme et de volonté impérieuse, avait tant de pouvoir sur les cœurs féminins.
Elle murmura, les lèvres tremblantes :
— C’est que je sais bien qu’un jour ou l’autre… bientôt, peut-être, vous me laisserez là… vous m’oublierez…
Les sourcils de l’officier se rapprochèrent. Si égoïste que fût devenu Boris, grâce à l’éducation reçue et aux adulations féminines qui avaient complété l’œuvre maternelle, il lui déplaisait de faire souffrir. Certes, cette considération ne l’avait jamais arrêté quand il s’agissait de contenter quelque caprice, mais il eût aimé à ne pas ressentir le léger remords qui l’impressionnait assez désagréablement, quand il savait qu’on pleurait à cause de lui.
Or, la princesse Catherine subirait ce sort, un jour ou l’autre. Il n’avait pas assez de fortune pour se permettre d’épouser cette jeune femme, très élégante, accoutumée à une existence luxueuse et mondaine, et n’apportant que des biens fort diminués par les prodigalités du défunt prince. D’ailleurs, son cœur était trop calme, à l’égard de la jolie veuve, pour lui inspirer même l’idée de ce mariage, qu’il eût tout le premier qualifié de folie, dans sa situation et surtout étant donnés ses goûts et son désir de restaurer l’existence fastueuse d’autrefois.
Avec ce fond de loyauté qui existait en lui, Boris avait pris soin de ne pas entretenir chez la princesse d’illusions à ce sujet. Mais elle était trop ardemment éprise pour se résigner par avance à l’oubli, et, parfois, elle laissait voir son inquiétude bien qu’elle connût le déplaisir qu’il en éprouvait.
Comme de coutume, cette fois encore, il parut ne pas avoir entendu, et mit la conversation sur un autre terrain.
En quittant un peu plus tard la demeure de Mme Sternof, dans l’automobile de son cousin, Cyrille demanda :
— Eh bien ! que dis-tu de notre cousine allemande ?
Boris, qui songeait, le menton sur sa main, répliqua :
— Toi-même, qu’en penses-tu ?
— Elle est remarquablement belle !
— Oui… et peu banale, au point de vue intelligence. Mais son regard est à étudier.
— Son regard ?… Oui, c’est vrai, il est… Je ne trouve pas le mot…
— Inquiétant. Et le sourire aussi. Cette femme, sous l’empire de quelque passion, doit être capable de tout.
— Oh ! Boris, tu vas trop loin !
— Il est possible que je me trompe… mais ces yeux-là ne me vont guère !
— Ils sont beaux, cependant.
— Beaux… c’est selon les goûts. Moi, ils ne me plaisent pas. Quant au baron de Halweg, il me paraît un de ces Allemands retors dont il faut se défier d’autant plus qu’ils prennent des airs de chattemite. Qu’est-ce qu’il vient faire ici ? Chercher à surprendre quelqu’un de nos secrets nationaux, Comme tant de ses compatriotes ?… Soi-disant, il veut faire connaître la Russie à sa fille. Hum !… Enfin, pour conclure, ils ne m’inspirent pas dès l’abord une sympathie exagérée, nos cousins de Prusse, et je souhaite que leur séjour ici ne se prolonge pas, car il me déplairait de renouveler la visite que nous devons leur faire jeudi sur leur invitation.
2.
Une barrière de bois pourri, toute grande ouverte, une allée de très beaux arbres envahis par les plantes parasites, un sol défoncé, horriblement boueux… de chaque côté de l’allée, des champs mal labourés, dont certaines parties restaient même en jachère…
Tel fut le spectacle que vit Boris, quand, vers la fin d’un après-midi d’avril, l’automobile dans laquelle il avait effectué le voyage s’arrêta à l’entrée du domaine de Marniew.
Le jeune homme était d’assez méchante humeur. Sa voiture avait dû passer par des chemins affreux ; en outre, des paysans stupides avaient donné des indications si peu compréhensibles, que deux fois le chauffeur s’était trompé de route. Le comte atteignait ainsi le but plus tard qu’il ne l’aurait voulu. Car, ayant décidé de se présenter à l’improviste, pour mieux saisir au naturel sa pupille en perspective, il n’avait pas prévenu de son arrivée… Et voici qu’il voyait devant lui cette allée, pire que toutes les routes déjà parcourues, bourbier innommable que le chauffeur considérait avec consternation.
Boris dit entre ses dents :
— C’est du joli ! Elle se vendra cher, la propriété, si tout le reste est entretenu à l’avenant !
Le chauffeur gémit :
— Il va falloir passer là, Excellence ?
— Eh ! oui, mon garçon ! Il n’y a pas moyen de faire autrement.
L’allée était longue, et le trajet parut interminable à Boris. En dedans, le jeune officier maugréait contre l’incurie du défunt propriétaire et se demandait en quel état de dégradation allait lui apparaître le logis.
Il le vit enfin, au-delà de ce qui avait été une large pelouse et ne représentait plus qu’un terrain défoncé, sur lequel s’étalaient quelques plaques d’herbe.
C’était une grande construction grise, lézardée, d’aspect assez imposant. Le soleil couchant jetait des reflets roses sur les fenêtres, dont quelques-unes étaient ouvertes. Un vieux cheval, très efflanqué, broutait l’herbe devant le logis. Il leva la tête, regarda l’automobile qui arrivait, puis se remit philosophiquement à son repas.
Boris sauta à terre et alla frapper à la porte principale, élevée au-dessus de quelques marches. Mais aucun bruit ne se fit entendre. La maison semblait déserte. Ayant renouvelé plusieurs fois sa tentative, sans résultat, le comte résolut de chercher ailleurs une autre entrée.
Il contourna la vieille demeure et atteignit ainsi une cour sur laquelle donnaient les communs. Là encore, même silence, même solitude.
Boris pénétra dans une vaste cuisine, où s’étalait le plus parfait désordre. On n’y voyait aucun préparatif de repas, bien que l’après-midi fût très avancé.
Le jeune homme appela plusieurs fois, sans obtenir de réponse. Alors, par un couloir, il gagna une autre pièce, la salle à manger sans doute, à en juger par la grande table qui en occupait le milieu. Mais d’autres meubles adaptés à cette destination, on ne voyait trace, en dehors d’une vieille armoire d’aspect très ordinaire.
Boris pensa : Voilà qui commence à n’être pas drôle ! Quelqu’un, cependant, doit bien habiter là-dedans ?
Un aboiement se fit entendre à ce moment. Boris eut un geste de satisfaction, et revint à la cuisine.
Au moment où il y entrait, un chien, surgissant de dehors, s’élança vers lui avec un aboiement sourd. Le comte, pour éviter d’être mordu, lui allongea un maître coup de pied, qui envoya la bête hurlante au milieu de la pièce.
Un cri de douleur et de colère retentit.
Dans la cuisine se précipita une petite créature aux yeux étincelants, qui tendait le poing vers Boris. Une voix étranglée cria :
— Vous l’avez tué !… vous l’avez tué !
Puis l’arrivante se jeta à genoux près du chien, qu’elle entoura de ses bras, tandis que ses lèvres se posaient sur la tête hirsute de l’animal qui geignait doucement.
Boris l’enveloppa d’un coup d’œil rapide. C’était une enfant toute menue, vêtue d’une jupe courte — une vieille jupe qui s’associait, comme aspect, au petit caraco déteint couvrant le buste frêle. Les pieds, très petits, étaient nus dans des sortes de sandales usées. Sur le dos, des cheveux bruns aux étranges reflets cuivrés tombaient en deux nattes rattachées ensemble par une ficelle rose, tandis qu’autour du visage ils s’ébouriffaient de façon plus pittoresque qu’ordonnée.
Quelque petite servante, dont la tenue donnait une idée peu avantageuse de ce que devait être celle de cet intérieur.
Boris, fort impatienté, s’avança de quelques pas en disant d’un ton bref :
— Laisse ce chien, qui n’a pas grand mal, et va prévenir la comtesse Verenof que son cousin le comte Vlavesky souhaite lui parler.
La fillette se redressa sur ses genoux, et l’officier vit se fixer sur lui de magnifiques prunelles sombres, qui exprimaient plus de colère que de surprise.
— Le comte Vlavesky ?… le cousin de grand-père ?… Eh bien ! vous êtes un méchant homme, et je vous déteste !… et je ne veux pas être votre cousine, moi !
Une exclamation s’échappa des lèvres de Boris.
— Que dites-vous ?… Est-ce que… vous êtes la petite-fille du comte Verenof ?
— Oui, Aniouta Ivanovna… Allez-vous-en ! Je ne veux pas que vous restiez ici !… Mon pauvre Rik !
Et, de nouveau, elle s’inclina pour caresser le museau du chien.
Boris pensa, non sans effroi : Eh bien ! elle est présentable, ma pupille !… Je n’ai qu’une chose à faire, c’est de filer de cette baraque. S’occupera qui voudra de cette petite sauvageonne.
A ce moment, un pas lourd se fit entendre au dehors. Sur le seuil de la cuisine apparut une grande femme osseuse, qui portait à son bras un lourd panier plein de légumes. Ses cheveux gris s’échappant en mèches désordonnées d’un bonnet noir poussiéreux, sa jupe effilochée pendant à droite, déchirée, le tablier de toile bise fort sale entourant sa taille anguleuse — tout cela n’était pas pour donner à Boris meilleure opinion du logis et de ses habitants.
Cette peu avenante personne s’arrêta net, visiblement stupéfaite à la vue de l’étranger.
Elle demanda d’un ton rogue :
— Vous désirez ?…
Boris dit avec une sécheresse hautaine :
— Je suis le comte Vlavesky, et je viens voir la petite fille du comte Verenof, mon cousin.
— Le comte Vlavesky !… Ah ! pardon, Excellence !… Aniouta Ivanovna, que faites-vous là ? Avez-vous salué Son Excellence ?
La grande femme, subitement transformée, s’inclinait, très empressée, grimaçait un sourire qui découvrait des dents jaunes et brisées.
Aniouta se leva d’un bond, les yeux brillants.
— Le saluer !… Je ne veux même pas le regarder ! Il a donné un coup de pied à Rik, et il a manqué le tuer !
— Le beau malheur ! Ça aurait fait une sale bête de moins. Excellence, je suis désolée ! Mais on ne peut en venir à bout ! J’y ai perdu mon temps… Que Votre Excellence me permette d’appeler mon mari…
Et, se détournant, elle cria vers le dehors :
— Piotre !… Piotre !
Après quoi, ayant posé à terre son panier, elle reprit, s’adressant à Boris avec une obséquieuse déférence :
— Votre Excellence veut-elle se retirer au salon ? Mon mari va venir… Il était depuis longtemps le régisseur du comte Verenof, et c’est à lui que notre vénéré barine avait donné la charge de prévenir les membres de sa famille, après sa mort. Il s’est acquitté aussitôt de cette tâche…
Tout en parlant, la femme conduisait Boris hors de la cuisine. Quant à Aniouta, elle avait délibérément tourné le dos à son cousin.
Le salon était une grande pièce à trois fenêtres, décorée de boiseries jadis gris perle, déplorablement sales maintenant. Au plafond, en plusieurs endroits fendu, se voyaient quelques traces de peintures dans le genre du dix-huitième siècle. Des chaises dépareillées, une table en acajou, boiteuse, une bibliothèque remplie de paperasses et de vieux livres composaient tout le mobilier.
La femme laissa là Boris et s’en alla à la recherche de son mari.
Le comte s’empressa d’ouvrir une des portes vitrées, afin que l’air vînt chasser l’odeur de moisi, la fraîcheur humide de cette pièce. Et il demeura sur le seuil, regardant vaguement le parterre — ou plutôt le reste de parterre qui s’étendait devant lui, abandonné, retournant à l’état de nature.
Il était fort perplexe. Qu’allait-il faire au sujet de cette enfant ? Il lui paraissait absolument impossible de s’occuper d’une aussi désagréable petite personne. Cette descendante des nobles Verenof n’avait, de toute évidence, reçu aucune éducation ! elle n’était qu’une paysanne, et déjà, à son âge, il devait être trop tard pour essayer de la transformer… D’autre part, si elle n’avait pas de quoi vivre, il faudrait bien qu’il assurât son existence… Elle pourrait peut-être trouver à se loger chez quelqu’un du village, où il payerait sa pension…
A ce, moment de ses réflexions, l’attention de Boris se porta vers un point du jardin où passait une petite créature aux pieds nus, qu’un affreux chien gris aux longs poils suivait sur les talons.
C’était Aniouta. Machinalement, Boris remarqua sa démarche légère, harmonieuse, et la courbe charmante des épaules, sous le caraco trop étroit.
Derrière lui, une voix onctueuse murmura :
— Excellence, pardonnez-moi…
Le comte se détourna. Un homme se tenait là, petit, fluet, très chauve, le teint blême et le nez volumineux. Ce personnage portait des vêtements crasseux, et abritait ses yeux pâles derrière des lunettes à lourde monture.
Boris demanda :
— Qui êtes-vous ?
— Piotre Pavlovitch Usnaïef, Excellence… régisseur du défunt comte Verenof… et tout au service de Votre Excellence.
Du premier coup d’œil, le personnage déplut à Boris. Le regard avait une expression sournoise, et l’échine s’inclinait trop bas.
Brièvement, le comte lui adressa quelques questions, relativement à la maladie et aux affaires du défunt. Piotre lui confirma ce qu’avait annoncé le notaire : le domaine, dont les meilleures terres avaient déjà été vendues par le comte Michel, se trouvait entièrement hypothéqué, de telle sorte qu’Aniouta ne retirait rien de la succession.
— Pas un rouble, Excellence !… Ah c’est une triste chose ! Je le disais bien au barine. Mais l’âge l’avait rendu insouciant…
Boris interrompit :
— Je crois qu’il l’a toujours été.
— Hélas ! oui, Excellence !… Mais avec la vieillesse, c’était pire. Depuis longtemps, il ne s’occupait plus de rien, et, quand j’essayais d’obtenir qu’on fît valoir un peu le domaine, il répondait : « A quoi bon ? Je ne veux pas qu’on m’ennuie avec toutes ces questions. »
— Il ne pensait donc pas à l’avenir de sa petite-fille ?
— Lui, Excellence ?… Il ne se souciait pas plus d’elle que si elle n’eût pas existé.
— Vraiment ?… Lui a-t-il fait donner au moins quelque éducation ?
— Il y avait ici, jusqu’à l’année dernière où elle est morte, une vieille demoiselle, Lioudmila Stepanovna Oudourine, qui avait été l’institutrice de la comtesse Olga, femme de notre jeune barine Ivan Michaïlovitch. Ce fut elle qui instruisit la petite fille, à sa manière, car elle était fort originale.
— Est-ce aussi cette personne qui a fait l’éducation de la comtesse Aniouta, qui lui a enseigné à s’habiller… comme une paysanne misérable ?
Le régisseur eut un petit sourire obséquieux.
— Ah ! Excellence, c’est déplorable, en effet ! Et la faute en est bien à Lioudmila Stepanovna. Parce que l’enfant était délicate, elle imagina de la faire vivre comme nos petites paysannes, nu-pieds, toujours à courir dans les champs. La barina y prit goût, et ne voulut plus changer d’existence.
— Mais son institutrice aurait pu l’y obliger ?
— Elle ? Mais elle n’avait pas d’autre volonté que celle de son élève ! C’étaient deux têtes dans le même bonnet, si Votre Excellence me permet l’expression.
Ici, en baissant un peu ses paupières molles, Piotre ajouta doucereusement :
— J’ai le regret de dire que notre petite barina aime à mener les gens, et que nous avons eu, Marpha et moi, beaucoup de peine avec elle, dès que nous voulions résister à ses caprices. Aussi ne nous a-t-elle pas en grande sympathie, comme Votre Excellence peut le penser. Mais nous n’avons cessé quand même de l’entourer de notre plus grand dévouement, sans attendre de reconnaissance.
Là-dessus, Piotre se tut, en jetant sournoisement un coup d’œil sur l’impassible visage du comte Vlavesky.
Boris dit froidement :
— Demain, je prendrai une décision à son sujet. Faites-moi préparer pour ce soir une chambre et un repas. Il faudra aussi garer l’automobile, et loger le chauffeur.
— Ce sera facile, Excellence… Je vais prévenir ma femme… Votre Excellence désire-t-elle autre chose, en attendant ?
— Non, rien.
Et, lui tournant le dos, Boris franchit le seuil de la porte vitrée, pour s’engager dans le jardin.