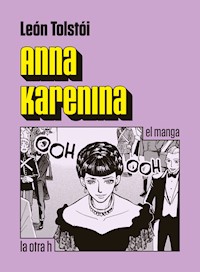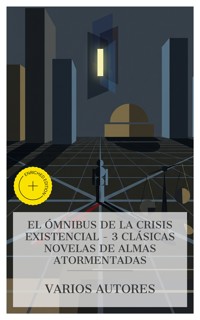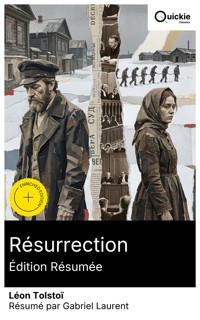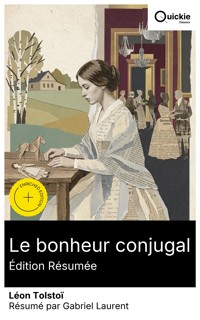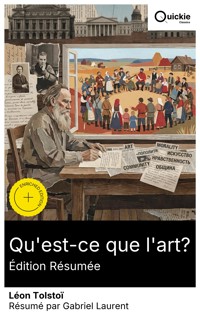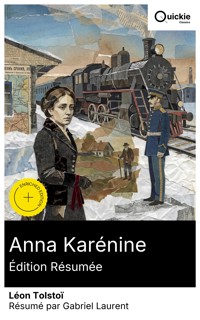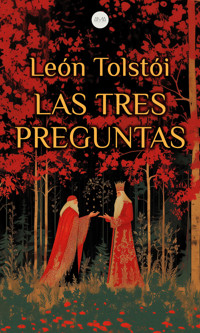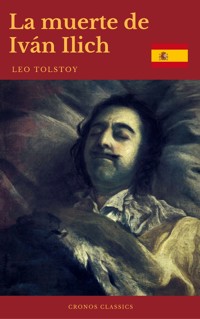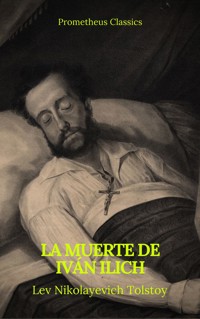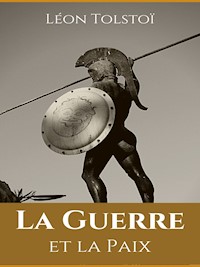
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Oeuvre mythique de la littérature russe, Guerre et Paix suit le destin de deux familles pendant les campagnes militaires du début du XIXe siècle. Dans cette fresque «monumentale», ce sont les tourments passionnés et les questions existentielles de tout un peuple que Tolstoï nous conte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 703
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Guerre et la Paix
La Guerre et la PaixDEUXIÈME PARTIE. L’INVASION 1807 – 1812CHAPITRE PREMIERCHAPITRE IICHAPITRE IIICHAPITRE IVCHAPITRE VCHAPITRE VIPage de copyrightLa Guerre et la Paix
Léon Tolstoï
DEUXIÈME PARTIE. L’INVASION 1807 – 1812
CHAPITRE PREMIER
I
En 1808, l’Empereur Alexandre se rendit à Erfurth pour avoir avec Napoléon une nouvelle entrevue, dont la pompe solennelle défraya longtemps les conversations des cercles aristocratiques de Pétersbourg.
En 1809, l’alliance des « deux arbitres du monde », comme on appelait alors les deux souverains, était si intime, qu’au moment où Napoléon déclara la guerre à l’Autriche, l’Empereur Alexandre décida qu’un corps d’armée russe passerait la frontière pour soutenir Bonaparte, son ennemi d’autrefois, contre son ex-allié l’Empereur d’Autriche, et le bruit courut qu’il était question d’un mariage entre Napoléon et une sœur de l’empereur.
En dehors des combinaisons et des éventualités de la politique extérieure, la société russe se préoccupait vivement à cette époque des réformes décrétées dans toutes les parties de l’administration. Cependant, malgré ces graves préoccupations, l’existence de tous les jours, la vraie existence individuelle, avec ses intérêts matériels de santé, de maladie, de travail, et de repos, ses aspirations intellectuelles vers les sciences, la poésie, la musique, ses passions, ses haines, ses amours, et ses amitiés, n’en suivait pas moins son cours habituel, sans s’inquiéter outre mesure du rapprochement ou de la rupture avec Napoléon, ni des grandes réformes entreprises.
Tous les projets philanthropiques de Pierre, qui, par suite de son manque de persévérance, étaient jusqu’à présent restés sans résultat, avaient été mis à exécution par le prince André, qui n’avait pas quitté la campagne, et cela, sans qu’il en fît grand étalage ou y trouvât grande difficulté. Doué de ce qui manquait essentiellement à son ami, c’est-à-dire d’une ténacité pratique, il savait donner, sans secousse et sans effort, l’impulsion à l’ensemble d’une entreprise : les trois cents paysans d’une de ses terres furent inscrits comme agriculteurs libres (un des premiers faits de ce genre en Russie) ; sur ses autres terres, la corvée fut remplacée par la redevance ; à Bogoutcharovo, il avait établi à ses frais une sage-femme, et le prêtre recevait un surplus d’émoluments, pour apprendre à lire aux enfants du village et de la domesticité.
Il partageait son temps entre Lissy-Gory, où son fils était encore entre les mains des femmes, et son ermitage de Bogoutcharovo, comme l’appelait son père. Malgré l’indifférence qu’il avait témoignée devant Pierre pour les événements du jour, il en suivait la marche avec un vif intérêt et recevait beaucoup de livres. Il remarquait avec surprise que des personnes arrivant en droite ligne de Pétersbourg pour faire visite à son père ; c’est-à-dire venant du centre même de l’action, où elles étaient à portée de tout savoir, aussi bien comme politique intérieure que comme politique étrangère, étaient de beaucoup moins bien informées que lui, qui vivait cloîtré sur sa terre.
Malgré le temps que lui prenaient la régie de ses propriétés et ses lectures variées, le prince André trouva encore moyen d’écrire une analyse critique de nos deux dernières campagnes, si malheureuses, et d’élaborer un projet de réforme de nos codes et de nos règlements militaires.
À la fin de l’hiver de 1809, il fit une tournée dans les terres de Riazan qui appartenaient à son fils, dont il était tuteur.
Assis, par un beau soleil de printemps, dans le fond de sa calèche, la pensée flottant dans l’espace, il regardait vaguement à droite et à gauche, et sentait s’épanouir tout son être, sous le charme de la première verdure des jeunes bourgeons des bouleaux, et des nuées printanières, qui couraient sur l’azur foncé du ciel. Après avoir laissé derrière lui le bac, où il avait passé l’année précédente avec Pierre, puis un village de pauvre apparence, avec ses granges et ses enclos, une descente vers le pont où un reste de neige fondait tout doucement, et la montée argileuse qui traversait des champs de blé, il entra dans un petit bois qui bordait la route des deux côtés. Grâce à l’absence de vent, il y faisait presque chaud ; aucun souffle n’agitait les bouleaux, tout couverts de feuilles naissantes, dont la sève poissait la couleur vert tendre. Par ci par là, la première herbe soulevait et perçait de ses touffes, émaillées de petites fleurs violettes, le tapis de feuilles mortes qui jonchaient le sol entre les arbres, au milieu desquels quelques sapins rappelaient désagréablement l’hiver par leur teinte sombre et uniforme. Les chevaux s’ébrouèrent : l’air était si doux qu’ils étaient couverts de sueur.
Pierre, le domestique, dit quelques mots au cocher, qui lui répondit affirmativement ; mais, l’assentiment de ce dernier ne lui suffisant pas, il se tourna vers son maître :
« Excellence, comme il fait bon respirer !
– Quoi ? Que dis-tu ?
– Il fait bon, Excellence !
– Ah oui, se dit le prince André à lui-même… Il parle sans doute du printemps ?… C’est vrai… comme tout est déjà vert, et si vite ?… Voilà le bouleau, le merisier, l’aune qui verdissent, et les chênes ?… Je n’en vois pas… Ah ! en voilà un ! »
À deux pas de lui, sur le bord de la route, un chêne, dix fois plus grand et plus fort que ses frères les bouleaux, un chêne géant, étendait au loin ses vieilles branches mutilées, et de profondes cicatrices perçaient son écorce arrachée. Ses grands bras décharnés, crochus, écartés en tous sens, lui donnaient l’aspect d’un monstre farouche, dédaigneux, plein de mépris, dans sa vieillesse, pour la jeunesse qui l’entourait et qui souriait au printemps et au soleil, dont l’influence le laissait insensible :
« Le printemps, l’amour, le bonheur ?… En êtes-vous encore à caresser ces illusions décevantes, semblait dire le vieux chêne. N’est-ce pas toujours la même fiction ? Il n’y a ni printemps, ni amour, ni bonheur !… Regardez ces pauvres sapins meurtris, toujours les mêmes… Regardez les bras noueux qui sortent partout de mon corps décharné… me voilà tel qu’ils m’ont fait, et je ne crois ni à vos espérances, ni à vos illusions ! »
Le prince André le regarda plus d’une fois en le dépassant, comme s’il en attendait une mystérieuse confidence, mais le chêne conserva son immobilité obstinée et maussade, au milieu des fleurs et de l’herbe qui poussaient à ses pieds : « Oui, ce chêne a raison, mille fois raison. Il faut laisser à la jeunesse les illusions. Quant à nous, nous savons ce que vaut la vie : elle n’a plus rien à nous offrir !… » Et tout un essaim de pensées tristes et douces s’éleva dans son âme. Il repassa son existence, et en arriva à cette conclusion désespérée, mais cependant tranquillisante, qu’il ne lui restait plus désormais qu’à végéter sans but et sans désirs, à s’abstenir de mal faire et à ne plus se tourmenter !
Le prince André, obligé, par suite de ses affaires de tutelle, de se rendre chez le maréchal de noblesse du district, qui n’était autre que le comte Élie Andréïévitch Rostow, fit cette course dans les premiers jours de mai : la forêt était toute feuillue, et la chaleur et la poussière si fortes, que le moindre filet d’eau donnait envie de s’y baigner.
Préoccupé des demandes qu’il avait à adresser au comte, il s’était déjà engagé, sans s’en apercevoir, dans la principale allée du jardin qui menait à la maison d’Otradnoë, lorsque de joyeuses voix féminines se firent entendre dans un des massifs, et il vit quelques jeunes filles accourir à la rencontre de sa calèche. La première, une brune, qui avait la taille très mince, les yeux noirs, une robe de nankin, avec un mouchoir de poche blanc jeté négligemment sur sa tête, d’où s’échappaient des mèches de cheveux ébouriffés, s’avançait vivement en lui criant quelque chose ; mais, à la vue d’un étranger, elle se retourna brusquement sans le regarder, et s’enfuit en éclatant de rire !
Le prince André éprouva une impression douloureuse. La journée était si belle, le soleil si étincelant, tout respirait un tel bonheur et une telle gaieté, jusqu’à cette fillette, à la taille flexible, qui tout entière à sa folle mais heureuse insouciance, semblait songer si peu à lui, qu’il se demanda avec tristesse : « De quoi se réjouit-elle donc ? À quoi pense-t-elle ? Ce n’est sûrement ni le code militaire ni l’organisation des redevances qui l’intéressent. »
Le comte Élie Andréïévitch vivait à Otradnoë comme par le passé, recevant chez lui tout le gouvernement, et offrant à ses invités des chasses, des spectacles, et des dîners avec accompagnement de musique. Toute visite était une bonne fortune pour lui : aussi le prince André dut-il céder à ses instances et coucher chez lui.
La journée lui parut des plus ennuyeuses, car ses hôtes et les principaux invités l’accaparèrent entièrement. Cependant il lui arriva à plusieurs reprises de regarder Natacha qui riait et s’amusait avec la jeunesse, et chaque fois il se demandait encore : « À quoi peut-elle donc penser ? »
Le soir, il fut longtemps sans pouvoir s’endormir : il lut, éteignit sa bougie, et la ralluma. Il faisait une chaleur étouffante dans sa chambre, dont les volets étaient fermés, et il en voulait à ce vieil imbécile (comme il appelait Rostow) de l’avoir retenu, en lui assurant que les papiers nécessaires manquaient ; il s’en voulait encore plus à lui-même d’avoir accepté son invitation.
Il se leva pour ouvrir la fenêtre ; à peine eut-il poussé au dehors les volets, que la lune, qui semblait guetter ce moment, inonda la chambre d’un flot de lumière. La nuit était fraîche, calme et transparente ; en face de la croisée s’élevait une charmille, sombre d’un côté, éclairée et argentée de l’autre ; dans le bas, un fouillis de tiges et de feuilles ruisselait de gouttelettes étincelantes ; plus loin, au delà de la noire charmille, un toit brillait sous sa couche de rosée ; à droite s’étendaient les branches feuillues d’un grand arbre, dont la blanche écorce miroitait aux rayons de la pleine lune qui voguait sur un ciel de printemps pur et à peine étoilé. Le prince André s’accouda sur le rebord de la fenêtre, et ses yeux se fixèrent sur le paysage. Il entendit alors, à l’étage supérieur, des voix de femmes… On n’y dormait donc pas !
« Une seule fois encore, je t’en prie ! dit une des voix, que le prince André reconnut aussitôt.
– Mais quand donc dormiras-tu ? reprit une autre voix.
– Mais si je ne puis dormir, ce n’est pas de ma faute ! Encore une fois… » Et ces deux voix murmurèrent à l’unisson le refrain d’une romance.
« Dieu, que c’est beau ! Eh bien, maintenant allons dormir.
– Va dormir, toi. Quant à moi, ça m’est impossible. »
On distinguait le léger frôlement de la robe de celle qui venait de parler, et même sa respiration, car elle devait s’être penchée en dehors de la fenêtre. Tout était silencieux, immobile ; on aurait dit que les ombres et les rayons projetés par la lune s’étaient pétrifiés. Le prince André avait peur de trahir par un geste sa présence involontaire.
« Sonia ! Sonia ! reprit la première voix, comment est-il possible de dormir ? Viens donc voir, comme c’est beau ! Dieu, que c’est beau !… éveille-toi ! » Et elle ajouta avec émotion : « Il n’y a jamais eu de nuit aussi ravissante, jamais, jamais !… ! » La voix de Sonia murmura une réponse. « Mais viens donc, regarde cette lune, mon cœur, ma petite âme, mais viens donc !… Mets-toi sur la pointe des pieds, rapproche tes genoux… on peut s’y tenir deux en se serrant un peu, tu vois, comme cela ?
– Prends donc garde, tu vas tomber. »
Il y eut comme une lutte, et la voix mécontente de Sonia reprit :
« Sais-tu qu’il va être deux heures ?
– Ah ! tu me gâtes tout mon plaisir ! va-t’en, va-t’en ! »
Le silence se rétablit, mais le prince André sentait, à ses légers mouvements et à ses soupirs, qu’elle était encore là.
« Ah ! mon Dieu, mon Dieu ! dit-elle tout à coup. Eh bien, allons dormir, puisqu’il le faut !… » Et elle ferma la croisée avec bruit.
« Ah oui ! que lui importe mon existence ! » se dit le prince André, qui avait écouté ce babillage, et qui, sans savoir pourquoi, avait craint et espéré entendre parler de lui… toujours elle, c’est comme un fait exprès ! Et il s’éleva dans son cœur un mélange confus de sensations et d’espérances, si jeunes et si opposées à sa vie habituelle, qu’il renonça à les analyser ; et, se jetant sur son lit, il s’endormit aussitôt.
Le lendemain matin, ayant pris congé du vieux comte, il partit sans voir les dames.
Au mois de juin, le prince André, en revenant chez lui, traversa de nouveau la forêt de bouleaux. Les clochettes de l’attelage y sonnaient plus sourdement que six semaines auparavant. Tout était épais, touffu, ombreux : les sapins dispersés çà et là ne nuisaient plus à la beauté de l’ensemble, et les aiguilles verdissantes de leurs branches témoignaient d’une manière éclatante qu’eux aussi subissaient l’influence générale.
La journée était chaude, il y avait de l’orage dans l’air : une petite nuée arrosa la poussière de la route et l’herbe du fossé : le côté gauche du bois restait dans l’ombre ; le côté droit, à peine agité par le vent, scintillait tout mouillé au soleil : tout fleurissait, et, de près et de loin, les rossignols se lançaient leurs roulades.
« Il me semble qu’il y avait ici un chêne qui me comprenait, » se dit le prince André, en regardant sur la gauche, et attiré à son insu par la beauté de l’arbre qu’il cherchait. Le vieux chêne transformé s’étendait en un dôme de verdure foncée, luxuriante, épanouie, qui se balançait, sous une légère brise, aux rayons du soleil couchant. On ne voyait plus ni branches fourchues ni meurtrissures : il n’y avait plus dans son aspect ni défiance amère ni chagrin morose ; rien que les jeunes feuilles pleines de sève qui avaient percé son écorce séculaire, et l’on se demandait avec surprise si c’était bien ce patriarche qui leur avait donné la vie !
« Oui, c’est bien lui ! » s’écria le prince André, et il sentit son cœur inondé de la joie intense que lui apportaient le printemps et cette nouvelle vie. Les souvenirs les plus intimes, les plus chers de son existence, défilèrent devant lui. Il revit le ciel bleu d’Austerlitz, les reproches peints sur la figure inanimée de sa femme, sa conversation avec Pierre sur le radeau, la petite fille ravie par la beauté de la nuit, et cette nuit, cette lune, tout se représenta à son imagination : « Non, ma vie ne peut être finie à trente et un ans ! Ce n’est pas assez que je sente ce qu’il y a en moi, il faut que les autres le sachent ! Il faut que Pierre et cette fillette, qui allait s’envoler dans le ciel, apprennent à me connaître ! Il faut que ma vie se reflète sur eux, et que leur vie se confonde avec la mienne ! »
Revenu de son excursion, il se décida à aller en automne à Pétersbourg, et s’ingénia à trouver des prétextes plausibles à ce voyage. Une série de raisons, plus péremptoires les unes que les autres, lui en démontra la nécessité : il n’était pas même éloigné de reprendre du service ; il s’étonnait d’avoir pu douter de la part active que lui réservait encore l’avenir. Et pourtant un mois auparavant il regardait comme impossible pour lui de quitter la campagne, et il se disait que son expérience se perdrait sans utilité, et serait un véritable non-sens, s’il n’en tirait pas un parti pratique. Il ne comprenait pas comment, sur la foi d’un pauvre raisonnement dénué de toute logique, il avait pu croire jadis que ce serait s’abaisser, après tout ce qu’il avait vu et appris, de croire encore à la possibilité d’être utile, à la possibilité d’être heureux et d’aimer. Sa raison lui disait à présent le contraire : il s’ennuyait, ses occupations habituelles ne l’intéressaient plus, et souvent, seul dans son cabinet, il se levait, s’approchait du miroir, se regardait longuement ; reportant ensuite les yeux sur le portrait de Lise, avec ses cheveux relevés à la grecque en petites boucles sur le front : il lui semblait que, sortant de son cadre doré, et oubliant ses mystérieuses et suprêmes paroles, elle le suivait des yeux avec une affectueuse curiosité et un gai sourire. Souvent il marchait dans la chambre, les mains croisées derrière le dos, fronçant le sourcil, ou souriant à ses visions confuses et décousues, à Pierre, à la jeune fille de la fenêtre, au chêne, à la gloire, à la beauté de la femme, à l’amour qui avait manqué à sa vie ! Lorsqu’on venait à le déranger pendant ses rêveries, il répondait d’une façon sèche, sévère, désagréable, mais avec une logique serrée, comme pour s’excuser envers lui-même du vague de ses pensées intimes, ce qui faisait dire à la princesse Marie que les occupations intellectuelles desséchaient le cœur des hommes.
Le prince André arriva à Pétersbourg au mois d’août 1809. La gloire du jeune Spéransky, ainsi que son énergie dans l’exécution des réformes, y étaient à leur apogée. À cette même époque, l’Empereur s’était foulé le pied en faisant une chute de voiture, et, obligé par suite de garder pendant trois semaines un repos absolu, il travaillait tous les jours avec lui. C’est alors que s’élaborèrent les deux célèbres oukases qui devaient révolutionner la société. L’un supprimait les rangs de cour, et l’autre réglait les examens à subir pour être nommé assesseur de collège et conseiller d’État ; de plus, il créait toute une constitution gouvernementale, qui devait changer de fond en comble l’ordre établi jusqu’alors dans les administrations financières, judiciaires et autres, depuis le conseil de l’empire jusqu’au conseil communal. Les vagues rêveries libérales que l’Empereur nourrissait en lui depuis son avènement au trône prenaient corps peu à peu, et se réalisaient avec l’aide de ses conseillers, Czartorisky, Novosiltsow, Kotchoubey et Strogonow, qu’il appelait en riant : le comité de Salut public.
En ce moment, Spéransky les remplaçait tous pour la partie civile, et Araktchéïew pour la partie militaire. Le prince André, en qualité de chambellan, parut à la cour, et l’Empereur, sur le passage duquel il se trouva à deux reprises, ne daigna pas l’honorer d’une parole. Il avait toujours cru remarquer que ni sa personne ni sa figure n’étaient sympathiques à Sa Majesté. Son soupçon fut confirmé par le regard froid et sec qui l’enveloppa, et il apprit bientôt que l’Empereur avait été mécontent de lui voir prendre sa retraite en 1805.
« Nos sympathies et nos antipathies ne se commandent pas, se dit le prince André ; aussi vaudra-t-il mieux ne pas lui présenter mon mémoire sur le nouveau code militaire, mais le lui faire passer, et lui laisser faire son chemin tout seul ! » Il le soumit pourtant à un vieux maréchal ami de son père, qui le reçut très affectueusement et lui promit d’en parler au souverain.
Dans le courant de la semaine, le prince André fut appelé chez le ministre de la guerre, le comte Araktchéïew.
À neuf heures du matin, au jour fixé, le prince André entra dans le salon de réception du comte ; il ne le connaissait pas personnellement, ne l’avait jamais vu, et tout ce qu’il avait appris sur lui ne lui inspirait ni respect ni estime :
« Il est le ministre de la guerre, il a la confiance de l’Empereur… peu importent donc ses qualités personnelles !… Il est chargé d’examiner mon mémoire et lui seul peut le lancer, » se disait le prince André.
À l’époque où il remplissait ses fonctions d’aide de camp, il avait assisté aux audiences données par différents personnages haut placés, et il avait remarqué que chacune avait son caractère particulier. Ici, elle en avait un complètement exceptionnel. Sur toutes les figures de ceux qui attendaient leur tour, on lisait indistinctement un sentiment général d’embarras, auquel se mêlait un air de soumission de commande. Ceux qui étaient les plus élevés en grade dissimulaient, sous des manières dégagées, et en plaisantant sur eux-mêmes et sur le ministre, le malaise qu’ils éprouvaient. D’autres restaient soucieux, d’autres riaient en chuchotant, et en répétant tout bas le sobriquet de « Sila[1] Andréïévitch », que l’on avait donné au ministre. Un général, visiblement offensé d’attendre aussi longtemps, regardait autour de lui, en se croisant négligemment les jambes, et en souriant avec dédain.
Mais dès que la porte s’ouvrit, tous les visages prirent la même expression, celle de la crainte. Le prince André avait demandé à l’officier de service de l’annoncer : celui-ci lui répondit ironiquement que son tour viendrait. Un militaire dont l’air effaré et malheureux avait frappé le prince André entra dans le cabinet du ministre, après que quelques personnes qui y avaient été introduites en furent sorties reconduites par l’aide de camp. Son audience fut longue : on entendit les éclats violents d’une voix désagréable, et l’officier, pâle, les lèvres tremblantes, en sortit et traversa le salon, la tête dans ses mains.
Ce fut le tour du prince André.
« À droite vers la fenêtre, » lui murmura-t-on à l’oreille.
Il entra dans un cabinet proprement tenu, mais sans luxe, et il vit devant lui un homme de quarante ans environ, dont le buste trop long supportait une tête d’une longueur également disproportionnée. Ses cheveux étaient coupés court, ses rides fortement accusées, et ses sourcils épais se fronçaient au-dessus de deux yeux éteints d’un vert glauque, et d’un nez rouge qui retombait sur sa bouche. Ce personnage tourna la tête de son côté, mais sans le regarder :
« Que demandez-vous ?
– Je ne demande rien, Excellence, » dit tranquillement le prince André.
Les yeux d’Araktchéïew se levèrent :
« Asseyez-vous, vous êtes le prince Bolkonsky ?
– Je ne demande rien, mais Sa Majesté l’Empereur a daigné envoyer mon mémoire à Votre Excellence.
– Je vous ferai observer, mon très cher, que j’ai lu votre mémoire, dit Araktchéïew en l’interrompant, et ne prononçant avec politesse que les deux premiers mots, pour reprendre immédiatement après son ton méprisant et grondeur. Vous proposez de nouvelles lois militaires ? Il y en a beaucoup d’anciennes, et personne ne les exécute… Aujourd’hui on ne fait qu’en écrire, c’est plus facile.
– C’est d’après la volonté de Sa Majesté l’Empereur que je suis venu demander à Votre Excellence ce qu’elle compte faire de mon mémoire.
– Je l’ai envoyé au comité, en y ajoutant mon opinion… je ne l’approuve pas, poursuivit-il en se levant ; et, prenant un papier sur la table, il le remit au prince André : – Voilà ! »
En travers de la feuille était écrit au crayon, sans orthographe, et sans ponctuation aucune : « Pas de base logique, copié sur le code militaire français, diffère sans motif du règlement militaire ! »
« Dans quel comité va-t-il être examiné ?
– Dans le comité chargé de la révision du code militaire, et j’ai présenté Votre Noblesse pour y être inscrite comme membre, mais sans appointements. »
Le prince André sourit :
« Je n’aurais pas accepté autrement.
– Membre sans appointements, vous entendez bien… j’ai l’honneur… Eh ! qu’y a-t-il là-bas encore ? » cria-t-il en le congédiant.
En attendant la nouvelle officielle de sa nomination comme membre du comité, le prince André renouvela connaissance avec les personnes au pouvoir qui pouvaient lui être utiles. Une curiosité inquiète et irrésistible, analogue à celle qui s’emparait de lui la veille d’une bataille, l’entraînait vers les sphères élevées, où se combinaient les mesures qui devaient avoir une si grande influence sur le sort de millions d’êtres ; il devinait, à l’irritation des vieux, aux efforts de ceux qui brûlaient du désir de savoir ce qui se passait, à la réserve des initiés, à l’agitation soucieuse de tous, au nombre infini de comités et de commissions, qu’il se préparait à Pétersbourg, dans cette année 1809, une formidable bataille civile, dont le général en chef était Spéransky, lequel avait pour lui tout l’attrait de l’inconnu et du génie.
La réforme, dont il n’avait qu’une vague idée, et le grand réformateur lui-même le préoccupaient si vivement, que la destinée de son mémoire n’eut plus pour lui qu’un intérêt secondaire.
Sa position personnelle lui ouvrit les cercles les plus différents et les plus élevés de la société. Le parti des réorganisateurs l’accueillit avec sympathie, d’abord à cause de sa réputation de haute intelligence et de grand savoir, et ensuite du renom de libéral que lui avait valu l’émancipation de ses paysans. Le parti des mécontents, opposé aux réformes, crut trouver en lui un renfort ; on supposa qu’il partageait les idées de son père. Les femmes et le monde virent en lui un parti riche et brillant, une nouvelle figure entourée d’une auréole romanesque, due à sa mort supposée et à la fin tragique de sa femme. Ceux qui l’avaient connu jadis trouvèrent que le temps avait singulièrement amélioré son caractère, qu’il s’était adouci, qu’il avait perdu une bonne partie de son affectation et de son orgueil, et qu’il avait gagné le calme que les années seules peuvent donner.
Le lendemain de sa visite à Araktchéïew, il alla à une soirée chez le comte Kotchoubey, lui raconta son entrevue avec « Sila Andréïévitch », dont Kotchoubey parlait également avec cet air de vague ironie qui l’avait frappé dans le salon d’attente du ministre de la guerre :
« Mon cher, vous ne pourrez, même une fois là dedans, vous passer de Michel Mikaïlovitch, c’est le grand faiseur. Je lui en parlerai, il m’a promis de venir ce soir…
– Mais en quoi les codes militaires peuvent-ils regarder Spéransky ? demanda le prince André, dont la réflexion fit sourire le comte Kotchoubey, qui secoua la tête, comme s’il était étonné de sa naïveté. »
– Nous avons causé de vous, de vos agriculteurs libres…
– Ah ! c’est donc vous, prince, qui avez donné la liberté à vos paysans ? s’écria d’un ton déplaisant un vieux du temps de Catherine.
– C’était un tout petit bien qui ne donnait aucun revenu, répondit le prince André, cherchant à pallier le fait pour ne pas irriter son interlocuteur.
– Vous étiez donc bien pressé ? continua celui-ci en regardant Kotchoubey. Je me demande seulement qui labourera la terre, si on donne la liberté aux paysans ?… Croyez-moi, il est plus facile de faire des lois que de gouverner, et je vous serais aussi bien obligé, comte, de me dire qui l’on nommera maintenant présidents des différents tribunaux, puisque tous doivent passer des examens ?
– Mais ceux qui les subiront, je pense, répliqua Kotchoubey.
– Eh bien, voilà un exemple : Prianichnikow, n’est-ce pas, est un homme précieux, mais il a soixante ans… faudra-t-il donc qu’il subisse aussi des examens ?
– Oui, c’est sans doute une difficulté, d’autant mieux que l’instruction est fort peu répandue, mais… » Kotchoubey n’acheva pas, et, prenant le prince André par le bras, il s’avança avec lui à la rencontre d’un homme de haute taille qui venait d’entrer dans le salon. Bien que son front énorme et chauve ne fût couvert que de quelques rares cheveux blonds, il ne paraissait âgé que de quarante ans. Sa figure allongée, ses mains larges et potelées se faisaient remarquer par cette blancheur mate de la peau, qui rappelle la pâleur maladive des soldats après un long séjour à l’hôpital. Il portait un frac bleu.
André le reconnut aussitôt et ressentit comme un choc à sa vue. Était-ce respect, envie, ou curiosité ? Il ne pouvait s’en rendre compte. Spéransky offrait en effet un type original. Jamais André n’avait vu à personne un aussi grand calme et une aussi grande assurance, avec des mouvements aussi gauches et aussi nonchalants, un regard aussi doux et en même temps aussi énergique, que dans ces yeux à demi fermés et légèrement voilés, jamais enfin autant de fermeté dans un sourire banal ! Tel était Spéransky, le secrétaire d’État, Spéransky, le bras droit de l’Empereur, qu’il avait accompagné à Erfurth, où plus d’une fois il avait eu l’honneur de causer avec Napoléon.
Il promena son regard sur les personnes présentes, sans se hâter de parler. Assuré d’avance qu’on l’écouterait, sa voix, dont le timbre calme et mesuré avait agréablement frappé le prince André, ne s’élevait jamais au-dessus d’un certain diapason, et il ne regardait que celui auquel il s’adressait.
Le prince suivait chacun de ses gestes, chacune de ses paroles. Le connaissant de réputation, il s’attendait, comme il arrive souvent à ceux qui portent d’habitude un jugement prématuré sur leur prochain, à trouver en lui toutes les perfections humaines.
Spéransky s’excusa auprès de Kotchoubey de n’être pas venu plus tôt, mais il avait été retenu au palais. Il avait évité de dire : « retenu par l’Empereur », et le prince André prit note de cette affectation de modestie. Lorsque Kotchoubey le présenta à Spéransky, celui-ci tourna lentement les yeux sur lui, et le regarda en silence, sans cesser de sourire :
« Je suis charmé de faire votre connaissance, j’ai entendu beaucoup parler de vous. »
Kotchoubey lui fit en peu de mots le récit de la réception d’Araktchéïew.
Le sourire de Spéransky s’accentua davantage :
« M. Magnitsky, le président de la commission pour les règlements militaires, est mon ami, et je puis, si vous le désirez, vous aboucher avec lui. »
Il articulait nettement chaque mot, chaque syllabe, et, après s’être arrêté à la fin de la phrase, il continua :
« J’espère que vous trouverez en lui de la sympathie et le désir de contribuer à tout ce qui est utile. »
Un petit cercle se forma autour d’eux.
Le prince André fut surpris du calme dédaigneux avec lequel Spéransky, obscur séminariste peu de temps auparavant, répondait au vieillard qui déplorait les nouvelles réformes, et semblait condescendre à l’honorer d’une explication ; mais, son interlocuteur ayant élevé la voix, il se borna à sourire, et déclara qu’il n’était en aucune façon juge de l’utilité ou de l’inutilité de ce qu’il plaisait à l’Empereur de décider.
Après quelques instants de conversation générale, il se leva, s’approcha du prince André et le prit à part à l’autre bout du salon : il entrait dans son programme de causer avec lui.
« J’étais tellement subjugué par la conversation animée de ce respectable vieillard, que je n’ai pas eu le temps, mon prince, d’échanger deux mots avec vous, » dit-il en souriant d’une façon un peu méprisante, comme pour lui faire sentir qu’il voyait bien que lui aussi comprenait toute la futilité des personnes avec lesquelles il venait de causer.
Le prince André se sentit flatté.
« Je vous connais depuis longtemps, continua Spéransky, d’abord par la libération de vos paysans, premier exemple qu’il serait désirable de voir imiter, et puis, parce que vous êtes le seul des chambellans qui ne soit pas offensé du nouvel oukase concernant le rang à la cour, qui a soulevé tant de mécontentement et tant de récriminations.
– C’est vrai, mon père n’a pas désiré me voir profiter de ce droit, et j’ai commencé mon service en passant par les rangs inférieurs.
– Votre père, bien qu’il soit un homme du siècle passé, est cependant bien au-dessus de ceux de nos contemporains qui critiquent cette mesure ; elle n’a d’autre but, après tout, que de rétablir la justice sur ses véritables bases.
– Je crois pourtant que ces critiques ne sont pas dénuées de fondement, répliqua le prince André, essayant de se soustraire à l’influence de cet homme, qu’il lui était désagréable d’approuver sans restriction. Il tenait même à le contredire, mais, absorbé par son travail d’observation, il ne pouvait s’exprimer avec sa liberté d’esprit habituelle.
– C’est-à-dire qu’elles ont pour fondement l’amour-propre personnel, reprit Spéransky avec tranquillité.
– En partie peut-être, mais aussi, à mon avis, les intérêts mêmes du gouvernement.
– Comment l’entendez-vous ?
– Je suis un disciple de Montesquieu, dit le prince André, et sa maxime : « que l’honneur est le principe des monarchies » me semble incontestable, et certains droits et privilèges de la noblesse me paraissent être des moyens de corroborer ce sentiment. »
Le sourire disparut de la figure de Spéransky, et sa physionomie ne fit qu’y gagner. La réponse du prince André avait excité son intérêt :
« Ah ! si vous envisagez la question sous ce point de vue ! dit-il en conservant son calme et en s’exprimant en français avec une certaine difficulté et plus de lenteur que lorsqu’il parlait le russe : – Montesquieu nous dit que l’honneur ne peut être soutenu par des privilèges nuisibles au service lui-même ; l’honneur est donc, ou l’abstention d’actes blâmables, ou le stimulant qui nous pousse à conquérir l’approbation et les récompenses destinées à en être le témoignage. Il en résulte, ajouta-t-il en serrant de plus près ses arguments, qu’une institution, qui est pour l’honneur une source d’émulation est une institution pareille en tous points à celle de la Légion d’honneur du grand Empereur Napoléon. On ne saurait dire, je pense, que celle-ci est nuisible, puisqu’elle contribue au bien du service et qu’elle n’est pas un privilège de caste ou de cour.
– Je le reconnais volontiers, mais je crois aussi que les privilèges de cour atteignent le même but, car tous ceux qui en jouissent se tiennent pour obligés de remplir dignement leurs fonctions.
– Et pourtant vous n’avez pas voulu en profiter, prince, dit Spéransky en terminant par une phrase aimable une conversation qui aurait certainement fini par embarrasser son jeune interlocuteur. – Si vous me faites l’honneur de venir chez moi mercredi soir, comme j’aurai vu Magnitsky d’ici là, je pourrai vous communiquer quelque chose d’intéressant, et j’aurai de plus le plaisir de causer plus longuement avec vous… » Et, le saluant de la main, il se glissa, à la française, hors du salon, en évitant d’être remarqué.
Pendant les premiers temps de son séjour à Pétersbourg, le prince André ne tarda pas à sentir que l’ordre d’idées développé en lui par la solitude se trouvait relégué au second plan par les soucis puérils qui ne cessaient de l’occuper.
Tous les soirs, en rentrant chez lui, il inscrivait dans un agenda quatre ou cinq visites indispensables, et autant de rendez-vous pris pour le lendemain. L’emploi de sa journée, combiné de façon à lui permettre d’être exact partout, prenait la plus grosse part des forces vives de sa vie : il ne faisait rien, ne pensait à rien, et les opinions qu’il émettait parfois avec succès n’étaient que le résultat de ses méditations de la campagne.
Il s’en voulait à lui-même lorsqu’il lui arrivait, dans la même journée, de répéter les mêmes choses dans des sociétés différentes ; mais, entraîné par ce tourbillon, il n’avait même plus le temps de s’apercevoir qu’il ne savait plus penser.
Spéransky le reçut le mercredi suivant ; un long et intime entretien produisit sur lui une profonde impression.
Dans son désir de trouver chez un autre cet idéal de perfection vers lequel il tendait lui-même, il crut aisément voir en Spéransky le type de vertu et d’intelligence qu’il avait rêvé. Si ce dernier avait appartenu au même milieu que lui, s’ils avaient eu la même éducation, les mêmes habitudes, la même manière de juger, il aurait sans doute découvert bientôt ses côtés faibles, humains et prosaïques, mais cet esprit, si bien équilibré et si étonnamment logique, lui inspirait d’autant plus de respect, qu’il ne s’en rendait pas entièrement compte. Le grand homme, de son côté, posait un peu devant lui. Était-ce parce qu’il avait apprécié ses capacités, ou parce qu’il croyait nécessaire de se l’attacher ? Le fait est qu’il ne négligeait aucune occasion de le flatter adroitement, et de lui faire entendre discrètement que son intelligence le rendait digne de s’élever jusqu’à lui, et qu’il était seul capable de comprendre la profondeur de ses conceptions et l’absurdité d’autrui.
Il lui avait répété plus d’une fois des phrases de ce genre :
« Chez nous tout ce qui sort de la routine, tout ce qui dépasse le niveau habituel, etc… » ou bien : « nous voulons que les loups soient protégés et nourris à « l’égal des brebis… » ou enfin : « ils ne peuvent nous comprendre… », et il les accompagnait d’une expression de physionomie qui voulait dire : « Nous comprenons, vous et moi, ce qu’ils valent, eux, et ce que nous sommes, nous ! »
Ce nouvel entretien, plus intime, ne fit qu’accroître l’impression première qu’avait produite sur lui Spéransky, en qui il voyait un homme d’une intelligence supérieure et un penseur profond, arrivé au pouvoir par une force indomptable de volonté, et en usant au profit de la Russie. Il était bien le philosophe qu’il cherchait, le philosophe qu’il aurait voulu être lui-même, expliquant les phénomènes de la vie par le raisonnement, n’admettant comme vrai que ce qui était sensé, et soumettant toute chose à l’examen de la raison. Ses pensées se formulaient avec une telle clarté, que le prince André se rangeait, malgré lui, en toutes choses à son avis, et n’élevait de faibles objections que pour faire acte d’indépendance. Tout était bien en lui, tout était parfait, sauf son regard froid, brillant, impénétrable, sauf ses mains blanches et délicates. Ces mains fixaient l’attention du prince André, il ne pouvait s’empêcher de les regarder, comme il nous arrive souvent de regarder les mains des gens au pouvoir, et elles lui causaient une irritation sourde, dont il ne se rendait pas compte. Le mépris ou le dédain qu’il affectait pour les hommes lui était aussi particulièrement désagréable, ainsi que la variété de ses procédés d’argumentation. Toutes les formes du raisonnement lui étaient familières, la comparaison surtout ; mais il lui reprochait de passer sans aucune transition de l’une à l’autre. Se posant en réformateur pratique, il jetait la pierre aux rêveurs ; tantôt il accablait de sa mordante ironie ses adversaires ; tantôt, employant une logique serrée, il s’élevait à la métaphysique la plus abstraite (une de ses armes oratoires favorites). Transporté sur ces hauteurs, il se plaisait alors à définir l’espace, le temps, la pensée, il y puisait de brillantes réfutations, ensuite il ramenait le sujet sur le terrain de la discussion.
Un signe caractéristique de ce puissant esprit était une foi inébranlable dans la force et dans les droits de l’Intelligence. On voyait que le doute, si habituel au prince André, lui était inconnu, et que la crainte de ne pouvoir exprimer toutes ses pensées, ou de douter, même un moment, de l’infaillibilité de ses croyances, ne l’avait jamais troublé.
Aussi éprouvait-il pour Spéransky une exaltation passionnée, la même qu’il avait ressentie pour Napoléon. Spéransky était fils de prêtre ; c’était, pour le vulgaire, une raison de le mépriser ; aussi, le prince André, sans le savoir, réagissait contre sa propre exaltation, et par cela même ne faisait qu’en accroître l’intensité.
À propos de la commission chargée de l’élaboration des lois, Spéransky lui raconta, en la raillant, qu’elle existait depuis cent cinquante ans, qu’elle avait coûté des millions sans rien produire, que Rosenkampf avait collé des étiquettes sur tous les articles de la législation comparée, et que c’était là l’unique résultat des millions dépensés :
« Nous voulons donner au sénat un nouveau pouvoir judiciaire et nous n’avons pas de lois ! Aussi est-ce un crime, mon prince, pour des personnes comme vous, de se retirer dans la vie privée. »
Le prince André lui fit observer que pour ce genre d’occupations il était nécessaire d’avoir reçu une éducation spéciale.
« Montrez-moi ceux qui la possèdent ? c’est un cercle vicieux, dont on ne peut sortir qu’en le bridant. »
Une semaine plus tard, le prince André fut nommé membre du comité chargé de l’élaboration du code militaire et, de plus, au moment où il y songeait le moins, chef d’une des sections de cette commission législative. Il consentit, à la prière de Spératisky, à s’occuper du code civil, et, s’aidant des codes Napoléon et Justinien, il travailla à la partie qui avait pour titre : « Le droit des gens ».
Deux ans auparavant, en 1808, Pierre, revenu de son voyage dans l’intérieur, se trouva, sans s’y attendre, à la tête de la franc-maçonnerie de Pétersbourg. Il organisa « des loges de table », constitua des loges régulières, en leur procurant leurs chartes et leurs titres de fondation ; il fit de la propagande, donna de l’argent pour l’achèvement du temple, et compléta de ses deniers les aumônes produites par les quêtes, au sujet desquelles les membres se montraient en général avares et inexacts. Il entretint aussi à ses frais la maison des pauvres fondée par l’ordre, et, se laissant aller aux mêmes entraînements, il employait sa vie comme par le passé. Il aimait à bien manger, à bien boire, et ne pouvait s’abstenir des plaisirs de la vie de garçon, tout en les jugeant immoraux et dégradants.
Malgré l’ardeur qu’il avait apportée au début de ses différentes occupations, il sentit, à la fin de l’année, que la terre promise de la franc-maçonnerie se dérobait sous ses pas. Il éprouva la sensation d’un homme qui, mettant avec confiance le pied sur une surface unie, sent qu’il s’enfonce dans un marais ; y posant l’autre pied, afin de bien se rendre compte de la solidité du terrain, il s’y embourba jusqu’aux genoux, et maintenant il y marchait malgré lui.
Bazdéïew, complètement éloigné de la direction des loges de Pétersbourg, ne quittait plus Moscou. Les frères étaient des hommes que Pierre coudoyait chaque jour dans la vie ordinaire, et il lui était à peu près impossible de ne voir que des frères dans la personne du prince B. ou de monsieur D., qu’il connaissait pour des gens faibles et sans valeur. Sous leurs tabliers de francs-maçons, sous leurs insignes, il voyait poindre leurs uniformes et leurs croix, qui étaient le véritable objet de leur existence. Souvent, lorsqu’il ramassait les aumônes et qu’il inscrivait vingt ou trente roubles à l’actif, souvent même au passif d’une dizaine de membres plus riches que lui, Pierre se rappelait leur serment de donner leur avoir au prochain, et il s’élevait dans son âme des doutes qu’il essayait en vain d’écarter.
Ses frères se partageaient pour lui en quatre catégories : à la première appartenaient ceux qui ne prenaient aucune part active ni aux affaires de la loge, ni aux affaires de l’humanité, exclusivement occupés à approfondir les mystères de leur ordre, à rechercher le sens de la Trinité, à étudier les trois bases générales, le soufre, le mercure et le sel, ou la signification du carré et des autres symboles du Temple de Salomon. Ceux-là, Pierre les respectait, c’étaient les anciens et Bazdéïew lui-même ; mais il ne comprenait pas quel intérêt ils pouvaient prendre à leurs recherches, et ne se sentait nullement porté vers le côté mystique de la franc-maçonnerie.
La seconde catégorie, dans laquelle il se rangeait, se composait d’adeptes qui, vacillants comme lui, cherchaient la véritable voie, et qui, ne l’ayant pas encore découverte, ne perdaient pas néanmoins l’espoir de la trouver un jour.
La troisième comprenait ceux qui, ne voyant dans cette association que les formes et les cérémonies extérieures, s’en tenaient à la stricte observance, sans se préoccuper du sens caché ; tels étaient Villarsky et le Vénérable lui-même.
La quatrième enfin était formée des gens, très nombreux à cette époque, qui, ne croyant à rien, ne désirant rien, ne tenaient à l’ordre que pour se rapprocher des riches et des puissants, et mettre à profit leurs relations avec eux.
L’activité de Pierre ne le satisfaisait pas : il reprochait à leur association, telle qu’il la voyait à Pétersbourg, de n’être qu’un pur formalisme, et il se disait, sans attaquer toutefois les fondements de l’institution, que les maçons de Russie faisaient fausse route en s’éloignant ainsi des principes sur lesquels elle était fondée ; aussi se décida-t-il à aller à l’étranger pour se faire initier aux mystères les plus élevés.
Il en revint dans le cours de l’été de 1809. Les maçons de Russie avaient appris par leurs correspondants que Besoukhow, ayant su gagner la confiance des hauts dignitaires de l’ordre, avait été, par suite de son initiation à la plupart de leurs mystères, promu au grade le plus élevé, et qu’il rapportait avec lui beaucoup de projets ; ils vinrent le voir dès son arrivée, et crurent remarquer qu’il leur ménageait une surprise.
On décida de tenir une assemblée générale jusqu’au grade d’apprenti, afin que Pierre leur remît le message dont il était chargé. La loge était au grand complet, et, une fois les formalités remplies, Pierre se leva :
« Chers frères, dit-il en bégayant et en tenant à la main d’un air embarrassé son discours écrit, chers frères, il ne suffit pas d’accomplir nos mystères dans le secret de la loge, il faut agir… agir… ! Nous nous sommes engourdis, et il faut se mettre à l’œuvre, poursuivit-il, en se décidant enfin à lire son manuscrit après ces quelques mots d’introduction.
– Pour répandre la vérité, pour amener le triomphe de la vertu, nous devrons détruire les préjugés, établir des règles conformes à l’esprit du temps, nous donner pour tâche l’éducation de la jeunesse, nous unir par des liens indissolubles à des esprits éclairés, afin de vaincre ensemble et hardiment la superstition, le manque de foi, la bêtise humaine, et former, parmi ceux qui sont dévoués à la cause, des ouvriers liés entre eux par l’unité du but, ayant en leurs mains force et pouvoir. Pour en arriver là, il faut faire pencher la balance du côté de la vertu, il faut que l’homme de bien reçoive même en ce monde la récompense de ses bonnes actions ; mais, dira-t-on, les institutions politiques actuelles s’opposent à l’exécution de ces nobles aspirations. Que nous reste-t-il donc à faire ? Fomenter des révolutions ? Bouleverser tout, et chasser la force par la force ? Non, nous sommes loin de prêcher les réformes violentes et arbitraires ! Elles méritent au contraire le blâme, car elles ne sauraient déraciner le mal, si les hommes restent les mêmes. La vérité doit s’imposer sans violence !
« Lorsque notre ordre sera parvenu à tirer les gens de bien de l’obscurité où ils végètent, alors seulement il aura le droit de faire de l’agitation, et de la diriger insensiblement vers le but qu’il se propose. En un mot, il faut établir un mode de gouvernement universel, sans chercher pour cela à rompre les liens civils et les conditions administratives, qui nous permettent, à l’heure qu’il est, d’atteindre le résultat que nous avons en vue, c’est-à-dire le triomphe de la vertu sur le vice. Le christianisme le voulait également, lorsqu’il enseignait aux hommes à être bons et sages, et à suivre, pour arriver au bien, l’exemple des âmes vertueuses.
« Lorsque le monde était encore plongé dans les ténèbres, la prédication était suffisante : la nouveauté de la vérité annoncée lui donnait une force qui s’est affaiblie ; maintenant il nous faut recourir à des moyens plus énergiques. Il est indispensable que l’homme, guidé par ses sensations, trouve dans la vertu un charme saisissant. Les passions ne se déracinent pas : il faut savoir les diriger, les élever, il faut que chacun puisse les satisfaire dans les limites de la vertu, il faut que nous lui en fournissions les moyens.
« Lorsque dans chaque pays il se sera formé un noyau d’hommes remarquables, chacun d’eux en formera d’autres à son tour ; liés fortement entre eux, ils ne connaîtront plus d’obstacles, et tout deviendra possible à un ordre qui a déjà réussi à faire en secret tant de bien à l’humanité !… »
Ce discours produisit une immense impression et révolutionna la loge. La majorité, y entrevoyant de dangereuses tendances à l’illuminisme, l’accueillit avec une froideur qui étonna Pierre. Le Vénérable en personne le prit à partie, et l’amena à développer, avec une chaleur croissante, les opinions qu’il venait d’émettre. La séance fut orageuse, des partis se formèrent ; les uns accusaient Pierre d’illuminisme, les autres le soutenaient, et pour la première fois il fut frappé de cette diversité infinie inhérente à l’esprit humain, qui fait qu’aucune vérité n’est jamais considérée sous le même aspect par deux personnes. Même parmi les membres qui semblaient être de son avis, chacun apportait aux idées qu’il avait exprimées des changements et des restrictions qu’il se refusait à admettre, convaincu que son opinion devait être intégralement adoptée.
Le Vénérable lui fit observer, d’un air ironique, que dans l’entraînement de la discussion il lui paraissait avoir fait preuve de plus d’emportement que d’esprit de charité. Pierre, sans lui répondre, lui demanda brièvement si sa proposition serait acceptée ; le Vénérable dit catégoriquement que non. Pierre quitta la loge, sans avoir même rempli les formalités d’usage, et rentra chez lui.
Pierre passa les trois journées qui suivirent cet incident, étendu sur un canapé, sans sortir, sans voir âme qui vive, et en proie au spleen le plus violent.
Il reçut une lettre de sa femme, qui le suppliait de lui accorder une entrevue, lui dépeignait le chagrin qu’elle éprouvait de leur séparation, lui exprimait le désir de lui consacrer toute sa vie, et lui annonçait qu’elle reviendrait prochainement de l’étranger à Pétersbourg.
Bientôt après, un des frères les moins respectés de l’ordre, força violemment sa porte, et, amenant la conversation sur la vie conjugale, reprocha à Pierre son injuste sévérité envers sa femme, sévérité contraire aux lois maçonniques qui commandent de pardonner au repentir.
Sa belle-mère lui fit aussi demander de venir la voir, ne fût-ce que pour un instant, afin de causer de choses graves. Pierre devinait un complot, mais dans la situation morale où il se trouvait sous l’influence de son ennui, le rapprochement qu’il pressentait lui devenait assez indifférent, car rien dans la vie ne lui paraissait avoir grande importance, et il sentait qu’il ne tenait plus guère soit à rester libre, soit à infliger à sa femme une plus longue punition.
« Personne n’a raison, personne n’a tort ; ainsi donc, elle non plus n’est pas coupable » pensait-il. N’était-ce pas chose indifférente pour lui, qui avait des intérêts si différents, de vivre ou de ne pas vivre avec elle ? Secouant son apathie, qui seule retenait son consentement, il se décida pourtant, avant de leur répondre, à aller à Moscou consulter Bazdéïew.
FRAGMENTS DU JOURNAL DE PIERRE :
« Moscou, 17 novembre. – Je reviens de chez le Bienfaiteur, et j’écris à la hâte tout ce que j’y ai ressenti. Il vit pauvrement, et voilà trois ans qu’il souffre d’une douloureuse maladie de vessie : jamais une plainte, jamais un murmure. Depuis le matin jusque bien avant dans la nuit, à part quelques instants consacrés à ses repas, d’une extrême frugalité, il se livre à des travaux scientifiques. Il m’a reçu affectueusement, m’a fait asseoir sur le lit où il était couché. Je l’abordai avec les signes maçonniques du grand Orient et de Jérusalem ; il y répondit, et me demanda, avec un doux sourire, ce que j’avais appris dans les loges de Prusse et d’Écosse. Je lui racontai, tout en lui communiquant les propositions que j’avais faites à celle de Pétersbourg, le mauvais accueil que j’y avais trouvé, et ma rupture avec les frères. Il garda longtemps le silence et m’exposa ensuite son opinion, qui éclaira aussitôt mon passé et mon avenir ; je fus frappé de sa question : « Vous souvenez-vous des trois buts de l’ordre : 1° la conservation et l’étude des mystères ; 2° la purification et le perfectionnement de soi-même, afin de pouvoir y participer ; 3° le perfectionnement de l’humanité par le désir de la purification ? Quel est le principal but des trois ? Sans doute le perfectionnement moral, car nous pouvons y tendre toujours, quelles que soient les circonstances, mais c’est aussi celui qui exige le plus d’efforts, et nous risquons de pécher par orgueil, en nous tournant vers l’étude des mystères que notre impureté nous rend indignes de comprendre, ou en prenant à tâche l’amélioration du genre humain, en restant nous-mêmes un exemple de perversité et d’indignité. L’illuminisme a perdu de sa pureté et s’est entaché d’orgueil pour s’être laissé entraîner par le courant de l’amour du bien public. » À ce point de vue, il a blâmé mon discours et tout ce que j’ai fait. Je lui ai donné raison. À propos de mes affaires de famille, il m’a dit que, le devoir du vrai maçon étant le perfectionnement de soi-même, nous croyons souvent y parvenir plus vite en nous débarrassant de toutes les difficultés à la fois, tandis que c’est le contraire : nous ne pouvons progresser qu’au milieu des luttes de la vie, par la connaissance de nous-même, où l’on ne peut parvenir que par la comparaison. Il ne faut point oublier non plus la vertu principale, l’amour de la mort. Les vicissitudes peuvent seules nous en démontrer toute la vanité et contribuer à nourrir en nous cet amour, c’est-à-dire la croyance à une nouvelle vie. Ces paroles me frappèrent d’autant plus que, malgré son terrible état de maladie, Bazdéïew ne se sent point fatigué de vivre. Il aime la mort, pour laquelle, malgré sa pureté et son élévation, il ne se reconnaît pas encore suffisamment préparé. En m’expliquant le grand carré de la création, il me dit que les chiffres 3 et 7 étaient la base de tout ; il me donna le conseil de ne pas me détacher de mes frères de Pétersbourg, de rester au second grade, et d’user de mon influence pour les préserver de l’entraînement de l’orgueil, et les soutenir dans la voie de la vérité et du progrès. Il me conseilla pour moi-même une stricte surveillance, et me donna ce cahier pour y tenir registre de toutes mes actions.
« Pétersbourg, 23 novembre. – Je vis de nouveau avec ma femme ; ma belle-mère arriva chez moi en larmes me dire qu’Hélène me suppliait de l’écouter, qu’elle était innocente, malheureuse de mon abandon… etc… Je sentais que si je la laissais venir, je n’aurais pas la force de résister à sa prière. Je ne savais que faire, ni à qui demander conseil. Si le Bienfaiteur eût été ici, il m’aurait secouru. Je relus ses lettres, je me rappelai nos causeries, et j’en conclus que je ne devais point refuser à celui qui demande, mais tendre la main à tous, et à plus forte raison à celle qui est liée à moi, et qu’il me fallait porter ma croix ! Mais si mon pardon a pour mobile le bien, que du moins ma réunion avec elle n’ait qu’un but spirituel ! J’ai dit à ma femme que je la suppliais d’oublier tout le passé, que je la priais de me pardonner si j’ai eu des torts, mais que, de mon côté, je n’avais aucun pardon à lui accorder. J’étais heureux de le lui dire. Qu’elle ne sache jamais combien il m’a été pénible de la revoir ! Je me suis établi dans l’étage d’en haut de la grande maison, et j’éprouve l’heureux sentiment de la régénération. »
La haute société, qui se réunissait soit à la cour, soit dans les grands bals, se divisait alors comme toujours en quelques cercles, dont chacun avait sa nuance particulière. Le plus nombreux était le cercle français, celui de l’alliance franco-russe, celui de Roumiantzow et de Caulaincourt. Aussitôt après sa réconciliation avec son mari, Hélène y occupa une des premières places. L’ambassade française et beaucoup de gens connus par leur esprit et leur amabilité fréquentèrent son salon.
Elle avait été à Erfurth pendant la mémorable entrevue des deux Empereurs, et y avait connu tout ce que l’Europe contenait de remarquable et qui entourait alors Napoléon. Elle y eut un succès éclatant. Napoléon lui-même, frappé au théâtre par sa beauté, voulut savoir qui elle était. Ses succès comme jeune femme belle et élégante n’étonnèrent point son mari, car elle avait encore embelli ; mais il fut surpris de la réputation qu’elle s’était acquise, pendant ces deux dernières années, d’une femme charmante, aussi spirituelle que belle. Le célèbre prince de Ligne lui écrivait des lettres de huit pages. Bilibine gardait ses meilleurs mots pour les lancer devant la comtesse Besoukhow ; être reçu dans son salon équivalait à un diplôme d’esprit. Les jeunes gens lisaient avant de se rendre à ses soirées, pour avoir quelque chose à dire. Les secrétaires d’ambassade et les ambassadeurs lui confiaient leurs secrets, si bien qu’Hélène était devenue, dans son genre, une véritable puissance. Pierre, qui la savait très ignorante, assistait parfois à ces réunions et à ces dîners, où l’on causait politique, poésie et philosophie, avec un sentiment étrange de stupéfaction et de crainte. Il éprouvait le sentiment que doit avoir un joueur de gobelets, s’attendant chaque fois à voir ses escamotages découverts ; mais personne n’y voyait rien. Ce genre de salon était-il un terrain d’élection pour la bêtise humaine, ou bien les dupes trouvaient-elles du plaisir à être dupées ? Le fait est que sa réputation de femme d’esprit fermement établie permettait à la comtesse Besoukhow de dire les plus grandes sottises : chacune de ses paroles excitait l’admiration, et on se plaisait à y découvrir un sens profond, qu’elle n’y avait pas soupçonné elle-même.
Cet original distrait, ce mari grand seigneur, qui ne gênait personne et ne nuisait pas à l’effet général produit par le ton distingué, de rigueur dans ce milieu, Pierre en un mot, était bien le mari qu’il fallait à cette brillante beauté, toute faite pour le monde, et servait au contraire à mettre en relief l’élégance et la tenue parfaite de sa femme. Les occupations de ces deux dernières années, qui, par leur nature abstraite, avaient fini par lui faire prendre en dédain tout ce qui était en dehors de ce cercle, lui avaient donné une manière d’être, teintée d’indifférence et de bienveillance banale, qui, par sa sincérité même, lui attirait une déférence involontaire. Il entrait dans le salon de sa femme comme il entrait au théâtre. Il connaissait tout le monde, accueillait chacun également bien, en restant à égale distance de tous. Si la conversation l’intéressait, il y prenait part, exposait ouvertement son avis, qui n’était peut-être pas toujours dans le ton voulu du moment, sans se préoccuper en rien de la présence des messieurs de l’ambassade. Mais l’opinion était si bien fixée sur cet original, mari de la femme la plus distinguée de Pétersbourg, qu’on ne songeait guère à prendre ses sorties au sérieux.
Parmi les jeunes gens qui fréquentaient assidûment la maison d’Hélène, on voyait Boris Droubetzkoï, dont la carrière était des plus brillantes. Hélène l’appelait « mon page », le traitait en enfant, et lui souriait comme à tout le monde, mais cependant ce sourire blessait Pierre. Boris affectait envers lui un respect plein de dignité et de compassion, qui ne faisait que l’irriter davantage. Ayant violemment souffert trois ans auparavant, il essayait de se soustraire à une seconde humiliation du même genre, d’abord en n’étant pas le mari de sa femme, et ensuite en ne se permettant pas de la soupçonner.
« Maintenant qu’elle est devenue bas-bleu, elle aura sans doute renoncé à ses entraînements d’autrefois. Il n’y a pas d’exemple qu’un bas-bleu ait jamais eu des entraînements de cœur, » se répétait-il à lui-même, en puisant, on ne sait où, cet axiome devenu pour lui une vérité mathématique. Et pourtant, chose étrange, la présence de Boris agissait sur lui physiquement, lui coupait bras et jambes, et paralysait en lui toute liberté de gestes et de mouvements. « C’est de l’antipathie, » se disait-il.
Ainsi, aux yeux du monde, Pierre passait pour un grand seigneur, mari un peu aveugle et même comique d’une femme charmante ; pour un original intelligent, qui ne faisait rien, ne gênait personne ; un bon enfant dans toute l’acception du mot ; tandis que dans le fond de son âme s’accomplissait le travail ardu, difficile, du développement intérieur, qui lui découvrait beaucoup et lui procurait de grandes joies, sans lui épargner cependant de terribles doutes ?
FRAGMENTS DU JOURNAL DE PIERRE :
« 24 novembre. – Levé à huit heures ; lu l’Évangile, assisté à la séance (Pierre, selon le conseil de Bazdéïew, avait accepté de faire partie d’un comité) ; revenu pour dîner seul. La comtesse a du monde qui m’est désagréable. Bu et mangé avec modération, copié après dîner des documents nécessaires aux frères. Le soir, descendu chez la comtesse ; j’y ai raconté une anecdote sur B., et me suis aperçu trop tard, aux éclats de rire qui ont accueilli mon récit, qu’il ne fallait pas la conter.
« Je me couche heureux et tranquille. Seigneur tout-puissant, aide-moi à marcher dans ta voie !
« 27 novembre. – Levé tard, resté longtemps et paresseusement étendu sur mon lit… Seigneur, soutiens-moi !… Lu l’Évangile sans le recueillement exigé. Le frère Ouroussow est venu causer avec moi des vanités de ce monde et des plans de réforme de l’Empereur. J’allais les critiquer, mais je me suis rappelé nos règles et les exhortations du Bienfaiteur : un vrai maçon, instrument actif dans le gouvernement, doit, lorsqu’on lui demande son concours, rester spectateur passif de ce qui ne le regarde pas. Ma langue est mon ennemie. Les frères V., G., O., sont venus me parler de la réception d’un nouvel adepte. Puis on a passé à l’explication des sept colonnes et des sept marches du Temple, des sept sciences, des sept vertus, des sept vices et des sept dons du Saint-Esprit. Frère O. très éloquent. Ce soir a eu lieu la réception. La nouvelle organisation du local a contribué à la beauté du spectacle. Boris Droubetzkoï a été reçu, j’ai été son parrain. Un étrange sentiment me bouleversait pendant notre tête-à-tête, et les mauvaises pensées m’assaillaient : je l’accusais, en se faisant affilier à notre ordre, de n’avoir d’autre but que d’obtenir la faveur de nos frères puissants dans le monde. Il m’a demandé à plusieurs reprises si N. et S. étaient de notre loge (ce à quoi je n’ai pu répondre). Je l’ai observé, je le crois incapable de ressentir du respect pour notre saint ordre. Il est trop occupé, trop satisfait de l’homme extérieur, pour désirer le perfectionnement intérieur. Je crois qu’il manque de sincérité et je me suis aperçu qu’il souriait avec mépris à mes paroles. Pendant que nous étions seuls, dans l’obscurité du Temple, je l’aurais volontiers percé du glaive nu que je tenais devant sa poitrine. Je n’ai pas été éloquent et je n’ai pu faire partager mes doutes aux frères et au Vénérable. Que le grand Architecte de l’Univers me guide dans les voies de la vérité et me fasse sortir du labyrinthe du mensonge !
« 3 décembre. – Réveillé tard, lu l’Évangile avec froideur. Sorti de ma chambre, marché dans la salle, impossible de penser. Boris Droubetzkoï est venu, et a raconté un tas d’histoires ; sa présence m’a agacé, je l’ai contredit. Il m’a répondu, je me suis fâché, et je lui ai répliqué par des choses désagréables et grossières. Il s’est tu, et je ne me suis rendu compte de ma conduite que trop tard. Je ne sais jamais me contenir avec lui ; la faute en est à mon amour-propre, car je me regarde comme au-dessus de lui, ce qui est mal ; il est indulgent pour mes faiblesses, tandis que moi, je le méprise. Mon Dieu, fais en sorte qu’en sa présence je voie toute mon iniquité et qu’elle puisse lui profiter également !
« 7 décembre. – Le Bienfaiteur m’est apparu en rêve ; son visage rajeuni brillait d’un éclat surprenant. Reçu aujourd’hui même une lettre de lui sur les devoirs du mariage. Viens, Seigneur, à mon secours ; je périrai par ma corruption, si tu m’abandonnes ! »
La fortune des Rostow n’était pas en équilibre, malgré les deux années passées à la campagne.
Nicolas, fidèle à sa promesse, continuait à servir sans bruit dans le même régiment, ce qui n’était pas de nature à lui ouvrir une brillante carrière. Il dépensait peu, mais le genre de vie qu’on menait à Otradnoë, et surtout la façon dont Mitenka régissait la fortune de la famille, faisaient faire la boule de neige aux dettes. Le vieux comte ne voyait qu’une issue à cette triste situation : obtenir pour lui un emploi du gouvernement ; et il se rendit à Pétersbourg avec tous les siens, pour quêter une place, et, comme il disait, pour amuser une dernière fois les jeunes filles.
Peu après leur arrivée, Berg fit sa déclaration à Véra et fut accepté.
À Moscou, la famille Rostow faisait tout naturellement partie de la plus haute société, mais ici leur cercle fut assez mêlé, et ils furent reçus en provinciaux par ceux-là mêmes qui, après avoir ouvertement profité à Moscou de leur hospitalité, daignaient à peine les reconnaître à Pétersbourg.
Ils tenaient table ouverte, et leurs soupers réunissaient les personnages les plus divers et les plus étranges : quelques pauvres vieux voisins de campagne, leurs filles avec la demoiselle d’honneur Péronnsky à leur côté, Pierre Besoukhow et le fils d’un maître de poste du district, employé à Pétersbourg. Les intimes de la maison étaient Droubetzkoï, Pierre Besoukhow, que le vieux comte avait rencontré dans la rue et qu’il avait amené chez lui, et Berg, qui y passait des journées entières à témoigner à la comtesse Véra les attentions exigées de la part d’un jeune homme à la veille de faire sa proposition.
Il montrait avec orgueil sa main droite blessée à Austerlitz, et tenait sans nécessité aucune son sabre de la main gauche. Sa persévérance à raconter cet incident, et l’importance qu’il y donnait, avaient fini par faire croire à son authenticité, et il avait obtenu deux récompenses.
Quand vint la guerre de Finlande, il s’y distingua également : ramassant un éclat de grenade, qui venait de tuer un aide de camp aux côtés du commandant des troupes, il le remit à son chef. Ce fait, raconté par lui à satiété, fut accepté avec la même facilité que son premier exploit, et Berg fut de nouveau récompensé. En 1809, il était donc capitaine dans la garde, décoré, et il occupait à Pétersbourg une place très avantageuse, pécuniairement parlant.
Quelques jaloux, il est vrai, dénigraient bien un peu ses mérites, mais on était forcé de convenir que c’était un brave militaire, exact au service, très bien noté par ses chefs, d’une moralité irréprochable, en train de parcourir une carrière brillante, et jouissant d’une position assurée dans le monde.
Quatre ans auparavant, un soir qu’il était au théâtre à Moscou, Berg y aperçut Véra Rostow, et, la désignant à un de ses camarades, Allemand comme lui, il lui dit : « Voilà celle qui sera ma femme. » Après avoir mûrement pesé toutes ses chances, et comparé sa position à celle des Rostow, il se décida à faire le pas décisif.
Sa proposition fut accueillie tout d’abord avec un sentiment de surprise peu flatteur pour lui : « Comment le fils d’un obscur gentillâtre de Livonie osait-il aspirer à la main d’une comtesse Rostow ? » Mais le trait distinctif de son caractère, son naïf égoïsme, lui aplanit encore une fois toutes les difficultés ; il était si convaincu de bien faire, que cette conviction se communiqua peu à peu à toute la famille, et l’on finit par trouver la combinaison parfaite. La fortune des Rostow était très dérangée, le futur ne l’ignorait certes point. Véra comptait vingt-quatre printemps, et, malgré sa beauté et sa sagesse, personne ne s’était encore présenté !… Le consentement fut donc accordé.
« Voyez-vous, disait Berg à son camarade, qu’il appelait son ami, parce qu’il était de bon ton d’avoir un ami, j’ai tout disposé, tout arrangé, et je ne me marierais pas si la moindre chose clochait dans mes plans. Mon papa et ma maman sont à l’abri du besoin, depuis que je leur ai fait obtenir une pension, et moi, je pourrai fort bien vivre à Pétersbourg, grâce aux revenus de ma place, à mon savoir-faire et à la dot de ma fiancée. Je ne l’épouse pas pour son argent… non, ce serait malhonnête, mais il faut que chacun, la femme comme le mari, apporte son contingent dans le ménage. À mon avoir j’inscris mon service, ce qui vaut bien sans doute quelque chose ; au sien, ses relations, sa petite fortune, toute médiocre qu’elle peut être, et avec le tout je pourrai parfaitement marcher. Et puis, elle est belle, d’un caractère solide, elle m’aime, ajouta-t-il en rougissant, je l’aime aussi, car elle a beaucoup de bon sens… c’est tout l’opposé de sa sœur, dont le caractère est désagréable et l’esprit insignifiant…, on dirait qu’elle n’est pas de la famille…, c’est une perle que ma fiancée…, vous la verrez, et j’espère que vous viendrez souvent…, il allait dire : « dîner, » mais après réflexion il se reprit et dit : « … prendre le thé, » et d’un coup de langue il lança vivement un petit anneau de fumée bien réussi, emblème parfait du bonheur qu’il rêvait.