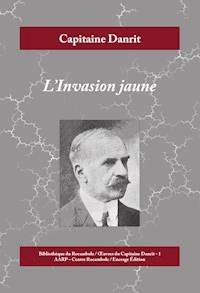Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encrage Édition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Œuvres de la Grande Guerre
- Sprache: Französisch
La sublimation des forces de l'armée française face à l'invasion allemandeEn 1912, le grand écrivain militaire Emile Driant, dit capitaine Danrit, rédige un roman dont le cadre est un conflit entre son pays et l’Allemagne, profitant de l’occasion pour valoriser une arme d’élite : le génie.Initialement publié dans le Journal des Voyages, ce roman qui a pour titre Robinsons souterrains et relate l’odyssée d’un groupe de sapeurs au cours de l’attaque d’un fort tenu par l’ennemi, va connaître une destinée surprenante, du fait du déclenchement du premier conflit mondial.Il est reproduit dans un grand nombre de journaux, au cours des premiers mois de la guerre, essentiellement les quotidiens de province, ce qui incite Danrit à le revoir, avant tout à cause de l’attaque en règle qu’il contient contre les pacifistes, au premier rang desquels les instituteurs. Aussi trouve-t-il le temps, non pas réécrire son roman, mais du moins de lui apporter quelques modifications.Danrit meurt au combat, devant Verdun, au début de l’année 1916. Même si son dernier roman — rebaptisé La Guerre souterraine — n’est pas, à proprement parler, un roman de guerre écrit durant le premier conflit mondial par un militaire de carrière, comme le seront ceux d’un Georges de Lys, il a bien sa place dans cette collection car il en contient le thème principal, la guerre, et traduit l’esprit de l’époque, celle de l’Union sacrée face à l’invasion allemande.Un roman d'aventures historique de l'époque de la Première Guerre mondiale qui ne manque pas de rythme !EXTRAIT — Non, encore une fois, non que je vous dis !— Voyons, mon adjudant !…— Inutile d’insister. Jamais je ne vous donnerai une autorisation pareille, quand c’est votre tour de prendre le service.— Mais puisque je serai revenu à temps pour le prendre, mon service !— On ne sait jamais. Et puis la consigne est formelle : défense d’aller dans les villages voisins ; il y a encore trop de patrouilles allemandes qui passent la Moselle la nuit et qui viennent rôder par ici : ce serait du propre de vous faire pincer le jour de votre arrivée…— Oui. Mais il y a toujours moyen de se défiler… Je suis sûr que le capitaine ne me refuserait pas, mon adjudant, si je lui expliquais…— Le capitaine est à l’ambulance avec un éclat d’obus dans la jambe ; le lieutenant est à la tranchée jusqu’à demain matin, et moi je suis seul à la compagnie et je vous dis non… Est-ce compris ?— C’est bien !A PROPOS DE L'AUTEUR Sous le nom de plume de Capitaine Danrit se cache l'officier militaire Emile Driant, né en 1855 et mort à Verdun en 1916. Emile Driant développe très tôt une prédisposition pour une carrière dans l'armée, s'illustrant particulièrement lors de ses études à Saint-Cyr. Brillant officier, Emile Driant devient parlementaire libéral lorsqu'il prend sa retraite militaire. Il utilisa le pseudonyme "Capitaine Danrit", anagramme de son nom, afin d'éviter la censure. Ses romans d'aventures militaires, influencés par le style de Jules Verne, ont connu un succès considérable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage est proposé dans le cadre des ressources du Centre Rocambole accessible par Internet à l’adresse :
www.lerocambole.net
Edition électronique réalisée avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Picardie
Bibliothèque du Rocambole
Œuvres de la Grande Guerre - 9
collection dirigée par Alfu
Capitaine Danrit
La Guerre souterraine
(Les Robinsons souterrains)
1912/1915
AARP — Centre Rocambole
Encrageédition
© 2014
ISBN 978-2-36058-914-2
Avertissement
de Philippe Nivet
Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Picardie
Directeur du Centre d’histoire des sociétés, des sciences et des conflits
Pendant la Première Guerre mondiale, la diffusion de la culture de guerre passe par différents vecteurs : la presse enfantine, à l’image du journalFillette, la presse illustrée, commeL’IllustrationouLe Miroir, ou les estampes, à l’exemple de celles de Jean-Louis Forain.
Le roman populaire, souvent publié d’abord en feuilleton, participe également de cette diffusion.
Exemple notoire : dans L’Eclat d’obus, roman de Maurice Leblanc, initialement publié dans les colonnes du Journal en 47 feuilletons quotidiens à l’automne 1915, on trouve ainsi de multiples dénonciations de la « guerre à l’allemande », marquée par les violations du droit des gens : « Assassiner et espionner, c’est pour [les Allemands] des formes naturelles et permises de guerre, et d’une guerre qu’ils avaient commencée en pleine période de paix ». Guillaume II y est présenté comme « le plus grand criminel qui se pût imaginer », tandis que les actes commis par les soldats allemands lors de l’invasion y sont résumés de manière saisissante : « Partout, c’était la dévastation stupide et l’anéantissement irraisonné. Partout, l’incendie et le pillage, et la mort. Otages fusillés, femmes assassinées bêtement, pour le plaisir. Eglises, châteaux, maisons de riches et masures de pauvres, il ne restait plus rien. Les ruines elles-mêmes avaient été détruites et les cadavres torturés ».
Si son insertion, en 1923, dans la série des Arsène Lupin a donné à ce roman une audience particulière, les thématiques qu’il développe se retrouvent dans d’autres textes de Maurice Leblanc et dans ceux de la plupart des auteurs populaires du temps, depuis Gaston Leroux jusqu’à Delly, en passant par Jules Chancel ou les auteurs des brochures de la collection « Patrie », tel Gustave Le Rouge ou Léon Groc.
Encrage Edition et le Centre Rocambole (centre de ressources international fondé par l’Association des Amis du Roman Populaire) ont la judicieuse idée d’exhumer ces documents et de les republier dans cette période marquée par la célébration du Centenaire de la Première Guerre mondiale. Le lecteur de ce début du XXIe siècle y verra comment étaient célébrés les soldats français, héroïques quels que soient leur âge et leur parcours antérieur, dénoncés les espions travaillant de longue date au profit de l’Allemagne et condamnées les atrocités de l’invasion. C’est toute une culture de guerre, assimilée par certains à un « bourrage de crâne », que l’on retrouve.
Préface
d’Alfu
Après avoir proposé une vision globale de la « guerre de demain » dans un volumineux ouvrage homonyme, Emile Driant, saint-cyrien, officier de carrière, né en 1855 dans l’Aisne, gendre du général Boulanger, démissionnaire de l’armée en 1905, puis député de Nancy — élu, sous l’étiquette Action libérale, en 1910, réélu en 1914, — propose, sous le nom de plume de « capitaine Danrit », des récits de guerre future où, tour à tour, les musulmans envahissent l’Europe (L’Invasion noire, 1895), puis les Asiatiques (L’Invasion jaune, 1905), ou encore l’Angleterre et la France entrent en guerre (La Guerre fatale, 1898). En 1912, inéluctablement, il en vient à rédiger un roman dont le cadre est un conflit entre son pays et l’Allemagne, profitant de l’occasion pour valoriser une arme d’élite : le génie, déjà évoquée dans La Guerre de forteresse (1892) — son premier roman, regroupé ensuite dans La Guerre de demain.
Passionné par les progrès de la science, et par contrecoup, de l’armement — par ailleurs auteur de romans de science-fiction : Robinsons des airs (1908), L’Aviateur du Pacifique (1909), etc., — Danrit y expose le principe d’une guerre de sape contre les forteresses dont l’importance stratégique n’est pas encore remise en cause.
Ce roman, qui a pour titre Robinsons souterrains et relate l’odyssée d’un groupe de sapeurs au cours de l’attaque d’un fort tenu par l’ennemi, va connaître une destinée surprenante, du fait du déclenchement du premier conflit mondial.
Initialement publié, à partir du 20 octobre 1912, dans le Journal des Voyages, grand hebdomadaire consacré à la littérature populaire, créé par Armand Montgrédien en 1877, le roman est reproduit ensuite dans un grand nombre de journaux, essentiellement les quotidiens de province, tel La Dépêche de Brest, en 1913.
Ce qui est intéressant pour nous, aujourd’hui, est qu’au cours des premiers mois de la guerre, les rééditions se multiplient. Robinsons souterrains peut être lu dans : Le Télégramme, de Toulouse ; Le Nouvelliste de Bretagne, de Rennes ; L’Eclair, de Montpellier ; La Tribune de l’Aube, de Troyes, ou encore Le Nouvelliste du Morbihan, de Lorient — sous le titre La Prise de Metz.
Dès lors, Danrit doit recevoir des commentaires sur ces publications, relatives au contenu idéologique du roman, et, avant tout, à son attaque en règle contre les pacifistes, au premier rang desquels il place les instituteurs. Aussi trouve-t-il le temps, non pas réécrire son roman, mais du moins de lui apporter quelques modifications.
Tout d’abord, il met l’action dans son contexte historique du moment. La guerre n’est plus imaginaire et ses causes sont connues. Il ne s’agit donc plus de dire :
« […] sous un infime prétexte soulevé par l’Espagne au Maroc, par l’Espagne devenue depuis quelques années provocatrice de conflits, la guerre avait éclaté soudainement par une attaque brusquée de l’Allemagne, prenant parti pour l’Espagne à laquelle la liait un traité secret. » (16)
Ensuite, il change quelques noms, à commencer par celui de son héros principal, qui de Teny devient Tribout, mais, surtout, il modifie sérieusement le personnage négatif de l’« Intellectuel », qui devient l’« Ingénieur ». Il s’en explique dans un avant-propos qui met les choses au clair :
« J’ai donc refondu mon livre de 1912 et supprimé en 1915 le personnage odieux de l’intellectuel antipatriote, en même temps que, fidèle à l’Union sacrée, j’ai rayé de ma mémoire les douloureuses manifestations de certains instituteurs d’avant-guerre. » (11)
En 1912, le personnage s’appelle Raucourt et est maître d’étude dans un collège de l’Yonne :
« Fils d’une longue lignée d’ouvriers modestes, il était le premier de sa race qui s’intéressât à d’autres problèmes que ceux de la vie courante, qui s’essayât, en un mot, à la pensée spéculative. Sans tarder, les théories communistes et même anarchiques l’avaient séduit, et il s’en était fait le propagateur violent, avec l’ardeur d’un néophyte et l’aveuglement d’un esprit borné, enivré de sa propre ascension. […] Ces autodidactes n’ont pas le sens de la complexité des choses, ni l’art des nuances. Et, défaut plus grave encore, ils abusent de formules qu’ils prennent pour des explications. […] Raucourt était donc convaincu que la société actuelle est irrémédiablement viciée par l’inégale répartition des richesses et que seuls des moyens violents, une crise, une révolution — impliquant nécessairement la disparition de l’Armée — pourraient remettre les choses en état. » (64)
Et il fait un émule en la personne d’un autre sapeur, Marquot, ouvrier à l’usine de gaz de La Villette, à Paris :
« Il avait dans Marquot, ouvrier syndiqué de la CGT, un admirateur et un disciple fervent qui buvait ses paroles comme celles d’un Messie libérateur, et qui s’exaltait en lisant les articles des pires journaux anarchistes que le maître d’étude lui mettait sous les yeux. » (64)
En 1915, Raucourt devient Lehmann et il travaille dans l’industrie :
« Les hommes m’appellent l’“Ingénieur”. Ce n’est pas tout à fait exact. Je suis agent de manufactures et je visite constamment, dans le Nord et l’Est de la France, les grosses usines métallurgiques. » (62)
Il n’est plus révolutionnaire mais seulement pacifiste car il connaît et admire l’Allemagne et n’admet pas que l’on entre en guerre contre elle pour un prétexte d’une revanche de 1870 dont on pourrait faire remonter les origines aux exactions des armées de Louis XIV :
« Quoique toutes mes sympathies aillent à la France, que mes vœux ardents tendent à son prochain triomphe, vous n’en doutez pas, n’est-ce pas, sergent ? j’estime qu’il est déplorable que ces deux grands pays s’ignorent, et que par le fait d’événements survenus il y a quarante-quatre ans, le progrès s’arrête devant les sentiments comme devant une muraille de fer. » (62)
Mais, en fait, dans l’une et l’autre version, le nommé Raucourt ou Lehman est un Allemand d’origine, naturalisé français, et vient garnir la longue liste des espions et des traîtres que propose la littérature populaire d’avant-guerre et de guerre.
Dans sa version de 1915, le roman prend un autre titre : tout d’abordLa Guerre de tranchéepour sa première parution dans le journal parisienLa Patrie— celui où est né Rocambole, en 1857 ! — du 25 septembre 1915 au 2 janvier 1916. PuisLa Guerre souterrainelorsqu’il est repris dans la presse de province ou des colonies. On peut en effet le lire bientôt, par exemple, dansL’Eclaireur de Niceou dansL’Echo d’Alger. Il paraît également en volume chez Flammarion en 1916.
Rappelons que l’auteur, qui, dès la déclaration de guerre, a demandé à être mobilisé, est commandant des 56e et 59e bataillons de chasseurs, avec le grade de lieutenant-colonel, quand, il est tué au combat, au bois des Caures, devant Verdun, le 22 février 1916 — à l’âge de 60 ans.
Même si son dernier roman n’est pas, à proprement parler, un roman de guerre écrit durant le premier conflit mondial par un militaire de carrière, comme le seront ceux d’un Georges de Lys, par exemple, il a bien sa place dans une collection des « Œuvres de la Grande Guerre » car il en contient le thème principal, la guerre, et traduit l’esprit de l’époque, celle de l’Union sacrée face à l’invasion allemande.
[Dédicace de 1912]
Je dédie ce livre, conçu en Lorraine française, aux annexés qui, depuis quarante-deux ans, n’oublient, ni ne désespèrent !
Commandant Driant, député de Nancy.
Château de Pixérécourt (Meurthe-et-Moselle), 1912.
Note de l’auteur
Ce livre a été conçu en 1912, deux ans avant la Grande Guerre.
Un congrès d’instituteurs, réuni à Chambéry, venait de formuler des déclarations antimilitaristes et antipatriotiques qu’il est inutile de rappeler ici, mais qui m’étaient apparues comme la pire des, menaces pour la Défense nationale.
Pour flétrir et combattre ces théories néfastes, à la veille de l’application de la loi de Trois Ans, théories qui d’ailleurs étaient loin d’être partagées par la majorité du corps enseignant, j’avais donné à un instituteur, au cours de la guerre imaginaire décrite ici, le rôle que je venais de lui voir jouer pendant la paix. J’en avais fait un congressiste de Chambéry, c’est-à-dire un mauvais soldat, un mauvais Français.
Aujourd’hui, l’orage qui montait à l’horizon de l’Europe tonne furieusement au-dessus de nos têtes ; dès la première heure, tous les Français sans exception se sont serrés autour du Drapeau. L’Union sacrée a réuni tous les partis en un seul, celui des Patriotes prêts à tous les sacrifices ; elle a éteint les haines politiques, mis fin à la persécution religieuse et fait de la Patrie française, le bloc formidable et admirable de tous les dévouements.
Dans ce mouvement magnifique, véritable révélation pour l’ennemi et pour la France, elle-même, les instituteurs se sont taillé, dès le premier jour, une belle et large place. A la clarté fulgurante des événements, ils se sont ressaisis : ils ont compris que, pour effacer le souvenir d’un passé trop récent, ils devaient prêcher d’exemple et la liste de leurs morts, le Tableau d’honneur de leurs citations ont, depuis les premières batailles, fait oublier les déclarations de leurs congrès.
J’en ai vu servir et mourir à mes côtés et, avant que cette guerre s’achève, je tiens à leur rendre loyalement le témoignage que je leur dois.
J’ai donc refondu mon livre de 1912 et supprimé en 1915 le personnage odieux de l’intellectuel antipatriote, en même temps que, fidèle à l’Union sacrée, j’ai rayé de ma mémoire les douloureuses manifestations de certains instituteurs d’avant-guerre.
Une France nouvelle est en train de se forger au feu de l’épreuve : puisse la Tolérance, fille de la Liberté, rapprocher, fondre en une seule toutes les âmes françaises !
Et puisse aussi le souvenir de la lutte en commun dans les tranchées, triompher de l’égoïsme d’en haut, éteindre les haines d’en bas, et inspirer désormais, dans une France régénérée, les éducateurs de nos enfants !
Lt-Colonel Driant,
72e Division
Secteur Postal 157.
Avertissement pour la lecture
Le texte placé entre des crochets est celui de la version de 1915 ; le texte placé entre des accolades est celui de la version de 1912.
1.
Indiscipline
— Non, encore une fois, non que je vous dis !
— Voyons, mon adjudant !…
— Inutile d’insister. Jamais je ne vous donnerai une autorisation pareille, quand c’est votre tour de prendre le service.
— Mais puisque je serai revenu à temps pour le prendre, mon service !
— On ne sait jamais. Et puis la consigne est formelle : défense d’aller dans les villages voisins ; il y a encore trop de patrouilles allemandes qui passent la Moselle la nuit et qui viennent rôder par ici : ce serait du propre de vous faire pincer le jour de votre arrivée…
— Oui. Mais il y a toujours moyen de se défiler… Je suis sûr que le capitaine ne me refuserait pas, mon adjudant, si je lui expliquais…
— Le capitaine est à l’ambulance avec un éclat d’obus dans la jambe ; le lieutenant est à la tranchée jusqu’à demain matin, et moi je suis seul à la compagnie et je vous dis non… Est-ce compris ?
— C’est bien !
Et Jacques [Tribout] {Tény}, sergent à la compagnie 25/1 {5/20}, du génie, fit demi-tour d’un mouvement rageur, en froissant nerveusement un papier qu’il tenait à la main.
— Mustang — c’était le nom de l’adjudant — le rappela d’un ton sec.
— Ma parole, fit-il, on dirait que vous protestez, que vous faites des gestes ! attention à vous, sergent [Tribout] {Tény} : les gestes je ne les aime pas, et depuis sept ans que j’ai l’honneur d’être adjudant, je ne les ai jamais supportés de personne.
Il y eut un silence et Mustang poursuivit :
— Avouez que, pour un début de relations, vous n’êtes pas heureux, mon garçon : comment, vous arrivez de France, vous n’êtes pas passé par toutes les misères de ce mois de siège, et votre premier mot en arrivant est pour demander une permission !
— Croyez-vous, mon adjudant, que je vous la demanderais si je n’avais pas une raison majeure, une raison…
Le jeune homme cherchait un qualificatif ; le terrible adjudant l’interrompit :
— Je ne connais de raisons majeures que les raisons de service : en campagne, il n’y a que celles-là qui comptent. Or, nous en sommes au moment le plus sérieux pour la compagnie : la période des grandes explosions va commencer : la prochaine est fixée à l’autre nuit ; ça sera quelque chose comme une solennité. Cinq mille kilos de poudre qui ouvriront un entonnoir comme on n’en a vu dans aucun siège, même à Sébastopol, et on dit que le major de tranchée y mettra le feu lui-même… à 4 heures juste. Et vous voudriez risquer de n’être pas là ?
— Mais je ne risque rien, mon adjudant, l’explosion n’est pas pour ce soir, que je sache, et vous pensez bien que si je pouvais craindre de me faire prendre par une patrouille allemande, je n’insisterais pas.
— Alors, vous insistez tout de même, après tout ce que j’ai pris la peine de vous dire ?
— J’insiste, mon adjudant, et il faut que j’y tienne, allez !
— Je vois ce que c’est… il y a un jupon là-bas comme point de direction : eh bien, j’ai dit non, c’est non !
Le sergent quitta la casemate, serrant les dents pour s’interdire une réplique qui lui brûlait les lèvres.
Il était déjà sur le seuil de la porte, quand l’adjudant lui cria une dernière recommandation d’un ton menaçant :
— Et puis n’oubliez pas d’aller vous présenter illico au major de tranchée !
Jacques, sans se retourner, continua son chemin, envoyant in petto à tous les diables le major, l’adjudant et les tranchées.
Tout son être frémissait, et la contrariété subie se peignait avec force sur son visage mobile.
La tête droite, la taille haute, les traits allongés et fins, portant ses vingt-cinq ans avec fierté et souplesse, il donnait au premier abord l’impression d’un beau et solide garçon, et conquérait tout de suite la sympathie qui s’attache à ceux qui conservent longtemps leur jeunesse saine et rieuse. Mais un examen plus approfondi révélait bien vite, dans cette face un peu pâle, quelque chose de décidé et d’énergique, une volonté tenace et même têtue, s’annonçant dans le pli imperceptible qui barrait le front et dans la ligne droite des lèvres pincées, une âme sérieuse, sachant à la fois s’enthousiasmer et se souvenir, car les yeux bleus, malgré leur apparente insouciance, s’ombraient parfois d’une teinte de mélancolie.
Cette physionomie, au masque viril estompé par les grâces encore visibles de l’adolescence, était ainsi singulièrement prenante.
Et pourtant, à cette heure, elle était mauvaise.
Il fallait d’ailleurs que le sergent fut un nouvel arrivé, pour essayer de parlementer avec l’adjudant de la compagnie divisionnaire du génie, et les soldats, qui de loin observaient curieusement le débat, auraient pu par avance lui prédire l’inutilité de sa démarche. Mustang était certes un brave homme, mais dix-huit ans d’obéissance formelle à la consigne le rendaient incapable de comprendre qu’on pût discuter un ordre. C’était par excellence le type « service », comme disaient les troupiers, qui n’avaient pas assez de littérature pour le comparer à Manlius Torquatus, et les fautes contre la discipline lui paraissaient les plus intolérables de toutes.
Heureusement qu’à ce moment son attention fut détournée par l’entrée d’une corvée de travailleurs venant déposer des outils, car il eût bondi d’indignation en entendant le sergent rabroué grommeler entre ses dents, tandis qu’il s’en allait :
— J’irai quand même
* * *
La casemate de l’adjudant Mustang où s’était déroulée cette courte scène s’ouvrait sur une profonde tranchée, qui à quelques pas de là se perdait dans les ténèbres.
Jacques s’y arrêta un instant pour réfléchir.
Au-dessus de sa tête, par intervalles passaient en sifflant des volées de balles qui venaient s’aplatir en rafales régulières et rythmées sur le sol extérieur, ou contre les bords supérieurs d’une gabionnade revêtue de sacs de terre. Quelques ricochets siffleurs, un peu de terre qui s’éboulait, puis le silence reprenait, jusqu’à ce qu’un nouvel essaim meurtrier partit des mitrailleuses du fort allemand, dont le saillant le plus proche se profilait à moins de 150 mètres, comme une bête gigantesque accroupie au bord du plateau du Saint-Quentin.
Car c’était au pied du Saint-Quentin — c’est-à-dire devant Metz — que cette scène s’était passée, que cette tranchée était creusée, que se dessinait cette attaque et se développaient ces parallèles ; devant Metz, qui depuis bientôt un demi-siècle n’avait pas vu de troupes françaises et qui assistait à cette heure, toute à l’espérance, au siège d’un des forts, dont ses vainqueurs d’un jour l’avaient entourée comme d’une ceinture de fer.
A vrai dire, en cette année 1914 {191*}, les événements s’étaient singulièrement précipités.
Jusque-là, l’Europe avait joui d’un repos relatif ; on avait pu croire un instant que le « spectre de la guerre » était définitivement écarté, et qu’on pouvait enfin, suivant la magnifique expression de l’historien, « le rouler dans le lambeau de pourpre où dorment à jamais les choses du passé ».
Et pourtant un œil exercé ne s’y serait pas trompé.
Le calme n’était qu’apparent, plus semblable au repos agité qui chez le malade précède la crise finale, qu’au sommeil réparateur de l’homme sain.
[Au milieu de l’année, en plein été, sous un infime prétexte soulevé par l’Autriche et qui ne tendait à rien moins qu’à l’asservissement de la Serbie, la grande guerre européenne prévue depuis longtemps avait éclaté soudainement. Un ultimatum brutal de l’Allemagne, épousant la cause autrichienne, devait entraîner par contrecoup la Russie, l’Angleterre, le Japon et, bientôt, l’Italie et les balkaniques dans ce conflit sanglant.]
{A la fin de l’année, au début même de l’hiver, sous un infime prétexte soulevé par l’Espagne au Maroc, par l’Espagne devenue depuis quelques années provocatrice de conflits, la guerre avait éclaté soudainement par une attaque brusquée de l’Allemagne, prenant parti pour l’Espagne à laquelle la liait un traité secret.}
[Le formidable assaut donné par les Pangermanistes au gouvernement impérial, accusé constamment de tiédeur et de faiblesse, les crises économiques et financières où se débattait vainement l’empire, enfin des relations qu’une diplomatie brutale et maladroite avait rendues, sinon tendues, du moins difficiles avec la plupart des grandes puissances, avaient décidé l’empereur à ce coup de force capable, s’il réussissait, de consolider la situation intérieure et d’assurer pour longtemps la suprématie commerciale et militaire de la toujours « plus grande Allemagne ».]
{Les assauts formidables donnés au gouvernement impérial par le socialisme grandissant, les crises économiques et financières où se débattait vainement l’empire, enfin les excitations perpétuelles de l’Angleterre, craignant pour sa suprématie maritime de plus en plus menacée, avaient décidé l’empereur à ce coup de force, capable, s’il réussissait, de consolider à la fois le pouvoir chancelant des Hohenzollern, et d’assurer pour longtemps la suprématie commerciale et militaire de la toujours « plus grande Allemagne ».}
En dépit des résolutions adoptées par l’Institut international de Droit qui siégeait à Gand en 1906, les Allemands, sans aucune déclaration de guerre préalable, avaient [envahi le Luxembourg et] jeté sur la Woëvre les 280.000 hommes de leurs {six} corps de couverture maintenus en tout temps à effectifs renforcés.
[En même temps, la masse principale allemande, composée de vingt-six corps d’armée, envahissait la Belgique, en dépit de la signature de l’Allemagne apposée au bas du traité qui garantissait aux yeux du monde entier la neutralité de ce vaillant pays.
« Chiffon de papier », déclara le chancelier de l’empire, et l’armée allemande passa.
Elle triomphait sans peine de la petite armée belge, enlevait, grâce aux canons monstrueux de 420 et de 380 et malgré une héroïque défense, les places de Liége et de Namur, laissant derrière elle des milliers de cadavres. Décidée à jeter à poignées dans la fournaise des assauts tout ce qu’il faudrait de vies humaines pour en finir vite, farouchement résolue d’ailleurs à peser sur les alliés et les neutres par la terreur, le massacre et l’incendie, elle passa.
Dévalant par le nord de la France sur un front qui s’étendait d’Anvers à Verdun, réduisant Maubeuge en quelques jours, grâce à son artillerie lourde, l’armée de Guillaume II prit sa course vers Paris en pivotant sur son aile gauche, essayant d’enlever au passage Nancy et Verdun.
Ce dernier projet échoua, malgré un premier succès de l’ennemi à Morhange. Le général de Castelnau sauva Nancy du déluge germanique par une résistance opiniâtre sur le Grand-Couronné, positions dont les députés de Nancy avaient obtenu, quelques mois avant la guerre, la mise en état de défense, et le Kronprinz, après la destruction de Longwy, petite place sans forts modernes, qui tint héroïquement pendant dix jours, ne parvint pas à investir Verdun.
Un mois à peine après l’ouverture des hostilités, le général von Kluck, formant l’aile marchante de l’énorme armée allemande, arrivait devant Paris par bonds de quarante kilomètres à la fois. Il semblait qu’il n’eût plus qu’à étendre la main pour briser en vingt-quatre heures le front nord du camp retranché à l’aide de ses canons géants, lorsque, soudain il obliqua vers sa gauche pour tomber sur le flanc de l’armée française en retraite, remettant au lendemain la prise de la capitale.
Inspiration funeste pour l’ennemi et qui changea le sort de la campagne, car Paris enlevé, c’était la France décapitée : c’était plusieurs milliards de ressources tombant aux mains des Allemands, le gouvernement obligé de tout diriger de Bordeaux, la France, enfin, obligée d’attendre le salut de l’intervention de ses alliés.
La bataille de la Marne, à cette heure tragique, sauva le pays ; dans un sursaut magnifique, à la voix de leur chef, le général Joffre, les appelant à vaincre ou à mourir, tous les corps français avaient fait tête, assailli les Allemands avec fureur et ceux-ci reculant de cent kilomètres, se terraient dans les tranchées de l’Aisne, détenant quelques départements français, mais incapables de reprendre une offensive désormais brisée.
On sait ce que dura cette période, si longue, de la Grande Guerre, pendant laquelle, par des prodiges d’initiative, l’armée française combla ses lacunes, accrut sa confiance par des attaques incessantes et permit à l’armée britannique, où tout était à improviser, d’apporter à la France le concours d’un million et demi de volontaires.
Le jour vint enfin où fut brisé le cercle de fer et de feu qui trop longtemps avait séparé de la nation les riches provinces du Nord et de l’Est, rançon douloureuse de toutes les guerres, et aussitôt une puissante armée, confiée à l’un des généraux qui s’étaient le plus brillamment révélé au cours de la campagne, le général de Maud’huy, investit le camp retranché de Metz.]
{Avant que fût notifiée au gouvernement français l’ouverture des hostilités, ces troupes avaient franchi la frontière et poussé d’un bond jusqu’à la Meuse. Leur objectif était de bouleverser le front de concentration des troupes françaises, en détruisant les voies ferrées et les quais de débarquement de la région comprise entre Verdun et Pagny-sur-Meuse. Et même un important parti de cavalerie avait poussé jusqu’au tunnel des Islettes, sur la ligne de Verdun à Châlons, pour le faire sauter.
Ce raid audacieux avait échoué.
Du côté français, on veillait, averti depuis deux ans déjà par les symptômes d’une tension inquiétante.
Certes l’heure avait été bien choisie par l’Allemagne, puisque c’était celle où l’une des deux classes de l’armée active venait d’être libérée et où les effectifs français étaient à l’étiage le plus bas.
Mais les hommes de la classe libérée avaient tous emporté leurs effets militaires et reçu un ordre d’appel individuel, pour rejoindre immédiatement le régiment qu’ils venaient de quitter.
En trente-six heures, tous les régiments de couverture avaient été ainsi remis sur pied de guerre et, grâce à l’énergique résistance et aux sanglants sacrifices des bataillons de chasseurs à pied, tenus constamment à effectifs renforcés, la marche des corps d’invasion avait été retardée sur dix points différents.
Quand les divisions mobilisées, suivies de près par des divisions de réserve, arrivèrent à la rescousse, les troupes allemandes, qui avaient déjà franchi la Meuse en trois points, durent se replier en hâte pour n’être pas coupées sur leurs derrières. Elles furent rejointes par sept corps d’armée allemands, mobilisés derrière Metz, et alors se livra cette première bataille de Neufchâteau qui dura cinq jours et dans laquelle, pour la première fois, grâce à la valeur des troupes et aux heureuses dispositions du commandant de nôtre aile droite, la fortune des combats nous redevint favorable.
Ce succès presque inespéré — car les pessimistes en France étaient légion — avait galvanisé le pays et retourné l’opinion de l’Europe : un élan général avait aussitôt fourni quatre milliards de ressources, partie en or, partie en papier, et le nerf de la guerre qui devait manquer aux Allemands après deux mois de lutte, se trouva assez fort, pour que l’armée du Tzar, du Tzar demeuré, en dépit de toutes les excitations et de toutes les fautes, notre unique et fidèle allié, pût entrer hâtivement en campagne.
L’attitude résolue de la Belgique et de la Hollande avait d’autre part fait échouer le fameux mouvement tournant par le Nord, sur lequel avaient compté les Allemands pour disperser nos forces et s’ouvrir le chemin le plus direct sur Paris.
Enfin l’Italie qui devait, par une mobilisation réglée depuis longtemps de concert avec le Grand état-major allemand, retenir sur sa frontière des Alpes deux corps d’armée français, avait suspendu ses armements au lendemain de la victoire de Neufchâteau et, suivant une tactique qui lui avait souvent rapporté, même après une défaite de ses propres troupes, des avantages et des provinces, elle attendait pour se décider que le sort des armes lui désignât plus nettement le vainqueur pour se ranger de son côté.
Et maintenant les Français, redevenus enthousiastes comme aux beaux jours de leurs triomphes d’antan, répondaient aux avances de la fortune par une offensive hardie et rapide.
Moins de sept semaines après le commencement des hostilités, la Lorraine allemande était déjà en partie envahie par leurs troupes ; Metz était cernée, investie, puis régulièrement assiégée sur tout son front occidental.}
* * *
Depuis un mois que le premier équipage de siège français était arrivé sur les hauteurs de Gravelotte et de Verneville et avait forcé de haute lutte en moins de dix jours les Ouvrages de l’Impératrice, l’attaque avait été conduite sur le Saint-Quentin{, objectif principal du général de Mald’huy, commandant du corps de siège,} avec une incomparable vigueur.
Le Saint-Quentin, couronné par les ouvrages de Frédéric-Charles, était la clef du camp retranché : à tout prix il fallait l’enlever.
Chaque nuit, on avait gagné sur le saillant du fort qui regarde Scy, et maintenant une dernière parallèle, la quatrième, l’enveloppait complètement : à courte distance et au-delà de cette parallèle, le génie avait creusé une profonde tranchée dénommée le « logement des mines » : de là s’enfonçaient sous terre, dans la direction du saillant attaqué, des galeries de mine, tentacules invisibles, qui permettraient de porter jusque sous le flanc du fort et notamment sous sa caponnière de flanquement, l’explosif auquel rien ne résiste.
Ce n’était pas sans des pertes cruelles que ce résultat considérable avait été obtenu et les douze compagnies du génie qui avaient commencé le travail de sape sur les premières pentes étaient déjà à demi décimées.
Mais des détachements venaient d’arriver de France pour en combler les vides : l’un d’eux, arrivé d’Angers le matin même, avait été de suite affecté aux travaux de mines les plus avancés de l’attaque.
Le sergent [Tribout] {Tény} en faisait partie et son premier contact avec l’adjudant Mustang le laissait furieux, désemparé, prêt à la révolte.
Dans son irritation, il retournait en tous sens le papier qu’il tenait à la main, et le relisait fébrilement comme pour y trouver une solution ou une excuse.
Ce billet était ainsi conçu :
Vaux (Les Lierres).
Jeudi.
Mon cher petit Jacques,
Te voilà donc enfin dans notre Lorraine hier encore annexée, à quelques kilomètres de cette ville de Metz où je débutais jadis comme jeune officier du génie ; et tu y viens, non plus comme autrefois, en te cachant, en te déguisant, pour y passer quelques heures fugitives et inquiètes, mais en vainqueur, avec ta compagnie, avec ta division, avec les troupes françaises !
Il y a donc une justice immanente : le grand jour luit enfin !
Eh bien, en prévision de ce jour, j’ai moi aussi travaillé, et le résultat de ce travail, je veux te le confier, mon cher enfant ; je veux que le commandant de votre corps de siège le reçoive des mains de mon petit-fils. Je veux que le vieil officier du génie que je suis soit perpétué par toi, et contribue à la prise de ce fort du Saint-Quentin que, depuis mon départ en retraite, j’ai sous les yeux, comme un reproche et un remords de mon pays.
Viens le plus vite possible avant de prendre ton service, car une fois dans la tranchée, on ne sait plus quand on en sort. Tu ne peux t’imaginer avec quelle impatience je te désire. Moi, qui ai attendu pendant près d’un demi-siècle, sans une minute de défaillance, le retour du drapeau français dans notre cher pays, je compte avec fièvre les heures qui s’écoulent trop lentement depuis que je te sais tout près de moi.
Tu connais la maison. Depuis cinq nuits, nous n’avons pas eu de patrouilles allemandes. En arrivant par le sentier qui longe le jardin, tu trouveras la petite porte jaune ouverte. Si elle était fermée, c’est que des Allemands seraient à la maison.
Sois prudent, et ne parle pas de cette visite. Encore une fois, je t’en conjure, viens vite !
Ton vieux grand-père,
Jérôme [Tribout] {Tény}.
P.-S. — Yvonne est avec nous. Ta sœur Odile va bien et t’embrasse avec moi.
Cette nouvelle lecture avait porté à son paroxysme le trouble du jeune homme.
Dans son âme se heurtaient mille sentiments confus.
Quel pouvait bien être ce travail mystérieux dont lui parlait son grand-père, et que ce dernier voulait à toute force lui communiquer ? Sans doute quelque secret concernant la défense du camp retranché de Metz. Et cette révélation devait être infiniment précieuse, car le vieil officier du génie s’y connaissait. Elle permettrait certainement d’épargner des vies, et, chose encore plus précieuse en temps de guerre, des heures.
De plus, {Car} la chute de Metz aurait une répercussion considérable sur la marche des événements.
Et, qui sait ? Peut-être était-ce aussi pour lui, Jacques, l’occasion si ardemment désirée depuis le début des hostilités de se signaler, de conquérir par des services exceptionnels le grade de sous-lieutenant.
Officier !
Et brusquement ce mot qui avait pour lui une consonance prestigieuse évoqua au fond de son cœur le post-scriptum de la lettre : « Yvonne est avec nous ».
Sans que le jeune homme s’en rendît bien compte, le désir de courir à Vaux s’aviva en lui, et son hésitation prit fin.
Il irait à Vaux ; il en serait revenu à temps pour prendre son service de nuit : nul ne connaîtrait et ne pourrait lui reprocher son absence.
Si audacieuse qu’elle fût, cette fugue lui semblait maintenant toute naturelle, et les raisons ne manquaient pas, qui la justifiaient à ses yeux.
Si le capitaine eût été présent, Jacques [Tribout] {Tény} lui eût lu le passage de la lettre de son grand-père qui l’appelait, et devant le motif invoqué par le vieil officier du génie, le commandant de la compagnie divisionnaire n’eût pas élevé la moindre difficulté ; il ne pouvait en être de même vis-à-vis de cet adjudant avec qui venait d’avoir lieu la désagréable escarmouche aboutissant à un refus : c’était un de ces « chiens de quartier » qui ne savent que mordre, esclaves aveugles du règlement et de la consigne.
Avec de telles gens, on ne discute pas.
Il s’expliquerait le lendemain avec le lieutenant Chrétien, son lieutenant, actuellement de service dans les travaux de sape profonde. Il savait déjà que celui-là était un chef accueillant, adoré à la compagnie : auprès de lui ses raisons triompheraient d’autant plus sûrement qu’il rapporterait de Vaux et lui communiquerait les précieux documents annoncés par Jérôme [Tribout] {Tény}.
Car nous sommes ainsi bâtis, que souvent l’esprit est en nous la dupe du cœur. Laborieusement notre logique aligne des arguments qu’elle croit siens, quand elle ne fait que parer de dehors raisonnables nos caprices et nos désirs.
* * *
Le parti de Jacques [Tribout] {Tény} est définitivement pris : il ira à Vaux.
Il ne s’agit plus maintenant que d’organiser l’aventureuse expédition.
Toutefois, il ne peut se dispenser de se présenter au major de tranchée, comme l’ordre lui en a été donné par l’adjudant.
Tout gradé nouvellement arrivé et participant aux travaux de sape ou de mine doit se présenter à lui le jour de son arrivée.
Sa montre marque 14 {2} heures et demie.
Les corvées de sape se relèvent après la soupe du soir, à 18 {6} heures 30 {½}. La visite au major est une formalité qui prendra un quart d’heure.
Et encore, peut-être aura-t-il la chance de ne pas le trouver.
Avec les trois heures et demie de liberté restantes, il aura le temps d’aller jusqu’à Vaux, qui se trouve à 2 kilomètres environ dans le fond de la vallée et il sera de retour pour prendre auprès de l’implacable adjudant son service de nuit.
A ce moment, une exclamation joyeuse le tire de ses calculs.
— Tiens ! c’est toi, [Tribout] {Tény} ! Qu’est-ce que tu fais par ici ?
C’est un de ses anciens camarades de collège qui l’interpelle, sergent lui aussi, mais aux chasseurs à pied.
— Oui, c’est moi. Bonsoir, [Remteaux] {Perrin}… Comme on se retrouve !
Une vigoureuse poignée de mains et Jacques explique comment il est venu avec le détachement d’Angers {de Lille}, pour combler les vides de son arme.
— Oui, il paraît que vous avez déjà perdu pas mal de monde, opine le chasseur ; au point du siège où nous en sommes arrivés, c’est à vous qu’incombe le principal rôle et j’imagine que ça ne doit pas être drôle de travailler comme des taupes dans le noir, d’être toujours à l’affût d’une explosion et de se trouver aplati dans un boyau. Et pourtant vous, au moins, vous servez à quelque chose. Tandis que nous ici ! Des gardes, encore des gardes, toujours des gardes ! Des agents de police, quoi ! Autant rester au quartier. Pas moyen de tirer un coup de fusil. Car les Allemands n’ont pas encore tenté une sortie et, en attendant le jour de l’assaut où le beau rôle nous revient, nous n’aurons guère affaire à eux ; alors, on nous occupe à un service de surveillance intérieure qui commence à devenir monotone. Ma parole, j’envierais jusqu’à ton métier de contremaître au milieu de tes équipes de terrassiers. Tu devrais un jour me faire visiter cela.
— Volontiers, quand je saurai m’y retrouver moi-même ; mais votre tour va venir, si j’ai bien compris ce que m’a dit l’adjudant tout à l’heure : on fait exploser une mine de 5.000 kilos après-demain, paraît-il : ce sont les fantassins qui la couronneront et peut-être, si l’entonnoir est assez grand pour jeter bas la contrescarpe, l’assaut du saillant suivra-t-il de près. Or, l’assaut, c’est votre revanche, à vous autres !
— A parler franc, je voudrais qu’il soit donné tout de suite, que Metz soit prise le lendemain et que nous filions d’ici : la vie en rase campagne, vois-tu, il n’y a que ça…
Mais Jacques n’écoute plus, car le temps presse ; et tout à son idée, il interrompt son camarade :
— Dis donc, tu sais où reste le major de tranchée ? Voudrais-tu m’y conduire ?
— Oh ! oh ! Monsieur rend visite au « Vieillard » ! Pas besoin de gants avec lui, il est tout rond… une tête de percepteur en retraite, qui ne pense plus qu’à faire son bridge au café du Commerce, sur la Grand-Place…
— Paraît qu’il faut se présenter à lui, quand on arrive…
— M’étonne pas ! Il aime à connaître ses hommes, surtout les gradés. Ainsi, l’autre jour, sans crier gare, il m’est tombé sur le dos.
— Ecoute, je suis pressé, tu me raconteras ton histoire le long du chemin…
— Bon ! Par ici, alors… C’est là-bas, tout au bout.
Et tout en poursuivant son récit, où se trouvait dépeints la vigilance du « Vieillard » et aussi son travers de répondre « amen » à tout ce qui venait d’un supérieur, le sergent de chasseurs remonta avec Jacques le long de la tranchée dite « logement des mines ».
C’était une tranchée profonde de 3 mètres {de 2 à 3 mètres}, et large de 2 {4}. Elle était creusée au fond d’un pli de terrain dont la dépression, parallèle au saillant attaqué, rompait la pente régulière qui montait vers le fort. Moitié à ciel ouvert, moitié enfouie sous le talus du ravin, protégée en outre par un parapet constitué par le déblai des terres, elle défiait les plus puissants calibres de la forteresse.
Jacques s’en félicita.
— Ce n’est pas trop de précautions, lui fit remarquer son compagnon. Il faudrait une carapace de béton pour résister aux obus-torpilles qu’on nous envoie de là-haut. Et d’ailleurs, ici sont installés les principaux services. Voici, tout près, notre poste de garde, et à côté un poste de réserve et d’ambulance. Assez peu confortable, rien d’un palace-hôtel, tu sais !
— Et le matériel du génie, où est-il logé ?
— Ces quatre casemates là-bas lui sont affectées. La première, celle devant laquelle nous allons passer, c’est le dépôt des outils ; puis un atelier de réparation des bois, le magasin à poudre ; enfin la chambre des moteurs, avec les ventilateurs…
— Tu es au courant de tout cela comme un véritable sapeur !
— C’est pas malin à savoir. On y prend assez souvent la garde, devant tous ces locaux ! Et il y a des consignes spéciales pour chacun.
Tout en devisant, les deux hommes étaient parvenus devant une brèche qui s’ouvrait dans la paroi de la tranchée, sur la plaine, et où venait aboutir un chemin aux ornières profondes, durcies par la gelée.
Séduits par la clarté, leurs yeux fatigués du demi-jour de la galerie s’arrêtèrent un instant sur la campagne.
C’était un paysage d’hiver, morne et triste, endormi sous la neige, et tout en grisaille ; ses ondulations lentes et molles se perdaient dans la brume à l’horizon, où se préparait un coucher de soleil empourpré. Des feux rares fumaient dans la plaine, autour des villages, au milieu des vergers et des jardins.
Aux environs de la tranchée, la terre toute blanche était trouée d’alvéoles noirâtres : c’étaient les excavations creusées dans le sol par les marmites allemandes {obus allemands}.
Un peu plus bas, un repli de terrain abritait quelques croix de bois, qui s’érigeaient sur de modestes éminences.
— C’est là que sont enterrés ceux qui ont été tués dans la tranchée, expliqua le fantassin, et encore tous ne sont pas là !
— Il y a un autre cimetière ?
— Non. Mais les galeries ont servi de tombeau à un grand nombre… Tu penses bien qu’on ne les retrouve pas tous…
— Comment cela ?
Les deux hommes redescendirent dans la tranchée et se remirent en route.
— C’est un de mes plus tristes souvenirs ici, reprit le sergent… Il y a de cela environ quinze jours. On allait faire sauter les fourneaux de mine qui devaient, en explosant, creuser des entonnoirs où serait établie la quatrième parallèle. Quelques heures avant la mise à feu, alors qu’une douzaine de sapeurs achevaient le bourrage du dernier fourneau, un obus-torpille arrivant sous un grand angle a atteint le fourneau lui-même et l’a fait partir : les douze mineurs ont été ensevelis.
— Et on n’a rien fait pour les sauver ?
— Tu penses bien que si, et ce ne sont pas les sauveteurs qui ont manqué. J’ai été appelé avec mon poste pour établir un cordon de police à l’entrée de la galerie et empêcher qu’on y entrât, car elle était encore pleine de vapeurs asphyxiantes, et quelques-uns y étaient déjà restés. Malgré cela, j’ai eu toutes les peines du monde à faire respecter ma consigne. Ils voulaient tous porter secours à leurs camarades, malgré la mort certaine… Il est vrai que c’était horrible. Les tuyaux de ventilation n’avaient pas été détruits par l’explosion, et par là ou entendait les cris et les râles des camarades. Pendant deux heures ils ont hurlé à la mort… et il n’y a pas eu moyen d’arriver jusqu’à eux assez vite. Le général de [Maud’huy] {Mald’huy} est venu : quand il a vu qu’on n’arriverait plus à temps, il a fait venir le curé de Lessy, qui s’est avancé aussi loin que possible dans la galerie éboulée. Et là, pendant que, derrière lui, nous rendions les honneurs, le prêtre a dit les prières des morts et a béni le rempart de terre qui murait les malheureux… Puis… on a creusé ailleurs un autre rameau… Alors, tu vois, ceux-là, leur cimetière, c’est la mine !…
Jacques écoutait pensif. C’était peut-être aussi le sort que lui réservait cette guerre souterraine, celle que son destin et aussi le choix de sa carrière l’appelait à connaître : son imagination ardente lui faisait revivre les dernières heures de ces malheureux asphyxiés ou broyés sur l’heure, plus heureux d’ailleurs que les matelots enfermés dans les flancs d’un sous-marin naufragé, condamnés à attendre la mort pendant de longs jours dans les ténèbres et l’épouvante.
Mais son loquace compagnon, moins sensible, et chez qui les émotions étaient de courte durée, l’arracha à sa sombre méditation par de banales réflexions qui satisfaisaient du moins son besoin de parler.
— Ah ! si l’on pouvait prendre les forts de loin, sans se déranger…
— Il faudrait pouvoir agir à distance, par télémécanique, répondit Jacques en se remettant avec effort au ton de son interlocuteur.
— Par la télémécanique ?
— Oui, c’est-à-dire en commandant à distance les appareils…
— Oh ! alors, les Allemands doivent savoir en jouer, de la télémécanique ! car ils nous envoient, sans se déranger, des torpilles aériennes.
Ce fut au tour de Jacques de s’étonner.
— Qu’est-ce que ce nouvel engin ?
— Une espèce de petit dirigeable, dont la nacelle remplie d’explosifs se détache quand elle arrive au-dessus de son objectif.
— Mais qui fait manœuvrer l’appareil ?
— Voilà justement ! Il n’y a personne à bord de ce maudit ballon. Et pourtant son hélice de propulsion fonctionne, car on l’entend ; son gouvernail aussi, car il évolue dans tous les sens. Les officiers disent que ce sont les ondes électriques émises par le fort qui le dirigent. C’est comme une torpille marine qu’on ferait évoluer à distance.
— Je savais qu’on était arrivé à certains résultats sur mer dans ce sens, mais les torpilles aériennes sont une surprise de cette guerre : elle nous en réserve bien d’autres, sans doute, conclut Jacques en serrant la main de son interlocuteur pour prendre congé de lui, car on était arrivé devant la casemate du major.
— J’espère qu’elle nous ménagera celle de nous rencontrer là-haut, observa [Remteaux] {fit le fantassin}.
— Pas de sitôt, je pense, repartit Jacques. Avant de mourir, il faut penser à vaincre.
— Ah ! expliquons-nous ! Tu ne m’as pas compris. Là-haut, j’ai voulu dire au fort ! Vous, les sapeurs, vous allez arriver par-dessous ; nous, nous passerons par-dessus ; on se retrouvera là-haut…
— Alors c’est un match de vitesse que tu proposes ?
— Oui, et je suis bien persuadé que c’est nous, les chasseurs, qui entrerons au fort les premiers.
— C’est à voir ! fit Jacques en riant.
Et, sur une nouvelle poignée de main, il frappa à la porte de la casemate sur laquelle était écrit : « Major de tranchée ».
— Entrez ! répondit-on aussitôt.
L’officier, penché sur un plan, était en train de donner des explications à un sergent dessinateur{, debout près de lui}. A l’entrée de Jacques, il leva la tête, regarda et ne dit mot.
Jacques alors se présenta d’une voix claironnante, les talons joints, le buste dressé, et les yeux dans les yeux de son supérieur :
— Sergent [Tribout] {Tény}, de la 1re {2e} compagnie du 9e {3e} génie, détachement d’Angers {de Lille} !
— Bon ! bon ! mon garçon, je ne suis pas sourd, fit le major d’un ton jovial.
Au même instant, une sonnerie de téléphone retentit, et l’officier se pencha vers l’appareil, laissant au sergent, planté comme un piquet au milieu de la pièce, tout loisir pour examiner les lieux.
Le téléphone, tout d’abord, intéressa Jacques par son étrangeté et sa complication Il se composait d’une espèce de grande caisse, surmontée d’un transmetteur ordinaire. De cette caisse sortait tout un réseau de fils, dont les uns venaient aboutir à des bobines de toutes dimensions ; les autres à un tableau de résistances ; d’autres encore à une boîte métallique, de laquelle s’échappaient des sons musicaux très aigus, sur une seule note, au rythme extrêmement rapide et régulier. Et, trouant le plafond, un fil à grosse section semblait rattacher tout l’appareil à une antenne extérieure.
Jacques finit par reconnaître un poste radiotéléphonique, c’est-à-dire de téléphonie sans fil. On avait beaucoup parlé, avant la guerre, des expériences des lieutenants de vaisseau Colin et Jance, dont les efforts, couronnés de succès, avaient enfin donné une solution pratique au problème de la transmission de la voix par les ondes hertziennes. L’emploi de cet instrument était naturellement indiqué dans les circonstances présentes, car les patrouilles allemandes auraient eu beau jeu à interrompre les communications du major de tranchée avec le quartier général en coupant continuellement les conducteurs téléphoniques.
Dans le coin opposé au téléphone, travaillait le dessinateur plié en deux sur sa planche à dessin. En face de lui, un chronomètre de précision à régulateur électrique voisinait avec des engins de mise de feu, marquant placidement et inlassablement les secondes, de son aiguille baladeuse.
Jacques ne put s’empêcher de frémir à la pensée qu’à l’heure indiquée par ce chronomètre, si indifférent avec son air d’éternité, le courant libéré par les appareils exploseurs irait provoquer la déflagration des milliers de kilogrammes de poudre enfouis sous terre. Une légère pression du doigt, le simple déplacement d’une manette, et des remparts s’effondreraient, des centaines d’existences seraient supprimées, et la route s’ouvrirait à l’assaut triomphal et sanglant.
Cependant, le major avait terminé sa conversation. Il revint vers Jacques et familièrement lui posa la main sur l’épaule.
— [Tribout] {Tény}, m’avez-vous dit : sergent [Tribout] {Tény}, n’est-ce pas ? je ne me trompe point : eh bien, mon ami, vous portez là un beau nom. C’est celui d’un vaillant officier du génie, que j’ai bien connu, alors que j’étais encore tout jeune sous-lieutenant.
— C’est peut-être de mon grand-père que vous voulez parler, mon commandant.
— Attendez… oui, je crois qu’il était du pays messin. Il avait pris part à la guerre de 70, et aimait à nous raconter les épisodes de la défense de Metz…
— C’est bien cela, mon commandant ; mon grand-père se nomme Jérôme [Tribout] {Tény}, et demeure tout près d’ici, à Vaux, son village natal, où il s’est retiré. Je serais même heureux…
Mais le major lui coupa la parole, et reprit l’éloge de son vieux collègue.
— C’était un officier de valeur, un brillant élève de cette ancienne école du génie de Metz, qui a formé tant d’illustres mineurs, un disciple ou un contemporain des Monge, des Bossut, des Favart d’Herbigny, des Boisgérard, des Carnot, de tous ces célèbres ingénieurs, qui furent la gloire de nos armées sous la République et l’Empire… Voilà des modèles, jeune homme, qu’il vous faut imiter… car je pense que vous avez l’ambition de devenir officier, vous aussi.
— C’est mon plus cher désir, mon commandant ; je préparais l’examen quand la guerre est arrivée.
— Parfait, mon jeune ami ! Votre examen, vous le passerez au bruit du canon et, quant aux vieilles traditions de l’armée, c’est auprès de votre grand-père qu’il faudra les apprendre…
Jacques saisit l’invitation au vol :
— Précisément, mon commandant, mon grand-père m’écrit qu’il serait très désireux de me voir le plus tôt possible, pour…
— Oh ! mon cher, il ne faut pas y penser pour le moment…
— Mais, mon commandant, je vous assure…
D’une voix sèche et tranchante, le major l’interrompit aussitôt :
— Sergent, le corps du génie s’est toujours distingué par son sentiment du devoir… Vous devez comprendre qu’il n’y a pas lieu d’insister…
Décontenancé, Jacques se tut. Malgré son allure bourgeoise, le major était peu commode, et le sergent, que la rondeur de l’officier avait d’abord enhardi, dut reconnaître qu’il s’était lourdement trompé.
— D’ailleurs, reprit le commandant d’une voix radoucie, mais non sans ironie, je vous engage à être très exact dans votre service, surtout aujourd’hui et demain. Voilà notre soleil, au corps de siège, réglez-vous sur lui. Il n’y a pas d’autre heure que celle-là dans les tranchées, les rameaux et les galeries : le général de [Maud’huy] {Mald’huy}, lui-même, a fait régler sur lui la montre de son chef d’état-major à cinq secondes près.
Et du doigt, il désigna le chronomètre.
Subjugué, Jacques obéit machinalement, et régla sa montre.
— Là, voilà qui est bien. Comme cela, vous ne risquez pas d’être surpris par l’explosion…
— Par l’explosion ? reprit Jacques comme un écho.
Il l’avait déjà oubliée. Sa pensée était ailleurs ! Et, intérieurement, il maudissait le temps perdu en conversations inutiles.
— Comment, vous êtes arrivé au corps depuis ce matin, et vous ignorez qu’après-demain, à 4 heures précises du matin, pas une seconde avant ni après, 5.000 kilogrammes de poudre vont exploser à l’extrémité de la galerie n°3. Vous ignorez que demain se joue la première scène du dernier acte : celui des grandes explosions qui aboutit au renversement de la contrescarpe. Car, jusqu’à présent, nos entonnoirs n’étaient que de simples fondrières. Vous allez voir celle-là !…
— Je me moque pas mal de son explosion ! murmura rageusement le sergent. Il faut que j’aille à Vaux et j’irai !
— Tenez, voyez ! ajouta le major en s’animant, et sa bonne face ronde prit un air tragique. Pour être plus sûr de ne pas manquer l’heure, ce sera mon chronomètre lui-même qui fera la mise du feu ! Regardez ! Je mets cet index sur 4 heures et, avec cette clef, je ferme le circuit ! Pour une explosion, ce sera une belle explosion !
Le « Vieillard », comme l’avait appelé le sergent [Remteaux] {Perrin}, s’enthousiasmait, et c’était un curieux contraste de voir cet homme aux allures pacifiques et à la tournure de comptable paisible, se préparant à déchaîner un volcan.
Mais Jacques était de la race des têtus, et la contradiction l’exaspérait.
Loin de le détourner de son projet, les belliqueuses démonstrations du commandant, suivant le refus presque brutal qu’il avait opposé à la prière du sous-officier, l’enfonçaient de plus en plus dans la résolution de partir sans retard pour Vaux.
Il éprouva même une espèce de soulagement à sentir ses dernières hésitations disparaître et sa mauvaise humeur de voir le temps s’écouler fit place à une froide détermination. Il salua largement pour prendre congé de l’officier, fit demi-tour posément et sortit.
* * *
Il n’y a plus de temps à perdre. Au pas gymnastique, Jacques redescend la tranchée et revient en hâte à la casemate de l’adjudant auquel il ne peut se dispenser de demander un dernier renseignement.
Juste à ce moment une corvée en sort.
Cinq ou six hommes portant chacun un certain nombre d’outils la composent ; à leur tête, un petit caporal imberbe qui salue en passant d’un geste familier.
— Ah ! fait l’adjudant étonné de revoir le sergent, vous avez réfléchi ?… Tant mieux… Tenez, voilà justement vos travailleurs qui vont préparer leur chantier de cette nuit.
— Je voulais vous demander, mon adjudant, à quelle heure, exactement, je devais prendre le service ?
— A dix-huit {six} heures et demie tapant, à ma montre.
— Bien ; et vous avez l’heure du major de tranchée, sans doute ?
— Evidemment : quelle heure voulez-vous qu’on ait ici, si ce n’est pas celle-là ?
— Et à quelle galerie dois-je me rendre ?
— Vous devez venir prendre le service ici même, car c’est devant ma casemate que se rassemblent toutes les corvées, avec les gardes de tranchée.
— J’ai compris ; maintenant j’aurais voulu savoir encore…
— Où est votre chantier, je parie ? Facile de vous contenter : les sapeurs qui sortent d’ici y transportent leurs outils. Vous n’avez qu’à les suivre… Galerie F. Je vous engage même à y aller, mais dépêchez-vous, car une fois engagés dans la galerie majeure, vous les perdrez de vue, si vous n’êtes pas sur leurs talons ; il y a des rameaux secondaires qui…
Jacques salue aussitôt et prend congé : il se précipite derrière les sapeurs qui se sont dirigés vers la gauche, et ont déjà disparu à un tournant.
Il tient en effet, par-dessus tout, à connaître l’emplacement de son chantier, car s’il revient de Vaux avec un certain retard, comme il commence à le craindre, il rejoindra directement ses sapeurs sans passer par la casemate de l’adjudant.
Celui-ci grognera peut-être un peu, mais ignorant que le sergent a désobéi en allant à Vaux, il ne pourra qu’infliger un blâme ou une légère punition, pour retard à prendre le service.
Tout en monologuant ainsi intérieurement, Jacques a rejoint les sapeurs sur une place d’armes — simple élargissement de la tranchée — au moment où ils s’engagent dans une galerie descendante ; il les compte ; ils ne sont que six : inutile d’être plus nombreux dans ce travail à l’étroit.
La « galerie majeure », comme l’a appelée l’adjudant, est un couloir de 2 mètres de haut sur 2 m 10 de large au plafond : son coffrage est formé de madriers espacés de 50 en 50 centimètres et coiffés de chapeaux. Entre les madriers, des planches jointives contiennent les terres.
De place en place des ampoules électriques accrochées au plafond illuminent le couloir obscur, marquant un triomphe sur les anciens procédés, sur les lanternes de jadis à la lumière pâle et souffreteuse. Les alignements lumineux s’enfoncent pour dévier dans les ténèbres et se perdent au premier tournant.
Après avoir cheminé une soixantaine de mètres derrière la corvée, le sergent [Tribout] {Tény} s’engage à droite avec elle dans un rameau secondaire, où les hommes se mettent sur un rang, car si le boyau a toujours 2 mètres de haut, il n’a plus que 1 mètre de large. Mais il est très court ; presque aussitôt la petite équipe oblique à gauche et s’enfile dans un autre rameau qui fait avec le précédent un angle de 120 degrés environ. Une trentaine de mètres encore, puis la voix du caporal s’élève, qui commande halte.
La galerie s’est élargie ; elle s’arrête ici. On est sur le front le plus avancé.
Alors seulement le sergent dépasse les hommes, rejoint le caporal et l’interpelle : celui-ci dirige sur lui la lumière d’une lanterne qu’il tient à la main et fait un geste d’étonnement :
— C’est vous, le nouveau sergent arrivé avec le détachement d’Angers {de Lille} ?
— Oui, c’est moi. Et vous, comment vous appelez-vous ?
— Bernard, sergent, et bien content de vous voir arriver, car faute de gradés, on commençait à trinquer ferme, nous autres !
— Eh bien, Bernard, moi aussi, je suis content de vous voir, car je voudrais causer un instant avec vous avant de prendre le service… L’adjudant m’a dit que je le prenais ce soir à 18 {6} heures et demie ; alors, c’est ici ?
— Oui, sergent, seulement il faut aller chercher la corvée devant la casemate de l’adjudant, près du dépôt d’outils, là où je vous ai croisé tout à l’heure.
— Je sais, je sais… Mais le travail, c’est ici qu’il commence ?
— C’est ici, sergent. Nous n’avons qu’à continuer la galerie commencée pendant 15 ou 20 mètres encore, puis au bout creuser une chambre à poudre : je ne suis pas sûr de la longueur, car ici nous ne devons pas être loin des rameaux Ies plus avancés des contre-mines allemandes. L’adjudant vous donnera le topo du travail que je lui ai rendu hier et qu’il a mis à jour. Il paraît qu’ici nous cheminons vers la caponnière du fort lui-même.
— Et la galerie sur laquelle celle-ci s’embranche ?
— Elle est dirigée sur le saillant d’un ouvrage avancé, mais qui ne fait pas partie du fort : c’est un retranchement d’infanterie qui borde le changement de pente.
Le caporal s’interrompt pour donner quelques ordres à mi-voix aux sapeurs qui maintenant apportent des madriers et des planches.
Puis, revenant vers le sous-officier :
— Savez-vous, sergent, que je suis rudement content de vous voir arriver ? Voilà trois nuits de suite que je marche, et par ce froid noir…
— Il ne fait pas froid dans les galeries, pourtant.
— Non, si vous le voulez, mais il y fait humide, et la transition, quand on en sort est extrêmement pénible. Et avec cela, il ne ferait pas bon se faire porter malade. D’abord, on ne peut pas laisser les camarades tout seuls à la sape, et puis l’adjudant Mustang n’est pas commode… surtout depuis qu’il est à peu près seul pour régler le service : une « consultation motivée » auprès du docteur coûterait cher…
— Oh, les consultations, la visite, quand on n’est pas tout à fait sur le flanc, on ne doit pas y penser en campagne : on est Français avant tout, n’est-ce pas, Bernard ?
— Pour ça, oui, sergent, Français de Normandie ; c’est pas les plus mauvais, vous savez ; n’importe, la fatigue finit par vous épuiser. Je serai rudement content de retrouver mon « pieu » ce soir !
— Où couchez-vous ?
— A Lessy, dans la deuxième maison à l’entrée de la Grand-Rue, chez des braves gens qui m’ont donné le lit de leur fils parti à Francfort dans la landwehr.
— Eh bien, Bernard, vous coucherez dans ce lit-là, cette nuit ! Et j’en suis ravi pour vous, car j’espère que nous ferons bon ménage. A quand les galons d’or ?
— Oh ! sergent, je n’ai que deux mois de grade !
— Oui, mais en campagne le temps compte double et l’avancement est plus rapide.
— Plus rapide, c’est vrai, parce que les vacances s’ouvrent bigrement vite : nous avons déjà bien des camarades tués, depuis l’ouverture de la tranchée. Et ce n’est pas gai. On a beau être cuirassé et se dire qu’après tout…
Un bruit sourd les interrompt soudain et coupe court aux réflexions philosophiques du caporal.
— Les deux grosses pièces de tourelle du saillant du fort, qui tirent sur notre batterie de mortiers, de Rozerieulles, murmure-t-il.
— Des pièces jumelées, alors.
— Oui, elles tirent ensemble.
Un second coup roule et s’éteint lentement : c’est un grondement lointain, qui semble venir des profondeurs la terre. Et pourtant la détonation a dû se produire sommet du plateau, tout près de là.
Le sergent s’en étonne.
— Nous sommes déjà à une grande profondeur, explique Bernard. Avez-vous remarqué que la pente de la galerie descend tout le temps ?
— Oui, et en même temps, le terrain se relève à la surface. De sorte qu’il doit bien y avoir une quinzaine de mètres de terre au-dessus de nos têtes.
— Mettez-en dix avec, sergent !
— Mais alors, nous allons aboutir sous l’ouvrage ?
— Le capitaine, avant d’être blessé, disait qu’il fallait atteindre leur caponnière d’angle en passant sous leur système de contre-mines…
— Diable !
— Nous ne devons pas être loin de leurs premières écoutes ; je crois même que nous en sommes plus près que nous ne le croyons : mais il est impossible de deviner où ils sont, car ils ne piochent pas, ils ne font aucun bruit, et c’est la supériorité énorme qu’ils ont sur nous. Ils écoutent dans leurs galeries construites dès le temps de paix et ils peuvent nous envoyer à coup sûr le camouflet qui nous aplatit. Ecoutez, sergent, je ne suis pas peureux, mais chaque fois que je descends dans la galerie, j’ai le pressentiment qu’elle me servira de tombe.
—