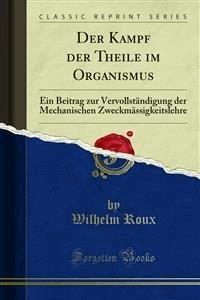Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions Matériologiques
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Französisch
Une étude consacrée à un essai du célèbre embryologue Wilhelm Roux
En 1881, le grand embryologiste allemand Wilhelm Roux publie cet essai dont la densité et l’originalité ne cessent, encore aujourd’hui, d’étonner. Inspiré par les idées de Charles Darwin, il cherche à en prolonger la portée en imaginant l’organisme comme un territoire où des formes variables de sélection naturelle opèrent sur toutes les entités, de la cellule à l’organe. Comment ces dynamiques opèreraient-elles ? Seraient-elles de même nature ? Pourraient-elles interagir ? Bien plus qu’un jeu de l’esprit, c’est à une exploration subtile que le lecteur est convié, dans les méandres d’une pensée foisonnante, qui se déploie dans une filiation parfois rebelle vis à vis de l’auteur de
l’Origine des espèces. Ce dernier n’en déclara pas moins que c’était « un des livres les plus importants […] sur l’évolution » qu’il lui avait été donné de lire. Bien que méconnu, cet ouvrage marqua néanmoins profondément ses lecteurs les plus illustres. Nietzsche, notamment, y puisa la source de son engouement pour la biologie, et les fondements de certains de ses concepts majeurs : Wilhelm Roux se trouve ainsi être le passeur entre deux des plus grands penseurs de l’ère moderne. Et par une pirouette de l’Histoire, certaines hypothèses de ce livre, longtemps tenues pour obsolètes, se révèlent au contraire visionnaires, au regard de travaux récents qui réévaluent considérablement la place du hasard dans le fonctionnement des cellules et des organismes. Première traduction en français de cette échappée solitaire de la pensée biologique, ce texte est précédé d’une préface qui développe de manière critique cette postérité inattendue.
Découvrez une vision de l'organisme comme un territoire où des formes variables de sélection naturelle opèrent sur toutes les entités, de la cellule à l’organe.
EXTRAIT
Si l’adaptation au stimulus est si parfaite que celui-ci est devenu absolument vital et qu’en son absence l’assimilation et la conservation de la qualité normale ne se produisent pas du tout, il en résulte une conséquence supplémentaire. Les parties de l’organisme ne pourront ainsi se conserver et se former que là où le stimulus agira ; et là où le stimulus prendra une certaine forme, il se produira un arrangement de la forme du stimulus, les organes devant adopter la forme et la structure du stimulus. Si, par exemple, le stimulus agit plutôt dans certaines directions, comme c’est le cas dans les os, alors les cellules mères se trouvant dans ces directions sont les plus sollicitées pour former la substance osseuse.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Wilhelm Roux est un embryologiste et zoologiste allemand (1850-1924), considéré comme un père fondateur de l'embryologie expérimentale. Il est également à l'origine du premier journal consacré à cette discipline :
Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen (
Archives pour le mécanisme de développement des organismes).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La lutte des parties dans l’organisme
Contribution pour un perfectionnement de la théorie de la finalité mécanique
Copyright
Présentation
En 1881, le grand embryologiste allemand Wilhelm Roux publie cet essai dont la densité et l’originalité ne cessent, encore aujourd’hui, d’étonner. Inspiré par les idées de Charles Darwin, il cherche à en prolonger la portée en imaginant l’organisme comme un territoire où des formes variables de sélection naturelle opèrent sur toutes les entités, de la cellule à l’organe. Comment ces dynamiques opèreraient-elles ? Seraient-elles de même nature ? Pourraient-elles intéragir ? Bien plus qu’un jeu de l’esprit, c’est à une exploration subtile que le lecteur est convié, dans les méandres d’une pensée foisonnante, qui se déploie dans une filiation parfois rebelle vis à vis de l’auteur de l’Origine des espèces. Ce dernier n’en déclara pas moins que c’était « un des livres les plus importants […] sur l’évolution » qu’il lui avait été donné de lire.
L'auteur
Wilhelm Roux (1850-1924), biologiste allemand, est l’un des fondateurs de l’embryologie expérimentale, durant la deuxième partie du XIXe siècle.
Table des matières
Avant-propos des éditeurs
(Thomas Heams et Marc Silberstein)
Avant-propos des traducteurs
(Laure Cohort, Sonia Danizet-Bechet, Anne-Laure Pasco-Saligny et Cyrille Thébault)
Préface.
La lutte des parties dans l’organisme
, ou l’impasse visionnaire
(Thomas Heams)
1 -
La vie scientifique de Roux
2 -
La Lutte
, entre audace et solitude
3 -
Postérités de
La Lutte
. Roux, entre Darwin et Nietzsche
4 -
Roux par delà Nietzsche, le retour de la biologie
Avant-propos
Chapitre I. L’adaptation fonctionnelle
1 -
Les performances
2 -
Hérédité des effets de l’adaptation fonctionnelle
Chapitre II. La lutte des parties dans l’organisme
1 -
Fondement
2 -
Types et performances de la lutte des parties
3 -
Résumé des performances de la lutte des parties
Chapitre III. Mise en évidence de l’effet trophique des stimuli fonctionnels
Résumé
Chapitre IV. Effets différenciateurs et formateurs des stimuli fonctionnels
Chapitre V. De l’essence de l’organique
Chapitre VI. Résumé
Avant-propos des éditeurs
Thomas Heams est maître de conférences en génomique fonctionnelle animale à AgroParisTech. Il a codirigé le livre Les Mondes darwiniens (1re éd. 2009 ; 2e éd. éditions Matériologiques, 2011).
Pour les Éditions Matériologiques
Cette édition de La Lutte des parties dans l’organisme. Contribution pour un perfectionnement de la théorie de la finalité mécanique[1] de Wilhelm Roux est, à notre connaissance, la première jamais proposée en français, et même la première traduction. C’est pour les Éditions Matériologiques une satisfaction singulière d’illustrer, par ce texte, sa volonté de traduction de textes de référence en sciences et philosophie des sciences.
Plutôt qu’un texte muséifié, nous proposons ici une édition critique. Une préface en restitue le contexte et tente d’en explorer la portée. La traduction est bien évidemment intégrale, mais nous avons choisi d’insérer des notes qui en rendent la lecture plus commode, notamment à l’occasion des descriptions anatomiques. Ces notes concises se veulent une aide concrète à la lecture, et ne prétendent pas à l’exhaustivité académique. Par ailleurs, quand des textes importants sont cités par Roux, notamment les écrits de Darwin, nous faisons le choix de renvoyer à des éditions de référence plus couramment disponibles. Tous nos ajouts sont clairement identifiés comme notes d’éditeurs (Ndé). Il n’y a pas donc de confusion avec l’appareil de notes que Roux avait introduit et que nous maintenons par ailleurs en l’état.
Les éditeurs souhaitent remercier chaleureusement l’équipe de traducteurs qui a accepté cette entreprise au long cours. Ils ont commencé ce travail avec enthousiasme dans le cadre de leurs travaux de fin d’étude, par l’intermédiaire de Ghislaine Tamisier que nous remercions ici, avec le double défi de restituer la langue et la pensée rouxiennes, en s’immergeant dans un univers scientifique et un lexique qui leur étaient inconnus. Il sera aisé de constater que ce défi, remporté haut la main, révèle leur grand talent. Chacun notera, dans leur avant-propos, dont la lecture préalable est nécessaire, la maturité et le soin qu’ils ont apportés à ce travail, et l’honneur qu’ils font, par la manière dont ils en parlent, à l’indispensable métier de traducteur qu’ils exercent désormais. Ce fut une belle aventure intellectuelle, mais aussi humaine, que de bénéficier de leur travail.
Nous souhaitons aussi remercier le Service commun de la documentation de l’université de Strasbourg (http://docnum.u-strasbg.fr/cdm4/document.php?CISOROOT=/coll13&CISOPTR=41242&REC=1) qui a numérisé à notre demande leur exemplaire de Der Kampf der Theile im Organismus, un des seuls disponibles en France, et l’a mis à disposition du public. Et comme les traducteurs, nous remercions Elke Witt de sa disponibilité et de sa contribution.
Notes du chapitre
[1] ↑ Der Kampf der Theile im Organismus. Ein Beitrag zur Vervollständigung der mechanischen Zweckmässigkeitslehre, publié en allemand par les éditions W. Engelmann à Leipzig en 1881.
Avant-propos des traducteurs
Laure Cohort, Sonia Danizet-Bechet, Anne-Laure Pasco-Saligny, Cyrille Thébault, sont traducteurs allemand-français (École supérieure d’interprètes et de traducteurs – ESIT, rattachée à l’université Paris 3).
La Lutte des parties dans l’organisme a été publié en 1881, il s’agit là d’un texte difficile au style alambiqué et parfois déroutant. C’est surtout l’ouvrage d’un scientifique précis et prudent, conscient des limites de ses connaissances, mais déterminé à convaincre le lecteur de la pertinence de sa théorie.
Pour servir au mieux ce texte, notre travail consistait à en reproduire les spécificités tout en facilitant sa lecture pour le public d’aujourd’hui. Nous avons conservé autant que possible la voix de l’auteur et modernisé uniquement les passages dont la syntaxe était particulièrement complexe.
La traduction à huit mains a été un défi à plusieurs égards, notamment en matière d’harmonisation, mais cela nous a permis de réfléchir ensemble aux problèmes qui se présentaient.
L’un des premiers choix que nous avons faits a été de traduire l’allemand « zweckmässig » par « finalitaire », alors que l’apparition de « finalitaire » daterait de la seconde moitié du XXe siècle. Dans une version contemporaine des Énigmes de l’univers de Haeckel, « zweckmässig » était traduit par l’idée de « conformité à une fin ou un but », proposition plus longue et peu maniable, insatisfaisante au vu de la complexité de nombreux passages du texte. L’adjectif « finalitaire » nous a ainsi paru plus simple et tout aussi fidèle au sens donné par Roux.
Le terme « Entwicklung » appelait également une solution particulière. En 1881, « évolution » et « développement » étaient en effet synonymes. On parlait ainsi sans souci d’« évolution de l’embryon ». Afin d’actualiser la traduction et de ne pas tomber dans la confusion, nous avons choisi de traduire systématiquement « Entwicklung » par « développement » lorsqu’il est question d’embryon et d’individu, et par « évolution » lorsqu’il s’agit de lois générales et de phylogénèse.
Par ailleurs, nous avons été attentifs à formuler correctement les concepts que Roux emprunte à d’autres auteurs, comme la fameuse « lutte pour l’existence » de Darwin, ou encore l’idée lamarckienne d’« usage » et de « défaut d’usage ».
Mais il fallait également transmettre avec exactitude les concepts propres à Roux. Bien que certains termes paraissent proches, comme ceux de « qualité », « substance » et « processus », ils ne pouvaient être confondus. Pour Roux, le terme de « substance » est général tandis qu’une qualité est une substance dotée d’un caractère particulier, et un processus une activité exécutée par une substance. Il nous importait également de respecter les formulations de Roux, comme lorsqu’il décrit des qualités qui « se nourrissent ». Enfin, nous avons choisi de citer les auteurs de la même manière que dans le texte original : tantôt avec, tantôt sans l’initiale du prénom.
En traduction, tout parti pris est en soi arbitraire et par conséquent critiquable. Nous espérons cependant avoir pu, dans cette traduction, rendre à Roux et à cet ouvrage tous les honneurs qu’ils méritent. Bonne lecture !
Les traducteurs
Nous tenons avant tout à remercier ici Elke Witt pour ses précieuses remarques et ses explications qui ont éclairé notre lanterne à plusieurs reprises, ainsi que Thomas Heams, pour sa disponibilité et sa relecture attentive de notre travail.
Notes du chapitre
[1] ↑ Laure Cohort est diplômée de l’École supérieure d’interprètes et de traducteurs (ESIT) de Paris et titulaire d’un Master de traduction éditoriale, économique et technique. Elle travaille comme traductrice indépendante, depuis l’allemand et l’anglais vers le français. Site : www.laurecohort.fr.
[2] ↑ Sonia Danizet-Bechet a étudié à l’École supérieure d’interprètes et de traducteurs, où elle a obtenu son Master de traduction éditoriale, économique et technique. Après des débuts réussis de traductrice, elle a finalement décidé de se reconvertir dans un tout autre domaine.
[3] ↑ Diplômée de l’ESIT et titulaire d’un Master de traduction éditoriale, économique et technique, Anne-Laure Pasco-Saligny est traductrice experte au sein d’un cabinet de traduction spécialisé dans la communication d’entreprise.
[4] ↑ Cyrille Thébault est traducteur allemand-français et réviseur. à la suite d’études d’allemand (Caen) et de traduction (ESIT, Paris), il collabore notamment avec ARTE comme traducteur externe. Il maîtrise par ailleurs l’écriture gothique (transcription de la Frakturschrift et de la Kurrentschrift) et a traduit entre autres des articles traitant de Herbert Spencer et de Hippolyte Taine (critique scientifique et psychologie expérimentale). Contact : [email protected]
Préface. La lutte des parties dans l’organisme, ou l’impasse visionnaire
Il en va peut-être parfois de la pensée en biologie comme des promenades en forêt : le plus beau est peut-être dans les détours. La Lutte des parties dans l’organisme en est un. C’est un des nombreux essais qui ont façonné la biologie de la fin du XIXe siècle en Allemagne, dans ce moment de transition où la mèche allumée par Darwin, qui a déjà largement produit ses premiers effets, passe de langue en langue, notamment popularisée par Ernst Haeckel puis August Weismann, mais où la génétique n’est pas encore apparue aux avant-postes. Un moment où la biologie se cherche, notamment sur le plan expérimental. Où de nombreux appareils d’observation deviennent disponibles, mais rendent les armes aux plus petites échelles, là où se nichent, dans la cellule, dans son noyau, de si nombreuses réponses. La Lutte est un témoin de ce bouillonnement, une de ces multiples pistes, véritablement un essai, au sens littéral du terme. Dense, documenté, novateur, dérangeant même, ce livre semble avoir de nombreux atouts pour susciter un débat fécond. Et pourtant, il ne sera que peu commenté, et vivra une existence presque souterraine, cantonnée à quelques notes de bas de pages, et presque jamais par des biologistes. Pourquoi alors, redonner aujourd’hui une seconde vie à ce livre, une première traduction en français, et vraisemblablement, une première traduction tout court ? Parce que c’est tout simplement un livre important. Son auteur, Wilhelm Roux, est un des fondateurs de l’embryologie moderne. La Lutte a été lue passionnément par Nietzsche qu’il a largement influencé, et reçu plus que favorablement par Darwin lui-même. Voilà qui en fait déjà bien plus qu’un objet de curiosité. Plus étonnant encore, il s’avère que certaines de ses thèses regagnent en intérêt, bien que Roux lui-même n’eût jamais pu prévoir comment. C’est, enfin, un document inédit, tant sur la forme que sur le fond, quant à la pensée de ce temps. C’est pour toutes ces raisons que mettre de la lumière sur ce texte et le faire circuler à nouveau est une entreprise bien légitime. Mais avant d’en esquisser le contenu et les retombées, il est peut-être largement temps de faire connaissance avec son auteur...
1 - La vie scientifique de Roux
Wilhelm Roux est né en 1850. Il entreprend des études de médecine qui le mènent à Iena, Berlin et Strasbourg, où il étudie auprès des sommités telles que Rudolf Virchow, un des pères de la théorie cellulaire, Ernst Haeckel, le grand passeur de Darwin en Allemagne, et Gustav Schwalbe, célèbre paléoanthropologue et neurologue de l’époque. En 1878 il soutient son doctorat sur la ramification des vaisseaux sanguins dans le foie [2] et obtient un premier poste d’enseignement à Breslau en 1879 (aujourd’hui Wroclaw), où il prendra la direction de l’Institut d’embryologie. C’est dans ce contexte que Roux va lancer les bases de sa grande contribution à la science : rien moins que fonder l’embryologie expérimentale, ou, pour reprendre le terme qu’il choisit : « la mécanique du développement » (1884). L’embryologie de ce temps vit sous l’égide des enseignements d’Haeckel, que l’histoire a retenus et synthétisés sous la formule éclairante, lapidaire (et parfois contestable...) : « L’ontogenèse récapitule la phylogenèse. » Par cette loi dite biogénétique, ou loi de récapitulation, Haeckel a sans nul doute permis la jonction entre l’évolution comparée et l’embryologie, chacune des deux disciplines nourrissant l’autre.
Cette direction prise fait cependant de la dernière une science très largement descriptive. Roux veut aller au-delà de ce programme de recherche et, de fait, le refonder. Il veut comprendre le développement sous son angle le plus mécanistique, il veut en comprendre les causes proximales, l’enchaînement précis des causes et des effets, comme en témoigne d’ailleurs le sujet de sa thèse. Cette tournure d’esprit mécaniste est un invariant important pour comprendre la carrière, par ailleurs complexe, de Roux. Et c’est dans ce but qu’il va chercher à expérimenter en embryologie. Non plus seulement disséquer et comparer des embryons comme ses prédécesseurs, mais intervenir, agir sur le développement in vivo, jusque dans ses phases les plus précoces, pour en observer les conséquences et en déduire les mécanismes à l’œuvre.
C’est dans cette logique que se place, à cette époque l’élaboration de La Lutte des parties dans l’organisme, qui parait en 1881. Projet parallèle en apparence, hautement spéculatif, dont on comprend la logique et la temporalité si on le replace dans ce contexte. Si, dans les pas de Haeckel, Roux associe sciences de l’évolution et embryologie, il va le faire dans une perspective radicalement différente, et novatrice : il s’agit initialement d’importer le concept de sélection naturelle à l’intérieur des organismes, pour expliquer la formation de leurs différentes composantes, à toutes les échelles. Le but de cette entreprise affleure dans le sous-titre de l’ouvrage, « Contribution pour un perfectionnement de la théorie de la finalité mécanique » : comme nous le verrons en détail plus bas, Roux souhaite, avec une grille de lecture mécaniste, consolider la théorie darwinienne de l’évolution, seule légitime selon lui pour expliquer la finalité, mais qu’il estime insuffisante à elle seule pour le faire.
Roux va mener, dans les années 1880, des recherches qui vont marquer l’histoire de sa discipline. On le crédite parfois de travaux pionniers en 1885 sur l’entretien de cellules embryonnaires de poulets in vitro, qui ouvrent la voie à la culture cellulaire, alors une prouesse technique devenue désormais universellement répandue dans tous les laboratoires de biologie cellulaire. Il évoque d’ailleurs la possibilité de transplantation cellulaire dans La Lutte, en citant les travaux et les écrits de son maître Virchow. On lui doit aussi, et peut-être surtout, le choix décisif des œufs d’amphibiens comme matériel d’étude des premières divisions cellulaires du développement. En intervenant mécaniquement sur des embryons, qu’il immobilise, il montre que le plan médian des organismes bilatéraux est le même que celui de la première division cellulaire. Il montrera par la suite que ce plan est déterminé par le point d’entrée du spermatozoïde dans l’œuf lors de la fécondation. Ainsi se réalise progressivement son projet expérimental de compréhension des causes et des effets dans chaque étape du développement. En bon mécaniste encore, il testera successivement l’effet de la gravité, de la chaleur, de la lumière, de l’oxygène et même plus tard de l’électricité sur ces étapes. Là encore, le désir de bien distinguer les effets de chaque nature, externes et internes, est explicite.
Comme tout scientifique digne de ce nom, Roux va aussi beaucoup se tromper. Se demandant si les cellules issues des premières divisions embryonnaires sont capables d’un développement autonome (ce qu’il nomme « autodifférentiation ») ou si elles s’influencent les unes les autres (« différentiation [inter]dépendante »), il publie en 1888 une expérience célèbre dans laquelle il observe le devenir de cellules après la première division en en brûlant une avec une épingle chauffée à blanc. Il conclura à l’indépendance des développements cellulaires, idée qui sera largement rejetée ultérieurement : pionnier dans sa méthode, Roux en ignore encore légitimement les difficultés techniques qui conduisent parfois à des conclusions erronées. Reste que ses approches pratiques se diffuseront vite, fournissant un corpus de résultats dont la cohérence croissante aura un prix, celui de réfuter ses premières conclusions. Mais si ces résultats sont oubliés, le legs méthodologique demeure, lui, à ce jour incontesté. D’autres erreurs de parcours sont notables chez Roux, dont la plus célèbre reste celle de la théorie dite de division nucléaire inégale. Elle répondait à la question de savoir si les différences entre cellules provenaient ou non d’un partage inégal des chromosomes (découverts en 1882, ils sont nommés ainsi en 1888) lors de la division. Roux n’exclut d’abord pas ce partage inégal, puis croit le démontrer avec ses outils expérimentaux sur des embryons de grenouille. La théorie du partage inégal gagna rapidement du crédit, et elle est restée dans les archives sous le nom de théorie Weismann-Roux, car à sa décharge, Roux en partagea la paternité avec August Weismann, l’un des plus grands évolutionnistes et biologistes de l’histoire, le père de la distinction entre lignée somatique et lignée germinale qui permit une réfutation quasi définitive de l’hérédité des caractères acquis, et par ailleurs l’un des seuls lecteurs enthousiastes vraiment connus de La Lutte. C’est d’ailleurs notamment dans son maitre-ouvrage de 1892, Das Keimplasma. Eine Theorie der Vererbung[3] , qu’il développe ladite théorie, après Roux. Mais l’histoire a reconnu que cette théorie était fausse et c’est Hans Driesch qui le démontrera. Alors jeune scientifique de 22 ans, il cherche à généraliser les résultats de Roux dans d’autres espèces, mais au vu de ses résultats il en viendra progressivement, à l’inverse, à les remettre en cause. Il en résultera une controverse entre les deux hommes, entre deux générations aussi, car Roux, devenu entre-temps une importante figure institutionnelle, rechignera longtemps à accepter l’évidence de son erreur, au prix d’hypothèses ad hoc sans cesse moins convaincantes.
Après Breslau puis, de 1889 à 1895, l’Institut anatomique d’Innsbruck, Roux va quitter la biologie expérimentale pour s’attacher à la publication de ses œuvres et à la fondation des Roux’ Archive für Entwicklungsmechanik der Organismen. Il s’y consacre notamment à l’Institut anatomique de Halle, dont il prend la direction jusqu’en 1921 et où il terminera sa carrière. Il y avait à faire : Viktor Hamburger a qualifié Roux d’un des biologistes les plus prolifiques de son temps [4] , bien que d’une lecture qui ne semble pas évidente… Il évoque une prose abstraite et théorique, et souvent aride. Et si certaines de ses planches illustrées sont devenues célèbres, elles n’en constituent que 7 pages sur 1 600. Wilhelm Roux meurt en 1924.
2 - La Lutte, entre audace et solitude
Dans cette vie, La lutte représente un moment qui peut paraître étrange. Bien que ce livre, comme on l’a vu, s’intègre dans la pensée rouxienne, il constitue néanmoins une échappée solitaire. Il est, soulignons-le, l’œuvre d’un jeune trentenaire, il est audacieux, il avance de multiples hypothèses : il avait donc toutes les qualités requises pour devenir le fil directeur de fructueuses recherches. Las, on ne trouve pas véritablement dans son travail de protocoles expérimentaux visant à tester ses hypothèses, et au-delà de Roux lui-même, l’ouvrage ne semble pas avoir fait école. Peut-être que la fraîche réception du livre explique en partie cette absence de postérité. Jamais traduit, peu commenté (on dit cependant que Roux fut félicité par Haeckel), il fut probablement victime de sa propre audace. Roux mentionne lui-même dans son autobiographie la réaction d’un de ses professeurs, Gustav Schwalbe : « N’écrivez plus jamais un ouvrage philosophique de ce genre sans quoi vous ne deviendrez jamais un professeur d’anatomie ! [5] » Au-delà d’une proverbiale frilosité mandarinale pour les nouvelles idées, Roux explique cette réception par la méfiance académique pour une embryologie analytique qui viendrait ébranler les fondations de l’embryologie descriptive qui prospérait alors. Au vu de sa carrière, il semble en tout cas que Roux ait suivi ces conseils de prudence et ait refréné ses accès d’audace. Il a ainsi tout simplement contribué lui-même à refermer la porte qu’il avait ouverte, et les horizons prometteurs qui étaient entre-apparus. Est-ce de la lucidité ? L’histoire n’a-t-elle pas ici sagement remisé dans l’arrière-boutique une spéculation vaine ?
Peut-être en partie, mais on voudrait ici proposer une autre hypothèse. En effet, certaines œuvres, souvent les plus grandes, dépassent leur auteur et leur époque. Et il n’est pas incongru de se demander si La Lutte n’en est pas un bon exemple. Car si les commentaires sur le livre ne sont pas légion, il y en a un qui retient tout particulièrement l’attention : « Pour autant que je puisse imparfaitement en juger, il s’agit de l’ouvrage sur l’évolution le plus important qui soit paru depuis quelque temps. » Le compliment n’est pas désagréable… surtout quand il est de la main de Charles Darwin lui-même, qui y réagira dès sa sortie dans une lettre à G.J. Romanes, avant que sa mort, un an plus tard, ne l’empêche d’y revenir plus en détail. Qu’y a-t-il donc de si notable dans ce livre en allemand, pour que le grand naturaliste anglais lui-même juge bon de le distinguer parmi toute la production scientifique de son temps ? Une filiation, peut-être.
Dans son titre même, le livre se présente, on l’aura compris, comme une référence explicite à la lutte pour la survie entre individus via la sélection naturelle proposée par Charles Darwin (et Alfred Russel Wallace, comme le mentionne Roux en fin connaisseur) en 1858 à la Société linnéenne, puis en 1859 dans L’Origine des espèces[6] . Le clin d’œil est assumé, et dès le début de l’ouvrage, Roux semble se ranger clairement du côté de Darwin (mais il remontera jusqu’à Empédocle et Héraclite…) et contre celui de Lamarck pour ce qui est de l’explication des mécanismes de l’évolution, bien que cette opposition schématique ne nous paraisse aujourd’hui que partiellement recevable. Elle témoigne en tout cas d’un appétit de Roux pour la biologie en général, et pas seulement pour son champ d’investigation expérimentale. Et c’est donc cette ouverture d’esprit qui va lui suggérer le fil directeur du livre, qu’il est temps de présenter.
Roux postule que ce qui prévaut à l’intérieur d’un organisme est la variation, et pas l’homogénéité. Il voit celui-ci comme un champ de forces contradictoires, avec des structures de différentes échelles et de différentes formes. Or, rappelons-le, il cherche à en expliquer le développement. C’est là que le parallèle avec la théorie darwinienne, qui fonde La Lutte, intervient. En effet, l’idée que la variété prévaut est au fondement de la pensée darwinienne, et c’est une de celles qui justifient la différence avec le lamarckisme. Là où les évolutionnistes prédarwiniens cherchaient les mécanismes d’apparition de la différence, de la variété, en convoquant d’illusoires forces vitales, Darwin répond avec génie que la variation n’est pas l’aboutissement, mais est l’état par défaut dans une population. Et que la nature fait le tri dans cette variété toujours présente. Roux, constatant la similitude des présupposés, va donc proposer de défendre qu’une dynamique comparable est à l’œuvre à l’intérieur des organismes. Rappelons ici, et c’est peut être d’ailleurs essentiel, que Roux n’était pas perturbé dans ses réflexions, si l’on ose dire, par la génétique. Bien que les lois de Mendel fussent formulées depuis quinze ans, elles n’étaient pas largement connues de la communauté des biologistes d’alors et ne seront redécouvertes qu’au tournant du XXe siècle : l’époque de Roux est donc celle d’un formidable banc d’essai de théories essayant de fonder en science la notion d’hérédité, qu’il s’agisse de la manière dont les caractères sont transmis de génération en génération, ou de la manière dont ils sont conduits à s’exprimer dans chaque individu. La Lutte est une de ces tentatives et cherche à répondre à ces deux questions, et tout particulièrement la dernière, en important le concept de sélection naturelle et en l’adaptant à l’intérieur de chaque organisme. À l’appui de cette démarche, Roux mentionne aussi un autre pilier de la pensée darwinienne qui veut que la multiplication des organismes impose, au vu des ressources finies, une sélection des plus adaptés : selon lui, Darwin et Wallace ont montré « qu’en raison de la multiplication géométrique des organismes il devait y avoir une lutte semblable entre eux, et qu’en raison des variations continues de toutes les parties à l’intérieur de l’organisme on pouvait supposer que seuls les meilleurs organismes survivaient ». Puisqu’il juge la situation « interne » comparable, grande est pour Roux la tentation de lui appliquer les mêmes lois.
Mais ce faisant, Roux va plus loin que le stade de la simple transposition. Sa proposition se veut aussi un complément indispensable à la sélection naturelle. En proposant une hypothèse mécanistique de la structuration des organismes, Roux espère rationaliser l’explication de leurs différences et donc, d’une certaine manière, se placer en amont de la sélection naturelle, en révélant pourquoi les objets sur lesquels elle s’exerce, les organismes, varient les uns les autres. Il s’agit donc d’un mécanisme inspiré de la sélection naturelle de Darwin mais qui en souligne aussi les supposées insuffisances et qui d’une certaine manière, lui dispute sa place de grande explication du vivant. C’est là une des découvertes passionnantes que la lecture de La Lutte révèle : loin d’être une laborieuse homothétie de la pensée darwinienne, elle en est une filiation bâtarde, souvent concurrente et parfois même ambiguë, et c’est tout ce qui en fait le sel, à la fois comme théorie scientifique, mais aussi comme document historique. En effet, le texte révèle en creux les débats et les contradictions de son époque.
On peut illustrer cela par un concept au cœur de la théorie rouxienne. Tout à son projet d’éviter le recours à toute explication de nature métaphysique, Roux va convoquer, pour expliquer la manière dont les différences apparaissent entre cellules, tissus ou organes, le concept d’adaptation fonctionnelle, qui va d’ailleurs donner son nom au premier chapitre du livre. Ce concept est, en fait, sa lecture du principe d’usage et de non-usage, qui veut que l’apparition et la pérennité des organes par exemple, s’expliquent par leur fortification et leur utilisation de génération en génération. C’est donc une réminiscence d’un des fondements du principe lamarckien d’hérédité des caractères acquis, et l’on mesure ici l’influence haeckelienne dans l’approche que Roux choisit de suivre, Haeckel ayant sur ce point une position intermédiaire entre Darwin et Lamarck. Pour achever de rendre complexe ce débat, il convient d’ailleurs de mentionner que Darwin lui-même, dans La Variation des animaux et des plantes à l’état domestique (1868) [7] , opérera un revirement partiel en reconnaissant une certaine validité audit principe, sans pour autant le mettre sur le même plan que la sélection naturelle…, ce que Roux ne se prive d’ailleurs pas, en fin lecteur, de faire remarquer. En conséquence de quoi, on pourrait ironiquement qualifier la démarche rouxienne de darwinisme interne renforçant le darwinisme classique avec une pointe d’antidarwinisme… Le lecteur aura tout loisir, qu’il en soit ici convaincu, de se perdre dans ces arcanes ! Soyons cependant rassurant : le paradoxe souligné ci-dessus se résout néanmoins pour bonne part. À la vérité, Roux ne confronte pas ces explications entre elles. La variabilité, qui engendre la variété des formes, est à l’origine de différences qui sont le moteur de cette adaptation fonctionnelle, qui va structurer les corps et permettre en aval à la sélection naturelle de jouer sur les individus. En quelque sorte, il remplace la boite noire de la différenciation, dans la chaîne causale explicative, par le principe de l’adaptation fonctionnelle, sans que celui-ci ne phagocyte complètement les hypothèses sélectives de Darwin.
Ce n’est qu’une fois ces considérations posées que Roux abordera le chapitre éponyme de l’ouvrage : « La lutte des parties dans l’organisme ». C’est dès les premières lignes de ce chapitre que Roux apparaît d’une fulgurante modernité. Il entend aller contre l’idée répandue que tout est « excellemment ordonné » dans les organismes, qu’il y règne des « lois immuables ». Il convoque Empédocle et Virchow pour aboutir à son idée maîtresse : l’inégalité des parties. Reprenant l’idée de Darwin, il affirme que c’est au contraire l’homogénéité qui est difficile à atteindre. Pour ce faire, il pousse même le raisonnement très loin puisqu’il rappelle que « tout, en effet, se modifie perpétuellement, y compris les machines de métal » et que puisque « deux cristaux ne sont jamais parfaitement identiques, à plus forte raison deux organismes ». Ces pages sont d’une très grande importance dans l’histoire de la pensée en biologie, et il semble que leur originalité n’ait que trop tardé à être reconnue, y compris de nos jours. Qu’on y réfléchisse un instant : est-il si courant, même aujourd’hui, d’imaginer que deux cellules voisines d’un même tissu sont fondamentalement différentes ? On verra plus loin que c’est souvent l’inverse qui est soutenu : possédant les mêmes gènes, partageant le même micro-environnement, elles sont supposées par défaut réagir de manière homogène à de mêmes « signaux », et donc mettre en œuvre le même programme. C’est sur ces bases que repose notre vision consensuelle de l’édification des organismes. Mais Roux nous dit ici qu’il n’en est rien, que c’est leur différence qu’il faut postuler. Il se pourrait qu’il ait ici fait preuve d’une incroyable prescience…
Mais revenons au texte. Puisqu’il y a variété, le lecteur comprend alors qu’il en découle des luttes entre les entités, à chaque niveau d’observation. Roux en abordera quatre : les molécules, les cellules, les tissus, les organes. Par molécules, il faut ici entendre les structures subcellulaires, leur nature étant alors mystérieuse à bien des égards. C’est par elles qu’il va d’abord longuement commencer. Il postule qu’elles sont de natures différentes et qu’elles vont rentrer en compétition pour l’espace et pour le métabolisme, en leur postulant des capacités d’assimilation différentielles. Ainsi, parmi elles, certaines se régénéreront plus vite, dureront plus longtemps, économiseront de l’énergie et surtout, seront capables de mieux croître, par le phénomène que Roux appelle la surcompensation du consommé (quand l’assimilation dépasse la dégradation). En outre, leur réactivité aux stimuli extérieurs entrera aussi en jeu. Il s’ensuit que certaines substances plutôt que d’autres gagneront la lutte pour l’espace et permettront alors in fine l’homogénéisation des contenus cellulaires. Enfin, une lutte directe peut aussi avoir lieu pour propager les propriétés de certaines de ces substances.
Avec nos yeux contemporains, ces considérations peuvent paraître très datées, et de fait, elles le sont largement. Néanmoins elles prennent une tout autre dimension quand Roux va tenter de les transposer à l’échelon suivant, celui de la lutte entre cellules. Il est d’ailleurs frappant de constater que Roux ne se contente absolument pas de décliner, à chaque échelon, la même logique de « lutte ». Il explore précisément ce qui fait la spécificité de chaque échelon. S’il postule des points communs entre le niveau « moléculaire » et le niveau cellulaire, il en remarque la principale différence, qui est la capacité propre aux cellules à proliférer, à se multiplier. En toute logique il va donc adapter son concept de la lutte entre cellules en expliquant les différences entre la compétition par augmentation de taille et celle par multiplication, qui aboutissent cependant toutes deux au principe de différenciation des cellules par des processus sélectifs. Et bien que Roux n’ait pas disposé des outils que le XXe siècle a progressivement mis à la portée des biologistes, c’est à ce niveau d’observation que ces propositions sont les plus perspicaces, comme nous le verrons plus loin. Pour les deux derniers niveaux d’observation, les tissus et les organes, Roux intègre de nouvelles contraintes dans son raisonnement. Ici, il ne s’agit plus seulement d’une lutte aboutissant à la destruction d’une des parties. Si elle peut conduire à éliminer d’éventuels organes inutiles, elle a surtout pour fonction de maintenir l’équilibre entre les tissus et les organes nécessaires. On pourrait ici rapprocher cette proposition de théories récentes selon lesquelles des équilibres au niveau tissulaires peuvent, s’ils sont brisés, aboutir à des phénomènes pathologiques comme la carcinogenèse.
Ici encore, le lecteur jugera ce qui, dans ce raisonnement, s’apparente à une curiosité historique, ou ce qui peut éventuellement nourrir une réflexion contemporaine. Il ressort de cette lutte multi-échelle que « les rapports de taille nécessaires à la fonction se forment d’eux-mêmes », et l’on voit bien à travers cette formule que Roux souhaite penser la formation de l’organisme à partir de l’intérieur, sur la base de ses seules ressources internes. Il développe, dans la fin de son ouvrage, une théorie complexe, documentée par de nombreux exemples en apparence compatibles, selon laquelle ce qu’il appelle des « stimuli » de natures variées peut avoir un effet trophique, c’est-à-dire nourrisseur sur les différentes parties. Ici, s’il faut bien convenir qu’on ne trouve pas de postérité documentée et concrète à ces idées dans la littérature scientifique ultérieure, elles n’en sont pas vaines pour autant. Penser l’organisme comme un espace où les relations entre entités sont de nature « trophique », c’est aussi échapper à une autre vision des choses, bien présente aujourd’hui, selon laquelle ces mêmes entités seraient en constant échange de « signaux ». Or cette relation « informationnelle » entre cellules ne nous explique pas de manière satisfaisante pourquoi les cellules obtempèrent. L’idée qu’il existe une certaine interdépendance trophique entre parties, et vis-à-vis des stimulus extérieurs, permet de sortir de la vision d’un organisme comme pure machine à obéir à ses gènes, en envisageant la multicellularité comme une voie – parmi d’autres – d’exploitation de la différence entre entités.
3 - Postérités de La Lutte. Roux, entre Darwin et Nietzsche
Ainsi, mélange d’idées parfois indéniablement clairvoyantes, parfois excessivement complexes, trop en avance pour être testées ou trop fragiles pour résister aux nouveaux cadres conceptuels qui vont structurer la biologie avec la redécouverte des lois de la génétique, La Lutte s’apparente à un ovni scientifique. Et il faut bien admettre que ces idées n’ont jamais vraiment occupé le devant de la scène, bien que pour certaines d’entre elles, l’avenir proche pourrait révéler quelques belles surprises. Dans l’article d’hommage que l’embryologiste Viktor Hamburger consacre à Wilhelm Roux en 1997 [8] , la place de La Lutte est réduite à la portion congrue, quelques lignes à peine. Elle semble n’avoir qu’une dimension anecdotique dans l’histoire du père de l’embryologie expérimentale. De fait, l’œuvre ne semble pas longtemps avoir fait école, et, comme déjà indiqué, l’on ne trouve que peu de citations substantielles dans la littérature biologique. Cet ouvrage aurait peut-être été complètement oublié s’il n’avait trouvé un écho durable dans un autre domaine, celui de la philosophie, en croisant le chemin de Friedrich Nietzsche, et ce de la plus éclatante des manières. De sorte que rendre La Lutte disponible aujourd’hui, c’est faire œuvre utile pour les historiens des sciences, comme pour ceux de la philosophie.
Nietzsche entretient avec les sciences du vivant, et avec Darwin, un rapport complexe et… évolutif, qui a été abondamment commenté. Si notre regard contemporain voit en ces deux penseurs deux grands briseurs d’idoles, deux grands acteurs du bouleversement de la pensée, il n’en demeure pas moins que Nietzsche lisait le naturaliste anglais avec des sentiments contradictoires, oscillant entre la reconnaissance et la défiance [9] . Il est donc savoureux de prendre conscience que c’est une lecture elle-même partiellement darwinienne de l’organisme qui va lui permettre d’élaborer une des plus importantes notions de sa pensée de l’Homme comme force provenant de l’intérieur. En 1887, il critiquera Darwin en arguant, en une évidente référence rouxienne, que « l’essentiel du processus vital est justement cette monstrueuse puissance formatrice qui, à partir de l’intérieur, est créatrice de formes et qui utilise, exploite les “circonstances extérieures” [10] ».
Cette référence à Wilhelm Roux est « évidente » car elle est bien documentée. Le philosophe allemand découvre La Lutte dès sa publication en 1881 et le lira au moins une autre fois en 1883, comme en témoignent différents de ses fragments. Et cette œuvre, dont il va retenir le tableau d’organismes comme lieux de conflits intérieurs, sera pour Nietzsche rien moins que la véritable porte d’entrée grâce à laquelle il s’initie à la physiologie au service de la philosophie du corps qu’il élabore. Dans le tourbillon de la production nietzschéenne, un des axes le plus déterminant, et qui défie peut-être le plus radicalement nos convictions, est son entreprise de déconstruction du cogito cartésien, c’est-à-dire la conviction selon laquelle, quand on a évacué toutes les illusions que nos sens peuvent provoquer, il nous reste cependant une certitude inaliénable : celle que nous existons au présent en train de penser. Nietzsche va s’employer à faire voler cette certitude résiduelle en éclat, dans un passage célèbre de La Volonté de puissance : « Dans ce célèbre cogito, il y a : 1° quelque chose pense ; 2° je crois que c’est moi qui pense ; 3° mais en admettant même que ce deuxième point soit incertain, étant matière de croyance, le premier point : quelque chose pense, contient également une croyance, celle que “penser” soit une activité à laquelle il faille imaginer un sujet, ne fût-ce que “quelque chose” » (Livre I, § 98, 1888). Le coup est rude.
Quel rapport entre cette mise en pièces et la pensée rouxienne ? Il faut pour le comprendre, opérer un petit saut temporel. Car c’est tout un pan de la biologie du XIXe siècle qui a, d’une certaine manière, armé le bras de Nietzsche [11] . Et c’est à Rudolf Virchow, le père de la théorie cellulaire, qu’il faut ici remonter. En posant que tout organisme vivant est constitué d’une immense pluralité d’entités que sont les cellules, Virchow sème indirectement la confusion sur ce que nous avons de plus ancré en chacun d’entre nous : le sentiment d’une individualité, d’une unité, qui passe par la certitude d’avoir une conscience propre et singulière. Virchow lui-même explique que les biologistes ont « toujours été abusés par le phénomène mental du moi », une antienne dont on voit bien combien Nietzsche en fera son miel, notamment quand il écrira que la biologie de son siècle le fait rentrer dans une phase de « modestie de la conscience ». Dans la « république des cellules » que postule Virchow, le moi est inévitablement décentralisé, atomisé, et Nietzsche ne se privera pas de filer cette métaphore, en parlant du corps comme d’une « société », un « rassemblement » qu’il qualifiera pour sa part de hiérarchisé. Et nul doute qu’entre Virchow et Nietzsche, Roux va bien sûr trouver toute sa place. Le lecteur pourra y penser en particulier quand il lira la métaphore rouxienne du corps comme État, où certaines cellules jouent des rôles aussi divers que des commerçants, des artistes ou des ingénieurs d’un pays. Il pourra aussi retrouver la trace de Roux dans un aphorisme célèbre du philosophe allemand : « L’uniformité est pur délire », formule rouxienne s’il en est… Mais plus encore, ce qui va frapper Nietzsche, c’est cette vision d’un corps comme lieu de luttes à toutes les échelles, comme lieu de tensions conflictuelles entre parties. Cette description de l’organisme va résonner avec la pensée nietzschéenne, qui va l’adapter en ajoutant une dimension d’agressivité et de violence. En accordant une importance particulière à ce que Roux appelle l’excitation fonctionnelle, qui pourrait s’apparenter à une blessure ou à une irritation initiale, Nietzsche va conférer aux organismes qui le fascinent tant – il les qualifie de « merveille[s] des merveilles » – une propriété propre, un besoin d’expansion, une force partant de l’intérieur : c’est la volonté de puissance. Et, trace peut être de la complexité des débats évoqués plus haut, il se sert aussi de Roux pour argumenter contre Darwin, comme le résume Müller-Lauter : « Nietzsche trouve par là une preuve notoire de la prééminence du à-partir-de-l’intérieur sur l’extérieur [12] » et conclura que les mécanismes rouxiens permettent de dire du développement des organismes en particulier et des lois du vivant en général que « tout cela arrive sans la lutte des individus ». Bien évidemment, on constate que Nietzsche sélectionne chez Roux une série d’arguments dans le but d’asseoir une pensée philosophique dont on peut se demander si elle avait réellement besoin d’éléments biologiques à son appui. Il serait certainement faux d’imaginer que c’est la seule lecture possible de ce texte, ni même si celui-ci s’impose vraiment comme lecture nécessaire à une philosophie du corps. Mais force est de constater que La Lutte est un chaînon essentiel du parcours de pensée entre deux des plus grands penseurs de la modernité. On saurait imaginer destin moins enviable…
4 - Roux par delà Nietzsche, le retour de la biologie
Mais que retenir d’un tel destin, si déroutant pour un ouvrage technique d’embryologie ? Nietzsche aurait-il été le seul lecteur qui permit une certaine postérité à La Lutte ? Ce fut, à la vérité, longtemps le cas. Si cet ouvrage de Roux n’a longtemps pas eu d’héritiers biologistes ou presque, c’est d’abord pour de bonnes raisons. Il est impensable aujourd’hui de comprendre le fonctionnement des organismes et leur développement sans y intégrer la génétique sur lequel ce texte fait l’impasse, pour d’évidentes raisons chronologiques, et de nombreux développements y sont en conséquence dépassés, à l’instar de bien des ouvrages de la même époque. Néanmoins, certaines des intuitions de Wilhelm Roux, et peut-être celles qui constituent le cœur de son hypothèse de travail, sont en passe de regagner un certain crédit. Sans chercher artificiellement à le réhabiliter, il est de plus en plus pertinent de se demander dans quelle mesure le postulat « sélectionniste » à la base de l’ouvrage n’est pas enfin promis à de beaux lendemains.
Cela n’a pas toujours été évident. La génétique, puis la biologie moléculaire ont assis l’idée que les organismes étaient le résultat d’un programme (programme génétique, programme de développement). Dans cette perspective, le programme se réalise par une interaction subtile et fine entre les cellules, qui répondent, comme on l’a vu plus haut, topographiquement et chronologiquement à une succession de signaux qu’elles échangent entre elles et intègrent pour produire des phénotypes cellulaires, tissulaires et organiques adaptés. Poussée à l’extrême, cette pensée instructionniste s’intègre parfaitement avec l’influente théorie évolutionniste du gène égoïste de Richard Dawkins, selon laquelle les organismes ne sont que des artefacts « inventés » par les gènes pour se reproduire : les gènes sont ici pure information, dont la réalisation matérielle, les êtres vivants, serait finalement de simples avatars. Dans cette vision génocentriste, dominante en biologie actuellement, où nous sommes le produit final d’une cascade complexe de communications finement régulées entre cellules, on ne voit pas précisément comment des équilibres pourraient résulter d’une quelconque lutte et d’une sélection. Si les informations circulent, pourquoi imaginer une quelconque forme de conflictualité ? Deux grandes théories biologiques échappent pourtant depuis longtemps à ce présupposé fondamental d’équilibre. La théorie de la sélection clonale, à la base de l’immunologie, présuppose que les cellules immunitaires donnent naissance, grâce à la recombinaison génique, à une immense variété de petites lignées clonales productrices chacune d’un anticorps différent, lignées qui seront « sélectionnées » au passage de l’antigène correspondant. Cette théorie longtemps controversée mais désormais unanimement reçue s’opposait initialement à une théorie instructive, voulant que les anticorps soient « moulés » sur les antigènes lors du contact. Il y a donc une phase de variabilité, à l’aveugle, suivie d’une phase de sélection, sur la base de l’adaptation à l’environnement local et à la fonction. Voilà donc ce que l’on pourrait nommer une « petite musique rouxienne » au cœur de notre système immunitaire ! Et il est ici intéressant de noter que la théorie instructive posait elle-même de nombreux problèmes au regard du dogme central de la biologie moléculaire, qui veut que l’information ne circule pas des protéines vers l’ADN : c’est donc un raisonnement sélectif qui a permis de sortir de cette ornière [13] . Roux aurait peut-être apprécié… De même, la théorie de référence pour la construction des réseaux neuronaux, dite stabilisation sélective des synapses, postule un comportement exploratoire des synapses, des contacts synaptiques surnuméraires et la stabilisation a posteriori de certains réseaux au détriment d’autres [14] . Là encore, une sélection réalise un tri sur la base d’une variété préexistante, et le neurobiologiste Gerald Edelman parle d’ailleurs à son propos de « darwinisme neural [15] »…
Si ces deux grandes théories biologiques ne font plus guère polémique dans leur domaine respectif, il existe toute une littérature grandissante qui s’appuie sur des hypothèses de sélection interne, dans des contextes variés. Les travaux précurseurs de Jim Till décrivent dès 1964 des mécanismes de prolifération stochastique des cellules souches hématopoïétiques peu compatibles avec un modèle instructionniste de la différenciation. James Michaelson propose en 1993 un article de synthèse sur la sélection cellulaire reprenant les exemples précédents, mais décrivant aussi des mécanismes similaires notamment dans le foie, et dans le développement du système génito-urinaire. Enfin, depuis le début des années 1980, Jean-Jacques Kupiec propose de renverser le cadre explicatif général la différenciation cellulaire, en faisant reposer celle-ci sur une stabilisation a posteriori d’états cellulaires stochastiques. Ce faisant, il postule la variabilité comme état par défaut du système, et donc comme force de structuration de l’organisme. Ces hypothèses, longtemps solitaires, se sont vues confortées au cours des années 1990 et 2000, par de nombreuses données expérimentales [16] . De nouvelles techniques, et des critiques croissantes contre le « tout-génétique » comme mode d’explication des phénomènes biologiques, ont favorisé les démarches visant à observer, in vivo et une par une, des cellules de populations clonales (c’est-à-dire possédant les mêmes gènes) dans des environnements homogènes. La grande tendance qui se dégage de ces observations est l’incroyable variabilité de leur expression génétique, comme si, au niveau cellulaire, le présupposé rouxien était fondamentalement vérifié. Et les articles décrivant des processus sélectifs reposant sur cette base de variabilité se multiplient.
Toutes ces recherches vont bien sur au-delà des intuitions de Wilhelm Roux, dont elles sont loin d’être un décalque. Elles ont peut-être en commun l’idée d’une unification des lois du vivant, bien qu’avec des nuances. Roux avait introduit les dynamiques darwiniennes en chaque organisme en respectant les niveaux hiérarchiques. Kupiec, par exemple, développe le concept d’ontophylogénèse, où ontogenèse et phylogenèse ne sont que les deux facettes d’un même mécanisme : la structure de la cellule, elle-même produit de la sélection naturelle, agit sur les interactions moléculaires et notamment l’expression des gènes, de sorte que la relation entre gènes et phénotype devient bidirectionnelle et que les niveaux hiérarchiques perdent de leur pertinence [17] .
Bien qu’ils aient contribué à repenser la biologie, les avatars modernes de Roux ont pour différence majeure d’intégrer, bien que parfois de manière hétérodoxe, les acquis de la génétique. Il serait donc illusoire de vouloir prêter plus qu’il n’en pouvait dire au biologiste du XIXe siècle. Convenons cependant qu’il y a pire destin, pour un ouvrage délaissé, que d’influer sur les pensées d’un des plus grands philosophes de tous les temps et d’entrer en résonance avec un bouleversement majeur de la biologie d’aujourd’hui. Pour ces deux raisons au moins, il faut savoir savourer à son juste prix l’occasion inespérée de pouvoir, grâce à cette première édition en français, retrouver le chemin de La Lutte… [18]
Notes du chapitre
[1] ↑ Thomas Heams est maître de conférence en génomique fonctionnelle animale à AgroParisTech et chercheur à l’INRA. Il a codirigé la publication des Mondes darwiniens aux Éditions Matériologiques, http://www.materiologiques.com/Les-mondes-darwiniens-L-evolution.
[2] ↑ L’importance de cette thèse a été récemment réévaluée. Voir Haymo Kurz, Konrad Sandau & Bodo Christ, « On the bifurcation of blood vessels – Wilhelm Roux’s doctoral thesis (Jena 1878) – a seminal work for biophysical modelling in developmental biology », Ann Anat., 179, 1997, 33-36, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S094096029780132X ; Domenico Ribatti, « A milestone in the study of the vascular system : Wilhelm Roux’s doctoral thesis on the bifurcation of blood vessels », Haematol., 87, 2002, 677-678, http://www.haematologica.org/content/87/7/677.full.pdf+html.
[3] ↑ Le Plasma germinatif. Une théorie de l’hérédité. En anglais, The Germ-Plasm. A Theory of Heredity, New York, Charles Scribner’s Sons, 1893, http://www.esp.org/books/weismann/germ-plasm/facsimile/.
[4] ↑ Viktor Hamburger, « Wilhelm Roux : visionary with a blind spot », J. Hist. Biol., 30 (2), 1997, http://www.jstor.org/discover/10.2307/4331433?uid=3738016&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=55941544863.
[5] ↑ In Die Medizin der Gegenwart in Selbstdarstellungen, 1, Leipzig, Meiner, 1923, 141-206, http://jama.ama-assn.org/content/81/13/1137.3.extract.
[6] ↑ Charles Darwin, On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life, London, John Murray, 1859, http://darwin-online.org.uk/content/frameset?itemID=F373&viewtype=side&pageseq=1. En français : traduit sur la dernière édition anglaise par Edmond Barbier, Paris, Alfred Coste, 1921, http://classiques.uqac.ca/classiques/darwin_charles_robert/origine_especes/origine_especes.html.
[7] ↑ Charles Darwin, The variation of animals and plants under domestication, London, John Murray, 1868, http://darwin-online.org.uk/EditorialIntroductions/Freeman_VariationunderDomestication.html. En français, Paris, C. Reinwald, 1879, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k406270g/f3.image.
[8] ↑ Viktor Hamburger, « Wilhelm Roux : visionary with a blind spot », op. cit.
[9] ↑ Voir notamment : Gregory Moore, Nietzsche, Biology and Metaphor, Cambridge University Press, 2002, http://www.cambridge.org/fr/knowledge/isbn/item1115766/?site_locale=fr_FR ; John Richardson, Nietzsche’s New Darwinism, Oxford University Press, 2004, http://ukcatalogue.oup.com/product/9780195171037.do.
[10] ↑ Wolfgang Müller-Lauter, Physiologie de la volonté de puissance, Allia, 1998, p.116.
[11] ↑ Barbara Stiegler, Nietzsche et la biologie, PUF, 2001.
[12] ↑ Wolfgang Müller-Lauter, Physiologie de la volonté de puissance, op. cit.
[13] ↑ Sur cette histoire des théories du système immunitaire, voir Thomas Pradeu, « Darwinisme, évolution et immunologie », in Thomas Heams, Philippe Huneman, Guillaume Lecointre, Marc Silberstein (dir.), Les Mondes darwiniens. L’évolution de l’évolution [2009], Paris, Éditions Matériologiques, 2011, http://www.materiologiques.com/Les-mondes-darwiniens-L-evolution.
[14] ↑ Voir Jean-Pierre Changeux, Philippe Courrege, Antoine Danchin, « Theory of epigenesis of neuronal networks by selective stabilization of synapses », Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 70, 1973, 2974-2978, http://www.pnas.org/content/70/10/2974.full.pdf+html.
[15] ↑ Gerald Edelman, Neural Darwinism. The Theory of Neuronal Group Selection, New York, Wiley, 1987.
[16] ↑ Voir Jean-Jacques Kupiec, Olivier Gandrillon, Michel Morange, Marc Silberstein (dir.), Le Hasard au cœur de la cellule, Paris, Éditions Matériologiques, 2011, http://www.materiologiques.com/Le-hasard-au-cœur-de-la-cellule.
[17] ↑ Voir notamment L’Origine des individus, Paris, Fayard, 2008.
[18] ↑