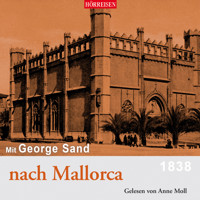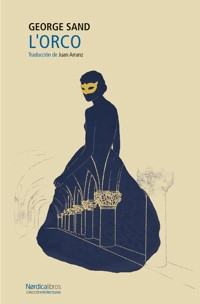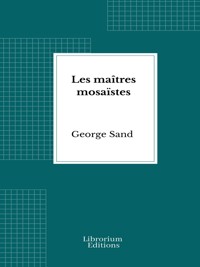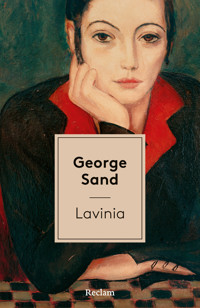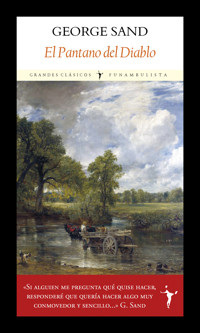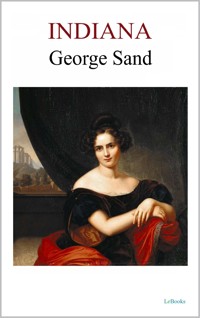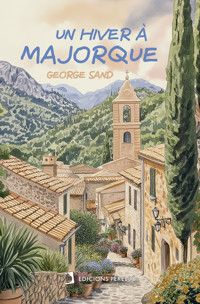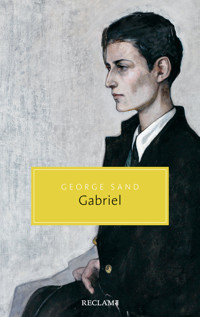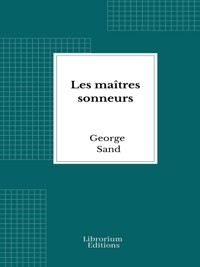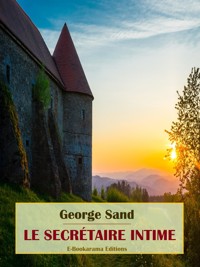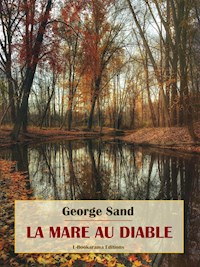
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"La Mare au Diable" est un roman écrit par George Sand qui est d’abord paru sous forme d’un feuilleton dans la revue
Le courrier français du 6 au 18 février 1846, puis en volume la même année.
Roman complexe,
"La Mare au Diable" est à la fois un roman champêtre, sentimental et romantique. Il assure à Sand la notoriété en tant que romancière : de nombreux écrivains font l’éloge de ce livre que Sainte-Beuve qualifie de « petit chef-d’œuvre».
L’action se passe dans le Berry et la romancière s’attache à louer la simplicité et la beauté de la vie paysanne à travers son héros, le laboureur Germain. Celui-ci part rencontrer sa future femme avec Marie, une jeune voisine. Leur voyage est non seulement géographique, mais également métaphorique et initiatique : les personnages ne savent plus où ils sont ni où ils en sont…
Résumé:
Germain ne peut se consoler de la mort de sa femme qui l'a laissé seul avec trois enfants. Son beau-père l'engage à ne plus pleurer et à se remarier. Germain accepte, pour le bien de ses enfants. Une veuve d'une région voisine cherche à se remarier. Germain part lui rendre visite accompagné par Marie, une jeune fille du pays dont lui a confié la garde. Elle doit se placer dans une ferme proche du lieu où vit la veuve. Un des fils de Germain est aussi du voyage, en passager clandestin. Un orage les presse de quitter leur route pour se réfugier dans une forêt. Ils campent toute la nuit près d'une mare. C'est un lieu enchanté qui les rapproche irrésistiblement les uns des autres. Marie confie qu'elle préfère les hommes plus âgés qu'elle. Au matin, on reprend la route, la magie de la nuit s'étant dissipée. Ayant atteint le but de leur voyage, Germain et Marie doivent tous les deux faire face à de cruelles déconvenues. Germain n'est pas le seul prétendant auprès de la veuve qui joue les coquettes. Il est celui qu'elle préfère, mais il ne veut pas participer à une compétition qu'il juge humiliante. Il part chercher son fils qu'il a confié à Marie. Mais la jeune fille et l'enfant ont fui la ferme où le propriétaire a tenté d'abuser de Marie. Germain les retrouve dans les bois. Chacun rentre chez soi. Il faudra bien du temps à Germain pour s'avouer qu'il est amoureux...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
table des matières
LE MARE AU DIABLE
Notice
I. L’auteur au lecteur
II. Le labour
III. Le père Maurice
IV. Germain le fin laboureur
V. La Guillette
VI. Petit-Pierre
VII. Dans la lande
VIII. Sous les grands chênes
IX. La prière du soir
X. Malgré le froid
XI. à la belle étoile
XII. La lionne du village
XIII. Le maître
XIV. La vieille
XV. Le retour à la ferme
XVI. La mère Maurice
XVII. La petite Marie
APPENDICE
I. Les noces de campagne
II. Les livrées
III. Le mariage
IV. Le chou
LE MARE AU DIABLE
George Sand
Notice
Quand j’ai commencé, par la Mare au Diable, une série de romans champêtres que je me proposais de réunir sous le titre de Veillées du Chanvreur, je n’ai eu aucun système, aucune prétention révolutionnaire en littérature. Personne ne fait une révolution à soi tout seul, et il en est, surtout dans les arts, que l’humanité accomplit sans trop savoir comment, parce que c’est tout le monde qui s’en charge. Mais ceci n’est pas applicable au roman de mœurs rustiques : il a existé de tout temps et sous toutes les formes, tantôt pompeuses, tantôt maniérées, tantôt naïves. Je l’ai dit, et dois le répéter ici, le rêve de la vie champêtre a été de tout temps l’idéal des villes et même celui des cours. Je n’ai rien fait de neuf en suivant la pente qui ramène l’homme civilisé aux charmes de la vie primitive. Je n’ai voulu ni faire une nouvelle langue, ni me chercher une nouvelle manière. On me l’a cependant affirmé dans bon nombre de feuilletons, mais je sais mieux que personne à quoi m’en tenir sur mes propres desseins, et je m’étonne toujours que la critique en cherche si long, quand l’idée la plus simple, la circonstance la plus vulgaire, sont les seules inspirations auxquelles les productions de l’art doivent l’être. Pour la Mare au Diable en particulier, le fait que j’ai rapporté dans l’avant-propos, une gravure d’Holbein, qui m’avait frappé, une scène réelle que j’eus sous les yeux dans le même moment, au temps des semailles, voilà tout ce qui m’a poussé à écrire cette histoire modeste, placée au milieu des humbles paysages que je parcourais chaque jour. Si on me demande ce que j’ai voulu faire, je répondrai que j’ai voulu faire une chose très touchante et très simple, et que je n’ai pas réussi à mon gré. J’ai bien vu, j’ai bien senti le beau dans le simple, mais voir et peindre sont deux ! Tout ce que l’artiste peut espérer de mieux, c’est d’engager ceux qui ont des yeux à regarder aussi. Voyez donc la simplicité, vous autres, voyez le ciel et les champs, et les arbres, et les paysans surtout dans ce qu’ils ont de bon et de vrai : vous les verrez un peu dans mon livre, vous les verrez beaucoup mieux dans la nature.
Nohant, 12 avril 1851. George Sand.
I. L’auteur au lecteur
À la sueur de ton visaige
Tu gagnerois ta pauvre vie,
Après long travail et usaige,
Voicy la mort qui te convie.
Ce quatrain en vieux français, placé au-dessous d’une composition d’Holbein, est d’une tristesse profonde dans sa naïveté. La gravure représente un laboureur conduisant sa charrue au milieu d’un champ. Une vaste campagne s’étend au loin, on y voit de pauvres cabanes ; le soleil se couche derrière la colline. C’est la fin d’une rude journée de travail. Le paysan est vieux, trapu, couvert de haillons. L’attelage de quatre chevaux qu’il pousse en avant est maigre, exténué ; le soc s’enfonce dans un fonds raboteux et rebelle. Un seul être est allègre et ingambe dans cette scène de sueur et usaige . C’est un personnage fantastique, un squelette armé d’un fouet, qui court dans le sillon à côté des chevaux effrayés et les frappe, servant ainsi de valet de charrue au vieux laboureur. C’est la mort, ce spectre qu’Holbein a introduit allégoriquement dans la succession de sujets philosophiques et religieux, à la fois lugubres et bouffons, intitulée les Simulacres de la mort.
Dans cette collection, ou plutôt dans cette vaste composition où la mort, jouant son rôle à toutes les pages, est le lien et la pensée dominante, Holbein a fait comparaître les souverains, les pontifes, les amants, les joueurs, les ivrognes, les nonnes, les courtisanes, les brigands, les pauvres, les guerriers, les moines, les juifs, les voyageurs, tout le monde de son temps et du nôtre, et partout le spectre de la mort raille, menace et triomphe. D’un seul tableau elle est absente. C’est celui où le pauvre Lazare, couché sur un fumier à la porte du riche, déclare qu’il ne la craint pas, sans doute parce qu’il n’a rien à perdre et que sa vie est une mort anticipée.
Cette pensée stoïcienne du christianisme demi-païen de la Renaissance est-elle bien consolante, et les âmes religieuses y trouvent-elles leur compte ? L’ambitieux, le fourbe, le tyran, le débauché, tous ces pécheurs superbes qui abusent de la vie, et que la mort tient par les cheveux, vont être punis, sans doute ; mais l’aveugle, le mendiant, le fou, le pauvre paysan, sont-ils dédommagés de leur longue misère par la seule réflexion que la mort n’est pas un mal pour eux ? Non ! Une tristesse implacable, une effroyable fatalité pèse sur l’œuvre de l’artiste. Cela ressemble à une malédiction amère lancée sur le sort de l’humanité.
C’est bien là la satire douloureuse, la peinture vraie de la société qu’Holbein avait sous les yeux. Crime et malheur, voilà ce qui le frappait ; mais nous, artistes d’un autre siècle, que peindrons-nous ? Chercherons-nous dans la pensée de la mort la rémunération de l’humanité présente ? L’invoquerons-nous comme le châtiment de l’injustice et le dédommagement de la souffrance ?
Non, nous n’avons plus affaire à la mort, mais à la vie. Nous ne croyons plus ni au néant de la tombe, ni au salut acheté par un renoncement forcé ; nous voulons que la vie soit bonne, parce que nous voulons qu’elle soit féconde . Il faut que Lazare quitte son fumier, afin que le pauvre ne se réjouisse plus de la mort du riche. Il faut que tous soient heureux, afin que le bonheur de quelques-uns ne soit pas criminel et maudit de Dieu. Il faut que le laboureur, en semant son blé, sache qu’il travaille à l’œuvre de vie, et non qu’il se réjouisse de ce que la mort marche à ses côtés. Il faut enfin que la mort ne soit plus ni le châtiment de la prospérité, ni la consolation de la détresse. Dieu ne l’a destinée ni à punir, ni à dédommager de la vie ; car il a béni la vie, et la tombe ne doit pas être un refuge où il soit permis d’envoyer ceux qu’on ne veut pas rendre heureux.
Certains artistes de notre temps, jetant un regard sérieux sur ce qui les entoure, s’attachent à peindre la douleur, l’abjection de la misère, le fumier de Lazare . Ceci peut être du domaine de l’art et de la philosophie ; mais, en peignant la misère si laide, si avilie, parfois si vicieuse et si criminelle, leur but est-il atteint, et l’effet en est-il salutaire, comme ils le voudraient ? Nous n’osons pas nous prononcer là-dessus. On peut nous dire qu’en montrant ce gouffre creusé sous le sol fragile de l’opulence, ils effraient le mauvais riche, comme, au temps de la danse macabre , on lui montrait sa fosse béante et la mort prête à l’enlacer dans ses bras immondes. Aujourd’hui on lui montre le bandit crochetant sa porte et l’assassin guettant son sommeil. Nous confessons que nous ne comprenons pas trop comment on le réconciliera avec l’humanité qu’il méprise, comment on le rendra sensible aux douleurs du pauvre qu’il redoute, en lui montrant ce pauvre sous la forme du forçat évadé et du rôdeur de nuit. L’affreuse mort, grinçant des dents et jouant du violon dans les images d’Holbein et de ses devanciers, n’a pas trouvé moyen, sous cet aspect, de convertir les pervers et de consoler les victimes. Est-ce que notre littérature ne procéderait pas un peu en ceci comme les artistes du Moyen âge et de la Renaissance ?
Les buveurs d’Holbein remplissent leurs coupes avec une sorte de fureur pour écarter l’idée de la mort qui, invisible pour eux, leur sert d’échanson. Les mauvais riches d’aujourd’hui demandent des fortifications et des canons pour écarter l’idée d’une jacquerie que l’art leur montre, travaillant dans l’ombre, en détail, en attendant le moment de fondre sur l’état social. L’ église du Moyen âge répondait aux terreurs des puissants de la terre par la vente des indulgences. Le gouvernement d’aujourd’hui calme l’inquiétude des riches en leur faisant payer beaucoup de gendarmes et de geôliers, de baïonnettes et de prisons.
Albert Dürer, Michel-Ange, Holbein, Callot, Goya, ont fait de puissantes satires des maux de leur siècle et de leur pays. Ce sont des œuvres immortelles, des pages historiques d’une valeur incontestable ; nous ne voulons pas dénier aux artistes le droit de sonder les plaies de la société et de les mettre à nu sous nos yeux ; mais n’y a-t-il pas autre chose à faire maintenant que la peinture d’épouvante et de menace ? Dans cette littérature de mystères d’iniquité, que le talent et l’imagination ont mise à la mode, nous aimons mieux les figures douces et suaves que les scélérats à effet dramatique. Celles-là peuvent entreprendre et amener des conversions, les autres font peur, et la peur ne guérit pas l’égoïsme, elle l’augmente.
Nous croyons que la mission de l’art est une mission de sentiment et d’amour, que le roman d’aujourd’hui devrait remplacer la parabole et l’apologue des temps naïfs, et que l’artiste a une tâche plus large et plus poétique que celle de proposer quelques mesures de prudence et de conciliation pour atténuer l’effroi qu’inspirent ses peintures. Son but devrait être de faire aimer les objets de sa sollicitude et, au besoin, je ne lui ferais pas un reproche de les embellir un peu. L’art n’est pas une étude de la réalité positive ; c’est une recherche de la vérité idéale, et Le Vicaire de Wakefield fut un livre plus utile et plus sain à l’âme que Le Paysan perverti et Les Liaisons dangereuses.
Lecteur, pardonnez-moi ces réflexions, et veuillez les accepter en manière de préface. Il n’y en aura point dans l’historiette que je vais vous raconter, et elle sera si courte et si simple que j’avais besoin de m’en excuser d’avance, en vous disant ce que je pense des histoires terribles.
C’est à propos d’un laboureur que je me suis laissé entraîner à cette digression. C’est l’histoire d’un laboureur précisément que j’avais l’intention de vous dire et que je vous dirai tout à l’heure.
II. Le labour
Je venais de regarder longtemps et avec une profonde mélancolie le laboureur d’Holbein, et je me promenais dans la campagne, rêvant à la vie des champs et à la destinée du cultivateur. Sans doute il est lugubre de consumer ses forces et ses jours à fendre le sein de cette terre jalouse, qui se fait arracher les trésors de sa fécondité, lorsqu’un morceau de pain le plus noir et le plus grossier est, à la fin de la journée, l’unique récompense et l’unique profit attachés à un si dur labeur . Ces richesses qui couvrent le sol, ces moissons, ces fruits, ces bestiaux orgueilleux qui s’engraissent dans les longues herbes, sont la propriété de quelques-uns et les instruments de la fatigue et de l’esclavage du plus grand nombre. L’homme de loisir n’aime en général pour eux-mêmes, ni les champs, ni les prairies, ni le spectacle de la nature, ni les animaux superbes qui doivent se convertir en pièces d’or pour son usage. L’homme de loisir vient chercher un peu d’air et de santé dans le séjour de la campagne, puis il retourne dépenser dans les grandes villes le fruit du travail de ses vassaux.
De son côté, l’homme du travail est trop accablé, trop malheureux et trop effrayé de l’avenir, pour jouir de la beauté des campagnes et des charmes de la vie rustique. Pour lui aussi les champs dorés, les belles prairies, les animaux superbes, représentent des sacs d’écus dont il n’aura qu’une faible part, insuffisante à ses besoins, et que, pourtant, il faut remplir, chaque année, ces sacs maudits, pour satisfaire le maître et payer le droit de vivre parcimonieusement et misérablement sur son domaine.
Et pourtant, la nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle verse la poésie et la beauté à tous les êtres, à toutes les plantes, qu’on laisse s’y développer à souhait. Elle possède le secret du bonheur, et nul n’a su le lui ravir. Le plus heureux des hommes serait celui qui, possédant la science de son labeur et travaillant de ses mains, puisant le bien-être et la liberté dans l’exercice de sa force intelligente, aurait le temps de vivre par le cœur et par le cerveau, de comprendre son œuvre et d’aimer celle de Dieu. L’artiste a des jouissances de ce genre, dans la contemplation et la reproduction des beautés de la nature ; mais, en voyant la douleur des hommes qui peuplent ce paradis de la terre, l’artiste au cœur droit et humain est troublé au milieu de sa jouissance. Le bonheur serait là où l’esprit, le cœur et les bras, travaillant de concert sous l’œil de la Providence, une sainte harmonie existerait entre la munificence de Dieu et les ravissements de l’âme humaine. C’est alors qu’au lieu de la piteuse et affreuse mort, marchant dans son sillon, le fouet à la main, le peintre d’allégories pourrait placer à ses côtés un ange radieux, semant à pleines mains le blé béni sur le sillon fumant.
Et le rêve d’une existence douce, libre, poétique, laborieuse et simple pour l’homme des champs, n’est pas si difficile à concevoir qu’on doive le reléguer parmi les chimères. Le mot triste et doux de Virgile : « O heureux l’homme des champs s’il connaissait son bonheur » est un regret ; mais, comme tous les regrets, c’est aussi une prédiction. Un jour viendra où le laboureur pourra être aussi un artiste, sinon pour exprimer (ce qui importera assez peu alors), du moins pour sentir le beau. Croit-on que cette mystérieuse intuition de la poésie ne soit pas en lui déjà à l’état d’instinct et de vague rêverie ? Chez ceux qu’un peu d’aisance protège dès aujourd’hui, et chez qui l’excès du malheur n’étouffe pas tout développement moral et intellectuel, le bonheur pur, senti et apprécié est à l’état élémentaire ; et, d’ailleurs, si du sein de la douleur et de la fatigue, des voix de poètes se sont déjà élevées, pourquoi dirait-on que le travail des bras est exclusif des fonctions de l’âme ? Sans doute cette exclusion est le résultat général d’un travail excessif et d’une misère profonde ; mais qu’on ne dise pas que quand l’homme travaillera modérément et utilement, il n’y aura plus que de mauvais ouvriers et de mauvais poètes. Celui qui puise de nobles jouissances dans le sentiment de la poésie est un vrai poète, n’eût-il pas fait un vers dans toute sa vie.
Mes pensées avaient pris ce cours, et je ne m’apercevais pas que cette confiance dans l’éducabilité de l’homme était fortifiée en moi par les influences extérieures. Je marchais sur la lisière d’un champ que des paysans étaient en train de préparer pour la semaille prochaine. L’arène était vaste comme celle du tableau d’Holbein. Le paysage était vaste aussi et encadrait de grandes lignes de verdure, un peu rougie aux approches de l’automne, ce large terrain d’un brun vigoureux, où des pluies récentes avaient laissé, dans quelques sillons, des lignes d’eau que le soleil faisait briller comme de minces filets d’argent. La journée était claire et tiède, et la terre, fraîchement ouverte par le tranchant des charrues, exhalait une vapeur légère. Dans le haut du champ un vieillard, dont le dos large et la figure sévère rappelaient celui d’Holbein, mais dont les vêtements n’annonçaient pas la misère, poussait gravement son areau de forme antique, traîné par deux bœufs tranquilles, à la robe d’un jaune pâle, véritables patriarches de la prairie, hauts de taille, un peu maigres, les cornes longues et rabattues, de ces vieux travailleurs qu’une longue habitude a rendus frères, comme on les appelle dans nos campagnes, et qui, privés l’un de l’autre, se refusent au travail avec un nouveau compagnon et se laissent mourir de chagrin. Les gens qui ne connaissent pas la campagne taxent de fable l’amitié du bœuf pour son camarade d’attelage. Qu’ils viennent voir au fond de l’étable un pauvre animal maigre, exténué, battant de sa queue inquiète ses flancs décharnés, soufflant avec effroi et dédain sur la nourriture qu’on lui présente, les yeux toujours tournés vers la porte en grattant du pied la place vide à ses côtés, flairant les jougs et les chaînes que son compagnon a portés, et l’appelant sans cesse avec de déplorables mugissements. Le bouvier dira : « C’est une paire de bœufs perdue ; son frère est mort et celui-là ne travaillera plus. Il faudrait pouvoir l’engraisser pour l’abattre ; mais il ne veut pas manger et bientôt il sera mort de faim. »
Le vieux laboureur travaillait lentement, en silence, sans efforts inutiles. Son docile attelage ne se pressait pas plus que lui ; mais, grâce à la continuité d’un labeur sans distraction et d’une dépense de forces éprouvées et soutenues, son sillon était aussi vite creusé que celui de son fils, qui menait, à quelque distance, quatre bœufs moins robustes, dans une veine de terres plus fortes et plus pierreuses.