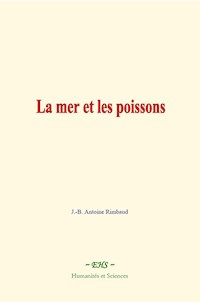
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHS
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
En considérant l’immensité de la mer et la fécondité prodigieuse, excessive, des animaux qui peuplent ce domaine, on s’imagine facilement qu’il y a là le siège d’une vie non moins étendue que le réceptacle où elle se déroule. C’est une erreur.
À l’inverse des continents, dont la flore et la faune étalent leur splendeur à peu près partout, les mers renferment leur production dans une zone relativement fort étroite. Une petite partie seulement de la surface de la terre est inculte et sans vie ; c’est le contraire qui existe sous les eaux : si le désert est là une exception, il est ici la règle ; car, autant la nature animée occupe de place sur le sol terrestre, autant elle en a peu sur le sol sous-marin. Tout ou presque tout ce que la mer contient de richesses utiles à la terre, par une admirable économie de ressorts providentiels, gît accumulé ou se meut concentriquement dans les régions riveraines ou sur les saillies du gouffre que l’on désigne sous le nom de bancs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 60
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La mer et les poissons.
La mer et les poissons
Chapitre I
Région poissonneuse de la mer et ses limites. — Le poisson de mer est-il ou n’est-il pas domesticable ?
En considérant l’immensité de la mer et la fécondité prodigieuse, excessive, des animaux qui peuplent ce domaine, on s’imagine facilement qu’il y a là le siège d’une vie non moins étendue que le réceptacle où elle se déroule. C’est une erreur.
À l’inverse des continents, dont la flore et la faune étalent leur splendeur à peu près partout, les mers renferment leur production dans une zone relativement fort étroite. Une petite partie seulement de la surface de la terre est inculte et sans vie ; c’est le contraire qui existe sous les eaux : si le désert est là une exception, il est ici la règle ; car, autant la nature animée occupe de place sur le sol terrestre, autant elle en a peu sur le sol sous-marin. Tout ou presque tout ce que la mer contient de richesses utiles à la terre, par une admirable économie de ressorts providentiels, gît accumulé ou se meut concentriquement dans les régions riveraines ou sur les saillies du gouffre que l’on désigne sous le nom de bancs.
C’est, en effet, dans cet espace très-restreint, comparativement à l’étendue et à l’épaisseur de la masse d’eau océanique, que les principes vivifiants de la faune marine se résolvent en une incommensurable magnificence de produits divers ; c’est là et non dans les profondeurs inabordables de l’abîme, que s’accomplit la révolution des lois naturelles qui assurent à la terre la jouissance des biens de la mer, en les fixant ou les faisant converger invariablement dans le périmètre des rivages.
Nous mettons nos rêves à la place de la réalité lorsque nous refusons de reconnaître les bornes auxquelles s’arrête l’élaboration des aliments que l’Océan doit à son insatiable commensale l’Humanité ; nous manquons de clairvoyance lorsque, mesurant la fertilité des eaux à leur immensité, nous prétendons qu’elle est inépuisable par cela seul qu’elle est si vaste.
Voyez jusqu’où descendent, sur le talus immergé des côtes, les dernières manifestations de la flore pierreuse de la mer. Vous trouverez là une profondeur de deux cent cinquante mètres, trois cents au plus. C’est ici que finit généralement la région poissonneuse ; c’est ici que commence le désert. De là aux grèves, la distance n’est pas très-considérable : vingt à vingt-cinq lieues pour quelques points où la déclivité du sol sous-marin est peu sensible ; quatre à cinq lieues et quelquefois bien moins, pour la plupart des autres rivages.
Telle est approximativement la largeur du champ élaborateur et récepteur des moissons marines, la zone dans laquelle la main de la Providence sème, fait croître, distribue et retient les récoltes, selon un ordre de suprême logique excluant toute combinaison auxiliaire et ne laissant à l’homme que le soin de disposer des bienfaits de l’œuvre naturelle.
Mais si la région poissonneuse est infiniment plus réduite qu’on ne le croit, si elle ne va guère au-delà des prairies qui se développent en un vert ruban sous la nappe d’eau voisine des côtes, la procréation y est cependant si vigoureusement constituée, si prodigalement généreuse, que, pour faire jaillir de cette source une abondance intarissable, il suffirait de nous astreindre à y puiser avec un peu de cette prévoyance ménagère que nous apportons à garantir l’ensemencement de nos champs ruraux et la maturité de leurs moissons.
C’est trop difficile, paraît-il. Substituer la règle au dérèglement, la prévoyance à l’insouciance, renoncer à de grossières routines, c’est en effet bien difficile, quand l’homme est ainsi fait ou qu’il préfère souffrir de ses mauvaises habitudes que de s’en séparer. Ne demandez donc point à l’industrie des pêches d’abandonner ses procédés dévastateurs, les méthodes presque sauvages dont elle use pour opérer la capture des produits de la mer. L’habitude est une puissance qui n’abdique jamais volontairement ; elle ne peut être renversée que par une révolution.
D’où viendra la révolution appelée par la nécessité de procurer la subsistance à cet accroissement de générations humaines dont le sol de la vieille Europe sera bientôt tout couvert ? Grave et anxieux problème, souvent agité, dans ces derniers temps, mais toujours laissé sans solution.
En vain la science, alerte à veiller sur les intérêts de l’Humanité, a-t-elle tenté de le résoudre en essayant de multiplier et de propager les fruits des eaux par une sorte d’imitation de l’art agricole : cette idée peu pratique, conçue dans un laboratoire imparfaitement ouvert aux notions de l’expérience, n’a abouti qu’à frapper la semence du poisson et celle des mollusques d’une nouvelle cause de destruction. Il s’agissait de trouver méthodiquement un moyen sûr d’augmenter ces ressources alimentaires, et nous ne sommes parvenus qu’à découvrir un procédé infaillible à les amoindrir. Nous poursuivions l’abondance et nous nous sommes égarés dans le chemin qui mène à la disette. Aurons-nous enfin le bon sens de sortir de cette mauvaise voie ?
Voilà bien des années déjà, que nous luttons pour le triomphe de cette vérité palpable, nous ne dirons pas au sens commun, mais au sens marin, que s’il y a fatalement une culture du sol, il n’y a pas nécessairement, ni utilement, une culture des eaux. Vainement avons-nous écrit un livre, l’Industrie des eaux salées, afin de démontrer que la pêche modérée, la pêche judicieusement réglée est la seule exploitation raisonnable des fruits du domaine aquatique : il ne cesse de survenir de nouveaux partisans de la grande, mais folle idée, qu’il est possible de gérer la production de la mer comme nous gérons celle de la terre.
Serait-ce parce que nos assertions et nos preuves manqueraient de cette autorité du savoir et de la bonne foi qui impose la confiance ? Non, puisque de l’aveu même de nos contradicteurs, notre ouvrage, « d’une grande valeur technique, écrit avec une intelligence spéciale, plein de renseignements précieux et d’indications lumineuses, révèle autant de netteté dans les vues que de conscience et de talent dans la manière de les exposer, et se résume en exprimant des convictions laborieusement acquises ». C’est donc parce que dire vrai n’est pas absolument le moyen d’être convaincant auprès des personnes trop attachées à de brillantes illusions.
Selon ces esprits doués d’une imagination ardente, aussi éclairés que généreux, mais peut-être étrangers à ces questions de la mer et des poissons, ordinairement peu familières aux hommes de science, nous nous serions trop hâté de condamner l’aquiculture en la jugeant, d’abord, par les échecs qu’elle a subis et, ensuite, par cette considération qu’il est impossible de reproduire dans des viviers, quelque spacieux qu’ils soient, les conditions nécessaires au développement de la faune marine. Afin de faire ressortir la précipitation dont on nous accuse, on rappelle qu’il n’est pas une grande entreprise, aujourd’hui en pleine réussite, dont la prospérité n’ait été mise en doute à ses débuts.





























