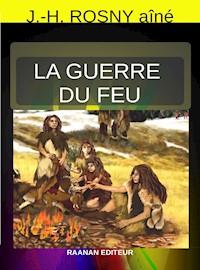1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
La Mort de la Terre est un roman de science-fiction écrit par J.-H. Rosny aîné. Il a été publié en feuilleton en 1910.
Résumé
| Dans un futur lointain, la Terre est devenue, du fait de sa surexploitation par l’espèce humaine, un immense désert desséché. Les quelques communautés restantes limitent les naissances et incitent les humains à pratiquer l’euthanasie pour obtenir une mort plus rapide. Targ, sa femme, sa sœur, et leurs enfants, les derniers vivants sur Terre encore prêts à survivre, partent à la recherche d’eau et de nouvelles terres pour reconstruire. En parallèle, une autre race d’êtres mi-vivants mi-minéraux, prospère sur les ruines de la civilisation humaine : les ferromagnétaux…|
Extrait
| I
Paroles à travers l’étendue
L’affreux vent du Nord s’était tu. Sa voix mauvaise, depuis quinze jours remplissait l’oasis de crainte et de tristesse. Il avait fallu dresser les brise-ouragan et les serres de silice élastique. Enfin, l’oasis commençait à tiédir.
Targ, le veilleur du Grand Planétaire, ressentit une de ces joies subites qui illuminèrent la vie des hommes, aux temps divins de l’Eau. Que les plantes étaient belles encore ! Elles reportaient Targ à l’amont des âges, alors que des océans couvraient les trois quarts du monde, que l’homme croissait parmi des sources, des rivières, des fleuves, des lacs des marécages. Quelle fraîcheur animait les générations innombrables des végétaux et des bêtes ! La vie pullulait jusqu’au plus profond des mers. Il y avait des prairies et des sylves d’algues comme des forêts d’arbres et des savanes d’herbes. Un avenir immense s’ouvrait devant les créatures ; l’homme pressentait à peine les lointains descendants qui trembleraient en attendant la fin du monde. Imagina-t-il jamais que l’agonie durerait plus de cent millénaires ?
Targ leva les yeux vers le ciel où plus jamais ne paraîtraient des nuages. La matinée était fraîche encore, mais, à midi, l’oasis serait torride.
— La moisson est prochaine ! murmura le veilleur..|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
SOMMMAIRE
I Paroles à travers l’étendue
II Vers les Terres-Rouges
III La planète homicide
IV Dans la terre profonde
V Au fond des abimes
VI Les ferromagnétique.
VII L’eau, mère de la vie
VIII Et seules survivent les Terres-Rouges
IX L’eau fugitive
X La secousse
XI Les fugitifs
XII Vers les oasis équatoriales
XIII La halte
XIV L’euthanasie
XV L’enclave a disparu
XVI Dans la nuit éternelle
Notes
J.-H. ROSNY AÎNÉ
LA MORT DE LA TERRE
roman
Plon, 1912 (pp. 1-111).
Raanan Éditeur
Livre 87| édition 2
IParoles à travers l’étendue
L’affreux vent du Nord s’était tu. Sa voix mauvaise, depuis quinze jours remplissait l’oasis de crainte et de tristesse. Il avait fallu dresser les brise-ouragan et les serres de silice élastique. Enfin, l’oasis commençait à tiédir.
Targ, le veilleur du Grand Planétaire, ressentit une de ces joies subites qui illuminèrent la vie des hommes, aux temps divins de l’Eau. Que les plantes étaient belles encore ! Elles reportaient Targ à l’amont des âges, alors que des océans couvraient les trois quarts du monde, que l’homme croissait parmi des sources, des rivières, des fleuves, des lacs des marécages. Quelle fraîcheur animait les générations innombrables des végétaux et des bêtes ! La vie pullulait jusqu’au plus profond des mers. Il y avait des prairies et des sylves d’algues comme des forêts d’arbres et des savanes d’herbes. Un avenir immense s’ouvrait devant les créatures ; l’homme pressentait à peine les lointains descendants qui trembleraient en attendant la fin du monde. Imagina-t-il jamais que l’agonie durerait plus de cent millénaires ?
Targ leva les yeux vers le ciel où plus jamais ne paraîtraient des nuages. La matinée était fraîche encore, mais, à midi, l’oasis serait torride.
— La moisson est prochaine ! murmura le veilleur.
Il montrait un visage bistre, des yeux et des cheveux aussi noirs que l’anthracite. Comme tous les Derniers Hommes, il avait la poitrine spacieuse, tandis que le ventre se rétrécissait. Ses mains étaient fines, ses mâchoires petites, ses membres décelaient plus d’agilité que de force. Un vêtement de fibres minérales, aussi souple et chaud que les laines antiques, s’adaptait exactement à son corps ; son être exhalait une grâce résignée, un charme craintif que soulignaient les joues étroites et le feu pensif des prunelles.
Il s’attardait à contempler un champ de hautes céréales, des rectangles d’arbres, dont chacun portait autant de fruits que de feuilles, et il dit :
— Âges sacrés, aubes prodigieuses où les plantes couvraient la jeune planète !
Comme le Grand Planétaire était aux confins de l’oasis et du désert, Targ pouvait apercevoir un sinistre paysage de granits, de silices et de métaux, une plaine de désolation étendue jusqu’aux contreforts des montagnes nues, sans glaciers, sans sources, sans un brin d’herbe ni une plaque de lichen. Dans ce désert de mort, l’oasis, avec ses plantations rectilignes et ses villages métalliques, était une tache misérable.
Targ sentit peser la vaste solitude et les monts implacables ; il leva mélancoliquement la tête vers la conque du Grand Planétaire. Cette conque étalait une corolle soufre vers l’échancrure des montagnes. Faite d’arcum et sensible comme une rétine, elle ne recevait que les rythmes du large, émanés des oasis et, selon le réglage, éteignait ceux auxquels le veilleur ne devait pas répondre.
Targ l’aimait comme un emblème des rares aventures encore possibles à la créature humaine ; dans ses tristesses, il se tournait vers elle, il en attendait du courage ou de l’espérance.
Une voix le fit tressaillir. Avec un faible sourire, il vit monter vers la plate-forme une jeune fille aux contours rythmiques. Elle portait librement ses cheveux de ténèbres ; son buste ondulait aussi flexible que la tige des longues céréales. Le veilleur la considérait avec amour. Sa Sœur Arva était la seule créature près de qui il retrouvât ces minutes subites, imprévues et charmantes, où il semblait que, au fond du mystère, quelques énergies veillaient encore pour le sauvetage des hommes.
Elle s’exclama, avec un rire contenu :
— Le temps est beau, Targ… Les plantes sont heureuses !
Elle aspira l’odeur consolante qui sourd de la chair verte des feuilles ; le feu noir de ses yeux palpitait. Trois oiseaux planèrent au-dessus des arbres et s’abattirent au bord de la plate-forme. Ils avaient la taille des anciens condors, des formes aussi pures que celles des beaux corps féminins, d’immenses ailes argentines, glacées d’améthyste, dont les pointes émettaient une lueur violette. Leurs têtes étaient grosses, leurs becs très courts, très souples, rouges comme des lèvres ; et l’expression de leurs yeux se rapprochait de l’expression humaine. L’un d’eux, levant la tête, fit entendre des sons articulés ; Targ prit la main d’Arva avec inquiétude.
— Tu as compris ? fit-il. La terre s’agite !…
Quoique, depuis très longtemps, aucune oasis n’eût péri par les secousse tellurique et que l’amplitude de celles-ci eût bien diminué depuis l’ère sinistre où elles avaient brisé la puissance humaine, Arva partagea le trouble de son frère.
Mais une idée capricieuse lui passant par l’esprit :
— Qui sait, fit-elle, si, après avoir fait tant de mal à nos frères, les tremblements de terre ne nous deviendront pas favorables ?
— Et comment ? demanda Targ avec indulgence.
— En faisant reparaître une partie des eaux !
Il y avait souvent rêvé, sans l’avoir dit à personne, car une telle pensée eût paru stupide et presque blasphématoire à une humanité déchue, dont toutes les terreurs évoquaient des soulèvements planétaires.
— Tu y penses donc aussi, s’exclama-t-il avec exaltation… Ne le dis à personne ! Tu les offenserais jusqu’au fond de l’âme !
— Je ne pouvais le dire qu’à toi.
De toutes parts surgissaient des bandes blanches d’oiseaux : ceux qui avaient rejoint Targ et Arva piétaient avec impatience. Le jeune homme leur parlait, en employant une syntaxe particulière. Car, à mesure que développait leur intelligence, les oiseaux s’étaient initiés au langage, – un langage qui n’admettait que des termes concrets et des phrases-images.
Leur notion de l’avenir demeurait obscure et courte, leur prévoyance instinctive. Depuis que l’homme ne se servait plus d’eux comme nourriture, ils vivaient heureux, incapables de concevoir leur propre mort et plus encore la fin de leur espèce.
L’oasis en élevait douze cents environ, dont la présence était d’une vive douceur et fort utile. L’homme, n’ayant pu regagner l’instinct, perdu pendant les ères de sa puissance, la condition actuelle du milieu le mettait aux prises avec des phénomènes que ne pouvaient guère signaler les appareils, si délicats pourtant, hérités des ancêtres, et que prévoyaient les oiseaux. Si ceux-ci avaient disparu, dernier vestige de la vie animale, une plus amère désolation se serait abattue sur les âmes.
Le péril n’est pas immédiat ! murmura Targ.
Une rumeur parcourait l’oasis ; des hommes jaillissaient aux abords des villages et des emblavures. Un individu trapu, dont le crâne massif semblait directement posé sur le torse, apparut au pied du Grand Planétaire. Il ouvrait des yeux dessillés et pauvres, dans un visage couleur d’iode ; ses mains, plates et rectangulaires, oscillaient au bout des bras ; courts.
— Nous verrons la fin du monde ! grogna-t-il… Nous serons la dernière génération des hommes.
Derrière lui, on entendit un rire caverneux. Dane, le centenaire, se montra avec son arrière-petit-fils et une femme aux yeux longs, aux cheveux de bronze. Elle marchait aussi légèrement que les oiseaux.
— Non, nous ne la verrons pas, affirma-t-elle. La mort des hommes sera lente… L’eau décroîtra jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que quelques familles autour d’un puits. Et ce sera plus terrible.
— Nous verrons la fin du monde ! s’obstina l’homme trapu.
— Tant mieux ! fit l’arrière-petit-fils de Dane. Que la terre boive aujourd’hui même, les dernières sources !
Sa face sinueuse, très étroite, décelait une tristesse sans bornes ; il s’étonnait lui-même de n’avoir pas supprimé son existence.
— Qui sait s’il n’y a pas un espoir ! marmonna l’ancêtre.
Le cœur de Targ battit ; il abaissa vers le centenaire des yeux où scintilla la jeunesse.
— Oh ! père !… s’écria-t-il.
Déjà la face du vieillard s’était immobilisée. Il retomba dans ce rêve taciturne, qui le faisait ressembler à un bloc de basalte ; Targ garda pour lui sa pensée.
La foule grossissait aux confins du désert et de l’oasis. Quelques planeurs s’élevèrent, qui venaient du Centre. On était à l’époque où le travail ne sollicitait guère les hommes : il n’y avait qu’à attendre le temps des récoltes. Car aucun insecte, aucun microbe, ne survivaient. Resserrés sur d’étroits domaines, hors desquels toute vie « protoplasmique » était impossible, les aïeux avaient mené une lutte efficace contre les parasites. Même les organismes microscopiques ne purent se maintenir, privés de cet imprévu qui résulte des agglomérations denses, des grands espaces, des transformations et des déplacements perpétuels.
D’ailleurs, maîtres de la distribution de l’eau, les hommes disposaient d’un pouvoir irrésistible contre les êtres qu’ils voulaient détruire. L’absence des anciens animaux domestiques et sauvages, véhicules incessants d’épidémie, avait encore avancé l’heure du triomphe. Maintenant l’homme, les oiseaux et les plantes étaient pour toujours à l’abri des maladies infectieuses.
Leur vie n’en était pas plus longue : beaucoup de microbes bienfaisants ayant disparu avec les autres, les infirmités propres à la machine humaine s’étaient développées, et des maladies nouvelles avaient surgi, maladies que l’on eût pu croire causées par des « microbes minéraux ». Par suite, l’homme retrouvait au-dedans des ennemis analogues à ceux qui le menaçaient au-dehors, et quoique le mariage fût un privilège réservé aux plus aptes, l’organisme atteignait rarement un âge avancé.
Bientôt plusieurs centaines d’hommes se trouvèrent réunis autour du Grand Planétaire. Il n’y avait qu’un faible tumulte ; la tradition du malheur se transmettait depuis trop de générations pour ne pas avoir tari ces réserves d’épouvante et de douleur qui sont la rançon des joies puissantes et des vastes espérances. Les Derniers Hommes avaient une sensibilité restreinte et guère d’imagination.
Toutefois, la foule était inquiète ; quelques visages se crispaient ; ce fut un soulagement lorsqu’un quadragénaire, sautant d’une Motrice, cria :
— Les appareils sismiques ne signalent rien encore… La secousse sera faible.
— De quoi nous inquiétons-nous ? s’écria la femme aux longs yeux. Que pouvons-nous faire et prévoir ? Toutes les mesures sont prises depuis les siècles des siècles ! Nous sommes à la merci de l’inconnu : c’est une affreuse sottise de s’enquérir d’un péril inévitable !
— Non, Hélé, répondit le quadragénaire ; ce n’est pas de la sottise, c’est de la vie. Tant que les hommes auront la force de s’inquiéter, leurs jours auront encore quelque douceur. Après, ils seront morts dès l’heure de leur naissance.
— Qu’il en soit ainsi ! ricana le petit-fils de Dane. Nos joies misérables et nos débiles tristesses valent moins que la mort.
Le quadragénaire secoua la tête. Comme Targ et sa sœur, il avait encore de l’avenir dans son âme et de la force dans sa large poitrine. Son regard clair rencontrant les yeux frais d’Arva, une fine émotion accéléra son souffle.
Cependant, d’autres groupes se rassemblaient aux divers secteurs de la périphérie. Grâce aux ondifères, disposés de mille en mille mètres, ces groupes communiquaient librement.