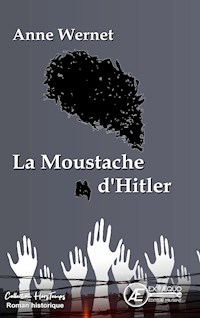
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ex Aequo
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Une histoire bouleversante décrivant un aspect méconnu de la Seconde guerre mondiale, celui de la résistance allemande.
Allemagne. Juin 1941. Alors qu'Hitler lance l'opération Barbarossa et ordonne à la Wehrmacht d'envahir l'URSS, la guerre prend un nouveau tournant. Dans le Grand Reich, l'opposition au Führer s'organise. À Hambourg, le réseau de Résistance 07 lance l'offensive et cherche à convaincre les Etats-Unis d'entrer en guerre contre Hitler. Willy, membre actif du réseau, réussit à monter une équipe dans la région de Coblence. Quatre jeunes gens, Anna, Silvie, Arnold et Josef, s'engagent à ses côtés. Entre distribution de tracts, exfiltration de témoin et amours naissants, les risques s'intensifient. Séparés durant l'été, confrontés à des choix difficiles, ils continuent malgré tout la lutte. Mais, quand Anna se retrouve mêlée à la folie mystique et ésotérique du Reichsführer Himmler, la situation leur échappe... Entre fiction et réalité historique, ce roman aborde un aspect méconnu de la Seconde guerre mondiale, celui des Allemands qui ont cherché à résister à la dictature nazie, au péril de leurs vies.
Suivez Anna, Silvie, Arnold et Josef dans leur palpitante aventure !
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anne Wernet
La Moustache d’Hitler
Roman historique
ISBN : 979-10-388-0137-0
Collection : Hors Temps
ISSN :2111-6512
Dépôt légal : mai 2021
© couverture Ex Æquo
© 2021 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de
traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays. Toute modification interdite.
Préface
Publier un premier roman est toujours une aventure ! Que ce soit pour l’auteur, pour qui tout est nouveau, que pour l’éditeur, qui fait une sorte de pari ! C’est le chemin que j’ai choisi d’emprunter en publiant ce roman d’Anne Wernet, auteure qui débute. Son texte, qui relate un aspect méconnu de l’histoire allemande et de l’Histoire en général ne pouvait pas me laisser indifférente ! Moi qui ai fait 4 ans d’études d’allemand, mêlant civilisation, histoire et langue, je dois bien avouer que je n’avais jamais entendu parler de la Résistance allemande (hormis par l’engagement de Sophie et Hans Scholl) Sujet tabou s’il en est ! Sujet digne d’intérêt donc pour ma collection Hors-Temps.
L’auteure a choisi de romancer plutôt que de vouloir à tout prix coller aux faits historiques et cette option est audacieuse. Elle permet à la fois d’être libre dans l’écriture, tout en restant fidèle au contexte, aux lieux, et aux personnages, le tout étant bien documenté !
Vous allez plonger dans la partie obscure de la Deuxième Guerre mondiale, avec son cortège d’horreurs et de drames humains ! Vous croiserez des êtres abjects et odieux, mais vous serez emportés par la lumière et l’humanité qui se dégagent des personnages créés par Anne ! Des jeunes gens héroïques à peine sortis de l’enfance, mais qui prouvent que l’engagement face à la dictature n’est pas un vain mot.
Catherine Moisand
Directrice de la Collection Hors-Temps
24 juin 1941, Rastenburg, Prusse-Orientale
Debout sur le marchepied du wagon, il avait l’air furieux. Totalement hors de lui. Les poings serrés le long du corps, le Führer était crispé de colère. Son visage était complètement déformé par la tension nerveuse. Ses sourcils surtout, sévèrement froncés, révélaient à Himmler la frustration de son supérieur. Même s’il ne s’était pas attendu à une arrivée chaleureuse, il avait fortement espéré que le bain matinal dans le luxueux Badewagen{1} aurait détendu le Führer. Incontestablement, il s’était trompé. Celui-ci le fusillait du regard, sans bouger. Au bout de quelques secondes interminables, Hitler descendit du train, s’approcha de son protégé, le salua promptement du salut nazi sans lui adresser le moindre mot. Puis, il monta à ses côtés à l’arrière d’une voiture blindée. Le chauffeur, un garde SS, démarra en trombe, suivi de près par trois autres véhicules de protection.
Hitler était arrivé par le train à huit heures précisément. Exceptionnellement, le Führer avait préféré voyager de nuit et Amerika avait englouti rapidement les quelque trois cents kilomètres qui séparaient Berlin de Rastenburg. D’habitude, les déplacements prenaient un air de fête, chaque entrée en gare rassemblait les foules agglutinées sur les quais pour venir saluer le Führer à la fenêtre de sa voiture. Hitler adorait ça. Il en avait fait un temps fort de ses campagnes de propagande. Des fanatiques ou des curieux hurlaient son nom, le saluaient d’une main levée avec fierté. D’autres étaient davantage subjugués par l’impressionnante bête d’acier dans laquelle le Führer circulait. 1 200 tonnes tirées par deux puissantes locomotives qui ne semblaient pas souffrir de ce poids, pouvant mener le convoi à plus de 120 kilomètres par heure. Le cahier des charges avait été déroutant par sa complexité, mais les industriels n’avaient pas lésiné sur les efforts. Entourés des meilleurs ingénieurs, ils avaient brillamment répondu aux attentes du Führer. Amerika était bel et bien le train le plus sécurisé du monde. Mais, depuis le début de l’opération Barbarossa, rencontrer la populace en transe sur son passage était devenu secondaire. Seule la guerre comptait.
Concentré sur la stratégie de conquête, même dans le véhicule, le Führer n’avait toujours pas décroché une parole à Himmler, qui attendait patiemment. Malgré l’habitude, cette sensation de mépris lui était insupportable. Après quelques minutes de secousses tolérables, résultats d’un chemin rocailleux volontairement négligé afin d’en dissuader son utilisation, les deux hommes arrivèrent à l’entrée de la Wolfsschanze{2}. Le nouveau QG d’Hitler était encore en chantier, mais des soldats surveillaient déjà la « Tanière du loup ». Himmler passa aisément le premier cercle de contrôle, une bande large de deux kilomètres qui entourait le QG. Des hommes de la SS étaient en train d’y installer des mines. Personne ne devait pouvoir entrer. Le Führer se félicita d’avoir à son service des hommes aussi dévoués. Goebbels en avait fait une affaire personnelle. Le ministre de la Propagande utilisait depuis 1933 tous les moyens pour valoriser le Führer. La deuxième zone de sécurité était réservée aux baraquements des soldats et on bâtissait des logements pour d’éventuelles visites officielles. Enfin, après plus d’une demi-heure, Himmler fit arrêter le véhicule au centre de la Tanière. Le bunker venait juste d’être achevé, un immense bloc de béton armé indestructible couvert de rondins de bois et de feuillages pour tromper les plus tenaces qui auraient résisté aux mines et aux futurs barbelés.
Le Reichsführer{3} sortit de la voiture, en fit le tour par l’arrière et ouvrit la portière au grand maître. Pour la première fois depuis leurs retrouvailles, celui-ci le remercia du regard, ce qui détendit Himmler. Ensemble, ils pénétrèrent dans le bunker. Malgré le début de l’été, il faisait frais et humide. Les rayons du soleil entraient à peine par de petites ouvertures. Les yeux des deux hommes mirent quelques secondes à s’adapter à cette curieuse luminosité avant de découvrir la décoration de la pièce. La commande d’Hitler avait parfaitement été respectée. L’intérieur du bunker était la copie conforme du bureau de Napoléon Ier à Fontainebleau, que la Wehrmacht{4} avait d’ailleurs spolié pour meubler la Tanière du loup. Un mince sourire de satisfaction apparut sur le visage d’Hitler. Il avait de l’admiration pour les empereurs et les empires, quels qu’ils soient. Évidemment, il avança le premier dans la pièce et se dirigea vers le fond, où un petit salon était installé. Il s’assit dans le fauteuil le plus large et invita Himmler à le rejoindre d’un geste de la main. Les deux hommes ne s’étaient échangé toujours aucune parole, signe d’une tension palpable.
Rapidement, une jeune femme blonde de taille moyenne entra dans le bunker. Les cheveux tirés en arrière et attachés en chignon lui donnaient un air austère. Sans prononcer un mot, elle déposa sur la petite table basse de quoi se désaltérer : un cognac français pour Himmler, et une bouteille de Fachingen pour le Führer. Son eau préférée. Hitler remercia la servante tandis qu’Himmler la regarda s’en aller. Un sourire pervers se dessina sur le visage rond du Reichsführer, mais il s’effaça dès qu’Hitler engagea la conversation :
— Les chiffres reçus ce jour par la Wehrmacht ne me conviennent pas du tout. L’armée ne fait pas assez de prisonniers…
Il marqua une pause, se pencha sur une assiette remplie de pâtisseries, se servit un strudel, le regarda fixement et enfin ajouta d’une voix grave et sérieuse :
— Pas assez de morts.
Puis, il croqua avec voracité dans le strudel.
Indubitablement, l’échange allait être dur. Ce que confirma l’index qu’Hitler glissa sur sa moustache en brosse à dents. Toujours de haut en bas. Petite coquetterie annonciatrice de sévérité. Depuis 1933, Himmler connaissait son Guide et ses réactions dans les moindres détails. Il avait appris à les apprivoiser. Se redressant sur le fauteuil, prêt à mener un combat argumentaire, il essaya de justifier les difficultés de son armée :
— Même si la Wehrmacht a bien préparé l’offensive, le terrain est complètement méconnu. Les troupes ne peuvent pas avancer aussi vite en Russie qu’en France ou en Belgique, où les généraux pratiquent les territoires depuis des années.
Le Führer finit d’abord d’avaler la dernière bouchée de son strudel, puis rétorqua, un peu énervé :
— Avec toutes les sommes que nous engageons, que j’engage, la Luftwaffe{5} doit être capable de faire un bon repérage aérien !
— Ce sont évidemment nos pratiques. Malgré tout, la reconnaissance aérienne prend du temps et les pilotes soviétiques sont d’excellents tireurs de ligne. Il faut avancer avec prudence. Avec tout le respect que je vous dois, mon Führer, je suis obligé d’insister : nous avançons moins rapidement que sur le front ouest, mais les troupes progressent malgré tout. C’est l’essentiel. Le Reichsführer Goering supervise les actions et il mène sa mission admirablement bien.
Hitler détestait qu’on cherche à lui tenir tête, et encore moins Himmler. Ils avaient tissé des liens d’amitié forts, mais cela complexifiait parfois le rapport hiérarchique. Et Hitler était incontestablement le chef suprême.
— Je ne pense pas qu’admirable soit un mot approprié. Il n’y a rien d’admirable à ce qu’un général de mon armée fasse avancer ses troupes. C’est juste son travail. Votre travail, mon cher Himmler ! Et j’en veux plus. L’opération Barbarossa devait être une surprise pour l’Armée rouge…
L’irritation du Führer était de plus en plus vive. Himmler s’empressa de réagir :
— Et ça a été le cas, mon Führer. Les Soviétiques ne s’attendaient pas à notre attaque.
Hitler prit une profonde inspiration afin d’essayer de canaliser sa colère. Puis il éleva la voix :
— Comment pouvez-vous affirmer cela alors que j’ai ouï dire qu’un de nos soldats, un membre de la Wehrmacht, nous a honteusement trahis ? Est-ce bien cela ? Expliquez-moi donc.
Persuadé que cette histoire n’était pas arrivée jusqu’au Führer, Himmler cacha néanmoins son étonnement afin de montrer qu’il gardait le contrôle de la situation.
— Effectivement, nous avons perdu la trace d’un de nos hommes. Mais rien ne nous dit qu’il soit passé à l’ennemi.
— Vous me confirmez donc l’existence d’un déserteur ? C’est inadmissible !
— Je suis entièrement d’accord avec vous sur ce point, mon Führer. Cependant, la rumeur d’une attaque imminente circule déjà depuis plusieurs jours dans la Stavka{6}. Et Staline n’y croyait pas. Le déserteur ne change rien à la surprise. En quarante-huit heures, la Wehrmacht a quand même déjà bien percé le front nord-ouest. La Lituanie est entièrement conquise. Nous pouvons considérer que cette opération de grande envergure est un véritable succès.
Les deux hommes se regardaient nerveusement. Aucun ne souhaitait donner raison à l’autre.
— Staline est furieux que nous n’ayons pas respecté le pacte de non-agression signé en 1939. Il se sent humilié personnellement. Il va tout faire pour se venger. Il ne faut pas croire que les Soviétiques n’ont pas la capacité de riposter.
— Il est évident, mon Führer, que Staline va engager les représailles. Peut-être qu’eux-mêmes envisageaient de nous attaquer. Ils lisent quand même la presse internationale en Russie, ils connaissent notre positionnement. En Allemagne, les communistes ont été les premiers arrêtés, avant même les Juifs. Forcément, Staline devait s’attendre, tôt ou tard, à cette invasion. Cependant, nos forces sont nettement supérieures. Trois millions de soldats allemands, et les Finnois, les Roumains et même les Hongrois qui s’associent à nous…
— Et en face, près de trois millions de rouges qui détestent notre société hiérarchisée. Pour eux, la bourgeoisie que nous représentons doit disparaître. Ne sous-estimons pas ces bolcheviks. Et surtout, n’oubliez pas, Himmler…
Le Führer marqua une pause, se pencha vers son interlocuteur et reprit d’une voix excessivement calme et saccadée :
— C’est moi qui vous ai installé là où vous êtes. J’ai confiance en vous, mais je ne supporte pas l’arrogance et le dédain. Entendez-vous ?
Hitler attendit une réponse qui prit la forme d’un simple hochement de tête, puis se redressa dans son fauteuil et continua plus posément :
— L’ennemi n’est pas si faible. Ne l’oubliez pas. C’est pour cette raison qu’il faut augmenter le nombre de prisonniers de guerre. Il faut épuiser leurs réserves avant qu’ils ne s’organisent. Après une longue marche forcée, vous leur faites construire des camps et beaucoup mourront d’épuisement. Ça fera déjà de la vermine en moins.
Ayant repris l’ascendant dans la conversation, Hitler se détendit. Le paradoxe entre la violence de ses propos et la tonalité de sa voix ne choquait pas Himmler. De la vermine, c’est ainsi qu’il considérait lui aussi les communistes. Hitler prit son verre de Fachingen de sa main droite et fit tournoyer l’eau à l’intérieur. Il resta pensif quelques secondes, en observant les mouvements de l’eau, puis le vida d’un coup sec. Puis il ajouta :
— Avec l’avancée territoriale, notre travail pour imposer la domination de la race aryenne s’intensifie donc. Qu’en est-il actuellement ?
— Pour cette mission de masse, nous avons créé quatre nouveaux bataillons de Einsatzgruppen{7}, bien différents de ceux que nous avons utilisés depuis l’Anschluss{8}. Le problème était sensiblement différent en Autriche. Il fallait surtout sécuriser les territoires occupés…
— Évidemment, ici, ça va beaucoup plus loin qu’une surveillance de territoire…
Himmler laissa à peine le Führer terminer sa phrase qu’il développa. Le sujet le passionnait :
— J’ai toujours en tête le traité que nous avons signé. Chaque bataillon est divisé en Sonderkommandos{9}, ils sont donc « autorisés, dans le cadre de leur mission et sous leur propre responsabilité, à prendre des mesures exécutives contre la population civile ». Ils achèvent leur formation spécifique, ils sont pour ainsi dire prêts à organiser les tueries en masse.
Alors qu’Himmler se mit à rire nerveusement, Hitler le fustigea du regard. Sous son apparence débonnaire, l’homme en face de lui était un véritable boucher. Ses joues rondes et sa fine moustache n’y changeaient rien. Il ne pouvait plus se permettre ce type d’erreur. Himmler sentit un frisson lui parcourir l’échine et regretta ses paroles sur-le-champ. Il n’était pas novice pourtant. Il savait que certains mots ne devaient jamais être utilisés. Il attendit une réaction plus vive qui n’arriva pas. Hitler avait encore d’autres questions et poursuivit d’un ton ferme :
— Ne me décevez pas, mon cher Heinrich. Ne me décevez pas ! Vous savez ce que vous risquez.
Oui, il le savait. À tout instant, Hitler pouvait supprimer tous les crédits que le Grand Reich réservait à l’Ahnenerbe{10}, l’institut chargé de prouver la supériorité de la race aryenne. Si les deux dirigeants étaient très attachés à ce projet, pour Himmler c’était le but de sa vie.
Juin 1941, Güls, proche banlieue de Coblence
Anna traversa la rue après avoir vérifié d’un bref coup d’œil que la chaussée était libre. Il ne lui restait qu’une petite centaine de mètres pour arriver au cimetière, mais la pente était très raide. Elle avança sans difficulté malgré la chaleur précoce de l’été. L’habitude. Cela allait faire bientôt deux mois qu’elle empruntait quotidiennement le même chemin, rituel indispensable au maintien du souvenir et à la lutte contre son chagrin. À chaque fois qu’elle approchait du lourd portail vert en fer forgé, elle était émerveillée du contraste qui s’offrait à ses yeux. Le gris des quelques tombes et la tristesse des cœurs se perdaient dans les couleurs de la végétation. Le long du mur qui permettait d’accéder au cimetière, les chagrinés étaient accueillis par des roses trémières qui semblaient leur tendre la main, avec à leurs pieds une multitude de coquelicots dans lesquels les premiers papillons venaient bourdonner. La vie. Anna poussa la grille fermement et prit soin de bien refermer derrière elle. D’abord parce qu’il le fallait. Un gros panneau avec plusieurs consignes strictes le lui rappelait. Ensuite parce qu’elle ne souhaitait pas être dérangée.
Le cimetière n’était pas très grand, miroir du village où tout le monde se connaissait et se côtoyait dans le respect. Pour cette raison, l’accident avait été un choc dans le bourg. Il était si jeune, si beau. Il avait toute la vie devant lui. Il avait commencé des études de philosophie et aimait partager ses connaissances, échanger, débattre. Parfois les discussions étaient houleuses, surtout celles du vendredi soir, au café La Liberté, quand quelques-uns avaient peut-être un peu trop bu. Mais cela finissait toujours par des accolades et des rires aux éclats. Et puis, ce fut définitivement fini. C’était un soir d’avril, il faisait encore particulièrement sombre malgré les jours qui s’allongeaient. Franz venait d’arriver de Munich par le train. Il voulait passer quelques moments chez ses parents vieillissants, pour profiter d’eux et les aider aussi dans les tâches du quotidien, pendant la période de fermeture de l’université. Il avait six kilomètres à parcourir pour rejoindre le village et était déjà bien engagé sur la route qui longeait la Moselle quand il se fit faucher violemment par une voiture de la SS. Personne n’avait rien pu faire. Il était mort sur le coup. Tout le village était venu à son enterrement, et certains même de bien plus loin si bien que l’église avait été trop petite pour la cérémonie. Bien sûr, Anna était présente. Anna et Franz étaient amis presque depuis leurs naissances et malgré l’éloignement géographique, les deux complices restaient proches. Anna ne croyait pas à l’accident.
La sépulture de Franz était au bout de la dix-huitième travée. Anna les compta consciencieusement les unes après les autres en se dirigeant vers la tombe. À la dix-huitième travée, elle tourna à gauche et longea pendant plusieurs dizaines de mètres les monuments, ramassant spontanément les pots de fleurs qui avaient pu se renverser à cause du vent. C’était surprenant et troublant de voir se révéler l’attachement des humains aux morts. Il n’y avait aucune logique. Parfois, les tombes semblaient très vétustes, les personnes décédées depuis de très longues années, et pourtant elles restaient très fleuries, comme si quelqu’un venait s’y recueillir fréquemment. Dans d’autres cas, c’était l’inverse. Un corps fraîchement refroidi et une stèle vide de décoration. Une vie qui semblait avoir moins compté. Anna était émue de ces spectacles qui s’offraient à elle. Comme si elle s’immisçait dans leur intimité, par une brèche dans la pierre pourtant si dure. Il lui arrivait même de sentir les larmes lui monter aux yeux. Dans ces cas-là, elle secouait la tête vigoureusement pour les sécher et pour essayer de mêler ses pensées mélancoliques à d’autres, plus joyeuses. Après encore quelques pas, elle arriva devant la tombe de son ami. Elle s’agenouilla. Puis, baissant la tête après avoir fait un furtif signe de croix, elle ferma les yeux quelques secondes. Elle essayait de se remémorer un souvenir différent chaque jour. Cet instant-là, elle se rappela le jour où elle s’était perdue dans les bois et commençait à avoir très peur et très froid. Elle avait à peine huit ans. Une partie de cache-cache qui aurait pu bien mal se terminer, quand elle vit arriver tout un groupe l’appelant avec l’énergie de l’espoir pour la retrouver. En tête, son papa. Et derrière lui, son ami. Elle était sauvée. Enfin, elle se releva et se frotta vigoureusement ses genoux poussiéreux que sa robe en carreaux de Vichy rouge et blanc n’avait pas recouverts. Alors, elle sortit le bouquet de son panier en osier et le déposa sur la sépulture. Puis, elle tourna les talons, prête à partir. À côté, il y avait une tombe complètement détruite par le temps, sur laquelle avait été posée une pancarte où on pouvait lire « Cette concession est échue. Veuillez vous adresser à la mairie. Service de l’état civil. » En regardant de près, on pouvait voir le cercueil en bois grignoté par les mites. Anna ne s’y était jamais risquée jusque-là. Elle ne savait pas vraiment si elle croyait en Dieu, mais dans le doute elle se disait qu’il ne fallait pas déranger les morts. Ce jour-là pourtant, elle avait eu des instructions qu’elle respecta scrupuleusement. La jeune femme s’abaissa prétextant le besoin de nouer le lacet défait de sa chaussure. Puis, elle plongea rapidement la main dans la crevasse formée par l’effondrement de deux blocs de pierre et fouilla. Elle dut lutter pour ne pas trembler de dégoût. En quelques secondes, elle sortit ce qui semblait ressembler à un papier, mais n’osa pas regarder. Après avoir jeté l’objet dans son panier, Anna se releva et chercha du regard le portail en fer forgé. Il n’y avait personne d’autre dans le cimetière. D’un calme douteux, elle se dirigea hâtivement vers la sortie.
La place était encore déserte quand Anna arriva, mais elle savait que très vite elle serait gorgée de monde. Déjà à l’accoutumée le centre-ville de Coblence était très dynamique malgré les patrouilles de la Wehrmacht de plus en plus fréquentes. Mais ce soir, l’inauguration allait attirer la foule. Elle sortit de la place par une petite ruelle et trouva facilement un endroit pour garer sa bicyclette, juste devant une petite librairie. Constatant son ouverture, elle s’étonna. Il était tard, mais surtout c’était l’une des rares boutiques de livres dans laquelle on pouvait trouver encore des auteurs contestés par le régime. Ils étaient rangés sur une étagère spéciale, bien en retrait des autres rayonnages, derrière toute une collection de bibelots en tout genre. Il fallait connaître le mot de passe pour y avoir accès. Devenus rares, ils ne passaient plus qu’entre une minorité de mains bien prudentes. C’était surprenant que le régime ne l’ait pas encore forcé à la fermeture. Grâce à cette petite librairie qui résistait, Anna avait pu lire des ouvrages d’exception. Elle avait dévoré le roman d’Erich Maria Remarque, À l’Ouest, rien de nouveau, dans lequel se révélait l’horreur de la guerre, bien différemment des idées diffusées lors des camps de jeunesses hitlériennes auxquels Anna avait dû participer. Le livre avait échappé aux autodafés de 1933. D’abord à Berlin, puis dans toutes les grandes villes universitaires d’Allemagne, des partisans du régime avaient brûlé des livres sur les places publiques. Depuis qu’Hitler était au pouvoir, on ne pouvait plus penser par soi-même. Si Goebbels avait été le commanditaire de ces autodafés, très vite, des jeunes et des moins jeunes, endoctrinés, ou illuminés par les nouvelles idées, avaient coopéré, parfois même avec fierté. Ainsi, Anna, si petite à l’époque, avait regardé par la fenêtre des gens de son village quitter avec lourdeur leur maison, un gros de tas de livres pesant sur leurs avant-bras. Elle avait vu, puis respiré la fumée montant du centre du village. Elle n’avait pas tout compris à ce moment-là, mais aujourd’hui elle se sentait entière en lisant les lignes de ces différents ouvrages. Elle n’était pas allée au bout de l’œuvre de Karl Marx, elle manquait sérieusement de culture politique pour tout comprendre. En revanche, elle avait été subjuguée par les appels à la révolution de Rosa Luxemburg, tant par ses écrits que parce que c’était une femme, éprise de liberté, prête à tout pour la défendre.
Après un bref signe amical au bouquiniste par la devanture, Anna revint sur ses pas pour rejoindre Jesuitenplatz. Le grand jour était enfin arrivé, rassemblant comme prévu, un nombre incommensurable de gens de tous âges. Beaucoup d’enfants accompagnés de leurs parents étaient impatients de voir ce qu’il se cachait sous la grande couverture rouge surveillée de près par des soldats en arme. À vingt heures précises, la cérémonie commença. Sous les grands yeux écarquillés des bambins, perchés sur les épaules de leurs solides papas, le maire dévoila le trésor. Un petit plaisantin de bronze en culotte courte, dressé sur une fontaine, regardait la foule d’un air moqueur et se mit à cracher de l’eau sur les spectateurs éberlués. Des éclats de rire se firent entendre puis des applaudissements vigoureux vinrent accueillir la nouvelle fontaine du Schängel{11}. Pendant que les soldats se chargeaient de contrôler la foule qui se précipitait pour se faire arroser, Anna avait le champ libre. Elle repéra assez aisément l’homme décrit sur le papier. De loin, il avait l’air vraiment quelconque et se fondait dans la foule. Mais les mots avaient été précis. « Sous le troisième arbre du fond de la place. Une veste brune fermée par des boutons rouges ». Elle les avait appris par cœur avant de déchirer le papier en mille morceaux, de les déposer dans un mouchoir usagé, et d’enfouir la boule au fond d’une poubelle publique. Maintenant, il fallait être prudente. Anna se faufila entre des personnes plus ou moins excitées pour rejoindre l’homme sans l’atteindre. Une fois leurs regards croisés, elle le suivit prenant grand soin de maintenir la distance conseillée. « Jamais moins de trois mètres ». Ensemble sans l’être vraiment, ils circulèrent assez librement dans des rues anormalement vides jusqu’à une petite impasse. Anna attendit. L’homme entra dans une maison au fond de la cour et ferma la porte derrière lui. Anna leva les yeux et vit les rideaux des fenêtres du premier étage se fermer. Elle sut que c’était le signal. À son tour, elle se dirigea d’un pas décidé vers la porte de l’habitation, puis l’ouvrit.
Face à elle, un groupe de personnes difficiles à distinguer l’incitait à entrer rapidement. Elle s’avança sous leurs regards circonspects. En fermant la porte, Anna se rendit compte que sa main tremblait. Jusqu’ici, elle n’avait pas eu peur. Mais cet instant était déterminant. Elle se demanda s’il n’était pas trop tard pour reculer. Elle pensa à Franz et rejoignit le petit comité. La pièce était sombre et exiguë, faisant visiblement office de cuisine et de salle à manger. Le mobilier était sommaire : une table, six chaises, une cuisinière. Sur un buffet massif, des assiettes en porcelaine étaient exposées, unique signe particulier de richesse qui apportait une touche bourgeoise dans cet intérieur rudimentaire. Les assiettes avaient dû être fabriquées dans les usines de la famille Hutschenreuther, dans le sud de la Bavière, Anna reconnaissait ce style. Sa grand-mère avait les mêmes, des fleurs bleues très travaillées et des rebords qui gondolaient sur lesquels Anna aimait passer ses petits doigts d’enfant, rêvant à des vaguelettes qui l’emportaient au bord de la mer. Elle ne savait pas vraiment chez qui elle était, mais préférait ne pas poser de questions, mettant en pratique les quelques règles évoquées par son ami avant l’accident. Un premier homme se présenta succinctement. Il s’appelait Willy Staub, c’était lui qu’elle avait suivi. Grand, mince, une allure élégante, il était le chef de cette antenne du 07. Il devait avoir la petite vingtaine même s’il ne dit rien à ce sujet. Willy fit un tour de table, présentant successivement Josef et Arnold, deux jeunes recrues de dix-huit ans, Silvie, l’autre présence féminine du groupe et enfin le père Ernst, qui servait d’intermédiaire pour les jeunes de sa paroisse soucieux de participer à la révolution balbutiante. Anna se rassura d’être avec d’autres jeunes de son âge. Dans sa dix-huitième année, elle ne connaissait rien d’autre de la résistance qui s’organisait que les arrestations et les accusations de trahisons menées par le Führer et ses acolytes. Les présentations faites, Willy entra immédiatement dans le vif du sujet :
— Bien, je vais essayer d’être clair. Vous faites maintenant partie du 07. Le 07 est une organisation de résistance qui cherche à lutter contre le régime nazi par différents moyens. Les têtes du groupe sont à Hambourg, mais tout le monde est amené à être mobile pour réduire au maximum les risques de démantèlement du réseau et pour nous protéger tous en tant qu’individu. Malgré cela, nos actions sont dangereuses et vous devez en être pleinement conscients. On est de plus en plus nombreux dans le réseau, près de 3000, répartis sur l’ensemble de l’Allemagne, plus encore avec les territoires annexés, même s’il nous est difficile d’avoir une idée précise. Ce qui est certain, c’est que plus nous nous rallions les uns aux autres, plus nous avons des chances de battre ce régime. Pour le moment, comme vous débutez, je vais vous attribuer des tâches simples qui sont malgré tout passibles de lourdes sanctions. Mais sachez qu’à l’avenir, vous pourrez être sollicités sur des actions plus violentes. Il y a des choses qui se préparent, et vos actions accomplies sont des maillons d’une chaîne qui permettra la réussite. Elles sont donc très importantes. Mais, je ne peux pas tout vous dire. Dans le 07, on se fait confiance. Est-ce que c’est clair pour vous tous ?
Anna et les autres acquiescèrent de la tête, sans piper mot, surpris par l’incroyable assurance de cet homme à peine plus âgé qu’eux. Ils étaient impatients de savoir la suite et peut-être aussi un peu paralysés par l’inquiétude.
— Silvie, tu vas commencer par taper des tracts à la machine, on les glissera dans les poches des vestes les jours de marché. Tu viendras quand tu pourras, en passant par l’arrière de la maison. Je te montrerai tout à l’heure, il y a un autre accès par une petite ruelle assez sombre et peu fréquentée. Le matériel est déjà en place, on pourrait commencer demain, d’abord ensemble, puis tu seras seule.
Silvie avait écouté consciencieusement et chercha une réponse révélant sa motivation :
— D’accord, je m’occuperai donc de la production des tracts. Est-ce que tu sais combien d’exemplaires il faudra ?
— Le plus possible. Mais tu t’organises comme tu peux, surtout sans changer tes habitudes pour ne pas éveiller des soupçons. Vous, Josef et Arnold, vous allez être chargés de la distribution. Et ce n’est pas une mince affaire. Dans un premier temps, je vous donnerai des lieux et des dates, mais très vite, vous devrez être capables de vous organiser seuls. Il faut que l’information circule rapidement : le Führer et tous ceux qui tournent autour de lui ne sont pas là pour notre liberté.
— C’est entendu ! répondirent simultanément les deux amis.
— Toutes les missions sont risquées, mais la distribution de tracts est l’une des plus périlleuses. Vous agissez dans des lieux publics où la police est présente en permanence. Je préfère que vous l’entendiez. Il est encore temps de changer d’avis…
Willy attendit un geste ou une parole de la part d’Arnold et Josef, mais ils étaient tous deux déterminés. Ils ne reculeraient pas. Le Père Ernst, silencieux, mais très attentif aux échanges, constatait avec émotion la motivation de ces nouvelles recrues.
Enfin, Willy se tourna vers Anna, intimidée. Il fronça les sourcils et quelques rides précoces apparurent autour de ses yeux.
— Toi, Anna, tu vas travailler avec moi. Pas très loin d’ici, deux personnes poursuivies par la Gestapo{12} sont cachées par le 07. Ils attendent qu’on leur fournisse des papiers et qu’on les aide à passer la frontière. C’est difficile à organiser et surtout cela prend du temps. En attendant, il faut que nous organisions leur ravitaillement. Cela peut être l’affaire de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines… Te sens-tu capable de mener à bien cette mission ?
Anna ne réfléchit pas, la réponse fut immédiate. Oui, elle s’en sentait capable. Enfin, elle se sentait assez en confiance avec ce groupe fraîchement rencontré pour en être capable.
— En attendant que je revienne vers toi, tu vaques à tes occupations habituelles. Fais comme si nous ne nous étions jamais rencontrés.
Anna acquiesça. Elle se demandait combien de temps elle allait devoir attendre, mais elle n’osa poser la question. Sur ces derniers mots, la troupe se sépara.
La nuit était maintenant tombée. La foule sur Jesuitenplatz s’était dispersée, mais le Schängel continuait d’arroser quelques personnes alcoolisées, plus âgées que celles présentes pendant l’inauguration. Anna n’eut aucun mal à récupérer sa bicyclette et rentra rapidement chez elle. Sa veilleuse accrochée sur le guidon étant un peu capricieuse, elle avait pédalé de toutes ses forces pour se sentir vite en sécurité. Elle déposa son vélo dans l’écurie et en profita pour caresser la vieille jument de son père, maréchal-ferrant. Il l’avait sauvé d’une mort certaine quand son propriétaire ne souhaitait plus s’en occuper et depuis, elle coulait des jours tranquilles. Ensuite, Anna se dirigea vers sa chambre en essayant de faire le moins de bruit possible. Son père était un homme gentil, honnête et respectueux. Il ne passait pas son temps à surveiller Anna ni à vouloir la marier rapidement pour qu’elle ne soit plus à sa charge, comme c’était le cas dans de nombreuses familles du village. Au contraire, il l’encourageait à apprendre, à être autonome et à faire ce qu’il lui plaisait. Néanmoins, depuis l’accident, il était devenu plus inquiet et avait parfois du mal à s’endormir sachant sa fille dehors. Anna ne souhaitait pas le réveiller. Elle se déshabilla, posa sa robe délicatement sur le valet et se faufila sous les draps. Elle s’endormit rapidement malgré l’excitation, bercée par le son des cloches qui sonnaient minuit. Étonnamment, ses pensées étaient davantage tournées vers ce jeune homme dynamique et déterminé que vers la future mission qu’il lui avait attribuée.
3 juillet 1941, Lioubavitchi, petit village proche de Smolensk, Russie
Katy Douchenko sortait du fenil, du foin pour les lapins à la main, quand elle entendit des cris au loin qui se rapprochaient d’elle. Katy plissa les yeux pour essayer de distinguer une silhouette. Rapidement, elle reconnut sa fille qui courait sur le chemin de terre en direction de l’isba.
« Maman, viens immédiatement à la maison ! Vite ! C’est très important ! »
La surprise lui fit lâcher toute la paille qu’elle portait, mais malgré l’insistance de sa fille, elle ne put s’empêcher de la ramasser avant de la rejoindre. Katy se redressa non sans difficulté, le poids d’une vie entière à travailler la terre pesait sur son dos. Ses jambes arquées peinaient à mouvoir son corps trapu. Elle courut lentement vers la maison de bois.
Quand Katy Douchenko entra, le parquet grinça. Si toutes les isbas se ressemblaient dans le village, faites de rondins de pin empilés les uns sur les autres, soutenus par quelques piquets, de la corde et comblés par de l’argile, celle de Katy et de sa fille était une des seules à bénéficier d’un aménagement au sol. Son mari qui travaillait dans une scierie non loin de là avait réussi à récupérer assez de planches pour en fabriquer un. Cela évitait la poussière et l’humidité de la terre battue et les préservait de quelques maladies. En revanche, impossible de traverser la pièce en toute discrétion, et cela valait même pour les rongeurs de toutes tailles qui parfois venaient profiter du frais de l’isba. Après les premières frayeurs, Katy et sa fille s’étaient habituées.
Katy, épuisée par sa petite course, s’affala dans un vieux fauteuil poussiéreux pour écouter. Sa fille restait debout, la main posée fermement sur la table. Son regard révélait le sérieux des annonces qu’elle s’apprêtait à faire. Elle prit sa respiration et enchaîna un flot de paroles continues que Katy eut du mal à suivre.
C’était la première fois depuis le début de l’invasion que Staline s’était adressé à son peuple. La fille de Katy avait pu écouter tout le discours dans l’usine à Smolensk. Toutes les ouvrières avaient d’ailleurs dû cesser le travail afin de pouvoir l’écouter. La situation était vraiment inquiétante.
« Un grave danger pèse sur notre Patrie »{13}. Lioubavitchi était un petit village collé à la Biélorussie fraîchement envahie. Ils étaient donc les prochaines cibles de la Wehrmacht.
« L’ennemi est cruel, inexorable. Il s’assigne pour but de s’emparer de nos terres arrosées de notre sueur, de s’emparer de notre blé et de notre pétrole, fruits de notre labeur. »
La fille de Katy avait toujours eu des facilités pour mémoriser, des comptines d’abord, puis des poésies, et aujourd’hui, elle avait retenu quasiment tous les mots de Staline, qu’elle répétait à sa mère. Le discours était long et celle-ci, tendue entre angoisse et colère, n’en retenait que quelques bribes.
« Il faut aussi qu’il n’y ait point de place dans nos rangs pour les pleurnicheurs et les poltrons, les semeurs de panique et les déserteurs ; que nos hommes soient exempts de peur dans la lutte et marchent avec abnégation dans notre guerre libératrice pour le salut de la Patrie, contre les asservisseurs fascistes.
Il faut immédiatement réorganiser tout notre travail sur le pied de guerre, en subordonnant toutes choses aux intérêts du front et à l’organisation de l’écrasement de l’ennemi.
Les kolkhoziens doivent emmener tout leur bétail, verser leur blé en dépôt aux organismes d’État qui l’achemineront vers les régions de l’arrière.
Dans les régions occupées par l’ennemi, il faut former des détachements de partisans à cheval et à pied, des groupes de destruction pour lutter contre les unités de l’armée ennemie, pour attiser la guérilla en tous lieux, pour faire sauter les ponts et les routes, détériorer les communications téléphoniques et télégraphiques, incendier les forêts, les dépôts, les convois.
Dans les régions envahies, il faut créer des conditions insupportables pour l’ennemi et tous ses auxiliaires, les poursuivre et les détruire à chaque pas, faire échouer toutes les mesures prises par l’ennemi.
Toutes les forces du peuple pour écraser l’ennemi !
En avant vers notre victoire ! »
Au fur et à mesure qu’elle écoutait sa fille, Katy Douchenko bouillonnait intérieurement. Sa récolte ? Elle la donnait déjà depuis bien longtemps à l’État, s’organisant pour survivre en évitant la famine. Du bétail ? Plus rien. Le régime était venu un matin pour récupérer toutes les bêtes du village et les parquer dans les fermes collectives. Elle avait réussi difficilement à dissimuler quelques lapins qu’elle élevait en toute discrétion.
Katy n’aimait pas le communisme. Katy détestait Staline au moins autant qu’Hitler. De son point de vue, ils n’étaient pas tellement différents. Mais cela, elle ne le disait à personne. Elle gardait tout au plus profond d’elle-même. Elle avait perdu toute confianceen l’être humain depuis la mort de son mari, trente ans auparavant, dénoncé injustement comme tsariste par un voisin communiste un peu envieux. Elle s’était retrouvée seule, enceinte de quelques semaines. Mais elle gardait un goût prononcé pour les questions politiques qu’elle suivait du mieux qu’elle pouvait, avec les maigres informations soutirées çà et là. Alors là, vraiment, les mots de Staline dans la bouche de sa fille l’agaçaient. Devoir donner ses récoltes à l’un ou à l’autre de ces monstres lui était complètement indifférent. Et quel retournement de veste ? Staline qui jusqu’ici respectait scrupuleusement le pacte de non-agression germano-soviétique et qui allait jusqu’à fournir des matières premières à la Wehrmacht ! Katy Douchenko se leva pour se servir un grand verre d’eau qu’elle but d’une traite. Il fallait faire passer l’ironie de la situation qui était bloquée dans sa gorge. Elle ne savait pas comment enfouir son rire nerveux naissant autrement. Aucun soupçon ne devait peser sur elle, pour le bien de sa fille. Le verre vide, elle réussit à reprendre un air triste et angoissé.
Finalement, de ce long discours propagandiste, elle avait retenu l’essentiel : les hommes de 16 à 60 ans, les femmes de 18 à 50 ans devaient s’inscrire dans des groupes de défense civile. Katy allait à nouveau être seule.
Sa fille partie diffuser les nouvelles aux autres habitants, dans la petite isba, le silence régna subitement. Katy Douchenko pouvait supporter beaucoup, mais la solitude, elle n’en était plus sûre.
4 juillet 1941, Coblence, Allemagne
Quand Silvie ouvrit la première fois les yeux, elle se sentit incapable de bouger. Le sommeil s’était fait attendre, et elle avait passé la nuit à réfléchir à la mission qu’elle exécutait depuis quelque temps. Et le jour ne s’était pas encore levé.
Sa vie avait basculé depuis son entrée dans le 07. Des tracts, encore des tracts, toujours des tracts. Elle ne pensait plus qu’à cela. Tous les jours, sauf le dimanche, elle quittait la boulangerie de Madame Schmitz à midi pile. Employée en tant que vendeuse depuis quelques mois, ce travail était essentiel pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Puis, elle enfourchait sa bicyclette et pédalait jusqu’au repère du 07. Dans la petite maison, elle avait vraiment pris ses marques. Dès qu’elle y entrait, elle accrochait sa besace au petit portemanteau juste derrière la porte. Puis elle se dirigeait vers la commode, ouvrait le premier tiroir et prenait une feuille sur chacun des deux tas bien séparés. Les superposant, elle se concentrait pour rédiger de sa plus belle écriture les textes qui lui parvenaient par Willy. Il fallait appuyer fort sur la pointe du stylo noir, afin que le papier carbone dépose une couche d’encre sur la face lisse de la deuxième feuille. La feuille de papier couchée devenait alors le miroir de l’autre morceau de papier. À ce moment précis, elle devait être rapide. Il ne lui restait plus beaucoup de temps avant de retourner à la boulangerie. Son travail lui permettait de ne lever aucun soupçon sur son activité clandestine. Elle plaçait alors la feuille de papier fort sur le tambour du duplicateur et ouvrait le second tiroir de la commode. Elle en sortait une liasse de papier tirage qu’elle déposait sur le plateau de la machine. Dans le dernier tiroir de la commode, plus profond, plusieurs bouteilles d’alcool à brûler lui permettaient d’achever le travail. Elle en utilisait une par jour, pour remplir le réservoir de la machine. Enfin, il n’y avait plus qu’à tourner la manivelle. La rotation du tambour pressait la feuille de papier fort avec les feuilles de tirage qui, imbibées d’alcool, s’imprégnaient des mots déposés sur la matrice.
« Où que vous soyez, empêchez que ne se développe cette machine qui divise les Allemands et anéantit les peuples. Résistez. Rejoignez-nous. »
Avec ce procédé, Silvie pouvait dupliquer près de 200 tracts par jour. Ce qui était très loin d’être négligeable. En revanche, quand elle quittait la maison, l’odeur nauséabonde du vieil alcool bon marché lui restait dans les narines tout l’après-midi, rendant son service à la boulangerie bien moins évident que le matin. À plusieurs reprises, sa patronne l’avait houspillée. Mais Silvie tenait bon. Pour les Juifs, pour les résistants morts, pour l’égalité et la liberté. Et surtout pour donner un sens à sa vie. C’était sa révolte.
Cette nuit, la colère l’avait envahie. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait participer à la distribution de ses tracts. Enfin, raisonnablement, elle le comprenait. Tout lui avait été soigneusement expliqué. Les paroles de Willy tournaient en boucle dans sa tête. Les tâches et les personnes doivent le moins possible se mélanger. C’est plus complexe pour les recherches de la Gestapo. Le moindre soupçon est un aller simple pour Dachau. Quasiment impossible d’en sortir vivant. Le père Ernst y a vécu l’enfer pendant de longs mois. Il a miraculeusement été libéré. Conforté dans sa foi, il s’est engagé dans la Résistance, encourageant ses paroissiens à faire pareil. Nous sommes la Résistance, et notre premier devoir est de ne pas se faire prendre. Willy avait été clair et Josef et Arnold désignés pour cette action. Malgré tout, elle trouvait cela injuste.





























