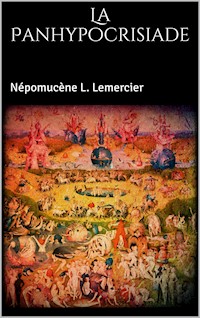ÉPITREA DANTE ALIGHIERI.
CHANT PREMIER.
CHANT DEUXIEME.
CHANT TROISIÈME.
CHANT QUATRIEME.
CHANT CINQUIÈME.
CHANT SIXIÈME.
CHANT SEPTIÈME.
CHANT HUITIÈME.
CHANT NEUVIÈME.
CHANT DIXIÈME.
CHANT ONZIEME.
CHANT DOUZIÈME.
CHANT TREIZIÈME.
CHANT QUATORZIÈME.
CHANT QUINZIÈME.
CHANT SEIZIÈME.
ÉPITREA DANTE ALIGHIERI.
Impérissable
Dante,Ou
recevras-tu ma lettre? Quels lieux habites-tu, depuis que tu n'es
plus dans ce monde vicieux où, de jour en jour, nous sentons que ton
génie vengeur nous manque? Mon envoi ne te parviendra dans aucun des
cercles qui forment l'immense spirale de ton enfer; ils ne sont que
l'allégorie des horribles réalités de la vie humaine: ni dans les
circuits de ton purgatoire; ils ne figurent que le labyrinthe où
nous égarent nos erreurs passionnées, avant que nous arrivions au
repos: ni dans les limbes de ton paradis; tableau poétique d'une
béatitude et d'une gloire que tes rêves nous ont tracées. Je
t'adresse donc cet écrit dans les régions inconnues, séjour ouvert
par l'immortalité aux ames sublimes d'Homère, de Lucrèce, de
Virgile, d'Arioste, de Camoëns, de Tasse, de Milton, de Klopstock,
et de Voltaire. Une messagère ailée, l'Imagination, te le portera
dans l'espace où tu planes avec eux.Il
faut que je me confesse à toi, profond scrutateur des consciences:
car je rougirais du moindre scrupule, devant ta redoutable ironie.J'ai
découvert, sous les décombres d'un vieux sanctuaire de la Vérité,
le manuscrit d'un poëte nommé
Mimopeste,
c'est-à-dire, fatal aux mimes. Je publie son travail comme étant le
mien. Son poëme, dont je m'attribue l'honneur, est intitulé
Panhypocrisiade; ce
qui, conformément au caractère satirique de son auteur, et à
l'étymologie grecque, signifie
POEME SUR TOUTE HYPOCRISIE.Il
paraît que l'auteur avait ajouté dans son esprit à cette ancienne
maxime de l'ecclésiaste,
vanité des vanités! tout est vanité!
un axiôme non moins général sur notre pauvre terre;
hypocrisie des hypocrisies, tout est hypocrisie.Il
a vu les humains tels qu'ils sont: il les a peints tels qu'il les a
vus. S'en fâcheront-ils? non: parce qu'il n'a pas, comme tu l'as
fait si courageusement, marqué d'un sceau réprobateur le front de
ses ennemis personnels; parce qu'il n'a pas, en égalant ton audace,
pris la liberté de mettre dans son enfer des princes, des cardinaux
et des papes vivants; mais qu'au lieu d'y jeter ses contemporains, il
n'y a placé que les morts du seizième âge; et qu'il n'y a point
représenté les hommes qui existent encore. Ceux-ci respirent la
franchise; ils sont la sincérité même, grâce à notre
perfectibilité prouvée, et à nos lumières progressives qui leur
ont démontré combien il est superflu de mentir et de porter des
masques!J'avais
dérobé avec tant de plaisir, au poëte que je vole encore, l'idée
d'une théogonie nouvelle, dont je fis agir les divinités qui
figurèrent les phénomènes de la nature dévoilée par nos sciences
dans mon Atlantiade,
que je n'ai pu résister à l'envie de commettre ce nouveau larcin.
Tu trouveras ici quelques-uns des mêmes dieux qu'il a créés,
d'après son systême newtonien. Il les introduit dans cet autre
ouvrage hardi qu'il a qualifié du titre de
comédie épique.Si
j'eusse voulu l'accompagner de commentaires et de scholies, il m'eût
fallu composer un gros in-folio de bénédictin, sur tout ce qu'il
renferme de relatif à la fable et à l'histoire politique,
ecclésiastique et militaire, sur toutes les curiosités qu'il a
extraites des mémoires. Mais il vaut mieux que j'imite adroitement
certain auteur d'une défense des Jésuites, qui en publia la
première édition sans notes, afin, dit-il plaisamment, que les rats
de la critique qui le voudront éplucher et ronger, viennent se
prendre dans la souricière de leur ignorance.Ta
mâle philosophie saura saisir le plan moral qu'a suivi le poëte.
Ton siècle t'inspira l'image des tourments de l'Enfer: le sien lui a
inspiré la peinture de ses joyeux divertissements.Il
aurait eu matière à peindre aussi largement le nôtre, qui lui eût
fourni des scènes non moins terribles que ridicules, et dont voici
le principal sujet, résumé dans quelques vers épigrammatiques.Notre
beau siècle, en France, ayant plantéChêne
civique, arbre de liberté,Prophétisa
que son ombre immortelleÉtoufferait
tiges de royauté:Puis,
en védette, il y mit sentinelle.Mais
vint au poste un rusé bûcheron,Tourneur
expert; or, trompant l'horoscope.Sa
main coupa les branches et le tronc,Sceptres
en fit, à revendre en Europe;Et
le beau siècle enrichit le larron:Mais
la racine est restée, et tient bon.Tu
me demanderas comment on a souffert qu'on y portât sitôt la
coignée; le dixain suivant va te répondre.Nos
fiers tribuns, déclamant pour leurs droits,Foulaient
aux pieds couronnes, armoiries;Nos
fiers seigneurs, vantant leurs rêveries,Juraient
amour au pur sang de leurs rois:Que
firent donc tant de grands fanatiques,Dès
qu'un enfant des troubles politiquesS'érigea
maître?... Ah! saluant son char,De
royauté les serviteurs antiquesSe
sont unis, en lestes domestiques,A
nos Brutus, bons valets de César.Un
Aristophane n'eût-il pas vu là tout le fonds d'une ample et forte
comédie? mais était-il possible qu'on la jouât sous la censure
oppressive que maintenait à cette époque la tyrannie dont le ciel
nous a délivrés?Un
pâle trio d'Aristarques,De
ses froids ciseaux coupant tout,Eut
sur le génie et le goûtLe
ministère des trois Parques.Ces
temps ont déja fui: la noble liberté des lettres et de la pensée
revivra sous le règne des lois.Montre
ce nouveau poëme, quand tu l'auras lu tout entier, à
Michel-Ange, à
Shakespeare, et
même au bon
Rabelais; et, si
l'originalité de cette sorte d'épopée théâtrale leur paraît en
accord avec vos inventions gigantesques, et avec l'indépendance de
vos génies, consulte-les sur sa durée. Peut-être, se riant dans
leur barbe des jugements de nos modernes docteurs, augureront-ils
qu'avant un siècle encore, c'est-à-dire un de vos jours, en style
d'immortels, on l'imprimera plus de vingt fois, quoique étant hors
du code des classiques.La
haute et mordante raillerie qui l'anime n'est point celle de la
méchanceté, mais d'une vive indignation de la vertu contre le vice.Adieu,
Dante! je me distrais avec les Muses du spectacle des tristes
discordes. Ainsi que toi, je soupire après les lois stables,
fondamentalement constitutionnelles, qui seules assureraient le
bonheur et l'illustration de ma patrie. Tu fus tour-à-tour poursuivi
des Guelfes et des Gibelins pour t'être précipité trop aveuglément
dans leurs factions: ils proscrivirent ta tête, rasèrent ta maison,
t'accablèrent de calomnies, et tâchèrent d'ensevelir ton nom en
décriant tes poésies, en te réduisant à défendre seul la gloire
de tes propres œuvres; et moi, qu'instruisit ton exemple à
m'écarter des partis pour ne soutenir qu'une juste cause, comment
n'ai-je pu me préserver des attaques perfides, et d'une part des
mêmes misères que tu as endurées? Les hommes punissent donc le
refus constant de servir leurs fureurs, comme l'ardente énergie qui
s'efforce à les dompter, le fer à la main! Ah! la perspective de
toute paix est détruite pour les citoyens, lorsque s'ouvrent une
fois les gouffres des révolutions; et c'est sur-tout à leur entrée
que me semblent applicables ces menaces de tes portes infernales:Per
me si va nella città dolente,Per
me si va nell' eterno dolore,Per
me si va tra la perduta gente.Lasciate
ogni speranza, voi che'ntrate!Adieu
donc! puisse ma mémoire être protégée de la tienne, et ne pas
périr! La vie de l'esprit est ici-bas aussi incertaine que la vie du
corps. Toi, qui nous quittas au quatorzième siècle, tu es plus sûr
de durer que moi qui transcrivais ceci, pour l'avenir, pendant les
premières années du dix-neuvième.
CHANT PREMIER.
Exposition
du sujet. Le Poëte veut chanter une fête que se donnent les démons
au moment où leurs supplices sont suspendus. Lieu de l'enfer dans
une comète lancée au travers de l'étendue et de l'obscurité.
Description des plaisirs que goûtent les démons, de leur théâtre,
et de la foule qui vient assister au drame tragi-comique de la vie de
Charles-Quint, et
des révolutions de son siècle. Peintures de la toile qui couvre
l'avant-scène. Là sont représentées toutes les superstitions du
monde terrestre. La toile se lève,
la Terre et
Copernic
apparaissent.
Copernic instruit
celle-ci sur son propre mouvement autour du soleil. Dialogue
du Temps,
de l'Espace, et
de la Terre, dont
les entretiens terminent le prologue qui prépare le sujet du drame
infernal. Une seconde toile s'abaisse sur le théâtre, et présente
aux spectateurs le tableau de la fausse renommée des héros
sanguinaires. Le drame est prêt à commencer.CHANT
PREMIER.Ma
muse, qui du monde a vu les tragédiesAux
esprits immortels servir de comédies,Du
ciel et de l'enfer va chanter les acteurs,Les
drames, le théâtre, et tous les spectateurs.Dieu
permit qu'une fois, dans l'empire des diables,Succédassent
les jeux à leurs maux effroyables;Les
carreaux et les fouets restèrent suspendus,Et
de longs cris joyeux y furent entendus.Je
veux, d'un pinceau neuf, essayer les peinturesDes
plaisirs de l'enfer, et non de ses tortures.Dans
l'Ether sans limite, il est des profondeursOù
des traits du soleil se bornent les splendeurs:L'espace
est traversé par des sphères sans nombre,Et
la lumière au loin le partage avec l'ombre.D'un
côté, sous le deuil, et de l'autre, sous l'or,Là,
règne Lampélie, et là, règne Ennuctor.De
l'astre pur des jours Lampélie est la fille;Et
loin de la carrière où sa présence brille,Le
sceptre d'Ennuctor, dieu de l'obscurité,Des
ténèbres régit l'abyme redouté.Dans
son empire affreux, par-delà notre monde,Une
ardente comète, à jamais vagabonde,Roule
au milieu des nuits, et de son épaisseurLe
seul feu des volcans éclaire la noirceur.C'est
là que sont déchus ces démons si terribles,Ces
hauts titans, l'horreur des fables et des bibles:Leurs
tourments trop chantés ne sont plus inouis;O
muse! chante donc les diables réjouis;Dis
les feux de l'abyme illuminant ses routes,Les
torches en festons pendantes à ses voûtes,Les
phosphores roulant en soleils colorés,Et
les métaux fondus en miroirs épurés:Dis
l'éclat des banquets, et les pompes qu'étaleDans
un gouffre enflammé la cohue infernale.Spectacle
comparable au fol aspect des cours,Où
des fêtes sans joie assemblent un concoursD'hommes
blêmes d'ennuis, et de femmes flétries,Qui
rampent, enchaînés d'or et de pierreries;S'efforçant,
à l'envi, de dérider leur front,Qu'attriste
la mémoire ou la peur d'un affront.Tels
sont les noirs esprits, en leur palais funeste:Ils
ne jouissent plus de la clarté céleste;Des
lampions fumants sont leurs astres menteurs;Leurs
faux jardins sont pleins de bouquets imposteurs:Les
lambris lumineux de leurs grands édifices,Brûlent
leurs yeux lassés de brillants artifices;Et
tout ce riche éclat, fatigant appareil,Les
jaunit, les rougit, comme un ardent soleil.Leurs
plaisirs les plus vifs sont les jeux du théâtre.Sous
d'énormes piliers est un amphithéâtre,Qu'inondent
les démons à flots tumultueux,Accourant
applaudir des drames monstrueux.Leur
art, qui de la scène élargit la carrière,Y
fait d'un personnage entrer la vie entière;Peu
jaloux qu'un seul lieu, dans son étroit contour,Resserre
une action terminée en un jour.De
leurs yeux immortels la vue est peu bornée:Devant
eux, comme un point passe une destinée;Et
leur regard saisit avec rapidité,L'enfance
d'un héros, et sa caducité.Pour
nous mieux figurer, tout grossiers que nous sommes,Ils
rapprochent d'instincts les bêtes et les hommes;De
l'œuvre du grand-tout curieux amateurs,La
nature animée a pour eux mille acteurs;Et
parmi les bergers, les rois, les chefs suprêmes,Ils
font intervenir les divinités mêmes.Ce
qui ravit sur-tout leur cœur enclin au mal,Ce
sont les vils tyrans, nés d'un germe infernal,Dont
la noirceur, charmant leur goût diabolique,Leur
semble un rare effet de haute politique;Bien
que des assassins les caractères basMontrent
les mêmes traits que ces grands scélérats.Leur
dialogue en vers est plaisant et tragique,Descend
à la satire, et s'élève à l'épique;Et
chacun des acteurs, en leurs mœurs ou leurs rangs,A
son propre langage et ses tons différents.Les
démons, au-dessus des plus savants artistes,Dédaignent
les ressorts de nos vains machinistes;Leurs
décorations, en tous leurs changements,Sont
un effet divin de prompts enchantements.On
y voit des hameaux, illusions vivantes,Des
bois, des eaux, des cieux, les images mouvantes,De
magiques châteaux, et de trompeuses fleurs,Et
des feux qui de l'aube imitent les pâleurs.Faut-il
offrir l'aspect du châtiment des crimes,Ils
lèvent le rideau qui cache leurs abymes;Et
leur regard encor s'effraie à pénétrerDes
gouffres, des volcans qu'il ne peut mesurer.Déja
s'ouvre le cirque à l'innombrable foule:Tous
fondent sur les bancs comme un torrent qui roule,Et
leur plaisir rugit non moins que la douleur.Sur
un mince clinquant de sanglante couleur,L'œil,
en lettres de feu, lit: «la
Charlequinade,«Ou
l'orgueil couronné par un siècle malade;«Pièce
comi-tragique, à divertissements,«Et
tournois, et combats, et grands embrasements.»Un
nébuleux rideau couvrant d'abord la scène,Offre,
en mille portraits, à l'œil qui s'y promène,Les
masques différents dont l'Erreur en tout lieuDéguisa
de tout temps la face du vrai dieu;Tableau
dont les couleurs charment l'Hypocrisie,Qui
de tant de faux dieux bénit la fantaisie.Là,
sont tous les chaos d'où les religionsTirèrent
de la nuit leurs superstitions.Comme
autant de soleils, au centre de leurs mondes,En
ce rideau, sortant des ténèbres profondes,Mille
divinités, partageant l'univers,Ont
leurs trônes, leurs cieux, leurs olympes divers.Un
monstre gigantesque, à cinq têtes énormes,D'un
ventre sans mesure étale ici les formes;C'est
le puissant Brama, que la crédulitéFait
passer dans un fleuve à l'immortalité:De
son sein, de ses flancs, et de ses pieds fertiles,S'écoulent
les tribus des hameaux et des villes.Là,
ce divin monarque, honoré dans Babel,Nourrit
le feu, du monde élément éternel:La
flamme, sur son front, rayonne en diadêmeEt
l'astre pur des jours, son lumineux emblême,Aux
hommes éblouis cachant leur créateur,Sous
l'éclat de l'ouvrage en éclipse l'auteur.Plus
loin, brille Mithra dans l'azur diaphane,Près
du doux Oromase et du triste Arimane;Triple
divinité, dont le pouvoir égalBalance
dans le monde et le bien et le mal:D'un
côté sont les cieux, le jour et la science;De
l'autre les enfers, la nuit et l'ignorance.La
grande Isis est là, cherchant son Osiris,Dont
Typhon dispersait les membres en débris:On
lui voit retirer de l'ombre sépulcraleSes
restes qu'elle assemble, et dresser un haut phalle,Simulacre
fécond, qu'elle veut conserverDe
ce que son amour n'en a pu retrouver.La
lune la revêt de parures nouvelles,Et
vers son fils Horus pendent ses huit mamelles.Le
bœuf, le crocodile, et le sphinx, et l'Ibis,Et
le bouc de Mendès, et le chien Anubis,Sont
peints dans le troupeau des bêtes consacréesPar
un peuple brutal à sa suite adorées.Son
époux, nouveau dieu de cent peuples vaincus,Semble
ressuscité sous les traits de Bacchus:Le
lotus sur sa tête en un lierre se change;Il
ne sort plus du Nil, il redescend du Gange,Tenant
pour sceptre un thyrse, et jaloux d'assisterAux
banquets de l'Ida, séjour de Jupiter.Du
trône olympien, le grand fils de Saturne,Versant
les biens, les maux, qu'il puisait dans son urne,Tonnait,
se transformait en aigle impérieux,En
taureau mugissant, en cygne gracieux:Ses
frères, son épouse, et ses fils et ses filles,Peuplaient
tout l'univers de divines familles.Mais
en un plus haut ciel Jéhova s'aperçoit,Disant
au premier jour: «Que la lumière soit.»Il
n'était que splendeur, que gloire, et la lumièreSous
un brûlant éclat voilait sa face entière.Enfin
sur un berceau, mystérieux trésor,Un
pigeon enflammé suspendait son essor,Tandis
que dans les bras d'une mère indigente,Mère
qui paraît vierge à sa grâce innocente,Dormait
l'enfant sauveur, né d'un dieu paternel:Triple
unité, que peint un triangle éternel.Retracerai-je
aux yeux ces légions d'idoles,Ces
pagodes au loin présentant leurs symboles;Depuis
le vieux Lama, l'objet d'honneurs si vains,Payant
l'encens des rois en excréments divins,Jusqu'au
dur Theutatès, si fier de sa massue,Et
de la chaîne d'or à ses lèvres pendue?Chimères,
qui cédaient à celles de la croix,Pour
qui, le fer en main, on criait: «Meurs, ou crois!»Ces
peintures montraient notre sphère embraséeSous
un glaive sanglant en deux parts divisée.Des
califes géants ouvraient leur paradisAux
élus forcenés combattant les maudits;Et
les temps, la nature, en traits allégoriques,Aux
peuples éblouis offraient cent dieux antiques.Les
pals et les bûchers qui bordaient ce tableau,Surchargeaient
d'ornements ce mystique rideau.Debout,
sur ses ergots, le peuple du parterreGronde
et siffle à l'égal des vents et du tonnerre.Les
princes de l'abyme, empire d'Ennuctor,Sont
dans leur loge assis, derrière un balcon d'or.Les
plus grands, qu'un vain sceptre et que la pourpre accable,Roidissant
par orgueil leur maintien misérable,Présentent
lourdement leur fausse majestéEn
spectacle risible à la malignité.D'autres,
de leur écaille étalant la richesse,Masquent
leur front abject d'une feinte noblesse:Des
manteaux étoilés couvrent leurs dos flétrisPar
la honte des coups dont ils furent meurtris.Ceux-ci,
moins insolents, sur leur visage infâmePortent,
en traits confus, l'opprobre de leur ame;Un
noir fiel rend amer leur pénible souris.Ceux-là,
de leur splendeur sont gênés et surpris,Ils
n'osent déployer leurs ailes diaprées,Et
déguisent leur queue et leurs griffes dorées.Non
loin de ces démons cornus et soucieux,Entre
elles se rongeant et s'épluchant des yeux,Leurs
épouses dressaient, diablesses arrogantes,Des
aigrettes de feu, des crêtes élégantes:Leur
cœur de jalousie était envenimé;Leurs
lèvres se séchaient d'un dépit enflammé,Sitôt
qu'une rivale, à leurs yeux rayonnante,Déroulait
plus d'émail sur sa croupe traînante;Ou
que, sous ses cheveux, tressés de serpents verts,Son
diadême au loin envoyait plus d'éclairs:A
son tour, celle-ci pâlissait consternéeQuand
d'un éclat voisin elle était dominée.Cependant
un orchestre interrompt les clameursDe
tout le cirque ému par de folles rumeurs.D'un
triple rang d'archets la profonde harmonie,Que
seconde des cors la douceur infinie,Elève
des sons purs, mélodieux, touchants,Dont
tressaillaient les cœurs, tendres échos des chants:Tantôt
ses longs accords soupirent une plainte,Tantôt
en bruits guerriers elle répand la crainte,Porte
les voluptés, la langueur dans les sens,Et
pénètre dans l'ame en aiguillons perçants.Mais
des princes d'enfer la cour est arrivée;Tous
les acteurs sont prêts, et la toile est levée.Notre
globe apparaît dans un ciel étendu;Là,
plane Copernic, astronome assidu,Portant
sa vue au loin de lunettes armée,Pour
mieux vaincre l'erreur des yeux de Ptolomée.Ce
prologue au sujet sert de commencement;Ainsi
qu'un haut portique ouvre un grand monument.COPERNIC
ET LA TERRE.COPERNIC.Terre,
sur le soleil c'est toi qui fais la roue:Cet
astre est ton essieu.LA
TERRE.Mortel,
né de ma boue,Homme,
frêle animal, es-tu si curieuxQue
d'oser sur ma sphère interroger les cieux?Tu
dois si peu de temps ramper à ma surface!En
toi-même plutôt cherche ce qui se passe.COPERNIC.Eh!
peut-on y voir clair? mon bonnet de docteurAtteste
qu'un scalpel, sous mon œil scrutateur,A
trop souvent, au sein d'une victime humaine,Cherché
par où l'artère est unie à la veine,Et
comment le poumon y forme un sang pourpréQui
se change en sang noir dans sa course altéré.Lorsqu'épiant
les nerfs, j'ai vu les tiges finesDes
troncs dont le cerveau reçoit tant de racines,Quand
j'ai sondé le crâne où fermente si fortL'ardeur
des passions, qu'éteint sitôt la mort;Et
l'écho du rocher frappé du son qui vole,Et
le souple larynx, route de la parole,Et
du cœur enflammé ce trépied véhémentQui,
partageant le corps en un double fragment,Soulève
en son courroux les voûtes ébranléesDont
la secousse émeut les entrailles troublées;Quand
j'ai percé l'horreur des replis intestins,Où
se perd et se rompt le fil de nos destins;Ce
foie où la tristesse et le fiel semblent fondre,Et
le sombre embarras du fatal hypocondre:Je
n'ai trouvé dans l'homme, au grand jour dépouillé,Qu'un
labyrinthe obscur où je m'étais souillé.J'ai
reculé, j'ai fui ce néant de moi-même;Et
me refugiant vers la raison suprême,Honteux
de demander, après un vain effort,Le
secret de la vie à la muette mort,Ma
pensée aussitôt recouvrit ces viscèresDont,
trop long-temps encor m'étalant les mystères,L'image,
en tout mortel, m'offrait même souventL'aspect
de l'homme éteint dans l'homme encor vivant.Respectant
les tissus où la sage natureCache
de nos ressorts la fragile structure,Etonné
que des yeux le liquide crystalDes
rayons éthérés fût le mouvant canal,Vers
les grands corps des cieux je levai ma paupière;Et
fier de réfléchir leurs torrents de lumière,Mon
esprit reconnut, planant de toutes parts,Que
plus loin que mon œil il étend ses regards;Et
j'ai vu ma grandeur, en cette intelligenceQui
de la bête à l'homme établit la distance.LA
TERRE.Superbe
insecte! eh quoi! tu prétends donc savoirL'ordre
de l'univers, ce qui le fait mouvoir?Toi,
de qui la faiblesse aux erreurs asservie,N'a
pu voir quel principe est l'agent de ta vie!COPERNIC.Je
sais que tu te meus; mais, ignorant pourquoi,J'en
sais sur toi du moins tout autant que sur moi.LA
TERRE.A
quoi bon t'enquérir, pour guider ton ménage,Si
le soleil ou moi nous faisons un voyage?COPERNIC.Ce
savoir, inutile à l'étroite raisonDes
mortels concentrés au soin de leur maison,Sert
aux explorateurs des bords de nos deux mondesA
nombrer tous leurs pas sur le sol et les ondes,Et
soumet, à l'aspect des astres mieux suivis,Les
terrestres labeurs aux célestes avis.Si
je n'avais connu sur quel axe inclinéeTu
tournes doublement par jour et par année,Du
zodiaque ardent comptant mal les retours,Je
n'eusse pu prévoir les saisons ni les jours,Ni
quand d'un astre, au loin précédant ta planète,L'apparence
changée ou recule, ou s'arrête;Ni
quand, sous l'écliptique ombragée en passant,La
lune cachera son disque brunissant,Ni
combien le soleil se baissant vers ta ligne,Des
jours égaux aux nuits hâte en un an le signe;Et
l'homme ignorerait du midi jusqu'au nord,Quels
mois viendront ouvrir son sillon ou son port.LA
TERRE.Va,
subtil raisonneur, dès avant Ptolomée,Qui
me laissa jadis sa relique embaumée,On
mangeait, on buvait, sans regarder si haut.Chaque
animal pour vivre en sait autant qu'il faut.COPERNIC.Chacun
suit son instinct et remplit sa carrière:Le
nôtre est de sonder le monde et la matière:Et
l'esprit qui te pèse et mesure tes pas,Est
plus noble que toi, qui ne te connais pas.Je
préfère un rayon de science profondeA
l'éclat des dehors couvrant ta sphère immonde:Tu
cesses de briller quand la clarté te fuit;La
pensée est la flamme, et veille dans la nuit.Cette
lampe immortelle éclaira PythagoreSur
l'immobilité du soleil qui te dore.Déja
les temps passés m'ont dit que NicétasTe
vit sous le soleil variant tes climats,De
ses feux vers l'aurore aller puiser la sourceQu'on
croyait au couchant apportés par sa course.Sous
l'espace des cieux mon compas s'est ouvert.Ton
étroit diamètre eût-il rien découvert?Celui
de ta carrière est l'immense mesure,Où
d'une parallaxe enfin l'atteinte sûreTouche,
au sommet d'un angle, un monde errant dans l'air,Jusqu'à
l'étoile fixe au plus haut de l'éther,Où
les astres lointains d'un ciel inaccessibleCachent
dans l'infini leur orbite insensible.LA
TERRE.Ainsi
tu brises donc l'antique firmament,Ceintre
de crystal pur, voûte de diamant,Dont
les clous d'or.....COPERNIC.Erreurs!
songes de l'ignorance!Vains
prestiges des sens dupes de l'apparence!LA
TERRE.Crois-tu
les détromper?COPERNIC.L'homme
apprendra de moiQue
son soleil si lourd, immense au prix de toi,Ne
peut, pour éclairer ta ronde petitesse,Au
cercle de tes jours rouler avec vîtesse;Tandis
que, pour t'offrir à ses traits éclatants,En
pivotant sur toi, tu tournes moins de temps.LA
TERRE.L'homme
ne croira pas qu'un transport si commodeDe
lui-même, le soir, le rende l'antipode.Les
oiseaux, dira-t-on, du nadir au zénith,De
vue, en fendant l'air, perdraient soudain leur nid.COPERNIC.On
saura qu'avec toi l'atmosphère qui roule,Entraîne
en cheminant ce qui vit sur ta boule;Comme
sur un navire, où tous ceux qu'il conduitS'imaginent
voir fuir tous les objets qu'il fuit.LA
TERRE.Au
mortel indolent qui se sent immobile,Affirme
que sans cesse il court de mille en mille,Et
qu'il voyage autant, sans s'en apercevoir,Que
Charles-Quint, toujours fier de se faire voir:L'ellébore
sera le prix de ta remarque,Elève
d'Hippocrate, et beau vainqueur d'Hipparque.COPERNIC.Je
ne m'empresse pas de proclamer à tousLes
lois de ma raison, car les humains sont fous;Et
des contemporains toujours l'ingratitudeProscrit
la vérité conquise par l'étude.D'Euclide
et d'Archimède astronome appuyé,Je
m'avance à pas lents, de doutes effrayé:Si
mon art faisait luire entre les deux solsticesLa
face des Césars, le poil des Bérénices,Astrologue
menteur, si mes vagues discoursSemblaient
mettre d'accord les cieux avec les cours,Si,
dans l'ombre observant mille intrigues secrètesJ'en
étais le devin, ainsi que des comètes,Mon
siècle, aimant la fourbe et l'ostentation,Me
nommerait des grands la constellation:Mais,
ne tendant qu'au vrai, je n'ai que Dieu pour maître,Ce
n'est que du tombeau que ma gloire peut naître,Après
les vains fracas qu'on entend éclaterAu
nom de tous nos rois, du pape et de Luther.Retiré
loin du bruit, l'ignorance et l'égliseNe
sacrifieront point Copernic à Moïse.Je
lègue mon systême à quelque zélateurQui
sera condamné d'un saint inquisiteurA
renier sa foi sur le cours de la terre:Tant
la vérité plaît aux prêtres de ta sphère!Adieu.
Je crois sentir qu'en fuyant d'ici-basL'ame,
à son apogée, ignore leurs débats.LA
TERRE.Crains
ce périhélie où son feu la dévore.COPERNIC.Je
suis dans le soleil, et je te mire encore.(Il
disparaît.)LA
TERRE, L'ESPACE ET LE TEMPS.LA
TERRE.De
quels maîtres divins en a donc tant apprisCet
animal pensant, de la lumière épris?Qui
de mes mouvements lui découvrit la trace?L'ESPACE
ET LE TEMPS.Nous.LA
TERRE.Qui
donc êtes-vous?LE
TEMPS.Moi,
le Temps.L'ESPACE.Moi,
l'Espace.LE
TEMPS.Oui,
c'est moi qui toujours, un long pendule en main,Dans
l'horloge des cieux sonne sur ton chemin.L'ESPACE.C'est
moi qui de la voûte où chaque étoile brilleForme
un cadran immense à l'éternelle aiguille.LA
TERRE.Je
reconnais ta voix, ô Temps fallacieux,Qui,
par ta double face, à-la-fois jeune et vieux,Regardes,
emportant les mondes sous ton aile,Le
passé qui me fuit, l'avenir qui m'appelle:Toi,
je te reconnais aux cercles azurésOù
sont de tes grandeurs marqués tous les degrés.L'ESPACE.Fils
de l'éternité, le temps produit chaque âge;Fils
de l'immensité, l'espace la partage;L'immobile
infini qu'on ne peut concevoir,En
son sein tous les deux nous laisse nous mouvoir;On
ne saisit qu'en nous les lieux et la durée;Et
par notre puissance, avec art mesurée,L'esprit,
qui tient de nous ses doctes éléments,De
nos rapports unis tire ses jugements.Ce
fut par nos leçons que l'humaine industrieTe
soumit aux calculs de sa géométrie.Sans
l'espace, le temps serait inaperçu;Sans
le temps, de l'espace on n'eût jamais rien su.LA
TERRE.Je
ne te comprends pas.LE
TEMPS.Trop
ignorante masse!Sentirais-tu
dans l'air toujours changer ta place,Si
tu n'apercevais de moments en momentsDes
astres d'alentour les divers changements?Le
terme de leur cours, leur vîtesse inégale,Ne
t'instruisent-ils pas par leur double intervalle?C'est
ainsi qu'un chasseur, en décochant deux traits,Les
juge lents ou prompts d'autant que loin ou prèsVers
le but de leur vol un même instant les porte:Et
tout ce qui se meut s'estime de la sorte.L'ESPACE.Oui,
des corps circulant dans ma capacité,La
pesanteur s'égale à leur vélocité;C'est
par nos seuls avis que l'homme qui te sondeSait
que ta lune agit sur les reflux de l'onde,Et
connaît que ton pôle en sa nutationBorne
à vingt-cinq mille ans sa révolution:C'est
peu que de prévoir les phases des planètes,Il
suit dans notre sein les retours des comètes,Trace
la parabole où leurs feux sont perdus,Et
prédit aux mortels qu'ils ne les verront plus.LA
TERRE.Ce
petit être-là reçut un haut génie!LE
TEMPS.Non,
le temps éternel, l'étendue infinie,Où
le temps mesurable et l'espace apparentEmportent
l'univers et passent en courant,Sont
pour l'homme des mots qu'il ne saurait entendre;Son
esprit jusque-là ne put jamais s'étendre;Et
n'attachant à tout qu'un sens matériel,Derrière
un ciel franchi n'imagine qu'un ciel.Il
faut que des moments, des lieux et des figures,Pour
être comparés, lui prêtent leurs mesures;Et
le temps fixe et vrai, le vide illimité,Se
cache autant à lui que la divinité.Que
de choses pourtant, véritables mystères,Que
sa science ignore, et nomme des chimères!Dieu
même, à sa faiblesse invisible en tout point,Parce
qu'il est voilé, lui semble n'être point.L'ESPACE.Eh!
l'homme, qui toujours examine et compare,Médite
peu le fond, et son esprit s'égare.Par
le temps et l'espace il compte les instants,Et
ne sait ce que c'est que l'espace et le temps.Un
an est un long siècle à son impatience;Un
siècle n'est qu'un jour pour sa vaine espérance:Son
orgueil ne voit pas que tout son avenirDans
le passé rapide est tout près de finir.Terre,
un quart de ton globe, inutile domaine,Aux
mortels couronnés paraît suffire à peine;Tandis
que leurs sujets, n'arpentant qu'un jardin,S'étonnent
des grandeurs de son étroit confin.Ainsi,
toujours trompé sur tout ce qu'il embrasse,L'homme
se croit durable et sans borne en sa place;La
mort vient, le dépouille, et je reprends sur luiJusqu'au
lieu resserré d'où son corps même a fui:Car,
tout passe en mon sein, emporté par les âges;Le
monde en doit sortir, et même ses images.LE
TEMPS.Un
drame néanmoins va montrer aux démonsCe
que font les mortels pour leurs rangs et leurs noms,Et
l'âge où Charles-Quint, en fatiguant sa vie,A
cru s'éterniser sur ta superficie.LA
TERRE.Où
donc est le théâtre où ses traits sont offerts?L'ESPACE.Aux
enfers.LA
TERRE.En
quels lieux sont cachés les enfers?L'ESPACE.L'erreur
se les figure au centre de ton globe:Une
comète au loin dans la nuit les dérobe,Monde
errant, embrasé, plus vaste que le tien;Car,
dans l'immensité, ton orbe entier n'est rien.Tu
le sais: dans le vide il est tant de demeures!Adieu!
poursuis ta route, et roule au gré des heures.Là
finit le prologue, on voit tout s'éclipser;L'acte,
image du siècle, enfin va commencer.Mais
sur la scène encor s'abaisse un second voile:La
fausse renommée y brille en une toileOù
le pinceau traça le triomphe des chars,Au
temple de mémoire entraînant les Césars.Quelques
sages, témoins de leurs superbes rôles,Soit
dédain, soit pitié qui haussât leurs épaules,Courrouçaient
d'un souris les centaures d'acierQui
de leur sabre nu croyaient les effrayer.On
voyait des grandeurs les cimes orageusesSur
des remparts en feu, qu'en ses courses fangeusesEntourait
de replis un long fleuve sanglant.Les
noirs torrents du Styx, le Phlégéton brûlant,Dont
l'horreur fabuleuse épouvante les ames,N'ont
rien de plus affreux, dans leurs eaux, dans leurs flammes,Qu'un
cours de sang humain, roulant à gros bouillons,Où
surnagent encor, en proie aux tourbillons,Des
pieds, des corps tronqués, des mains, de pâles têtes.Cependant
le vainqueur, dont les palmes sont prêtes,Traverse
le carnage; et, rougi de ce sang,L'affreux
jour qui s'y plonge en s'y réfléchissantFait
reluire au passage une pourpre enflammée,Vêtement
du héros cher à la renommée;Tandis
qu'un peuple aveugle entend de toutes partsLes
trompettes, les chants, les cris, et les pétards.L'enfer
se plaît à voir que du sang qui s'étaleLa
lueur rejaillit en pourpre triomphale.Le
peintre est applaudi par les noirs spectateurs.La
toile enfin remonte, et fait place aux acteurs.
CHANT DEUXIEME.
La toile se lève. Description du
lieu de la scène. L'amiralBonnivet, endormi dans sa tente, aperçoit l'image de sa maîtresse,
qui lui reproche d'avoir entraîné les Français en Italie, moins
pour leur gloire que par le desir de la revoir à Milan. Entretien
deClément Marotet de l'amiral.
Apparition de l'ombrede Bayardau pied d'un chêne, devant leConnétable de
Bourbon, qu'il laisse avec laConscience. Scène entrela Conscienceetle
Connétabletransfuge. Dialogue de laMortet d'uneFourmi. Pressentiment que s'exprime à
soi-mêmele chêneantique sous
lequel apparut Bayard. Histoire et chûte de ce vieux arbre, arraché
par des soldats.CHANT DEUXIÈME.Le théâtre présente, en un château gothique,Une chambre, que pare un lit non moins antique:La nuit y règne encor sous deux rideaux épaisBrodés à larges fleurs, surmontés par un dais.Là, s'agite en dormant un chef plein de vaillance,Qui pour François-Premier a manié la lance,Bonnivet, dont le camp siége au bord du Tésin:Les vîtraux sont blanchis des rayons du matin.Vers le lit du guerrier une image se glisse;Fille du souvenir, c'est la belle Clérice.BONNIVET ET L'IMAGE DE CLÉRICE.L'IMAGE DE CLÉRICE.Tu languis, amiral! n'est-ce donc pas pour moiQue tu fis traverser les Alpes à ton roi?Si j'en crois les baisers et les mots de ta
bouche,Milan n'eut rien pour toi de plus doux que ma
couche.Moi, folle Italienne, ardente en mon amour,Je te fis oublier tes Lucrèces de cour:D'autant plus préférable à ces illustres belles,Qu'alors qu'on les subjugue on est fatigué
d'elles;Tandis que sans façon me laissant obtenir,Quand on sort de mes bras, on veut y revenir.L'abandon inquiet de vos prudes maîtressesNe vaut pas les transports de mes vives caresses,Et leur triste scrupule, et leurs plaisirs gênésEmbrasent moins vos sens que mes sens effrénés.Mon port a-t-il perdu ses graces attrayantes?Ai-je les yeux moins vifs, les lèvres moins
riantes,Le col moins blanc, le sein moins ferme et moins
poli,Le bras, le pied, le..... quoi? qu'ai-je de moins
joli?Ah! mon cher Bonnivet! tu brûles, tu soupires,Et l'ardeur qui t'émeut dit ce que tu desires.....Viens donc.BONNIVET.O ma Clérice! objet aimable et beau!Déja tu m'apparus vers ce double ruisseauQui, mêlant ses tributs pour former la Durance,Des rocs de Briançon coule avec abondance.Là, dans ma couche ainsi réveillant mes desirs,Tu me vins de Milan retracer les plaisirs:Tes appas demi-nus me ravirent en songe;Et quand de tes baisers je goûtais le mensonge,Tu semblas t'échapper comme une ombre sans corps,Loin du lit qu'en désordre avaient mis tes
transports.L'IMAGE DE CLÉRICE.J'ai voulu, te laissant le regret de ma perte,Au sein de l'Italie à tes armes rouverte,T'attirer doucement par le secret pouvoirQue j'ai sur tout Français épris de mon œil noir.Mon orgueil a bien ri, s'il faut parler sans
feinte,Quand, plein de ma mémoire en tous tes sens
empreinte,Au conseil de ton roi, par cent nobles raisons,Tu poussas son armée à repasser les monts.Ah! de ton éloquence héroïque, suprême,Ma flamme était la source inconnue à toi-même.Tu crus, en confondant les plus sages guerriers,N'avoir devant les yeux que l'honneur des
lauriers;Tu ne voyais que moi: j'étais la seule envieDont l'attrait t'amenât sous les murs de Pavie.Les peuples ont-ils cru qu'un magnanime roiAu milieu des périls entraînât, sur ta foi,Ses soldats, et la fleur des preux de sa famille,Pour rendre un libertin à l'amour d'une fille?Tel est le monde! Allons; aux assiégés vaincusReprends-moi dans Pavie, et presse le blocus.(L'image disparaît.)BONNIVET,s'éveillant.Que dit-elle?.... Ah! j'entends la trompette qui
sonne.Déja sur l'horizon le jour naissant rayonne.....Levons-nous..... dans mon camp devançons le
soleil.Quoi donc? à quel objet rêvais-je en mon sommeil?A Clérice!... Elle-même.... Oh! l'étrange
folie!....Son amour m'aurait fait rentrer dans l'Italie!Non, non, dans les périls dont je me sens pressé,Ce lâche sentiment ne m'eût jamais poussé:Vous n'êtes pas, madame, une seconde Hélène;Votre Milan n'est pas l'Ilion qui m'amène.Non, je n'ai point pour vous suivi le roi des
rois;Je n'ai point follement, jaloux de vains exploits,Pour me reconquérir vos faveurs et vos charmes,Ebranlé tout-à-coup les Alpes sous mes armes,Et porté mes canons sur des rocs sourcilleuxOù jamais n'ont tonné que les foudres des cieux.Qui? moi! pour contenter mes amoureux caprices,Mettre une armée entière au bord des précipices,Exposer un grand roi, ses parents, ses soldats;Les conduire en aveugle à de lointains combats!Pour qui? pour ma maîtresse offerte à ma mémoire?Non, mon cœur n'écouta que la voix de la gloire;Et sans qu'à mes projets un fol amour ait part,Je vins ici venger nos affronts et Bayard.CLÉMENT-MAROT, ET BONNIVET.BONNIVET.C'est vous, galant Marot! vous, levé dès l'aurore!MAROT.Oui, j'aime à voir l'éclat dont l'orient se dore;Et le dieu des beaux vers m'emplit de feux
nouveaux,Quand l'heure matinale attèle ses chevaux.J'aime à voir de son char la lumière vermeilleLuire au camp des Français, que le clairon
éveille;Et, brillant dans l'azur, l'astre de LuciferEmailler les vallons étincelants de fer.BONNIVET.Si vous ne me parliez sur le ton des poëtes,Je vous méconnaîtrais, armé comme vous l'êtes.MAROT.Je ne ferais nul cas d'un poëte de courQui n'endosserait point la cuirasse à son tour.BONNIVET.Marot veut que son sang, grace à quelques
prouesses,Lui mérite les pleurs des plus nobles princesses.MAROT.Marot chez les neuf sœurs survivra plus d'un jour,Blessé du fer de Mars et des traits de l'Amour.BONNIVET.La propre sœur du roi, si j'en crois la chronique,Vous l'aura dit, peut-être, en un style saphique.MAROT.La sœur de notre roi, duchesse d'Alençon,Protège en moi du Pinde un humble nourrisson:Je l'aide quelquefois des avis de ma museA tourner plaisamment un conte qui l'amuse.Mais les grands sont jaloux quand elle me sourit,Et fait céder pour moi l'étiquette à l'esprit.BONNIVET.Marguerite, en secret, vous met, dit-on, en verve?MAROT.La Pallas de nos jours doit être ma Minerve.Est-ce un sujet de glose aux malins envieux?BONNIVET.Que fait donc votre muse, absente de ses yeux?MAROT.Elle chante le roi, pour qui je prends l'épée.BONNIVET.Brave rimeur, courage! A quand votre épopée?MAROT.Le Parnasse, amiral, est plus lent à forcerQue vos remparts tonnants, si prompts à renverser.Un poëme renaît sur d'héroïques cendres.Nous n'avons qu'un Homère; il est tant
d'Alexandres!N'imaginez donc pas, en vous raillant toujours,Qu'un poëte, en soldat, marche au gré des
tambours.BONNIVET.Vous, n'imaginez pas qu'en ses folles boufféesVotre docte Phébus élève nos trophées.MAROT.Non; l'honneur d'un guerrier a d'autres fondementsQui prêtent à nos vers d'utiles ornements.BONNIVET.Ah! les héros outrés et la fiction pure,Des œuvres d'Apollon sont la seule parure;Et de grands mots, tirés du latin et du grec,Enrichissent leur fonds, quelquefois pauvre et
sec.Voilà ce qui soutient les vaines renomméesDes beaux diseurs de rien, en paroles rimées.MAROT.Si je connais votre art ainsi que vous le mien,Je confesse qu'ici je n'en parle pas bien.Chacun notre métier: perdons la frénésieMoi, de parler de guerre, et vous, de poésie.Souffrez qu'ici Marot, cavalier mal-expert,Use à son gré du temps que vous jugez qu'il perd;Que, sans titre en vos camps, rimant son badinage,Il offre à plus d'un siècle un miroir de son âge.Venez; le roi vous mande, et va tenir conseil.L'Europe ne doit plus voir un double soleil:Valois dit qu'il est temps que Charles-Quint lui
cède.BONNIVET.S'il m'écoute, il vaincra.MAROT.Que Dieu vous soit en aide!BONNIVET.Lannoy veut nous surprendre... Ah! je jure
qu'avant,Les nonnes de Pavie, en leur étroit couventRecevront mes soudards comme révérends pères.MAROT.Bon! que comme Marie elles soient vierges-mères.Ils sortent; les démons rirent aux grands éclats,Que la virginité, dévolue aux prélats,Dût-être un jour en proie aux baisers à
moustaches:Car de l'honneur dévot le diable aime les taches.Tout a changé d'aspect: dix jours sont écoulés.La scène offre aux regards des chemins isolés;Ils tendent vers un camp dont l'enceinte est
voisine:Sur de larges vallons Pavie au loin domine.Le soleil qui se couche éclaire encor les frontsDes arbres dont le soir déja noircit les troncs:Là, d'un chêne élevé la grande ombre s'allonge.Un coursier, qui hennit sous le frein d'or qu'il
ronge,Porte en ce lieu Bourbon, connétable fameux,Transfuge de la France, et proscrit belliqueux.C'est l'heure où du sommeil accourent les
fantômes;Où les esprits ailés, les Sylphes et les Gnômes,Courbent, en voltigeant, la bruyère des bois,Et remplissent les airs de murmurantes voix.Sous d'humides vapeurs tout semble se confondre;Le jour est prêt à fuir, et la nuit prête à
fondre.BOURBON.Soleil! en t'éloignant tu vois mes camps agir:L'astre d'un prince ingrat comme toi va rougir;Et, me fuyant demain, sa splendeur éclipséeCédera pour sa honte à ma gloire offensée.Heureux François-Premier, tremble d'être puniPar ce même mortel que ta haine a banni.Charles-Quint que je sers, mon juste et nouveau
maître,Des brigues de ta cour me vengera peut-être;Et je te convaincrai, plaisir digne de moi!Qu'un sujet outragé peut avilir un roi.Que vois-je?... est-ce une erreur, une chimère
vaine?...Quel guerrier m'apparaît appuyé sous ce
chêne?.....C'est celui qu'à Rébec j'ai vu de sang baigné,Me jeter en mourant un regard indigné!C'est lui! je reconnais ses traits, et sa stature,Sa longue épée en croix, et sa pesante armure.....Écarte-toi, fantôme! et sors de mon chemin....!Pour m'arracher la bride il étend une main....!Avance, ô mon coursier!... Presse le pas! te
dis-je....Quoi! son crin se hérisse, il recule.... ô
prodige!Bourbon même, Bourbon de crainte est
combattu......Et toi, chez les vivants pourquoi reparais-tu?Rentre au lit de la mort, ou cette lance.....L'OMBRE DE BAYARD.Approche.Je suis le chevalier sans peur et sans reproche.BOURBON.Qui t'a fait du tombeau quitter la froide nuit?L'OMBRE DE BAYARD.Bayard vient consterner l'orgueil qui te conduit.BOURBON.Ton roi, dont l'amitié t'honora dans ta vie,Humilia souvent ma vertu poursuivie:Lui dûmes-nous tous deux garder la même foi?L'OMBRE DE BAYARD.L'honneur pour nos pareils n'a qu'une même loi.BOURBON.J'abhorrais d'un tyran l'injustice hautaine.L'OMBRE DE BAYARD.Lorsqu'il daigna de moi, modeste capitaine,Recevoir l'accolade, aux champs de Marignan,Valois s'annonca-t-il en superbe tyran,Lui qui devant l'honneur de la chevalerieCourba sa tête auguste, espoir de la patrie?BOURBON.Il voulut d'un prestige exalter nos vertus,Pour vaincre ses rivaux par nos mains abattus.L'OMBRE DE BAYARD.Tu les sers contre lui, Connétable perfide!Regarde à tes côtés cette vierge rigide:Elle te redira qu'on doit au lit d'honneurMourir pour son pays sans reproche et sans peur.Adieu! va, déloyal! ton vil triomphe approche:Mais tu n'éviteras la peur ni le reproche.(L'ombre disparaît.)BOURBON ET LA CONSCIENCE.BOURBON.Où suis-je?... Oracle affreux qui confond mon
orgueil!O spectre tout armé, déserteur du cercueil,Serais-tu des enfers l'organe et le ministre?Arrête, ombre sévère!... Ah! quel adieu
sinistre!...Il s'enfonce à travers l'épaisseur des forêts,Silencieux comme elle, et sombre en tous ses
traits...Il fuit.... il a soufflé le désordre en mon
ame....O mânes redoutés!... Mais toi, maligne femme,Toi, parle; que veux-tu? l'horreur de cet instantDoit-elle provoquer ton sourire insultant?Pourquoi, d'un blanc si pur couverte tout entière,Me blesser dans la nuit par ta vive lumière?LA CONSCIENCE.Traître! la Conscience enfin te veut parler.BOURBON.Importune! à mon camp laisse moi revoler.LA CONSCIENCE.L'ombre du preux Bayard m'ordonna de te suivre:N'attends pas que de moi nul effort te
délivre.