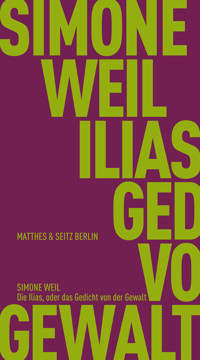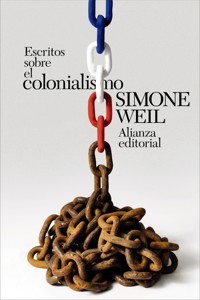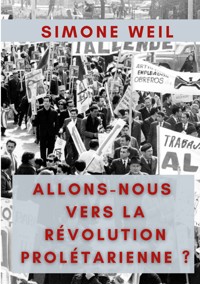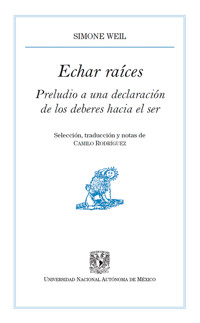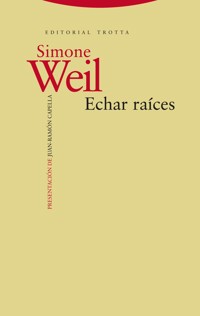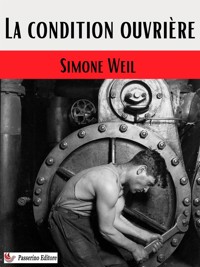1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Ceux qui aiment la fulgurance des citations qui contiennent tout un monde, ceux dont une seule phrase ou un court passage, retenu pour sa beauté ou sa clairvoyance, peut occuper l’esprit longtemps, bref tous ceux qui pratiquent plus volontiers la méditation que la spéculation, vont à coup sûr adorer La Pesanteur et la Grâce. Recueil des pensées les plus intimes d’un philosophe au parcours singulier qui renonça à sa condition bourgeoise pour travailler à l’usine et qui, d’origine juive, finit par se rapprocher du christianisme, cet ouvrage constitue une véritable initiation à l’oeuvre de Simone Weil. Sous une trentaine de rubriques se retrouvent les thèmes principaux de sa réflexion : effacement, acceptation du vide, mystique du travail… Mue par le constant désir d’abolir en elle le moi, Simone Weil paraît reformuler sans cesse tout au long de ces pages une seule et cruciale question, celle du salut : comment peut-on échapper à ce qui en nous ressemble à de la pesanteur ?
Paul Klein
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
La Pesanteur et la Grâce
suivi de Attente de Dieu
Simone Weil
Table des matières
Simone Weil
La pesanteur et la grâce
1. La pesanteur et la grâce
2. Vide et compensation
3. Accepter le vide
4. Détachement
5. L'imagination combleuse
6. Renoncement au temps
7. Désirer sans objet
8. Le moi
9. Décréation
10. Effacement
11. La nécessité et l'obéissance
12. Illusions
13. Idolâtrie
14. Amour
15. Le mal
16. Le malheur
17. La violence
18. La croix
19. Balance et levier
20. L'impossible
21. Contradiction
22. La distance entre le nécessaire et le bien
23. Hasard
24. Celui qu'il faut aimer est absent
25. L'athéisme purificateur
26. L’attention et la volonté
27. Dressage
28. L' intelligence et la grâce L' intelligence et la grâce
29. Lectures
30. L'anneau de Gyges
31. Le sens de l'univers
32. Metaxu
33. Beauté
34. Algèbre
35. La lettre sociale
36. Le gros animal
37. Israël
38. L'harmonie sociale
39. Mystique du travail
Simone Weil
Attente de Dieu
I. Lettres
1. Lettre I
2. Lettre II
3. Lettre III
II. Lettres D’adieux
1. Lettre IV
2. Lettre V
3. Lettre VI
III. Exposés
1. Réflexions sur le bon usage des études scolaires en vue de l'amour de Dieu
2. L'amour de Dieu et le malheur
I. Formes de l'amour implicite de Dieu
1. L'amour du prochain
2. Amour de l'ordre du monde
3. Amitié
4. Amour implicite et amour explicite
3. À propos du pater
4. Les trois fils de Noé et l'histoire de la civilisation méditerranéenne
IV. Appendice
1. Lettre à J M. Perrin
2. Lettre à Gustave Thibon
3. Lettre à Maurice Schumann
À propos de l’auteur
La pesanteur et la grâce
1940-1942
Simone Weil
Passages choisis, tirés de carnets personnels (écrits avant 1942) de Simone Weil par Gustave Thibon.
Chapitre 1
La pesanteur et la grâce
Tous les mouvements naturels de l’âme sont régis par des lois analogues à celles de la pesanteur matérielle. La grâce seule fait exception.
Il faut toujours s’attendre à ce que les choses se passent conformément à la pesanteur, sauf intervention du surnaturel.
Deux forces règnent sur l’univers : lumière et pesanteur.
Pesanteur. — D’une manière générale, ce qu’on attend des autres est déterminé par les effets de la pesanteur en nous ; ce qu’on en reçoit est déterminé par les effets de la pesanteur en eux. Parfois cela coïncide (par hasard), souvent non.
Pourquoi est-ce que dès qu’un être humain témoigne qu’il a peu ou beaucoup besoin d’un autre, celui-ci s’éloigne ? Pesanteur.
Lear, tragédie de la pesanteur. Tout ce qu’on nomme bassesse est un phénomène de pesanteur. D’ailleurs le terme de bassesse l’indique.
L’objet d’une action et le niveau de l’énergie qui l’alimente, choses distinctes.
Il faut faire telle chose. Mais où puiser l’énergie ? Une action vertueuse peut abaisser s’il n’y a pas d’énergie disponible au même niveau.
Le bas et le superficiel sont au même niveau. Il aime violemment, mais bassement : phrase possible. Il aime profondément, mais bassement : phrase impossible.
S’il est vrai que la même souffrance est bien plus difficile à supporter par un motif élevé que par un motif bas (les gens qui restaient debout, immobiles, de une à huit heures du matin pour avoir un œuf, l’auraient très difficilement fait pour sauver une vie humaine), une vertu basse est peut-être à certains égards mieux à l’épreuve des difficultés, des tentations et des malheurs qu’une vertu élevée. Soldats de Napoléon. De là l’usage de la cruauté pour maintenir ou relever le moral des soldats. Ne pas l’oublier par rapport à la défaillance.
C’est un cas particulier de la loi qui met généralement la force du côté de la bassesse. La pesanteur en est comme un symbole.
Queues alimentaires. Une même action est plus facile si le mobile est bas que s’il est élevé. Les mobiles bas enferment plus d’énergie que les mobiles élevés. Problème : comment transférer aux mobiles élevés l’énergie dévolue aux mobiles bas ?
Ne pas oublier qu’à certains moments de mes maux de tête, quand la crise montait, j’avais un désir intense de faire souffrir un autre être humain, en le frappant précisément au même endroit du front.
Désirs analogues, très fréquents parmi les hommes.
Plusieurs fois dans cet état, j’ai cédé du moins à la tentation de dire des mots blessants. Obéissance à la pesanteur. Le plus grand péché. On corrompt ainsi la fonction du langage, qui est d’exprimer les rapports des choses.
Attitude de supplication : nécessairement je dois me tourner vers autre chose que moi-même, puisqu’il s’agit d’être délivré de soi-même.
Tenter cette délivrance au moyen de ma propre énergie, ce serait comme une vache qui tire sur l’entrave et tombe ainsi à genoux.
Alors on libère en soi de l’énergie par une violence qui en dégrade davantage. Compensation au sens de la thermodynamique, cercle infernal dont on ne peut être délivré que d’en haut.
L’homme a la source de l’énergie morale à l’extérieur, comme de l’énergie physique (nourriture, respiration). Il la trouve généralement, et c’est pourquoi il a l’illusion — comme au physique — que son être porte en soi le principe de sa conservation. La privation seule fait sentir le besoin. Et, en cas de privation, il ne peut pas s’empêcher de se tourner vers n’importe quoi de comestible.
Un seul remède à cela : une chlorophylle permettant de se nourrir de lumière.
Ne pas juger. Toutes les fautes sont égales. Il n’y a qu’une faute : ne pas avoir la capacité de se nourrir de lumière. Car cette capacité étant abolie, toutes les fautes sont possibles.
« Ma nourriture est de faire la volonté de Celui qui m’envoie. »
Nul autre bien que cette capacité.
Descendre d’un mouvement où la pesanteur n’a aucune part... La pesanteur fait descendre, l’aile fait monter : quelle aile à la deuxième puissance peut faire descendre sans pesanteur ?
La création est faite du mouvement descendant de la pesanteur, du mouvement ascendant de la grâce et du mouvement descendant de la grâce à la deuxième puissance.
La grâce, c’est la loi du mouvement descendant.
S’abaisser, c’est monter à l’égard de la pesanteur morale. La pesanteur morale nous fait tomber vers le haut.
Un malheur trop grand met un être humain au-dessous de la pitié : dégoût, horreur et mépris.
La pitié descend jusqu’à un certain niveau, et non au-dessous. Comment la charité fait-elle pour descendre au-dessous ?
Ceux qui sont tombés si bas ont-ils pitié d’eux-mêmes ?
Chapitre 2
Vide et compensation
Mécanique humaine. Quiconque souffre cherche à communiquer sa souffrance — soit en maltraitant, soit en provoquant la pitié — afin de la diminuer, et il la diminue vraiment ainsi. Celui qui est tout en bas, que personne ne plaint, qui n’a le pouvoir de maltraiter personne (s’il n’a pas d’enfant ou d’être qui l’aime), sa souffrance reste en lui et l’empoisonne.
Cela est impérieux comme la pesanteur. Comment s’en délivre-t-on ? Comment se délivre-t-on de ce qui est comme la pesanteur ?
Tendance à répandre le mal hors de soi : je l’ai encore ! Les êtres et les choses ne me sont pas assez sacrés. Puissé-je ne rien souiller, quand je serais entièrement transformée en boue. Ne rien souiller même dans ma pensée. Même dans les pires moments je ne détruirais pas une statue grecque ou une fresque de Giotto, Pourquoi donc autre chose ? Pourquoi par exemple un instant de la vie d’un être humain qui pourrait être un instant heureux ?
Impossible de pardonner à qui nous a fait du mal, si ce mal nous abaisse. Il faut penser qu’il ne nous a pas abaissés, mais a révélé notre vrai niveau.
Désir de voir autrui souffrir ce qu’on souffre, exactement. C’est pourquoi, sauf dans les périodes d’instabilité sociale, les rancunes des misérables se portent sur leurs pareils.
C’est là un facteur de stabilité sociale.
Tendance à répandre la souffrance hors de soi. Si, par excès de faiblesse, on ne peut ni provoquer la pitié ni faire du mal à autrui, on fait du mal à la représentation de l’univers en soi.
Toute chose belle et bonne est alors comme une injure.
Faire du mal à autrui, c’est en recevoir quelque chose. Quoi ? Qu’a-t-on gagné (et qu’il faudra repayer) quand on a fait du mal ? On s’est accru. On est étendu. On a comblé un vide en soi en le créant chez autrui.
Pouvoir faire impunément du mal à autrui — par exemple passer sa colère sur un inférieur et qu’il soit forcé de se taire — c’est s’épargner une dépense d’énergie, dépense que l’autre doit assumer. De même pour la satisfaction illégitime d’un désir quelconque. L’énergie qu’on économise ainsi est aussitôt dégradée.
Pardonner. On ne peut pas. Quand quelqu’un nous a fait du mal, il se crée en nous des réactions. Le désir de la vengeance est un désir d’équilibre essentiel. Chercher l’équilibre sur un autre plan. Il faut aller par soi-même jusqu’à cette limite. Là on touche le vide. (Aide-toi, le ciel t’aidera…)
Maux de tête. À tel moment : moindre douleur en la projetant dans l’univers, mais univers altéré ; douleur plus vive, une fois ramenée à son lieu, mais quelque chose en moi ne souffre pas et reste en contact avec un univers non altéré. Agir de même avec les passions. Les faire descendre, les ramener à un point, et s’en désintéresser. Traiter ainsi notamment toutes les douleurs. Les empêcher d’approcher les choses.
La recherche de l’équilibre est mauvaise parce qu’elle est imaginaire. La vengeance. Même si en fait on tue ou torture son ennemi c’est, en un sens, imaginaire.
L’homme qui vivait pour sa cité, sa famille, ses amis, pour s’enrichir, pour accroître sa situation sociale, etc. — une guerre, et on l’emmène comme esclave, et dès lors, pour toujours, il doit s’épuiser à l’extrême limite de ses forces, simplement pour exister.
Cela est affreux, impossible, et c’est pourquoi il ne se présente pas devant lui de fin si misérable qu’il ne s’y accroche, ne serait-ce que de faire punir l’esclave qui travaille à ses côtés. Il n’a plus le choix des fins. N’importe laquelle est comme une branche pour qui se noie.
Ceux dont on avait détruit la cité et qu’on emmenait en esclavage n’avaient plus ni passé ni avenir : de quel objet pouvaient-ils emplir leur pensée ? De mensonges et des plus infimes, des plus pitoyables convoitises, prêts peut-être davantage à risquer la crucifixion pour voler un poulet qu’auparavant la mort dans le combat pour défendre leur ville. Sûrement même, ou bien ces supplices affreux n’auraient pas été nécessaires.
Ou bien il fallait pouvoir supporter le vide dans la pensée.
Pour avoir la force de contempler le malheur quand on est malheureux, il faut le pain surnaturel.
Le mécanisme par lequel une situation trop dure abaisse est que l’énergie fournie par les sentiments élevés est — généralement — limitée ; si la situation exige qu’on aille plus loin que cette limite, il faut avoir recours à des sentiments bas (peur, convoitises, goût du record, des honneurs extérieurs) plus riches en énergie.
Cette limitation est la clef de beaucoup de retournements.
Tragédie de ceux qui, s’étant portés par amour du bien, dans une voie où il y a à souffrir, arrivent au bout d’un temps donné à leur limite et s’avilissent.
Pierre sur le chemin. Se jeter sur la pierre, comme si, à partir d’une certaine intensité de désir, elle devait ne plus exister. Ou s’en aller comme si soi-même on n’existait pas.
Le désir enferme de l’absolu et s’il échoue (une fois l’énergie épuisée), l’absolu se transfère sur l’obstacle. État d’âme des vaincus, des opprimés.
Saisir (en chaque chose) qu’il y a une limite et qu’on ne la dépassera pas sans aide surnaturelle (ou alors de très peu) et en le payant ensuite par un terrible abaissement.
L’énergie libérée par la disparition d’objets qui constituaient des mobiles tend toujours à aller plus bas.
Les sentiments bas (envie, ressentiment) sont de l’énergie dégradée.
Toute forme de récompense constitue une dégradation d’énergie.
Le contentement de soi après une bonne action (ou une œuvre d’art) est une dégradation d’énergie supérieure. C’est pourquoi la main droite doit ignorer…
Une récompense purement imaginaire (un sourire de Louis XIV) est l’équivalent exact de ce qu’on a dépensé, car elle a exactement la valeur de ce qu’on a dépensé — contrairement aux récompenses réelles qui, comme telles, sont au-dessus ou au-dessous. Aussi les avantages imaginaires seuls fournissent l’énergie pour des efforts illimités. Mais il faut que Louis XIV sourie vraiment ; s’il ne sourit pas, privation indicible. Un roi ne peut payer que des récompenses la plupart du temps imaginaires, ou bien il serait insolvable.
Équivalent dans la religion à un certain niveau.
Faute de recevoir le sourire de Louis XIV, on se fabrique un Dieu qui nous sourit.
Ou encore on se loue soi-même. Il faut une récompense équivalente. Inévitable comme la pesanteur.
Un être aimé qui déçoit. Je lui ai écrit. Impossible qu’il ne me réponde pas ce que je me suis dit à moi-même en son nom.
Les hommes nous doivent ce que nous imaginons qu’ils nous donneront. Leur remettre cette dette.
Accepter qu’ils soient autres que les créatures de notre imagination, c’est imiter le renoncement de Dieu.
Moi aussi, je suis autre que ce que je m’imagine être. Le savoir, c’est le pardon.
Chapitre 3
Accepter le vide
« Nous croyons par tradition au sujet des dieux, et nous voyons par expérience au sujet des hommes que toujours, par une nécessité de nature, tout être exerce tout le pouvoir dont il dispose » (Thucydide). Comme du gaz, l’âme tend à occuper la totalité de l’espace qui lui est accordé. Un gaz qui se rétracterait et laisserait du vide, ce serait contraire à la loi d’entropie. Il n’en est pas ainsi du Dieu des chrétiens. C’est un Dieu surnaturel au lieu que Jéhovah est un Dieu naturel.
Ne pas exercer tout le pouvoir dont on dispose, c’est supporter le vide. Cela est contraire à toutes les lois de la nature : la grâce seule le peut.
La grâce comble, mais elle ne peut entrer que là où il y a un vide pour la recevoir, et c’est elle qui fait ce vide.
Nécessité d’une récompense, de recevoir l’équivalent de ce qu’on donne. Mais si, faisant violence à cette nécessité, on laisse un vide, il se produit comme un appel d’air, et une récompense surnaturelle survient. Elle ne vient pas si on a un autre salaire : ce vide la fait venir.
De même pour la remise des dettes (ce qui ne concerne pas seulement le mal que les autres nous ont fait, mais le bien qu’on leur a fait). Là encore on accepte un vide en soi-même.
Accepter un vide en soi-même, cela est surnaturel. Où trouver l’énergie pour un acte sans contrepartie ? L’énergie doit venir d’ailleurs. Mais pourtant, il faut d’abord un arrachement, quelque chose de désespéré, que d’abord un vide se produise. Vide : nuit obscure.
L’admiration, la pitié (le mélange des deux surtout) apportent une énergie réelle. Mais il faut s’en passer.
Il faut être un temps sans récompense, naturelle ou surnaturelle.
Il faut une représentation du monde où il y ait du vide, afin que le monde ait besoin de Dieu. Cela suppose le mal.
Aimer la vérité signifie supporter le vide, et par suite accepter la mort. La vérité est du côté de la mort.
L’homme n’échappe aux lois de ce monde que la durée d’un éclair. Instants d’arrêt, de contemplation, d’intuition pure, de vide mental, d’acceptation du vide moral. C’est par ces instants qu’il est capable de surnaturel.
Qui supporte un moment le vide, ou reçoit le pain surnaturel, ou tombe. Risque terrible, mais il faut le courir, et même un moment sans espérance. Mais il ne faut pas s’y jeter.
Chapitre 4
Détachement
Pour atteindre le détachement total, le malheur ne suffit pas. Il faut un malheur sans consolation. Il ne faut pas avoir de consolation. Aucune consolation représentable. La consolation ineffable descend alors.
Remettre les dettes. Accepter le passé, sans demander de compensation à l’avenir. Arrêter le temps à l’instant. C’est aussi l’acceptation de la mort.
« Il s’est vidé de sa divinité. » Se vider du monde. Revêtir la nature d’un esclave. Se réduire au point qu’on occupe dans l’espace et dans le temps. À rien.
Se dépouiller de la royauté imaginaire du monde. Solitude absolue. Alors on a la vérité du monde.
Deux manières de renoncer aux biens matériels
S’en priver en vue d’un bien spirituel.
Les concevoir et les sentir comme conditions de biens spirituels (exemple : la faim, la fatigue, l’humiliation obscurcissent l’intelligence et gênent la méditation) et néanmoins y renoncer.
Cette deuxième espèce de renoncement est seule nudité d’esprit.
Bien plus, les biens matériels seraient à peine dangereux s’ils apparaissaient seuls et non liés à des biens spirituels.
Renoncer à tout ce qui n’est pas la grâce et ne pas désirer la grâce.
L’extinction du désir (bouddhisme) ou le détachement — ou l’amor fati — ou le désir du bien absolu, c’est toujours la même chose : vider le désir, la finalité de tout contenu, désirer à vide, désirer sans souhait.
Détacher notre désir de tous les biens et attendre. L’expérience prouve que cette attente est comblée. On touche alors le bien absolu.
En tout, par-delà l’objet particulier quel qu’il soit, vouloir à vide, vouloir le vide. Car c’est un vide pour nous que ce bien que nous ne pouvons ni nous représenter ni définir. Mais ce vide est plus plein que tous les pleins.
Si on arrive là, on est tiré d’affaire, car Dieu comble le vide. Il ne s’agit nullement d’un processus intellectuel, au sens où nous l’entendons aujourd’hui. L’intelligence n’a rien à trouver, elle a à déblayer. Elle n’est bonne qu’aux tâches serviles.
Le bien est pour nous un néant puisque aucune chose n’est bonne. Mais ce néant n’est pas irréel. Tout ce qui existe, comparé à lui, est irréel.
Écarter les croyances combleuses de vides, adoucisseuses des amertumes. Celle à l’immortalité. Celle à l’utilité des péchés : etiam peccata. Celle à l’ordre providentiel des événements — bref les « consolations » qu’on recherche ordinairement dans la religion.
Aimer Dieu à travers la destruction de Troie et de Carthage, et sans consolation. L’amour n’est pas consolation, il est lumière.
La réalité du monde est faite par nous de notre attachement. C’est la réalité du moi transportée par nous dans les choses. Ce n’est nullement la réalité extérieure. Celle-ci n’est perceptible que par le détachement total. Ne restât-il qu’un fil, il y a encore attachement.
Le malheur qui contraint à porter l’attachement sur des objets misérables met à nu le caractère misérable de l’attachement. Par là, la nécessité du détachement devient plus claire.
L’attachement est fabricateur d’illusions, et quiconque veut le réel doit être détaché.
Dès qu’on sait que quelque chose est réel, on ne peut plus y être attaché.
L’attachement n’est pas autre chose que l’insuffisance dans le sentiment de la réalité. On est attaché à la possession d’une chose parce qu’on croit que si on cesse de la posséder, elle cesse d’être. Beaucoup de gens ne sentent pas avec toute leur âme qu’il y a une différence du tout au tout entre l’anéantissement d’une ville et leur exil irrémédiable hors de cette ville.
La misère humaine serait intolérable si elle n’était diluée dans le temps.
Empêcher qu’elle se dilue pour qu’elle soit intolérable.
« Et quand ils se furent rassasiés de larmes » (Iliade) - encore un moyen de rendre la pire souffrance tolérable.
Il ne faut pas pleurer pour ne pas être consolé.
Toute douleur qui ne détache pas est de la douleur perdue. Rien de plus affreux, froid désert, âme recroquevillée. Ovide. Esclaves de Plaute.
Ne jamais penser à une chose ou à un être qu’on aime et qu’on n’a pas sous les yeux sans songer que peut-être cette chose est détruite ou que cet être est mort.
Que cette pensée ne dissolve pas le sentiment de la réalité, mais le rende plus intense.
Chaque fois qu’on dit : « Que ta volonté soit faite », se représenter dans leur ensemble tous les malheurs possibles.
Deux manières de se tuer : suicide ou détachement.
Tuer par la pensée tout ce qu’on aime : seule manière de mourir. Mais seulement ce qu’on aime. (Celui qui ne hait pas son père, sa mère… Mais : aimez vos ennemis…)
Ne pas désirer que ce qu’on aime soit immortel. Devant un être humain, quel qu’il soit, ne le désirer ni immortel ni mort.
L’avare, par désir de son trésor, s’en prive. Si l’on peut mettre tout son bien dans une chose cachée dans la terre, pourquoi pas en Dieu ?
Mais quand Dieu est devenu aussi plein de signification que le trésor pour l’avare, se répéter fortement qu’il n’existe pas. Éprouver qu’on l’aime, même s’il n’existe pas.
C’est lui qui, par l’opération de la nuit obscure, se retire afin de ne pas être aimé comme un trésor par un avare.
Electre pleurant Oreste mort. Si on aime Dieu en pensant qu’il n’existe pas, il manifestera son existence.
Chapitre 5
L'imagination combleuse
L’imagination travaille continuellement à boucher toutes les fissures par où passerait la grâce.
Tout vide (non accepté) produit de la haine, de l’aigreur, de l’amertume, de la rancune. Le mal qu’on souhaite à ce qu’on hait, et qu’on imagine, rétablit l’équilibre.
Les miliciens du « Testament espagnol » qui inventaient des victoires pour supporter de mourir, exemple de l’imagination combleuse de vide. Quoiqu’on ne doive rien gagner à la victoire, on supporte de mourir pour une cause qui sera victorieuse, non pour une cause qui sera vaincue. Pour quelque chose d’absolument dénué de force, ce serait surhumain (disciples du Christ). La pensée de la mort appelle un contrepoids, et ce contrepoids — la grâce mise à part — ne peut être qu’un mensonge.
L’imagination combleuse de vides est essentiellement menteuse. Elle exclut la troisième dimension, car ce sont seulement les objets réels qui sont dans les trois dimensions. Elle exclut les rapports multiples.
Essayer de définir les choses qui, tout en se produisant effectivement, restent en un sens imaginaires. Guerre. Crimes. Vengeances. Malheur extrême.
Les crimes, en Espagne, se commettaient effectivement et pourtant ressemblaient à de simples vantardises.
Réalités qui n’ont pas plus de dimensions que le rêve.
Dans le mal, comme dans le rêve, il n’y a pas de lectures multiples. D’où la simplicité des criminels.
Crimes plats comme des rêves des deux côtés : côté du bourreau et côté de la victime. Quoi de plus affreux que de mourir dans un cauchemar ?
Compensations. Marius imaginait la vengeance future. Napoléon songeait à la postérité. Guillaume Il désirait une tasse de thé. Son imagination n’était pas assez fortement accrochée à la puissance pour traverser les années : elle se tournait vers une tasse de thé.
Adoration des grands par le peuple au XVIIe siècle (La Bruyère). C’était un effet de l’imagination combleuse de vides, effet évanoui depuis que l’argent s’y est substitué. Deux effets bas, mais l’argent plus encore.
Dans n’importe quelle situation, si on arrête l’imagination combleuse, il y a vide (pauvres en esprit).
Dans n’importe quelle situation (mais, dans certaines, au prix de quel abaissement !) l’imagination peut combler le vide. C’est ainsi que les êtres moyens peuvent être prisonniers, esclaves, prostituées, et traverser n’importe quelle souffrance sans purification.
Continuellement suspendre en soi-même le travail de l’imagination combleuse de vides.
Si on accepte n’importe quel vide, quel coup du sort peut empêcher d’aimer l’univers ?
On est assuré que, quoi qu’il arrive, l’univers est plein.
Chapitre 6
Renoncement au temps
Le temps est une image de l’éternité, mais c’est aussi un ersatz de l’éternité.
L’avare à qui on a pris son trésor. C’est du passé gelé qu’on lui enlève. Passé et avenir, les seules richesses de l’homme.
Avenir combleur de vides. Parfois aussi le passé joue ce rôle (j’étais, j’ai fait…) Dans d’autres cas, le malheur rend la pensée du bonheur intolérable ; il prive alors le malheureux de son passé (nessum maggior dolore...).
Le passé et l’avenir entravent l’effet salutaire de malheur en fournissant un champ illimité pour des élévations imaginaires. C’est pourquoi le renoncement au passé et à l’avenir est le premier des renoncements.
Le présent ne reçoit pas la finalité. L’avenir non plus, car il est seulement ce qui sera présent. Mais on ne le sait pas. Si on porte sur le présent la pointe de ce désir en nous qui correspond à la finalité, elle perce à travers jusqu’à l’éternel.
C’est là l’usage du désespoir qui détourne de l’avenir.
Quand on est déçu par un plaisir qu’on attendait et qui vient, la cause de la déception, c’est qu’on attendait de l’avenir. Et une fois qu’il est là, c’est du présent. Il faudrait que l’avenir fût là sans cesser d’être l’avenir. Absurdité dont seule l’éternité guérit.
Le temps et la caverne. Sortir de la caverne, être détaché consiste à ne plus s’orienter vers l’avenir.
Un mode de purification : prier Dieu, non seulement en secret par rapport aux hommes, mais en pensant que Dieu n’existe pas.
Piété à l’égard des morts : tout faire pour ce qui n’existe pas.
La douleur de la mort d’autrui, c’est cette douleur du vide, du déséquilibre. Efforts désormais sans objet, donc sans récompense. Si l’imagination y supplée, abaissement. « Laisse les morts enterrer leurs morts. » Et sa propre mort, n’en est-il pas de même ? L’objet, la récompense sont dans l’avenir. Privation d’avenir, vide, déséquilibre. C’est pourquoi « philosopher, c’est apprendre à mourir ». C’est pourquoi « prier est comme une mort ».
Quand la douleur et l’épuisement arrivent au point de faire naître dans l’âme le sentiment de la perpétuité ; en contemplant cette perpétuité avec acceptation et amour, on est arraché jusqu’à l’éternité.
Chapitre 7
Désirer sans objet
La purification est la séparation du bien et de la convoitise.
Descendre à la source des désirs pour arracher l’énergie à son objet. C’est là que les désirs sont vrais en tant qu’énergie. C’est l’objet qui est faux. Mais arrachement indicible dans l’âme à la séparation d’un désir et de son objet.
Si l’on descend en soi-même, on trouve qu’on possède exactement ce qu’on désire.
Si l’on désire tel être (mort), on désire un être particulier, limité ; c’est donc nécessairement un mortel, et on désire cet être-là, cet être qui… que… etc., bref, cet être qui est mort, tel jour, à telle heure. Et on l’a — mort.
Si on désire de l’argent, on désire une monnaie (institution), quelque chose qui ne peut être acquis que dans telle ou telle condition, donc on ne le désire que dans la mesure où… Or, dans cette mesure, on l’a.
La souffrance, le vide sont en de tels cas le mode d’existence des objets du désir. Qu’on écarte le voile d’irréalité et on verra qu’ils nous sont donnés ainsi.
Quand on le voit, on souffre encore, mais on est heureux.
Arriver à savoir exactement ce qu’a perdu l’avare à qui on a volé son trésor ; on apprendrait beaucoup.
Lauzun et la charge de capitaine de mousquetaires. Il aimait mieux être prisonnier et capitaine de mousquetaires que libre et non capitaine.
Ce sont des vêtements. « Ils eurent honte d’être nus. »
Perdre quelqu’un : on souffre que le mort, l’absent soit devenu de l’imaginaire, du faux. Mais le désir qu’on a de lui n’est pas imaginaire. Descendre en soi-même, où réside le désir qui n’est pas imaginaire. Faim : on imagine des nourritures, mais la faim elle-même est réelle : se saisir de la faim. La présence du mort est imaginaire mais son absence est bien réelle ; elle est désormais sa manière d’apparaître.
Il ne faut pas chercher le vide, car ce serait tenter Dieu que de compter sur le pain surnaturel pour le combler.
Il ne faut pas non plus le fuir.
Le vide est la plénitude suprême, mais l’homme n’a pas le droit de le savoir. La preuve est que le Christ lui-même l’a ignoré complètement, un moment. Une partie de moi doit le savoir, mais les autres non, car si elles le savaient à leur basse manière, il n’y aurait plus de vide.
Le Christ a eu toute la misère humaine, sauf le péché. Mais il a eu tout ce qui rend l’homme capable de péché. Ce qui rend l’homme capable de péché, c’est le vide. Tous les péchés sont des tentatives pour combler des vides. Ainsi ma vie pleine de souillures est proche de la sienne parfaitement pure, et de même pour les vies beaucoup plus basses. Si bas que je tombe, je ne m’éloignerai pas beaucoup de lui. Mais cela, si je tombe, je ne pourrai plus le savoir.
Poignée de main d’un ami revu après une longue absence. Je ne remarque même pas si c’est pour le sens du toucher un plaisir ou une douleur : comme l’aveugle sent directement les objets au bout de son bâton, je sens directement la présence de l’ami. De même les circonstances de la vie, quelles qu’elles soient, et Dieu.
Cela implique qu’il ne faut jamais chercher une consolation à la douleur. Car la félicité est au-delà du domaine de la consolation et de la douleur. Elle est perçue avec un autre sens, comme la perception des objets au bout d’un bâton ou d’un instrument est autre que le toucher proprement dit. Cet autre sens se forme par le déplacement de l’attention au moyen d’un apprentissage où l’âme tout entière et le corps participent.
C’est pourquoi dans l’Évangile : « Je vous dis que ceux-là ont reçu leur salaire. » Il ne faut pas de compensation. C’est le vide dans la sensibilité qui porte au-delà de la sensibilité.
Reniement de saint Pierre. Dire au Christ : je te resterai fidèle, c’est déjà le renier, car c’était supposer en soi et non dans la grâce la source de la fidélité. Heureusement, comme il était élu, ce reniement est devenu manifeste pour tous et pour lui. Chez combien d’autres, de telles vantardises s’accomplissent - et ils ne comprennent jamais.
Il était difficile d’être fidèle au Christ. C’était une fidélité à vide. Bien plus facile d’être fidèle jusqu’à la mort à Napoléon. Bien plus facile pour les martyrs, plus tard, d’être fidèles, car il y avait déjà l’Église, une force, avec des promesses temporelles. On meurt pour ce qui est fort, non pour ce qui est faible, ou du moins pour ce qui, étant momentanément faible, garde une auréole de force. La fidélité à Napoléon à Sainte-Hélène n’était pas une fidélité à vide. Mourir pour ce qui est fort fait perdre à la mort son amertume. Et, en même temps, tout son prix.
Supplier un homme, c’est une tentative désespérée pour faire passer à force d’intensité son propre système de valeurs dans l’esprit d’un autre. Supplier Dieu, c’est le contraire : tentative pour faire passer les valeurs divines dans sa propre âme. Loin de penser le plus intensément qu’on peut les valeurs auxquelles on est attaché, c’est un vide intérieur.
Chapitre 8
Le moi
Nous ne possédons rien au monde — car le hasard peut tout nous ôter — sinon le pouvoir de dire je. C’est cela qu’il faut donner à Dieu, c’est-à-dire détruire. Il n’y a absolument aucun autre acte libre qui nous soit permis, sinon la destruction du je.
Offrande : on ne peut pas offrir autre chose que le je, et tout ce qu’on nomme offrande n’est pas autre chose qu’une étiquette posée sur une revanche du je.
Rien au monde ne peut nous enlever le pouvoir de dire je. Rien, sauf l’extrême malheur. Rien n’est pire que l’extrême malheur qui du dehors détruit le je, puisque dès lors on ne peut plus le détruire soi-même. Qu’arrive-t-il à ceux dont le malheur a détruit du dehors le je ? On ne peut se représenter pour eux que l’anéantissement à la manière de la conception athée ou matérialiste.
Qu’ils aient perdu le je, cela ne veut pas dire qu’ils n’aient plus d’égoïsme. Au contraire. Certes, cela arrive quelquefois, quand il se produit un dévouement de chien. Mais d’autres fois l’être est au contraire réduit à l’égoïsme nu, végétatif. Un égoïsme sans je.
Pour peu qu’on ait commencé le processus de destruction du je, on peut empêcher qu’aucun malheur fasse du mal. Car le je n’est pas détruit par la pression extérieure sans une extrême révolte. Si on se refuse à cette révolte par amour pour Dieu, alors la destruction du je ne se produit pas du dehors, mais du dedans.
Douleur rédemptrice. Quand l’être humain est dans l’état de perfection, quand par le secours de la grâce, il a complètement détruit en lui-même le je, alors il tombe au degré de malheur qui correspondrait pour lui à la destruction du je par l’extérieur, c’est là la plénitude de la croix. Le malheur ne peut plus en lui détruire le je, car le je en lui n’existe plus, ayant entièrement disparu et laissé la place à Dieu. Mais le malheur produit un effet équivalent, sur le plan de la perfection, à la destruction extérieure du je. Il produit l’absence de Dieu. « Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
Qu’est-ce que cette absence de Dieu produite par l’extrême malheur dans l’âme parfaite ? Quelle est cette valeur qui y est attachée et qu’on nomme douleur rédemptrice ?
La douleur rédemptrice est ce par quoi le mal a réellement la plénitude de l’être dans toute la mesure où il peut la recevoir.
Par la douleur rédemptrice, Dieu est présent dans le mal extrême. Car l’absence de Dieu est le mode de présence divine qui correspond au mal - l’absence ressentie. Celui qui n’a pas Dieu en lui ne peut pas en ressentir l’absence.
C’est la pureté, la perfection, la plénitude, l’abîme du mal. Tandis que l’enfer est un faux abîme (cf. Thibon). L’enfer est superficiel. L’enfer est du néant qui a la prétention et donne l’illusion d’être.
La destruction purement extérieure du je est douleur quasi infernale. La destruction extérieure à laquelle l’âme s’associe par amour est douleur expiatrice, La production d’absence de Dieu dans l’âme complètement vidée d’elle-même par amour est douleur rédemptrice.
Dans le malheur, l’instinct vital survit aux attachements arrachés et s’accroche aveuglément à tout ce qui peut lui servir de support, comme une plante accroche ses vrilles. La reconnaissance (sinon sous une forme basse), la justice ne sont pas concevables dans cet état. Esclavage. Il n’y a plus la quantité supplémentaire d’énergie qui sert de support au libre arbitre, au moyen de laquelle l’homme prend de la distance. Le malheur, sous cet aspect, est hideux comme l’est toujours la vie à nu, comme un moignon, comme le grouillement des insectes. La vie sans forme. Survivre est là l’unique attachement. C’est là que commence l’extrême malheur, quand tous les attachements sont remplacés par celui de survivre. L’attachement apparaît là à nu. Sans autre objet que soi-même. Enfer.
C’est par ce mécanisme que rien ne semble plus doux aux malheureux que la vie, alors même que leur vie n’est en rien préférable à la mort.
Dans cette situation, accepter la mort, c’est le détachement total.
Quasi-enfer sur terre. Le déracinement extrême dans le malheur.
L’injustice humaine fabrique généralement non pas des martyrs, mais des quasi-damnés. Les êtres tombés dans le quasi-enfer sont comme l’homme dépouillé et blessé par des voleurs. Ils ont perdu le vêtement du caractère.
La plus grande souffrance qui laisse subsister des racines est encore à une distance infinie du quasi-enfer.
Quand on rend service à des êtres ainsi déracinés et qu’on reçoit en échange des mauvais procédés, de l’ingratitude, de la trahison, on subit simplement une faible part de leur malheur. On a le devoir de s’y exposer, dans une mesure limitée, comme on a le pouvoir de s’exposer au malheur. Quand cela se produit, on doit le supporter comme on supporte le malheur, sans rattacher cela à des personnes déterminées, car cela ne s’y rattache pas. Il y a quelque chose d’impersonnel dans le malheur quasi infernal comme dans la perfection.
Pour ceux dont le je est mort, on ne peut rien faire, absolument rien. Mais on ne sait jamais si, chez un être humain déterminé, le je est tout à fait mort ou seulement inanimé. S’il n’est pas tout à fait mort, l’amour peut le ranimer comme par une piqûre, mais seulement l’amour tout à fait pur, sans la moindre trace de condescendance, car la moindre nuance de mépris précipite vers la mort.
Quand le je est blessé du dehors, il a d’abord la révolte la plus extrême, la plus amère, comme un animal qui se débat. Mais dès que le je est à moitié mort, il désire être achevé et se laisse aller à l’évanouissement. Si alors une touche d’amour le réveille, c’est une douleur extrême et qui produit la colère et parfois la haine contre celui qui a provoqué cette douleur. De là chez les êtres déchus, ces réactions en apparence inexplicables de vengeance contre le bienfaiteur.
Il arrive aussi que chez le bienfaiteur l’amour ne soit pas pur. Alors le je, réveillé par l’amour recevant aussitôt une nouvelle blessure par le mépris, il surgit la haine la plus amère, haine légitime.
Celui chez qui le je est tout à fait mort au contraire, n’est aucunement gêné par l’amour qu’on lui témoigne. Il se laisse faire comme les chiens et les chats qui reçoivent de la nourriture, de la chaleur et des caresses et, comme eux, il est avide d’en recevoir le plus possible. Selon les cas, il s’attache comme un chien ou se laisse faire avec une espèce d’indifférence comme un chat. Il boit sans le moindre scrupule toute l’énergie de quiconque s’occupe de lui.
Par malheur, toute œuvre charitable risque d’avoir comme clients une majorité de gens sans scrupule ou surtout des êtres dont le je est tué.
Le je est d’autant plus vite tué que celui qui subit le malheur a un caractère plus faible. Plus exactement, le malheur limite, le malheur destructeur du je se situe plus ou moins loin suivant la trempe du caractère, et plus il se situe loin, plus on dit que le caractère est fort.
La situation plus ou moins éloignée de cette limite est — probablement un fait de nature comme la facilité pour les mathématiques, et celui qui, n’ayant aucune foi, est fier d’avoir gardé un « bon moral » dans des circonstances difficiles n’a pas plus raison que l’adolescent qui s’enorgueillit d’avoir de la facilité pour les mathématiques. Celui qui croit en Dieu court le danger d’une illusion plus grande encore, à savoir d’attribuer à la grâce ce qui est simplement un effet de nature essentiellement mécanique.
L’angoisse de l’extrême malheur est la destruction extérieure du je. Arnolphe, Phèdre, Lycaon. On a raison de se jeter à genoux, de supplier bassement, quand la mort violente qui va s’abattre doit tuer du dehors le je avant même que la vie soit détruite.
« Niobé aussi aux beaux cheveux a pensé à manger. » Cela est sublime à la manière de l’espace dans les fresques de Giotto.
Une humiliation qui force à renoncer même au désespoir.
Le péché en moi dit « je ».
Je suis tout. Mais ce « je » là est Dieu. Et ce n’est pas un je.
Le mal fait la distinction, empêche que Dieu soit équivalent à tout.
C’est ma misère qui fait que je suis je. C’est la misère de l’univers qui fait que, en un sens, Dieu est je (c’est-à-dire une personne).
Les Pharisiens étaient des gens qui comptaient sur leur propre force pour être vertueux.
L’humilité consiste à savoir qu’en ce qu’on nomme « je » il n’y a aucune source d’énergie qui permette de s’élever.
Tout ce qui est précieux en moi, sans exception, vient d’ailleurs que de moi, non pas comme don, mais comme prêt qui doit être sans cesse renouvelé. Tout ce qui est en moi, sans exception, e st absolument sans valeur ; et, parmi les dons venus d’ailleurs, tout ce que je m’approprie devient aussitôt sans valeur.
La joie parfaite exclut le sentiment même de joie, car dans l’âme emplie par l’objet, nul coin n’est disponible pour dire « je ».
On n’imagine pas de telles joies quand elles sont absentes, ainsi le stimulant manque pour les chercher.
Chapitre 9
Décréation
Décréation : faire passer du créé dans l’incréé.
Destruction : faire passer du créé dans le néant. Ersatz coupable de la décréation.
La création est un acte d’amour et elle est perpétuelle. À chaque instant notre existence est amour de Dieu pour nous. Mais Dieu ne peut aimer que soi-même. Son amour pour nous est amour pour soi à travers nous. Ainsi, lui qui nous donne l’être, il aime en nous le consentement à ne pas être.
Notre existence n’est faite que de son attente, de notre consentement à ne pas exister.
Perpétuellement, il mendie auprès de nous cette existence qu’il nous donne. Il nous la donne pour nous la mendier.
L’inflexible nécessité, la misère, la détresse, le poids écrasant du besoin et du travail qui épuise, la cruauté, les tortures la mort violente, la contrainte, la terreur, les maladies — tout cela c’est l’amour divin. C’est Dieu qui par amour se retire de nous afin que nous puissions l’aimer, Car si nous étions exposés au rayonnement direct de son amour, sans la protection de l’espace, du temps et de la matière, nous serions évaporés comme l’eau au soleil ; il n’y aurait pas assez de je en nous Pour abandonner le je par amour. La nécessité est l’écran mis entre Dieu et nous pour que nous puissions être. C’est à nous de percer l’écran pour cesser d’être.
Il existe une force « déifuge ». Sinon tout serait Dieu.
Il a été donné à l’homme une divinité imaginaire pour qu’il puisse s’en dépouiller comme le Christ de sa divinité réelle.
Renoncement. Imitation du renoncement de Dieu dans la création. Dieu renonce — en un sens — à être tout. Nous devons renoncer à être quelque chose. C’est le seul bien pour nous.
Nous sommes des tonneaux sans fond tant que nous n’avons pas compris que nous avons un fond.
Élévation et abaissement. Une femme qui se regarde dans un miroir et se pare ne sent pas la honte de réduire soi, cet être infini qui regarde toutes choses, à un petit espace. De même toutes les fois qu’on élève le moi (le moi social, psychologique, etc.) si haut qu’on l’élève, on se dégrade infiniment en se réduisant à n’être que cela. Quand le moi est abaissé (à moins que l’énergie ne tende à l’élever en désir), on sait qu’on n y est pas cela.
Une très belle femme qui regarde son image au miroir peut très bien croire qu’elle est cela. Une femme laide sait qu’elle n’est pas cela.
Tout ce qui est saisi par les facultés naturelles est hypothétique. Seul l’amour surnaturel pose. Ainsi nous sommes cocréateurs.
Nous participons à la création du monde en nous décréant nous-mêmes.
On ne possède que ce à quoi on renonce. Ce à quoi on ne renonce pas nous échappe. En ce sens, on ne peut posséder quoi que ce soit sans passer par Dieu.
Communion catholique. Dieu ne s’est pas seulement fait une fois chair, il se fait tous les jours matière pour se donner à l’homme et en être consommé. Réciproquement, par la fatigue, le malheur, la mort, l’homme est fait matière et consommé par Dieu. Comment refuser cette réciprocité ?
Il s’est vidé de sa divinité. Nous devons nous vider de la fausse divinité avec laquelle nous sommes nés.
Une fois qu’on a compris qu’on n’est rien, le but de tous les efforts est de devenir rien. C’est à cette fin qu’on souffre avec acceptation, c’est à cette fin qu’on agit, c’est à cette fin qu’on prie.
Mon Dieu, accordez-moi de devenir rien.
À mesure que je deviens rien, Dieu s’aime à travers moi.
Ce qui est en bas ressemble à ce qui est en haut. Par à l’esclavage est une image de l’obéissance à Dieu, l’humiliation une image de l’humilité, la nécessité physique une image de la poussée irrésistible de la grâce, l’abandon des saints au jour le jour une image du morcellement du temps chez les criminels et les prostituées, etc.
À ce titre, il faut rechercher ce qui est le plus bas, à titre d’image.
Que ce qui en nous est bas aille vers le bas afin que ce qui est haut puisse aller en haut. Car nous sommes retournés. Nous naissons tels. Rétablir l’ordre, c’est défaire en nous la créature.
Retournement de l’objectif et du subjectif.
De même, retournement du positif et du négatif. C’est aussi le sens de la philosophie des Upanishads.
Nous naissons et vivons à contresens, car nous naissons et vivons dans le péché qui est un renversement de la hiérarchie. La première opération est le retournement. La conversion.
Si le grain ne meurt… Il doit mourir pour libérer l’énergie qu’il porte en lui afin qu’il s’en forme d’autres combinaisons.
De même nous devons mourir pour libérer l’énergie attachée, pour posséder une énergie libre susceptible d’épouser le vrai rapport des choses.
L’extrême difficulté que j’éprouve souvent à exécuter la moindre action est une faveur qui m’est faite. Car ainsi, avec des actions ordinaires et sans attirer l’attention, je peux couper des racines de l’arbre. Si détaché qu’on soit de l’opinion, les actions extraordinaires enferment un stimulant qu’on ne peut pas en ôter. Ce stimulant est tout à fait absent des actions ordinaires. Trouver une difficulté extraordinaire à faire une action ordinaire est une faveur dont il faut être reconnaissant. Il ne faut pas demander la disparition de cette difficulté ; il faut implorer la grâce d’en faire usage.
D’une manière générale, ne souhaiter la disparition d’aucune de ses misères, mais la grâce qui les transfigure.
Les souffrances physiques (et les privations) sont souvent pour les hommes courageux une épreuve d’endurance et de force d’âme. Mais il en est un meilleur usage. Qu’elles ne soient donc pas cela pour moi. Qu’elles soient un témoignage sensible de la misère humaine. Que je les subisse d’une manière entièrement passive. Quoi qu’il arrive, comment pourrais-je jamais trouver le malheur trop grand, puisque la morsure du malheur et l’abaissement auquel il condamne permettent la connaissance de la misère humaine, connaissance qui est la porte de toute sagesse ?
Mais le plaisir, le bonheur, la prospérité, si on sait y reconnaître ce qui vient du dehors (du hasard, des circonstances, etc.), témoignent aussi de la misère humaine. En faire aussi cet usage. Et même la grâce, en tant que phénomène sensible…
Etre rien pour être à sa vraie place dans le tout.
Le renoncement exige qu’on passe par des angoisses équivalentes à celles que causerait en réalité la perte de tous les êtres chers et de tous les biens, y compris les facultés et acquisitions dans l’ordre de l’intelligence et du caractère, les opinions et les croyances sur ce qui est bien et ce qui est stable, etc. Et tout cela il ne faut pas se l’ôter soi-même, mais le perdre — comme Job. Mais l’énergie ainsi coupée de son objet ne doit pas être gaspillée en oscillations, dégradée. L’angoisse doit donc être plus grande encore que dans le malheur réel, elle ne doit pas être morcelée au long du temps ni dirigée vers une espérance.
Quand la passion de l’amour va jusqu’à l’énergie végétative, alors on a des cas comme Phèdre, Arnolphe, etc. « Et je sens là dedans qu’il faudra que je crève… »
Hippolyte est vraiment plus nécessaire à la vie de Phèdre, au sens le plus littéral, que la nourriture.
Pour que l’amour de Dieu pénètre aussi bas, il faut que la nature ait subi la dernière violence. Job, croix…
L’amour de Phèdre, d’Arnolphe est impur. Un amour qui descendrait aussi bas et qui serait pur…
Devenir rien jusqu’au niveau végétatif ; c’est alors que Dieu devient du pain.
Si nous nous considérons à un moment déterminé — l’instant présent, coupé du passé et de l’avenir — nous sommes innocents. Nous ne pouvons être à cet instant que ce que nous sommes : tout progrès implique une durée. Il est dans l’ordre du monde, à cet instant, que nous soyons tels.
Isoler ainsi un instant implique le pardon. Mais cet isolement est détachement.
Il n’y a que deux instants de nudité et de pureté parfaites dans la vie humaine : la naissance et la mort. On ne peut adorer Dieu sous la forme humaine sans souiller la divinité que comme nouveau-né et comme agonisant.
Mort. État instantané, sans passé ni avenir. Indispensable pour l’accès à l’éternité.
Si on trouve la plénitude de la joie dans la pensée que Dieu est, il faut trouver la même plénitude dans la connaissance que soi-même on n’est pas, car c’est la même pensée. Et cette connaissance n’est étendue à la sensibilité que par la souffrance et la mort.