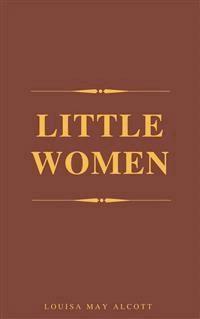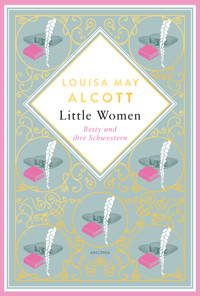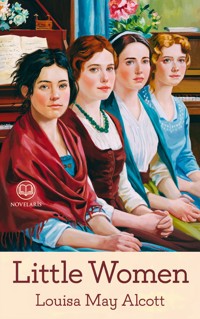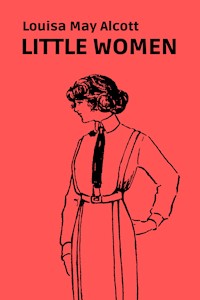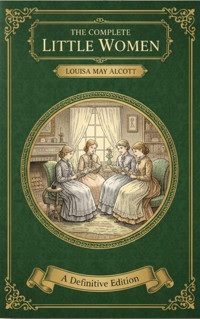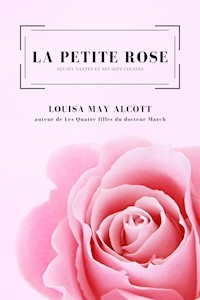
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alicia Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Louisa May Alcott est une grande romancière américaine connue notamment pour son livre
Les Quatre Filles du Docteur March (Little Women) qui a fait l’objet de multiples adaptations au cinéma, à la télévision et même en dessins animés.
Dans ce livre, elle nous raconte l’histoire de Rose, jeune orpheline de 12 ans, confiée à son oncle, le Dr Alexandre Campbell (oncle Alec). En attendant que celui-ci revienne de Chine, ses tantes, Miss Prudence et Miss Patience essayent d’apprivoiser la petite malheureuse qui vit emmurée dans sa peine et ne quitte plus sa chambre. Quand son oncle Alec rentre enfin, il découvre l’état déplorable de sa protégée, il décide avec l’aide de ses six tantes et de ses sept cousins de lui redonner goût à la vie. Grâce à cette nouvelle famille étonnante, pleine d’imagination, de curiosités, faisant preuve d’un courage rare et partageant ses facéties, ses joies et ses émotions, la jeune Rose ne connaîtra plus jamais l’ennui et va peu à peu s’ouvrir à sa nouvelle vie…
Ce roman sur l’amour, la mort, le chagrin et la renaissance nous offre une très belle leçon de vie et d’espérance.
EXTRAIT : « La pauvre petite Rose Campbell s’était réfugiée un jour dans le grand salon de ses tantes, afin de rêver à ses chagrins, sans crainte d’être dérangée par personne. Elle éprouvait une sorte de joie amère à pleurer, et, sachant par expérience que ses larmes n’allaient pas tarder à couler, elle tenait déjà son mouchoir à la main pour les essuyer. Son petit corps frêle et maladif était comme perdu dans les profondeurs d’un vaste fauteuil ; ses grands yeux bleus, légèrement cernés, regardaient sans les voir les objets qui l’entouraient, et sa figure pâle avait une expression douloureuse au-dessus de son âge. Il faut avouer que, si Rose souhaitait la tristesse, elle ne pouvait choisir une retraite plus convenable. Ce grand salon sombre et froid, avec ses rideaux baissés, ses lourdes tentures, son mobilier antique et sa galerie de vieux portraits de famille, était un endroit propice aux tristes rêveries. Son aspect seul engendrait la mélancolie, et la pluie qui fouettait sans relâche les fenêtres semblait dire à la petite affligée : « Pleurez ! pleurez ! Je pleure avec vous ! »
Pauvre Rose ! ses réflexions ne pouvaient pas être gaies. Elle n’avait jamais connu sa mère, morte quelques mois après sa naissance, et son père lui avait été enlevé l’année précédente après une longue et cruelle maladie. Elle portait encore ses vêtements de deuil, qui faisaient ressortir son extrême pâleur. Cependant, l’orpheline ne restait pas seule au monde. Elle possédait une très nombreuse famille d’oncles, de tantes et de cousins ; mais, cette famille, elle ne la connaissait que fort peu, car elle avait toujours vécu loin d’elle, avec son père, dans une autre région des États-Unis. Aussi se trouvait-elle comme une étrangère dans la maison de ses grand’tantes. À vrai dire, elle n’avait guère eu le temps de s’y habituer, car elle n’y était que depuis huit jours. »
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
La petite Rose
ses six tantes et ses sept cousins
Louisa May Alcott
Traduction parPierre-Jules Hetzel
Alicia Editions
Table des matières
1. Rose et Phœbé
2. Le Clan des Campbell
3. L’oncle Alec
4. Un échange
5. La chambre de l’oncle Alec
6. Une excursion en Chine
7. Nouvelles leçons
8. Le Secret de Phœbé
9. Le sacrifice de Rose
10. Pauvre Mac
11. Un triomphe
12. Dans les bois
13. Économie domestique
14. Une ligue. – Hygiène et physiologie
15. Sous le gui
16. Fausse alerte
17. Quelque chose à faire
18. Le trait d’union
19. Avec qui ?
20. Conclusion - Sept ans après
Rose et Phœbé
La pauvre petite Rose Campbell s’était réfugiée un jour dans le grand salon de ses tantes, afin de rêver à ses chagrins, sans crainte d’être dérangée par personne. Elle éprouvait une sorte de joie amère à pleurer, et, sachant par expérience que ses larmes n’allaient pas tarder à couler, elle tenait déjà son mouchoir à la main pour les essuyer. Son petit corps frêle et maladif était comme perdu dans les profondeurs d’un vaste fauteuil ; ses grands yeux bleus, légèrement cernés, regardaient sans les voir les objets qui l’entouraient, et sa figure pâle avait une expression douloureuse au-dessus de son âge. Il faut avouer que, si Rose souhaitait la tristesse, elle ne pouvait choisir une retraite plus convenable. Ce grand salon sombre et froid, avec ses rideaux baissés, ses lourdes tentures, son mobilier antique et sa galerie de vieux portraits de famille, était un endroit propice aux tristes rêveries. Son aspect seul engendrait la mélancolie, et la pluie qui fouettait sans relâche les fenêtres semblait dire à la petite affligée : « Pleurez ! pleurez ! Je pleure avec vous ! »
Pauvre Rose ! ses réflexions ne pouvaient pas être gaies. Elle n’avait jamais connu sa mère, morte quelques mois après sa naissance, et son père lui avait été enlevé l’année précédente après une longue et cruelle maladie. Elle portait encore ses vêtements de deuil, qui faisaient ressortir son extrême pâleur. Cependant, l’orpheline ne restait pas seule au monde. Elle possédait une très nombreuse famille d’oncles, de tantes et de cousins ; mais, cette famille, elle ne la connaissait que fort peu, car elle avait toujours vécu loin d’elle, avec son père, dans une autre région des États-Unis. Aussi se trouvait-elle comme une étrangère dans la maison de ses grand’tantes. À vrai dire, elle n’avait guère eu le temps de s’y habituer, car elle n’y était que depuis huit jours.
À son lit de mort, son père l’avait confiée à l’un de ses frères, le docteur Alexandre Campbell, que tous ses parents appelaient l’oncle Alec. Le docteur était alors en Chine, et on avait mis la petite fille en pension jusqu’au retour de son tuteur.
La vie de pension ne pouvait convenir à une enfant aussi délicate. Le chagrin très naturel qu’elle ressentait de la perte de son père, n’étant tempéré ni adouci par aucune affection sage et éclairée de la part de ceux qui l’entouraient, devint en quelque sorte morbide, et sa santé, déjà fortement ébranlée par tant d’épreuves, fut sérieusement menacée. Rose dépérissait à vue d’œil, et ses maîtresses, très inquiètes de la voir aussi maladive et craignant une grave responsabilité, avaient fait appel à sa famille.
En l’absence de son tuteur, c’était à miss Patience et à Prudence Campbell, ses deux grand’tantes, qu’incombait la charge de l’orpheline, et Rose vint habiter au manoir avec elles.
Une semaine entière s’était écoulée depuis lors ; mais, quoique les bonnes tantes eussent fait tous leurs efforts pour l’apprivoiser, elles avaient presque perdu leurs peines. Rose se trouvait l’être le plus malheureux du monde. On lui avait pourtant donné la permission de visiter la maison depuis la cave jusqu’au grenier. Or, c’était une sorte de vieux château rempli de surprises curieuses, de coins et de recoins mystérieux, d’escaliers dérobés et de chambres secrètes. Des fenêtres nombreuses s’ouvraient sur des points de vue merveilleux, tantôt sur la forêt commençant à reverdir, tantôt sur une montagne pittoresquement située, tantôt sur la ville de Newport, qui s’élevait au bord de la mer, ou sur l’Océan lui-même, qui formait un petit golfe au bas de l’immense jardin des dames Campbell. Des petits balcons perchés un peu partout, sans souci de la symétrie de l’architecture, donnaient au manoir un aspect des plus romantiques. Rose avait d’abord examiné tout cela avec intérêt ; mais elle s’en lassa vite, et on la surprit, à plusieurs reprises, la tête appuyée sur son bras et les yeux pleins de larmes amères. Alors tante Prudence avait poussé la générosité jusqu’à lui remettre la clef de deux pièces importantes. L’une était celle d’une longue galerie vitrée, véritable musée où l’on accumulait les curiosités rapportées de tous les coins du globe par les messieurs Campbell, marins depuis plusieurs générations.
L’autre ouvrait une grande office contenant les friandises que les enfants savent si bien apprécier. Hélas ! Rose avait regardé d’un œil aussi indifférent les bonbons et les confitures que les objets précieux de la galerie, et tante Prudence, désolée de sa tristesse, alla réclamer le concours de sa sœur.
Tante Patience, qui méritait bien son nom par la douceur angélique avec laquelle elle supportait les infirmités qui la retenaient clouée dans sa chambre, s’évertua à son tour à distraire sa nièce. Elle entreprit avec elle un ravissant trousseau de poupée qui eût certainement gagné le cœur de bien des petites filles plus âgées ; mais Rose n’aimait pas les poupées ; elle se souciait fort peu des robes rouges ou des chapeaux bleu de ciel qu’elle confectionnait, et tante Patience vit un jour de grosses larmes tomber une à une sur une magnifique robe de mariée en satin blanc. Le splendide trousseau fut relégué dans un carton, et personne ne parla de le continuer.
Après un grand conciliabule, les deux tantes, comme dernière ressource, imaginèrent de donner à leur nièce, pour l’amuser et lui tenir compagnie une petite fille du voisinage nommée Ariane Blish, citée partout comme un modèle. Ce fut encore pis : après le départ d’Ariane, Rose déclara que cette petite fille, qui ne remuait pas, qui ne parlait pas, qui se tenait bien droite sur sa chaise en répétant : oui, madame, non madame, ou merci, madame, ressemblait à s’y méprendre à une poupée, à une personne de cire, et qu’elle, Rose, avait failli la pincer, pour voir si quelque chose pouvait la faire sortir de son calme ou si son corps était bourré de son.
Cette fois, les grand’tantes abandonnèrent la partie et laissèrent Rose à ses propres ressources pendant trois ou quatre jours.
Il pleuvait presque continuellement, et Rose, très enrhumée, ne pouvait sortir. La plus grande partie de son temps se passait dans la bibliothèque, où l’on avait déposé les livres qui lui venaient de son père. Là, elle s’étendait sur un des sofas, pleurait un peu, lisait beaucoup et rêvait encore plus. C’était peut-être plus amusant pour elle, mais à coup sûr c’était mauvais pour sa santé. Elle devenait chaque jour plus pâle, plus maigre et plus énervée ; elle ne mangeait plus. Tante Patience avait beau l’embrasser et la consoler, et tante Prudence lui faire prendre du fer et du vin de quinquina, rien n’y faisait.
À force de se mettre l’esprit à la torture pour procurer des amusements à leur nièce, les pauvres tantes crurent enfin avoir trouvé ce qu’elles cherchaient ; mais elles se gardèrent bien d’en parler à Rose. Ce moyen infaillible de distraction pouvait fort bien ne pas être de son goût. Ce n’était ni plus ni moins que de charger les cousins de Rose, – au nombre de sept, – d’amuser leur petite cousine. Ah ! si les chères vieilles demoiselles avaient su combien leur nièce détestait les garçons, jamais elles n’eussent mis à exécution une pareille idée ! N’en sachant rien, elles envoyèrent à leurs neveux une invitation dans les règles pour le samedi suivant, jour de congé.
Ce même samedi, Rose, qui ne se doutait guère de ce que l’on tramait contre son repos, était, ainsi que nous venons de le dire, toute seule au salon et en proie à un de ses accès de mélancolie.
Elle n’avait pas encore eu le temps de verser une seule larme, qu’un bruit singulier vint subitement changer le cours de ses idées.
Elle se redressa dans son fauteuil et prêta l’oreille. Qu’était-ce donc ? Seulement un chant d’oiseau ; mais cet oiseau était extraordinairement doué, car son gazouillement devint successivement un sifflement perçant et un roucoulement plaintif. Sa voix passait sans effort des notes les plus graves aux notes les plus aiguës. C’étaient des trilles à n’en plus finir, puis une sorte de doux ramage qui se termina brusquement par un éclat de rire harmonieux.
Rose, oubliant son chagrin, se mit à rire aussi comme un joyeux écho et se leva vivement.
« C’est un oiseau moqueur, – se dit-elle, – ou peut-il être ? »
Elle courut à la porte du jardin, puis à celle de la cour. Rien. Le chant venait de l’intérieur de la maison.
« Est-ce qu’il serait dans la salle à manger ? » fit Rose tout étonnée.
Elle entra très doucement ; mais elle ne vit aucun autre oiseau que les colombes en chêne sculpté, qui, depuis plus d’un siècle, se becquetaient sur les panneaux du grand bahut.
« C’est trop fort ! s’écria l’enfant. Il est là, cependant, car je l’entends encore mieux que tout à l’heure… Ah ! il est dans la cuisine… Pas de bruit, ou il s’envolera !… »
Malgré les précautions infinies qu’elle prit pour ouvrir la porte de la cuisine, l’oiseau effarouché se tut aussitôt, et Rose n’aperçut plus qu’une fillette en robe d’indienne et en grand tablier bleu, qui, les bras nus jusqu’aux coudes et la robe relevée par deux épingles, frottait vigoureusement le plancher avec une brosse et du savon noir.
« Avez-vous entendu ce drôle d’oiseau ? lui demanda Rose. Savez-vous son nom ?
— On l’appelle Phœbé, répondit la petite fille avec un sourire plein de malice.
— Phœbé ? répéta Rose. Je n’ai jamais entendu parler d’un oiseau de ce nom. Quel dommage qu’il soit parti ! Il chantait si bien !
— Il n’est pas parti, reprit la fillette en jupons courts.
— Où est-il ?
— Dans mon gosier. Voulez-vous l’entendre encore ?
— Dans votre gosier ! s’écria Rose stupéfaite ; en êtes-vous sûre ? » Et, se perchant sur une table pour éviter les torrents de mousse de savon qui roulaient jusqu’à elle : « Oh ! oui, je voudrais l’entendre. »
La petite laveuse de plancher essuya ses mains mouillées après son tablier, se releva et se mit à chanter. Elle imita tour à tour le gazouillement du pinson, le sifflement de la mésange, le cri du geai, le chant de la fauvette et celui de bien d’autres oiseaux des bois, et termina comme la première fois par une explosion de notes joyeuses. En fermant les yeux, on se serait volontiers cru transporté dans une volière.
Rose, le regard fixe et la bouche ouverte, écoutait en extase ce concert improvisé.
« Bravo ! fit-elle à la fin. C’est ravissant. Où avez-vous appris à chanter comme cela ?
— Dans les bois, » répondit la jeune fille en se remettant à l’ouvrage avec une nouvelle ardeur.
Rose partit d’un éclat de rire.
« Alors, dit-elle, les oiseaux d’ici sont de bons maîtres, car je serais bien embarrassée d’en faire autant, moi qui ai pris des leçons des meilleurs professeurs de chant. Comment vous appelez-vous ?
— Phœbé Moore.
— Eh bien, Phœbé, je m’ennuie toute seule au salon ; si je ne vous gêne pas, je resterai ici un instant. Cela m’amuse de vous regarder.
— Oh ! vous ne me gênez pas du tout, mademoiselle, répondit Phœbé en tordant son torchon d’un air important.
— Comme cela doit être amusant de remuer le savon comme cela ! s’écria Rose. Pour un rien je vous aiderais !… mais tante Prudence n’en serait peut-être pas très contente, ajouta-t-elle après réflexion.
— Elle en serait très mécontente, répondit Phœbé, et elle n’aurait pas tort ; ce n’est pas votre affaire. Ne regrettez pas trop ce plaisir-là ; ce n’est pas, à beaucoup près, aussi amusant que vous le croyez, et vous en auriez bien vite assez. Allez, vous êtes mieux où vous êtes.
— Êtes-vous adroite ! continua Rose avec admiration… Vous devez joliment aider votre mère.
— Je n’ai ni père ni mère, dit Phœbé d’une voix triste.
— Alors où habitez-vous ?
— Ici même, depuis ce matin. La cuisinière cherchait une aide. On m’a prise à l’essai pendant huit jours. J’espère qu’on sera content de moi et qu’on me gardera.
— Je l’espère bien ! » s’écria Rose avec élan.
Elle avait déjà pris en amitié cette enfant qui chantait comme un oiseau et travaillait comme une femme.
« Si vous saviez comme je suis malheureuse ! » fit-elle d’un ton confidentiel.
Phœbé, très surprise, leva les yeux vers celle qui lui parlait ; elle ne comprenait pas comment on pouvait se trouver malheureuse quand on avait, comme Rose, une jolie robe de soie, un tablier brodé, un beau médaillon et un grand nœud de velours dans les cheveux.
« Je suis orpheline aussi, lui expliqua Rose.
— Êtes-vous pour longtemps chez vos tantes ? demanda Phœbé.
— Je ne sais pas. J’attends l’arrivée de mon tuteur ; c’est lui qui décidera. Est-ce que vous avez un tuteur, Phœbé ?
— Moi ? Oh ! non, mademoiselle. On m’a trouvée un jour à la porte de l’église quand je n’avais que quelques mois ; sans doute mes parents étaient trop pauvres pour me garder !… Une bonne dame charitable a eu pitié de moi ; elle m’a recueillie chez elle et a pris soin de moi jusqu’à présent, mais elle est morte depuis peu, et il faut que je travaille ; je ne m’en plains pas. Je suis d’âge à gagner ma vie.
— Quel âge avez-vous donc ?
— Entre onze et douze ans. On ne sait pas bien.
— Quelle histoire romanesque ! » s’écria Rose.
Le lavage terminé, Phœbé passa à un autre genre d’occupation. Elle prit un plat et un panier de haricots qu’elle éplucha avec prestesse.
Rose ne disait mot. Elle pensait, à part elle, que ce n’était pas gai de passer sa vie entière à travailler sans jamais avoir aucun plaisir.
« Vous avez dû beaucoup étudier, mademoiselle, lui dit alors Phœbé, qui trouvait probablement que c’était à son tour de questionner sa compagne.
— Je crois bien ! s’écria Rose. J’ai passé un an en pension et j’ai eu des leçons à n’en plus finir. Plus j’en apprenais, plus on m’en donnait. J’en avais la tête cassée. Mon pauvre papa ne ressemblait guère à ma maîtresse de pension ! Avec lui, je n’étais jamais fatiguée d’étudier… Ah ! nous étions bien heureux ensemble, nous nous aimions tant !… »
Les larmes, qui n’avaient pas voulu couler un quart d’heure avant dans le grand salon, jaillirent de ses yeux et roulèrent en abondance le long de ses joues pâles.
Phœbé cessa d’écosser ses haricots pour la regarder avec sympathie. Tout sentiment d’envie disparut chez elle quand elle vit que la jolie robe de Rose cachait un cœur désolé, et que son tablier brodé avait déjà essuyé plus d’une larme, et, si elle l’eût osé, elle serait allée consoler et embrasser la pauvre affligée.
« Je suis toute seule au monde, fit Rose entre deux sanglots.
— Vous n’êtes pas toute seule, lui dit timidement Phœbé. Vous avez je ne sais combien de tantes, d’oncles et de cousins. Debby, la cuisinière, m’a déjà dit qu’on allait vous gâter « d’une façon abominable, » parce que vous êtes l’unique fille de la famille. J’aimerais bien être gâtée comme cela. »
Rose sourit malgré ses larmes et s’écria d’un ton de détresse comique :
« Hélas ! oui, j’ai six tantes, et c’est là un de mes chagrins. Pensez donc, six tantes ! Je puis à peine les distinguer les unes des autres, quoiqu’elles ne se ressemblent pas, et c’est toute une affaire que de se rappeler leurs noms. Vous vous y perdriez comme moi. Voulez-vous que je vous fasse leur portrait ?
— Je veux bien.
— Il y a d’abord tante Prudence et tante Patience ; celles-là, vous les connaissez, puisque vous êtes chez elles. Elles sont très bonnes, mais elles ne sont pas amusantes. Ce sont mes grand’tantes, vous savez ! Elles ne sont mariées ni l’une ni l’autre, et mes cinq oncles, ainsi que mon cher papa, étaient les fils de leur frère, leurs neveux par conséquent. Je crois que c’est tante Prudence qui a élevé le plus jeune, l’oncle Alec.
— Cela ne fait que deux tantes, dit Phœbé en comptant sur ses doigts.
— N’ayez pas peur, nous arriverons au total. L’aîné de mes oncles s’appelle l’oncle Mac, et sa femme, tante Juliette. J’aime bien l’oncle Mac, mais je n’aime pas assez tante Juliette. Elle est longue et maigre comme un manche à balai. Elle porte des lunettes et elle a l’air si sévère que je tremble devant elle. Elle est toujours à dire que je m’écoute, et que c’est par paresse que je ne suis pas restée en pension… Cela fait trois, n’est-ce pas ?
— Oui.
— La quatrième, tante Myra, est veuve et se croit toujours malade. La cinquième, c’est tante Jessie qui paraît charmante, – c’est celle que je préfère. – Enfin, la dernière, tante Clara, est une élégante, une belle dame très jolie qui passe sa vie au bal et en visites.
— Est-ce qu’elles sont veuves aussi ces deux-là ? demanda Phœbé.
— Non ; mais oncle James, le mari de tante Jessie, est capitaine de vaisseau et reste rarement au port, et oncle Stéphen, le mari de tante Clara, habite Calcutta depuis longtemps. Je ne les connais pas, naturellement. Ouf ! que de tantes ! N’êtes-vous pas de mon avis ? »
Phœbé se mit à rire.
« Je finirais peut-être par m’accoutumer aux tantes, continua Rose, mais si vous saviez que de cousins !… J’en ai sept, et j’ai horreur des garçons ! Aussi, mercredi dernier, quand ils sont venus me faire visite, j’ai fait semblant de dormir pour leur échapper.
« Tante Prudence ne s’est doutée de rien, et je riais sous ma couverture ! J’ai réussi à les éviter cette fois-là ; mais il faudra bien que je fasse connaissance avec eux un de ces jours, et j’en frémis d’avance. »
Rose n’avait jamais vécu avec des enfants de son âge ; elle appréciait peu la société des petites filles, et elle considérait les petits garçons comme une sorte d’animal féroce.
Phœbé pensait autrement :
« Je suis sûre, lui dit-elle, que vous aimerez beaucoup vos cousins quand vous les connaîtrez. Vous vous plaignez de vous ennuyer, c’est avec eux que vous vous amuserez ! Ils sont perpétuellement en parties de plaisir, en promenades sur mer et en cavalcades. Je les ai vus passer plus d’une fois. Si vous saviez comme ils rient, comme ils chantent et comme ils ont l’air heureux !…
— J’ai peur des chevaux, dit Rose. Je ne voudrais pour rien au monde aller sur mer, et je déteste les garçons. »
La pauvre Rose aurait encore pu à la rigueur supporter l’une des trois calamités susdites, mais les trois réunies l’épouvantaient. Phœbé rit de bon cœur de ses transes et dit pour la consoler :
« Votre tuteur vous emmènera peut-être dans un endroit où il n’y aura pas de petits garçons. Debby m’a dit qu’il est très bon et qu’à chacun de ses voyages il rapporte des cadeaux pour tout le monde dans la maison.
— Voilà encore un de mes soucis, s’écria Rose. Si mon tuteur allait me déplaire, qu’est-ce que je deviendrais ? Je ne l’ai jamais vu, et il se pourra fort bien que nous ne nous entendions pas. C’est qu’il n’y a pas à dire, il faudra que je lui obéisse jusqu’à ce que j’aie dix-huit ans. Oh ! que cette pensée me tourmente !…
— À votre place, dit Phœbé, je tâcherais de n’y pas penser. Pourquoi vous tourmenter de ce que vous ne connaissez pas ? À chaque jour suffit sa peine ! Moi, je me trouverais parfaitement heureuse si j’allais en classe, si j’avais un tas de livres, point de corvées à faire, et une famille, fût-elle composée de six tantes, de quatre oncles et de sept cousins. »
On entendit tout à coup un roulement de voiture accompagné de cris d’enfants et de pas de chevaux.
« Qu’est-ce qui arrive ! s’écria Phœbé. On dirait un coup de tonnerre.
— C’est un cirque, répondit Rose, j’aperçois une voiture rouge et des petits chevaux noirs qui vont comme le vent. »
Le bruit ayant cessé, les petites filles allaient reprendre leurs confidences lorsque Debby, plus revêche que jamais, vint dire à Rose :
« Mademoiselle, on vous demande au salon.
— Ah ! mon Dieu, s’écria Rose effrayée, est-ce qu’il y a des visites ?
— Le devoir des petites filles est d’obéir sans faire de questions, répondit la vieille bonne d’un ton sentencieux.
— Pourvu que ce ne soit pas tante Myra, dit Rose en s’éloignant. Elle gémit sur mon sort comme si elle me croyait mourante, et elle passe tout le temps de sa visite à me tâter le pouls et à me demander comment va mon rhume.
— Je crois que la visite qu’elle va recevoir lui plaira encore moins que celle de tante Myra, » murmura Debby entre ses dents.
Et elle ajouta tout haut :
« En tout cas, miss Rose, j’espère qu’il ne vous prendra plus fantaisie de revenir à la cuisine ; ce n’est pas là votre place. »
Le Clan des Campbell
Rose se vengea des dernières paroles de Debby en lui faisant à travers la porte une grimace significative, puis elle remit son tablier droit, passa la main dans ses cheveux pour s’assurer qu’aucune boucle rebelle ne s’était échappée de son ruban et fit appel à tout son courage.
Ces préparatifs indispensables une fois terminés, elle entr’ouvrit sans bruit la porte du salon et y jeta un regard furtif. Elle n’y vit personne, et, n’entendant rien de suspect, elle s’imagina que les visiteurs étaient partis. Elle entra hardiment avec cette conviction ; mais ce qu’elle aperçut alors la fit reculer de plusieurs pas en poussant un petit cri étouffé.
Sept garçons étaient alignés contre le mur, par rang de taille ; il y en avait de tous les âges et de toutes les grandeurs, et ils se ressemblaient plus ou moins ; mais tous avaient des yeux bleus et des cheveux blonds, et tous portaient avec désinvolture le joli costume des Écossais. Rien n’y manquait : ni le plaid, ni la toque, ni les grandes guêtres et la jupe courte. Ils s’intitulaient fièrement : le Clan des Campbell. C’étaient les sept cousins de Rose.
D’un même mouvement, tous les sept lui tendirent la main en souriant et s’écrièrent d’une seule voix :
« Bonjour, cousine. Comment allez-vous ? »
Rose, éperdue, chercha des yeux une issue pour s’échapper. On eût dit une pauvre petite chatte effarouchée mise en présence d’une meute de dogues enragés. Sa frayeur était si grande, qu’au lieu de sept garçons, il lui semblait en voir au moins cinquante.
Le plus grand des jeunes Écossais la prévint dans son dessein de fuite. Rompant l’alignement, il s’avança vers elle pour lui dire gentiment :
« N’ayez pas peur de nous, ma cousine, je vous en prie. Le clan dont je suis le chef réclame humblement l’honneur de vous rendre ses devoirs. Permettez-nous de vous souhaiter la bienvenue, et veuillez m’excuser si je suis obligé de me présenter moi-même, comme étant le plus âgé. Je m’appelle Archibald, – Archie, pour abréger, – et je suis tout à votre service. »
Il lui tendit amicalement sa forte main brunie par le grand air. La timide petite Rose ne put faire autrement que de lui donner la sienne en échange, et Archie, voyant qu’elle avait bonne envie de fuir, retint prisonnière pendant quelques instants cette petite main effilée.
« Comme vous voyez, ma cousine, nous sommes venus en corps et en grande cérémonie pour vous faire honneur. J’espère que vous nous octroierez un jour votre amitié ; actuellement nous vous demandons seulement de vouloir bien nous écouter avec bienveillance… Laissez-moi vous présenter chacun de mes hommes par rang d’âge : Ce grand beau garçon qui vient après moi, c’est Charles, le fils unique de tante Clara, qui le gâte en conséquence. On l’a surnommé à l’unanimité le prince Charmant. Mac Kenzie le suivant, a quelques mois de moins que Charles. Nous ne rappelons jamais que Mac. C’est un enragé liseur. Il dévore tout ce qu’il peut trouver à lire, et jamais sa soif de lecture ne s’est apaisée. Son frère Stève ne lui ressemble guère. Admirez ces gants immaculés et ce nœud de cravate, et dites-moi si ce jeune homme ne mérite pas bien son surnom de Stève le Dandy ? Mac et Stève sont les fils de tante Juliette. Quand vous les connaîtrez tous les deux, vous les apprécierez, j’en suis sûr, à leur juste valeur… Quant aux trois derniers, il ne m’appartient pas d’en faire l’éloge, car ce sont mes propres frères : Georgie, Will et Jamie, notre bébé… Nous sommes les quatre fils de tante Jessie… – Allons, mes hommes, Attention au commandement ! Un pas en avant ! Saluez votre cousine ! »
Les jeunes Écossais obéirent avec une précision militaire. La pauvre Rose était de plus en plus rouge et embarrassée ; mais elle ne pouvait demeurer en reste de politesse avec ses sept cousins, et il lui fallut serrer successivement chacune des six autres mains qui lui étaient tendues.
Cette imposante cérémonie terminée, le clan se dispersa dans tous les coins du salon, et Rose alla se réfugier dans un grand fauteuil, du haut duquel elle observa à la dérobée les envahisseurs de sa retraite préférée, en appelant de tous ses vœux l’arrivée de tante Prudence.
Les « hommes » d’Archie avaient dû recevoir une consigne à laquelle ils tenaient à se conformer. Ils s’approchèrent à tour de rôle de leur cousine, lui adressèrent chacun une courte question, en reçurent une réponse encore plus brève, et s’éloignèrent ensuite comme soulagés d’un grand poids.
Le chef, Archie, vint naturellement le premier. Il s’appuya contre le dossier du fauteuil de Rose et lui dit d’un ton de protection :
« Je suis heureux d’avoir fait votre connaissance, ma cousine. J’espère que vous vous plaisez ici.
— Moi aussi, » répondit Rose sans se départir de sa gravité.
Mac rejeta ses longs cheveux en arrière et s’approcha gauchement.
« Aimez-vous la lecture ? lui demanda-t-il. Avez-vous apporté vos livres ?
— Oui, j’en ai quatre grandes caisses dans la bibliothèque. »
Aussitôt Mac disparut dans la direction de la bibliothèque, et on ne le revit plus de longtemps.
Stève s’avança alors avec grâce pour dire à Rose :
« Nous avons été bien contrariés mercredi en ne vous voyant pas. J’espère que votre rhume va mieux.
— Oh ! il est fini ; je vous remercie. »
Et Rose ne put réprimer un sourire en songeant à ce fameux mercredi où elle avait si bien esquivé la visite de ses cousins.
Stève fut très fier de ce sourire qui lui parut accordé à ses seuls mérites, et il se retira plus content de lui que jamais. Il fut remplacé par Charlie, qui dit à Rose sans le moindre embarras :
« Maman m’a chargé de vous faire ses amitiés et de vous prier de venir passer une après-midi avec nous, dès que votre rhume vous le permettra. Le manoir doit être triste pour une petite fille. »
Rose bondit sous cette insulte.
« Je ne suis pas si petite que cela, s’écria-t-elle, j’ai douze ans passés !
— Ah ! vraiment, fit le prince Charmant. Je ne m’en serais jamais douté. Je vous demande pardon, mademoiselle. »
Et, affectant de lui faire un salut cérémonieux, l’espiègle lui tourna le dos en riant sous cape.
Georgie et Will lui succédèrent. C’étaient deux gros garçons de onze et douze ans respectivement. Ils se plantèrent droit devant Rose et lui décochèrent à brûle-pourpoint la phrase qu’ils avaient préparée à l’avance :
« On nous a dit que vous aviez un singe ; l’avez-vous amené ?
— Auriez-vous un joli bateau ?
— Mon singe est mort, répondit Rose, et je n’aime pas les promenades sur l’eau. »
Les deux écoliers tournèrent sur leurs talons et s’éloignèrent tout d’une pièce comme des soldats de bois d’une boîte de Nuremberg.
Jamie vint alors demander naïvement à sa cousine :
« M’avez-vous apporté quelque chose ?
— Oui, beaucoup de bonbons. »
Là-dessus, Jamie, enchanté, grimpa sur les genoux de Rose et lui donna coup sur coup deux baisers sonores. Celle-ci, prise à l’improviste, demanda précipitamment :
« Avez-vous vu le Cirque ?
— Où donc ? s’écrièrent ses cousins.
— Là-bas, dans la rue. Je l’ai aperçu très peu de temps avant votre arrivée. Il y avait un char blanc et rouge et des petits chevaux. »
Rose s’arrêta court. Qu’y avait-il donc de si extraordinaire dans ces paroles pour qu’en les entendant ses cousins se missent à rire, à battre des mains et à crier comme des fous ? Quelle bévue avait-elle pu commettre inconsciemment ?
Quand le tumulte fut un peu apaisé, Archie lui en expliqua la cause :
« Ah ! cousine, lui dit-il, c’est ainsi que vous nous prenez pour un cirque ambulant, pour des bohémiens peut-être ?
— Comment ! c’était vous ? s’écria Rose.
— Mais oui, c’était nous ! On vous taquinera longtemps à ce sujet.
— Cette voiture était si drôle, balbutia Rose.
— Venez la voir, » interrompit le prince Charmant.
Deux minutes après, la petite fille se trouvait comme par enchantement dans l’écurie, puis dans la remise où on lui montrait bruyamment des poneys à longue queue et une élégante petite voiture bariolée de bandes rouges.
C’était la première fois que Rose pénétrait dans ces régions inconnues. Elle eut peur d’être grondée.
« Que va dire tante Prudence ? fit-elle à demi-voix.
— Tante Prudence, elle ne peut pas le trouver mauvais ; c’est elle qui nous a chargés de vous distraire. N’est-ce pas plus amusant d’être ici qu’au salon ?
— Je n’ai pas de manteau, continua Rose. Je vais prendre froid.
— N’ayez crainte, cousine. »
En un clin d’œil une toque fut posée sur ses cheveux bouclés, un plaid jeté sur ses épaules et une cravate nouée autour de son cou. Enfin Charlie ouvrit toute grande la porte de la calèche qui était dans la remise, et dit à Rose en l’aidant à s’y installer :
« Asseyez-vous là, madame, vous y serez très confortablement pendant que nous vous donnerons une légère idée de ce que nous savons faire. »
Aussitôt le clan exécuta une danse écossaise si drôle, que Rose en oublia sa frayeur des garçons en général et de ses cousins en particulier. Elle applaudit les artistes avec frénésie et rit comme elle ne l’avait pas fait depuis bien des mois.
« Sa Majesté est-elle satisfaite de ses très humbles serviteurs ? demanda Charlie à la fin du ballet.
— Ravie ! s’écria Rose avec enthousiasme. Vous dansez dans la perfection. Je n’ai jamais rien vu d’aussi joli, pas même au théâtre, la seule fois que j’y suis allée.
— Oui, nous ne dansons pas trop mal, fit Charlie en se redressant, mais ce n’est rien en comparaison de nos autres talents. Si nous avions apporté nos chalumeaux, nous vous aurions donné un concert. »
Rose commençait à croire qu’elle avait quitté l’Amérique pour se trouver tout à coup transportée dans les montagnes de l’Écosse.
« D’où vous est venue cette idée de former un clan ? demanda-t-elle. Notre famille serait-elle d’origine écossaise ? Je l’ignorais complètement. »
Archie se chargea de lui répondre du haut du phaéton où il s’était perché :
« Notre grand-père descend d’une des plus vieilles familles d’Écosse, lui dit-il. Un des romans de Walter Scott nous le remit en mémoire il y a trois mois. À force de chercher, nous trouvâmes une cornemuse, des chalumeaux et tous les ornements caractéristiques de notre costume, et nous organisâmes le clan des Campbell en jurant d’y faire honneur à tous les points de vue. Je vous avoue que c’est pour nous une grande source de distractions.
— Je n’en doute pas, fit Rose en hochant la tête d’un air d’approbation.
— Ma cousine, ajouta Charlie, nous vous donnerons quand vous en aurez envie le spectacle d’un combat à la claymore. Je représente Fitz-James, et Archie, Roderick Dhu. À nous deux, nous faisons des choses merveilleuses.
— Oui, s’écria Will, mais les autres ont bien aussi leurs mérites. Il faut entendre Stève jouer du chalumeau ! On dirait un rossignol. »
Georgie fit à son tour l’éloge de Mac :
« Nous ne faisons guère qu’exécuter les ordres de Mac, dit-il. C’est lui qui nous découvre dans les vieux bouquins les plus jolies légendes d’Écosse, qui nous dessine des costumes et nous apprend les mœurs et coutumes des anciens temps.
— Et vous, Jamie, qu’est-ce que vous faites ? demanda Rose au bébé, qui ne la quittait pas, sans doute par crainte de ne plus entendre parler des bonbons promis.