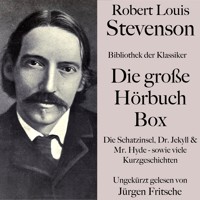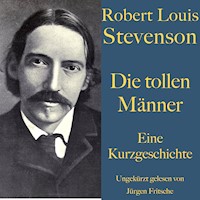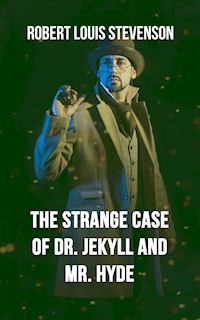Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CLAAE
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Une arrivée qui est loin d’être de tout repos pour un anglais marchant sur les plates-bandes des Français…
Le narrateur, un Anglais, débarque sur une île des Samoa pour tenir un comptoir commercial. À force de persévérance devant les obstacles que lui dressent les Blancs déjà installés et les insulaires ; malgré la tromperie, il épouse la jeune îlienne Uma.
Ce sont les péripéties entre colonisateurs et colonisés que dénonce Robert Louis Stevenson dans cette histoire.
«
C’était la coutume de ces parages et (comme je l’ai dit moi-même) nullement la faute de nous autres Blancs, mais celle des missionnaires. S’ils avaient laissé les indigènes tranquilles, je n’aurais pas eu besoin de cette supercherie »
Un thriller historique captivant et revendicatif au sujet de la colonisation
EXTRAIT
Quand je vis cette île pour la première fois, le matin allait remplacer la nuit. À l’ouest, la lune se couchait large et brillante encore. À l’est, en plein milieu de l’aurore toute rose l’étoile du jour étincelait comme un diamant. La brise de terre qui nous soufflait au visage avait un fort parfum de citron et de vanille – d’autres fruits encore, mais ceux-là les plus nets – et sa fraîcheur me fit éternuer. Je dois dire que j’avais passé, des années sur une île basse proche de la Ligne, vivant la plupart du temps solitaire parmi les indigènes. C’était donc ici une aventure nouvelle : le langage même me serait inconnu ; et l’aspect de ces bois et de ces montagnes, leur merveilleuse senteur, me rénovaient le sang.
À PROPOS DE L’AUTEUR
Robert Louis Stevenson, né le 13 novembre 1850 à Édimbourg et décédé le 3 décembre 1894 à Vailima (Samoa), est un écrivain écossais et un grand voyageur, célèbre pour son roman
L'Île au trésor ainsi que pour sa nouvelle
L'Étrange Cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. A rebours de ses contemporains naturalistes, la poétique de Stevenson est résolument anti-réaliste. Elle privilégie les lois et les exigences de la fiction contre celles du réel, sans pour autant s'enfermer dans une quelconque tour d'ivoire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CLAAEFrance
Nouvelle traduite de l’anglais par Théo VarletTitre original : The Beach of Falesaédité pour la première fois en 1893.
Photographie de la couverture : Cocotier jaune © Unclesam
© CLAAE 2016
Tous droits réservés. Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
EAN eBook : 9782379110191
© CLAAE 2016France
Robert Louis Stevenson
La plage de Falesa
CLAAE
Un mariage dans les mers du Sud
Quand je vis cette île pour la première fois, le matin allait remplacer la nuit. À l’ouest, la lune se couchait large et brillante encore. À l’est, en plein milieu de l’aurore toute rose l’étoile du jour étincelait comme un diamant. La brise de terre qui nous soufflait au visage avait un fort parfum de citron et de vanille – d’autres fruits encore, mais ceux-là les plus nets – et sa fraîcheur me fit éternuer. Je dois dire que j’avais passé, des années sur une île basse proche de la Ligne, vivant la plupart du temps solitaire parmi les indigènes. C’était donc ici une aventure nouvelle : le langage même me serait inconnu ; et l’aspect de ces bois et de ces montagnes, leur merveilleuse senteur, me rénovaient le sang.
Le capitaine souffla la lampe de l’habitacle.
— Là ! dit-il, là où s’élève un peu de fumée, M. Wiiltshire, derrière la brèche du récif. C’est Falesa, où se trouve votre station, le dernier village à l’est ; personne n’habite vers le vent – je ne sais pourquoi. Prenez ma lorgnette et vous distinguerez les maisons.
Je pris la lorgnette : le rivage saillit tout proche : je vis l’enchevêtrement des bois et la brèche du ressac ; les toits bruns et les noirs intérieurs des maisons apparurent entre les arbres.
— Voyez-vous un point blanc, là-bas vers l’est ? poursuivit le capitaine. C’est votre maison. Bâtisse de corail, situation élevée, véranda où l’on peut marcher trois de front : le meilleur établissement du Pacifique Sud. Le vieil Adams en l’apercevant me donna une poignée de main. « Me voici joliment bien tombé », dit-il.
— Pour sûr, dis-je, et à temps aussi ! Pauvre Johnny ! je ne l’ai jamais revu qu’une fois depuis, et alors il avait changé de ton… Ne pouvait s’entendre avec les indigènes, ou les Blancs, ou n’importe quoi ; et la fois d’après où nous revînmes, il était mort et enterré. Je lui mis sur un bout de planche : John Adams, obit 1863. Allez et faites de même. Ce garçon m’a manqué. Je n’ai jamais trouvé grand-chose à dire contre Johnny.
— De quoi mourut-il ? demandai-je.
— Une sorte de mal, dit le capitaine. Il paraît que cela le prit subitement. Il se leva dans la nuit et se bourra de Pain-Killer et de Kennedy’s Discovery1. Rien à faire : il était trop pincé pour le Kennedy. Alors il essaya d’ouvrir une caisse de gin. Rien à faire non plus : pas assez fort. Alors il dut sortir dans la véranda et chavirer par-dessus la balustrade. Quand on le retrouva le lendemain il était complètement fou – revenant tout le temps sur quelqu’un qui mettait de l’eau dans son coprah2. Pauvre John !
— A-t-on pensé que c’était l’île ?
— Ma foi, on a pensé que c’était l’île, ou les ennuis, ou quelque chose, répondit-il.
Je n’ai jamais entendu dire que ce ne fût pas un endroit sain. Notre dernier homme, Vigours, n’y perdit pas un cheveu. Il partit à cause de la plage – disant qu’il avait peur de Black Jack et de Case, et de Wistling Jimmie qui vivait encore à cette époque ; mais il se noya bientôt après, ayant bu. Quant au vieux capitaine Randall, il est resté ici tout le temps depuis 1840-45. Je n’ai jamais trouvé grand mal en Billy ni beaucoup de changement. C’est à croire qu’il va vivre autant que le vieux Kafuzleum3. Non, je crois que l’île est saine.
— Voici un bateau qui arrive, dis-je. Il est juste dans la passe ; on dirait une baleinière de seize pieds ; deux Blancs à l’arrière.
— C’est le bateau qui noya Whistling Jimmie ! s’écria le capitaine. Voyons la lunette. Oui, c’est Case, pour sûr, et le négro. Ils ont une réputation de gibiers de potence, vous savez tout ce qu’on raconte sur les plages. Ma foi, ce Whistling Jimmie était le pire tourment ; et il est parti pour la gloire, voyez-vous… Qu’est-ce que vous pariez qu’ils ne viennent pas pour du gin ? Cinq contre deux qu’ils en prennent six caisses.
Quand les deux commerçants furent à bord, leur aspect me plut aussitôt, ou mieux, l’aspect des deux et la conversation de l’un. Je languissais après des voisins blancs depuis quatre années sous la Ligne, que j’ai toujours comptées comme années de prison : – frappé du tabou, et obligé d’aller à l’Assemblée pour m’en faire relever ; achetant du gin et allant à la ruine, puis m’en repentant ; assis le soir chez moi avec ma lampe pour compagnie ; ou me promenant sur la plage et cherchant des mots pour qualifier ma folie d’être là où j’étais. Il n’y avait pas d’autres Blancs sur mon île, et lorsque je passai sur la suivante mes brutes de clients firent le meilleur de ma société. Aussi, j’eus un vrai plaisir à voir ces deux-ci lorsqu’ils montèrent à bord. L’un était nègre, pour sûr ; mais tous deux étaient proprement habillés de pyjamas rayés et de chapeaux de paille, et Case eût été présentable dans une ville. Il était jaune et petit, avec un nez de hibou dans la figure, des yeux pâles et la barbe taillée aux ciseaux. Personne ne connaissait son pays, sauf qu’il était de langue anglaise ; mais évidemment de bonne famille et d’excellente éducation. Il était distingué aussi, joueur d’accordéon de première classe ; et, si vous lui donniez un bout de ?celle, un bouchon ou un paquet de cartes, il vous montrait des tours meilleurs que ceux d’un professionnel. Il savait parler, à volonté, comme dans un salon ; et, à volonté, il savait blasphémer pis qu’un maître d’équipage yankee, et il en disait de quoi rendre malade un Canaque. Selon la manière qu’il croyait répondre le mieux à la circonstance, telle était l’habitude de Case : et toujours cela paraissait sortir naturellement, comme s’il était né pour cela. Il avait le courage d’un lion et l’astuce d’un rat ; et s’il n’est pas en enfer aujourd’hui, c’est que cet endroit n’existe pas. Je ne connais à cet homme qu’un bon côté : il raffolait de sa femme et la traitait avec douceur. C’était une femme de Samoa, qui se teignait les cheveux en rouge, à la mode samoane. Lorsqu’il vint là mourir (comme je le raconterai) on découvrit une chose étrange : il avait fait son testament, comme un chrétien, et tout allait à sa veuve – tout son bien, dit-on, avec tout celui de Black Jack, et par-dessus le marché celui de Billy Randall presque en entier, car c’était Case qui tenait les livres. Et ainsi elle s’en retourna sur la goélette Manua, et fait à présent la dame dans son pays.
Mais de tout cela, cette première matinée, je n’en savais pas plus qu’une mouche. Case me traita en gentleman et en ami, me souhaita la bienvenue à Falesa et mit ses services à ma disposition, chose d’autant plus utile que j’ignorais la langue indigène. Presque tout le jour nous restâmes dans la cabine à boire et faire plus ample connaissance, et je n’ai jamais entendu parler avec plus d’à-propos. Il n’y avait pas dans les îles plus adroit commerçant ni plus retors. Falesa m’apparaissait comme un endroit de la meilleure espèce ; et plus je buvais, plus mon cœur s’allégeait. Notre dernier agent avait fui la place en une demi-heure, et pris passage au hasard sur un caboteur qui venait de l’ouest. Le capitaine, en arrivant, avait trouvé le comptoir fermé, les clefs déposées chez le pasteur indigène, et une lettre du fugitif où il avouait craindre nettement pour sa vie. Depuis lors, la firme n’avait pas été représentée, et naturellement il n’y avait pas de marchandises. En outre le vent était bon, le capitaine espérait atteindre l’île suivante vers le soir, s’il avait bonne marée, et l’affaire de débarquer ma pacotille fut menée rondement. Nul besoin de m’en préoccuper, disait Case : personne ne toucherait à mes effets, tout le monde était honnête à Falesa, sauf pour les poulets ou un mauvais couteau ou quelque bout de tabac. Le mieux que j’avais à faire était de rester tranquille jusqu’au départ du bateau ; alors je viendrais tout droit chez lui, voir le vieux capitaine Randall, le père de la plage, boire la bienvenue, et j’irais dormir chez moi lorsqu’il ferait noir. Il était donc plein midi, et la goélette faisait route, lorsque je mis le pied sur le rivage de Falesa.
J’avais bu un verre ou deux à bord, je sortais juste d’une longue croisière, et le sol oscillait sous moi tel un pont de navire. Le monde était comme repeint à neuf ; mes pieds allaient en mesure ; j’aurais pu me croire à Fiddler’s Green4, si un tel endroit existe, et tant pis s’il n’existe pas ! C’était bon de fouler le gazon, de regarder les hautes montagnes, de voir les hommes enguirlandés de feuillage et les femmes aux brillants costumes rouges et bleus. Nous allions sous le gros soleil et dans l’ombre fraîche, savourant l’un et l’autre. Tous les enfants du village trottinaient après nous avec leurs têtes rasées et leurs corps bruns : et une sorte de grêle clameur s’élevait sur nos traces, comme un caquetage de volaille.
— Pardieu, dit Case, nous devons vous trouver une femme.
— C’est vrai, dis-je, j’oubliais.
Il y avait une foule de filles autour de nous, et je m’arrêtai pour les inspecter comme un pacha. Elles s’étaient toutes habillées à cause de la présence du navire ; et les femmes de Falesa sont une belle collection à voir. Si elles ont un défaut, c’est d’être un peu larges de carrure ; et j’y pensais justement lorsque Case me toucha l’épaule.
— Celle-là est gentille, dit-il.
J’en vis une arriver de l’autre côté, seule. Elle revenait de la pêche et ne portait qu’une simple chemise qui était toute trempée. Elle était jeune et très svelte pour une fille des îles, avec un visage allongé, un front élevé, et un regard sauvage, étrange, un peu vide, tenant le milieu entre celui d’un chat et celui d’un bébé.
— Qui est-ce ? dis-je. Elle fera l’affaire.
— C’est Uma, dit Case.
Et, l’appelant, il lui parla en indigène. Je ne comprenais pas ce qu’il disait, mais, au milieu de sa phrase, elle me lança un regard prompt et timide, comme un enfant qui attend un coup, puis baissa les yeux, et enfin sourit. Elle avait une grande bouche, des lèvres et un menton de statue ; et le sourire s’y montra un instant puis disparut. Alors, tête baissée, elle écouta Case jusqu’au bout, répliqua de sa jolie voix polynésienne, le regardant en plein visage, écouta de nouveau sa réponse, puis salua et s’éloigna. J’eus ma part du salut, mais pas de nouvelle œillade, et plus question de sourire.
— Je crois que tout va bien, dit Case.
Vous pouvez l’avoir. J’arrangerai cela avec la vieille mère. Vous pouvez taper dans le tas pour une poignée de tabac, ajouta-t-il en ricanant.
Le sourire avait dû me rester dans la mémoire, car je répliquai sèchement :
— Elle n’a pas l’air de cette espèce.
— Je ne saisis pas ce qu’elle est, dit Case. Je la crois très comme il faut. Reste à part soi, ne fraie pas avec la clique, et… oh non ! vous me comprenez mal : Uma est honnête.
Je crus qu’il parlait sérieusement, et cela m’étonna et me fit plaisir.
— Bien entendu, continua-t-il, je ne serais pas si sûr de l’avoir si elle n’en pinçait pour la coupe de votre foc. Tout ce que vous avez à faire est de vous tenir tranquille : laissez-moi travailler la mère de mon côté, et je vous amènerai la fille chez le capitaine pour le mariage.
Je n’aimais guère le mot mariage, et je le dis.
— Oh ! rien de dangereux à ce mariage, dit-il. C’est Black Jack qui officie.
Nous étions en vue de la maison des trois Blancs – car un nègre est compté comme blanc, de même qu’un Chinois ! drôle d’idée, mais fréquente aux Îles. C’était une maison de bois, avec une étroite véranda branlante. Le magasin était devant, avec un comptoir, des escabeaux, et le plus piètre étalage commercial : une ou deux caisses de boîtes de conserve, un baril de biscuits, quelques pièces de cotonnade, sans comparaison possible avec les miennes. Le seul rayon bien représenté était la contrebande, armes à feu et liqueurs. Si ce sont là mes seuls rivaux, pensai-je, je ferai mes affaires à Falesa. En effet, ils n’avaient qu’un moyen de me faire concurrence : les armes à feu et la boisson.
Dans la salle à manger se trouvait le vieux capitaine Randall, assis par terre à la façon des indigènes, gras et pâle, nu jusqu’à la ceinture, grisonnant comme un blaireau, et les yeux renfoncés par la boisson. Son corps était couvert de poils gris et fourmillait de mouches – il en avait une dans le coin de l’œil et ne s’en apercevait pas –, et les moustiques bourdonnaient autour de lui comme des abeilles. Tout homme d’un esprit droit eût aussitôt porté l’individu dehors pour l’enterrer ; et de le voir, et de penser qu’il avait soixante-dix ans, et de me souvenir qu’il avait autrefois commandé un navire, et qu’il était allé à terre dans ses beaux effets, et qu’il avait parlé haut dans les bars et les consulats, et s’était assis sous des vérandas de clubs – cela me dégoûta et me dégrisa.
À mon entrée, il essaya de se lever, mais sans succès. Alors il me tendit la main de sa place et murmura un vague salut.
— Papa a joliment bu ce matin, fit remarquer Case. Nous avons eu ici une épidémie et le capitaine Randall prend du gin comme prophylactique – est-ce vrai, papa ?
— Jamais pris pareille chose de ma vie ! s’écria le capitaine avec indignation. Prendre du gin pour ma santé, M. Quel-est-donc-votre-nom, est une mesure de précaution.
— Très bien, papa, dit Case. Mais il faudra vous réveiller. Nous allons avoir un mariage. M. Wiltshire ici présent va se marier.
Le vieil homme demanda avec qui.
— Avec Uma, dit Case.
— Uma ! s’écria le capitaine. Qu’a-t-il besoin d’Uma ? Il est venu ici pour sa santé, n’est-ce pas ? Que diable a-t-il besoin d’Uma.
— Fermez ça, papa, dit Case. Ce n’est pas vous qui devez l’épouser. Je pense que vous n’êtes ni son grand-père ni sa grand-mère. Je pense que M. Wiltshire fait ce qu’il lui plaît.
Là-dessus, il s’excusa, me disant qu’il lui fallait s’occuper de ce mariage, et me laissa seul avec le pauvre diable qui était son associé et, à vrai dire, sa dupe. Le commerce et le comptoir appartenaient tous deux au vieux Randall ; Case et le nègre étaient des parasites : ils s’attachaient à lui et s’en nourrissaient comme les mouches, sans qu’il s’en aperçût. Et en somme je n’ai pas de mal à dire de Billy Randall, si ce n’est que le cœur me levait en sa présence et que les heures que je passai alors avec lui me furent un vrai cauchemar.
Il faisait une chaleur suffocante dans cette pièce remplie de mouches. Car la maison était sale, basse, petite, et mal située, derrière le village, sur la lisière du bois, à l’abri de l’alizé. Les couchettes des trois hommes s’étalaient sur le sol, que jonchaient casseroles et plats. Il n’y avait pas de chaises où s’asseoir : Randall, lorsqu’il devenait violent, les mettait en morceaux. Je restai là et pris un repas qui me fut servi par la femme de Case. Là, je m’entretins tout le jour avec ce reste d’humanité, dont la langue s’embarrassait dans de basses vieilles plaisanteries et de longues vieilles histoires qu’il soulignait de son rire perpétuel, si bien qu’il ne s’apercevait pas de ma dépression. Il ne cessa tout le temps de siffler du gin, pleurnichant et tremblotant, et à chaque instant il me demandait pourquoi je voulais épouser Uma.
Mon ami, me répétai-je tout ce jour, il ne faut pas que tu deviennes un vieux gentleman comme celui-là.