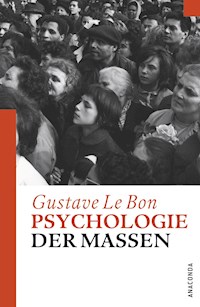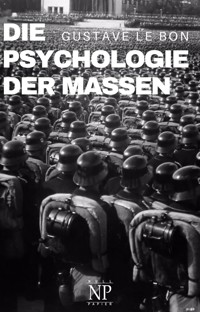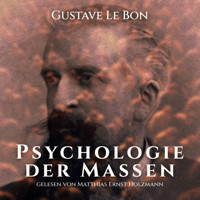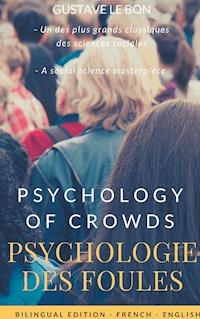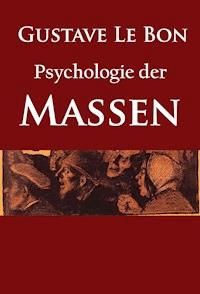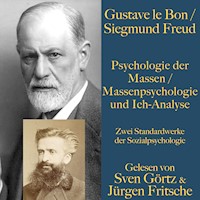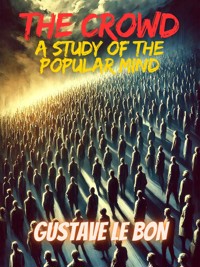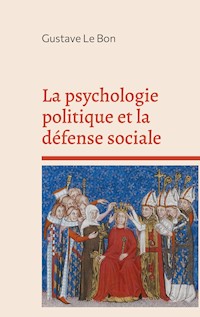
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
L'âge est passé où les dieux conduisaient l'histoire. La providence bienveillante qui guidait nos pas incertains et réparait nos erreurs, s'est évanouie sans retour. Abandonné à lui-même, l'homme doit s'orienter seul dans l'effrayant chaos des forces ignorées qui l'étreignent. Elles le dominent encore, mais il apprend chaque jour à les dominer à son tour. C'est cette domination sans cesse plus accentuée sur la nature que désigne le mot progrès. Maîtriser la nature ne suffit pas. Vivant en société, l'homme doit apprendre à se maîtriser lui-même et subir des lois communes. C'est aux chefs placés à la tête des nations qu'incombent la tâche d'édicter ces lois et de les faire respecter. La connaissance des moyens permettant de gouverner utilement les peuples, c'est-à-dire la psychologie politique a toujours constitué un difficile problème. Il l'est bien davantage aujourd'hui où des nécessités économiques nouvelles, nées des progrès scientifiques et industriels, pèsent lourdement sur les peuples et échappent à l'action de leurs gouvernements.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières.
Livre I :
But et méthode.
Chapitre 1
La psychologie politique.
Chapitre 2
Les nécessités économiques et les théories politiques.
Chapitre 3
Méthodes d’étude de la psychologie politique.
Livre II :
Facteurs psychologiques de la vie politique.
Chapitre 1 L’origine des lois et les illusions législatives.
Chapitre 2
Les méfaits des lois.
Chapitre 3
Rôle politique de la peur.
Chapitre 4
Transformation moderne du droit divin. L’Étatisme.
Chapitre 5
Facteurs psychologiques des luttes guerrières.
Chapitre 6
Facteurs psychologiques des luttes économiques.
Chapitre 7
Influences psychologiques de l’enseignement universitaire.
Livre III :
Le gouvernement populaire.
Chapitre 1
L’élite et la foule.
Chapitre 2
Genèse de la persuasion.
Chapitre 3
La mentalité ouvrière.
Chapitre 4
Formes nouvelles des aspirations populaires.
Chapitre 5
L’impopularité parlementaire et la surenchère.
Chapitre 6
Les progrès du despotisme.
Livre IV :
Les illusions socialistes et syndicalistes.
Chapitre 1
Les illusions socialistes.
Chapitre 2
Les illusions syndicalistes.
Chapitre 3
L’évolution anarchique du syndicalisme.
Livre V :
Les erreurs de psychologie politique en matière de colonisation.
Chapitre 1
Nos principes de colonisation.
Chapitre 2
Résultats psychologiques de l’éducation européenne sur les peuples inférieurs.
Chapitre 3
Résultats psychologiques des institutions et des religions européennes sur les peuples inférieurs.
Chapitre 4
Raisons psychologiques de l’impuissance de lacivilisation européenne à transformer les peuples inférieurs.
Chapitre 5
Les formes nouvelles de la colonisation.
Livre VI :
L’évolution anarchique et la lutte contre la désagrégation sociale.
Chapitre 1
L’anarchie sociale.
Chapitre 2
Les progrès de la criminalité.
Chapitre 3
L’assassinat politique.
Chapitre 4
Les persécutions religieuses.
Chapitre 5
Les luttes sociales.
Chapitre 6
Le fatalisme moderne et la dissociation des fatalités.
Chapitre 7
La défense sociale.
DU MEME AUTEUR.
CHAULVERON
Nostradamus et la fin des temps.
Le prophète Daniel et la fin des temps.
L’Apocalypse de Saint-Jean et la fin des temps 1.
L’Apocalypse de Saint-Jean et la fin des temps 2.
La pensée politique pour les complotistes.
Nostradamus et l’astrologie mondiale.
ANATOLE LE PELLETIER préface de CHAULVERON
Les oracles de Michel de Nostredame.
L’ABBE LEMANN et CHAULVERON
L’avenir de Jérusalem.
L’Antéchrist.
SUN TSE préface de CHAULVERON
L’art de la guerre et les 36 stratagèmes.
Gustave LE BON préface de CHAULVERON
Psychologie des foules, suivi de Lois psychologiques de
l’évolution des peuples.
La psychologie de la guerre.
La psychologie des révolutions.
Opinions et croyances.
SITE NTERNET
http://astrologie-mondiale.com.
Livre I :
But et méthode.
Chapitre 1.
La psychologie politique.
La première manifestation des progrès d’une science est de renoncer aux explications simples dont se contentent ses débuts. Ce qui paraissait d’abord facile à comprendre devient plus tard très difficile à expliquer.
Les études relatives à l’Évolution de la vie des nations ont subi la même loi. Après avoir essayé de tout interpréter, les historiens entrevoient maintenant qu’ils dissertaient souvent sur des illusions nées dans leur esprit.
Les phénomènes sociaux apparaissent aujourd’hui comme des mécanismes extrêmement compliqués, étroitement hiérarchisés et où la simplicité ne s’observe guère. L’évolution des peuples est aussi complexe que celle des êtres vivants.
La science cherche encore les lois qui déterminent les transformations des espèces et conditionnent leurs formes successives. Les lois de l’évolution sociale restent aussi peu connues. Quelques-unes seulement sont entrevues.
L’analyse des divers éléments dont l’agrégat constitue une société n’étant pas sortie de la phase des généralisations vagues et des assertions conjecturales, la vision des choses dont se contentent les théoriciens de l’inconnu demeurent très fragmentaires encore. Dans l’enchevêtrement des nécessités dirigeant la trajectoire de la vie d’un peuple, ils choisissent celles qui frappent leur esprit et négligent les autres. C’est pourquoi le récit des actes des souverains et surtout de leurs batailles semblait devoir constituer l’unique intérêt de l’Histoire. Tout ce qui concernait l’existence des peuples était, il y a peu de temps encore, dédaigné ou ignoré.
La science ne se contente plus des réponses sommaires faites jadis au "pourquoi" qui se hérissent de toutes parts et dont la vie politique des nations est remplie. Pourquoi tant de peuples surgis brusquement du néant, et remplissant le monde du bruit de leur grandeur ? Pourquoi ont-ils sombré ensuite dans un oubli si profond que pendant des siècles tout fut ignoré d’eux ? Comment naissent, évoluent et meurent les dieux, les institutions, les langues et les arts ? Conditionnent-ils les sociétés humaines, ou sont-ils au contraire conditionnés par elles ? Pourquoi certaines croyances comme l’Islamisme purent-elles s’édifier presque instantanément alors que d’autres mirent des siècles à s’établir ? Pourquoi le même Islamisme survécutil à la puissance politique qui lui servait de support et s’étend-il toujours alors que d’autres religions comme le christianisme et le bouddhisme semblent décliner et côtoyer leur fin ?
À tous ces « pourquoi » et à bien d’autres, les réponses ne manquèrent jamais. Nous ressemblons à l’enfant auquel il en faut toujours. Mais les explications dont pouvait se contenter une science très jeune, sa maturité ne les accepte plus.
L’âge est passé où les dieux conduisaient l’histoire. La providence bienveillante qui guidait nos pas incertains et réparait nos erreurs, s’est évanouie sans retour. Abandonné à lui-même, l’homme doit s’orienter seul dans l’effrayant chaos des forces ignorées qui l’étreignent. Elles le dominent encore, mais il apprend chaque jour à les dominer à son tour. C’est cette domination sans cesse plus accentuée sur la nature que désigne le mot progrès.
Maîtriser la nature ne suffit pas. Vivant en société, l’homme doit apprendre à se maîtriser lui-même et subir des lois communes. C’est aux chefs placés à la tête des nations qu’incombent la tâche d’édicter ces lois et de les faire respecter.
La connaissance des moyens permettant de gouverner utilement les peuples, c’est-à-dire la psychologie politique a toujours constitué un difficile problème. Il l’est bien davantage aujourd’hui où des nécessités économiques nouvelles, nées des progrès scientifiques et industriels, pèsent lourdement sur les peuples et échappent à l’action de leurs gouvernements.
La psychologie politique participe de l’incertitude des sciences sociales indiquée plus haut. Il faut bien cependant l’utiliser telle qu’elle est, car les événements nous poussent et n’attendent pas. Les décisions que ces derniers provoquent ont souvent une importance considérable, car les conséquences d’une erreur peuvent s’appesantir sur plusieurs générations. Le siècle qui précéda le nôtre en fournit de nombreux exemples.
Les plus importantes des règles du gouvernement des hommes sont celles relatives à l’action. Quand agir, comment agir et dans quelles limites agir ? La réponse à ces questions constitue tout l’art de la politique.
Une analyse attentive des fautes politiques dont est parsemée la trame de l’histoire montre qu’elles eurent généralement pour causes des erreurs de psychologie.
Les arts et les sciences sont soumis à certaines règles qu’on ne peut impunément violer. Il en existe d’aussi précises pour gouverner les hommes. Leur découverte est fort difficile, sans doute, puisque très peu jusqu’ici ont été nettement formulées.
Le seul véritable traité de psychologie politique connu fut publié il y a plus de quatre siècles par un illustre Florentin que son œuvre rendit immortel.
Le marbre luxueux qui protège son sommeil éternel est édifié sous les voûtes de la célèbre église Santa-Croce à Florence. Ce panthéon des gloires de l’Italie renferme de magnifiques monuments élevés à la mémoire des hommes qui firent sa grandeur Michel-Ange, Galilée, Dante, etc. Les mérites de ces demi-dieux de la pensée y sont gravés en lettres d’or.
Dans cette galerie d’illustres ombres il n’est guère qu’un tombeau sur lequel de longues inscriptions aient été jugées inutiles. Une seule indication y figure :
MACHIAVEL, 1527
Tanto nomini nullum par elogium
(nul éloge n’égale un tel nom)
L’œuvre qui valut à son auteur une épitaphe si glorieuse et si brève est le petit volume intitulé Le Prince, auquel je faisais allusion plus haut. L’illustre écrivain y formulait des règles précises sur l’art de gouverner les hommes de son temps.
De son temps et non d’un autre. C’est pour avoir oublié cette condition essentielle que le livre tant admiré d’abord fut décrié plus tard lorsque les idées et les mœurs ayant évolué, il cessa de traduire les nécessités des âges nouveaux.
Alors seulement Machiavel devint machiavélique.
Possédant le sens des réalités, l’éminent psychologue ne cherchait pas le meilleur, mais seulement le possible. Pour pénétrer son génie on doit se reporter à cette période brillante et perverse, où la vie d’autrui ne comptait guère et où le fait d’emporter son vin avec soi pour ne pas être empoisonné lorsqu’on allait dîner chez un cardinal ou simplement chez un ami était considéré comme très naturel. Juger la politique de cet âge avec les idées du nôtre, serait aussi illogique que de vouloir interpréter les croisades, les guerres de religion, la Saint-Barthélemy, à la lumière des conceptions actuelles.
Machiavel n’était pas un simple théoricien. Mêlé intimement par ses fonctions à la politique active de son pays, il avait souffert des dissensions qui bouleversaient les républiques italiennes, alors en plein régime syndicaliste et sans cesse troublées par les plus sanglantes discordes. Il avait vu en 1502, Florence réduite à créer un gonfalonat à vie qui n’était qu’une véritable dictature perpétuelle, c’est-à-dire du Césarisme pur. Cette dernière forme de gouvernement lui paraissait une phase fatale de l’anarchie qu’ont toujours engendrée les gouvernements populaires. Il ne se trompait guère, puisque toutes les républiques italiennes finirent, ainsi d’ailleurs que les républiques athénienne et romaine, de la même façon.
La plupart des règles relatives à l’art de conduire les hommes, enseignées par Machiavel, sont depuis longtemps inutilisables, et cependant, quatre siècles ont passé sur la poussière de ce grand mort, sans que nul ait tenté de refaire son œuvre.
La psychologie politique, ou science de gouverner, est pourtant si nécessaire que les hommes d’État ne sauraient s’en passer. Ils ne s’en passent donc pas, mais faute de lois formulées, les impulsions du moment et quelques règles traditionnelles fort sommaires, constituent leurs seuls guides.
De tels guides conduisent fréquemment à de coûteuses erreurs. Napoléon, si conscient de la psychologie des Français, ignora profondément celle des Russes et des Espagnols. Cette ignorance le jeta dans des guerres où tout son génie de conquérant échoua contre un patriotisme insoupçonné qu’aucune force n’aurait pu vaincre. Très mal conseillé, l’héritier de son nom accumula en Crimée, au Mexique, en Italie et ailleurs, des erreurs de psychologie fort graves qui nous valurent finalement une nouvelle invasion.
Les grands manieurs d’hommes sont nécessairement de grands psychologues. Sans la connaissance intime de la mentalité des individus et des peuples que possédait si bien Bismarck, la supériorité des armées germaniques n’aurait certainement pas suffi à fonder l’unité de l’Allemagne.
La psychologie politique s’édifie avec des matériaux divers dont les principaux sont la psychologie individuelle, la psychologie des foules et enfin, celle des races.
Les maîtres de notre enseignement considèrent évidemment ces connaissances comme fort inutiles, puisqu’on ne les trouve mentionnées dans aucun de leurs programmes. À l’École des sciences politiques, on semble même ignorer leur existence. N’est-il pas étrange qu’on puisse être reçu « docteur ès sciences politiques », sans avoir jamais entendu parler de connaissances qui sont pourtant les vraies bases de la politique ?
Quelques notions traditionnelles constituant le seul bagage psychologique des hommes d’État médiocres, ils se trouvent absolument désorientés devant certains problèmes nouveaux, dont la routine ne dit pas la solution. Les impulsions mobiles des partis devenant leurs guides, les erreurs alors commises sont innombrables.
Très longue en serait la liste, même limitée à ces dernières années. Erreur dangereuse de psychologie, cette séparation de l’Église et de l’État accordant au clergé une indépendance et une puissance que les plus catholiques de nos rois n’auraient jamais tolérées. Erreurs fondamentales de psychologie, nos principes d’éducation, si différents de ceux qui conduisirent l’Allemagne à réaliser tous ses progrès scientifiques, industriels et économiques. Erreurs de psychologie les idées d’assimilation auxquelles nos colonies doivent leur décadence. Erreur de psychologie, la mesure introduisant dans l’armée des apaches, jadis confinés dans des bataillons spéciaux composés d’autres apaches et où, par conséquent, leur contact ne pouvait contaminer personne. Erreur de psychologie aussi lourde, la capitulation du gouvernement dans la première grève des postiers. Erreurs de psychologie encore, un grand nombre de nos lois prétendues humanitaires. Erreur de psychologie toujours, cet utopique espoir de refaire les sociétés à coups de décrets et la croyance qu’un peuple peut se soustraire entièrement à l’influence de son passé.
Les forces qui déterminent les actions d’un peuple sont assurément complexes : forces naturelles, forces économiques, forces historiques, forces politiques, etc. Elles produisent finalement une certaine orientation de nos pensées et par conséquent de notre conduite. Ces forces si diverses se trouvent ainsi finalement transformées en forces psychologiques. C’est donc à ces dernières que toutes les autres se ramènent.
Les difficultés entre peuples sont quelquefois assez graves pour n’être résolues qu’à coups de canon. L’unique droit à invoquer alors est la loi du plus fort. Tels furent les différends de la Prusse et de l’Autriche, du Transvaal et de l’Angleterre, du Japon et de la Russie. Mais quand il s’agit de questions secondaires, les influences psychologiques habilement maniées réussissent parfois à remplacer les arguments militaires. Seul un adversaire très supérieur en puissance peut les dédaigner. Il frappera le sol de son épée comme le firent Napoléon et Bismarck et l’adversaire n’aura qu’à se taire en attendant l’heure de la revanche qui sonnera toujours.
Personne ne semble assez fort aujourd’hui pour employer ces procédés sommaires. Les enchevêtrements d’alliances ne permettent plus à aucun souverain de parler comme s’il était l’unique maître. L’aventure du Maroc a enseigné aux peuples le sort qui les attend s’ils ne savent pas solidariser leurs faiblesses pour se défendre.
C’est donc entre forces à peu près égales que s’engagent maintenant les discussions provoquées par les incidents de la vie quotidienne. Alors la psychologie reprend son rôle et l’action des diplomates peut devenir importante.
Il est indubitable cependant que cette action n’est plus aujourd’hui ce qu’elle était jadis. Instruit par le télégraphe, le téléphone, les journaux, le public discute passionnément les moindres événements politiques, pendant que les diplomates échangent lentement leurs notes obscures. Habitués autrefois à négocier dans l’ombre, il leur faut actuellement discuter en pleine lumière et suivre l’opinion au lieu de la précéder.
Et cependant leur rôle, injustement dédaigné, garde une certaine utilité. Des événements récents l’ont mise en évidence.
Plusieurs questions importantes furent en effet solutionnées grâce à des interventions diplomatiques. Bombardement des bateaux pêcheurs anglais par des cuirassés russes au début de la guerre avec le Japon, affaire de Casablanca, différend austro-russe à propos de la Serbie, etc. Si nous avions, à la veille de 1870, possédé des diplomates moins au-dessous de la plus navrante médiocrité, la guerre eût été ajournée à un moment où nous eussions pu préparer des alliances et non à celui choisi par l’ennemi.
C’est la psychologie politique encore qui apprend à résoudre des problèmes posés chaque jour. Discerner, par exemple, quand il faut céder ou résister aux exigences populaires. Selon leur tempérament, les hommes d’État cèdent indéfiniment ou résistent toujours. Détestable principe. Suivant les circonstances, il faut savoir résister ou au contraire céder. Aucune partie de la psychologie politique n’est plus difficile, et les conséquences des erreurs plus graves. La Révolution française eût été peutêtre évitée, sûrement atténuée, si à l’époque de la crise agricole et financière de 1788 qui avait accru la misère des classes ouvrières par la disette et le chômage, la classe aristocratique n’eût pas persisté à refuser l’égalité fiscale.
Il en résulta une haine intense contre les classes privilégiées et les émeutes qui engendrèrent la désagrégation d’un long passé.
Frappé autrefois de l’absence d’ouvrages spéciaux sur la psychologie politique, j’espérais toujours voir combler cette lacune.
Après dix années presque exclusivement consacrées aux expériences de physique d’où mon livre sur l’Évolution de la matière est sorti, ces recherches devinrent trop coûteuses pour être continuées. Je dus donc les abandonner et me résignai à reprendre d’anciennes études. Désireux d’appliquer à la politique les principes exposés dans plusieurs de mes précédents ouvrages, je priai mon éminent ami, le professeur Ribot, de m’indiquer les traités de psychologie politique publiés récemment. Sa réponse m’apprit qu’il n’en existait pas. Mon étonnement fut le même que lorsque 15 années auparavant voulant entreprendre l’étude de la psychologie des foules, je constatai qu’aucun écrit n’avait paru sur ce sujet.
Ce n’est pas, certe, que les dissertations politiques aient jamais manqué. Elles abondent au contraire depuis Aristote et Platon, mais leurs auteurs furent le plus souvent des théoriciens, étrangers aux réalités de leur temps et ne connaissant que l’homme chimérique enfanté par des rêves. Ni la psychologie, ni l’art de gouverner n’ont rien à leur demander.
L’absence d’ouvrages classiques sur un tel sujet et la non-existence de chaires consacrées à son enseignement prouvent que son utilité n’apparaît pas clairement. Il était donc nécessaire de la démontrer. Ce sera un des buts de ce livre.
La psychologie politique s’édifie, je l’ai dit plus haut, sur des matériaux tirés de l’étude de la psychologie individuelle, de celle des foules, de celle des peuples et enfin des enseignements de l’histoire. Plusieurs de ces matériaux commencent à être connus, mais ils ne sont pas le monument lui-même.
Dans l’état actuel de nos connaissances, la politique ne peut être qu’une adaptation journalière de la conduite à des nécessités. Rationnelles ou non, il n’importe si ce sont des nécessités. Les préjugés héréditaires d’un peuple et ses croyances religieuses peuvent être déclarées absurdes par la raison, mais un véritable homme d’État ne tentera jamais de les combattre, sachant qu’il ne peut le faire utilement. Seuls, des théoriciens, ignorants des réalités, croient que la raison pure gouvernera le monde et transformera les hommes. En réalité, l’intelligence prépare lentement les changements qui, à la longue, transformeront nos âmes, mais son action immédiate est très faible. Fort peu de choses peuvent être changées par elle brusquement.
La psychologie politique est encore, nous l’avons dit, dans l’âge des incertitudes. Cependant des règles (empiriques souvent, mais pourtant très sûres), se dégagent chaque jour. Ce n’est pas en les formulant qu’on saurait prouver leur valeur, mais bien en montrant les conséquences de leur ignorance. Ce sera encore un des buts que je me propose.
Le développement des principes qui m’ont servi de guide exigerait des commentaires que les dimensions de ce livre ne comportent pas. On les trouvera, longuement exposés dans mes ouvrages antérieurs.1
Je me suis presque exclusivement confiné dans ce livre à l’application des règles déterminables de la psychologie politique aux événements contemporains. Même limite à cette période très circonscrite, le sujet était encore si vaste qu’il m’a fallu souvent me contenter d’indications sommaires. Examiner le rôle de la psychologie politique dans l’histoire des peuples, dans la formation de leurs croyances, dans les luttes guerrières qui forment la trame de leur passé aurait nécessité plusieurs volumes.
Ayant à traiter des sujets un peu arides, capables par conséquent, d’effrayer le lecteur et d’épuiser facilement son attention, j’ai cherché à éviter les formes trop didactiques. Les propositions les plus sérieuses gagnent souvent à être présentées dans un cadre peu sévère.
Un des chapitres de cet ouvrage, consacré à décrire les facteurs de la persuasion, montre le rôle prépondérant de la répétition. C’est la conviction de son utilité qui m’a incité à répéter parfois les mêmes choses en termes peu différents. Je regrette que le défaut de place m’ait empêché de le faire davantage. Napoléon n’exagérait pas en disant que la répétition est la principale figure de rhétorique. Il est au moins permis d’affirmer qu’elle constitue un des plus actifs facteurs des convictions. Tous les grands hommes d’État ont été conscients de sa puissance. C’est au moyen de répétitions innombrables que l’empereur d’Allemagne réussit à persuader ses sujets de l’utilité des sacrifices nécessaires à la construction d’une grande flotte de guerre. L’ancien Président des États-Unis, monsieur Theodor Roosevelt, écrit donc très justement : « Toutes les grandes vérités fondamentales risquent de sonner comme des choses rebattues et pourtant, toutes rebattues qu’elles soient, elles ont besoin d’être réitérées encore et toujours ».
Si les répétitions sont nécessaires pour répandre des vérités connues, combien n’en faut-il pas pour faire accepter des vérités neuves. Je l’ai plus d’une fois expérimenté. Les apôtres qui, dans le cours des âges transformèrent nos conceptions et nos croyances n’y ont réussi que par des répétitions incessantes.
C’est qu’en effet le vrai mécanisme des convictions diffère profondément de celui qu’enseignent les livres. Fort utile pour des démonstrations scientifiques, le raisonnement ne joue qu’un rôle très faible dans la genèse de nos croyances. Les idées ne s’imposent nullement par leur exactitude, elles s’imposent seulement lorsque par le double mécanisme de la répétition et de la contagion, elles ont envahi ces régions de l’inconscient où s’élaborent les mobiles générateurs de notre conduite. Persuader ne consiste pas simplement à prouver la justesse d’une raison, mais bien à faire agir d’après cette raison.
1 Pour les principes généraux, voir : « L’homme et les sociétés, leurs origines et leur histoire », « Lois psychologiques de l’évolution des peuples », « Psychologie des foules », « Psychologie du socialisme », « Psychologie de l’éducation ». Pour les applications de la psychologie à l’histoire, voir : « Les premières civilisations de l’Orient » « La civilisation des Arabes », « Les civilisations de l’Inde », « Les opinions et les croyances », « La Révolution française et la psychologie des révolutions », « La vie des vérités »
Chapitre 2.
Les nécessités économiques et les théories politiques.
Les images évoquées dans l’esprit par des récits impressionnent médiocrement et c’est pourquoi les différences du passé et du présent n’apparaissent jamais bien clairement.
On ne se représente nettement les choses abstraites qu’en les comparant à des impressions concrètes déjà ressenties. Qui a vu une bataille ou un naufrage sera toujours impressionné par le récit d’événements semblables.
Cette représentation du passé par voie de comparaison concrète me fut rendue très frappante un jour dans les circonstances que voici :
Les hasards d’une excursion m’avaient conduit à traverser en automobile le pont jeté sur le fleuve qui divise en deux villes l’antique cité de Huy, en Belgique. Un brouillard tellement intense l’enveloppait qu’il fallut s’arrêter. Je descendis et m’accoudai au parapet.
Sous l’épais manteau de brume enveloppant les choses on entrevoyait des masses monumentales imposantes. C’était pour moi l’inconnu. J’attendis qu’il se dévoilât.
Soudain, un clair rayon de soleil dissipa les nuages et, dans une vision imprévue, surgirent, séparés par le fleuve, deux mondes, deux expressions de l’humanité dressées en face l’une de l’autre et qu’au premier coup d’œil on devinait menaçantes, inconciliables et terribles.
Sur la rive gauche un agrégat d’antiques édifices.
Dominant leur ensemble, un gigantesque châteaufort aux lignes rigides et une majestueuse cathédrale, dont la piété ardente de nombreuses générations avait pendant des siècles lentement festonné les contours.
Sur la rive droite, faisant face à ces grandes synthèses d’un autre âge, se développaient les murs tristes et nus d’une immense usine de briques grisâtres, surmontée de hautes cheminées, vomissant des torrents de fumée noire sillonnée de flammes.
À intervalles réguliers une porte s’ouvrait, livrant pas à de longues théories d’hommes hirsutes, couverts de sueur, la mine harassée, l’œil sombre. Fils d’ancêtres dominés par les dieux et les rois, ils n’avaient changé de maîtres que pour devenir les serviteurs du fer.
Et c’étaient bien deux mondes, deux civilisations en présence, obéissant à des mobiles différents, animés d’autres espoirs. D’un côté, un passé déjà mort mais dont nous subissons les volontés encore. De l’autre un présent chargé de mystères et portant dans ses flancs un avenir inconnu.
Ils existèrent toujours, ces deux mondes, et constamment hostiles, mais des sentiments semblables, une foi commune, comblait souvent l’abîme qui les séparait. Aujourd’hui, foi et sentiments ont disparu ne laissant debout que l’atavique hostilité du pauvre contre le riche. Libérés graduellement des croyances et des liens sociaux du passé, les travailleurs modernes se révèlent de plus en plus agressifs et oppressifs, menaçant les civilisations de tyrannies collectives qui feront peut-être regretter celle des pires despotes. Ils parlent en maître à des législateurs qui les flattent servilement et subissent tous leurs caprices. Le poids du nombre cherche chaque jour davantage à se substituer au poids de l’intelligence.
La vie politique est une adaptation des sentiments de l’homme au milieu qui l’entoure. Ces sentiments varient peu, car la nature humaine se transforme fort lentement, tandis que le milieu moderne évolue rapidement en raison des progrès continuels de la science et de l’industrie.
Quand l’ambiance extérieure se modifie trop vite, l’adaptation est difficile et il en résulte le malaise général observé aujourd’hui. Faire cadrer la nature de l’homme avec les nécessités de tout ordre qui l’étreignent, et dont il n’est pas maître, constitue un problème sans cesse renaissant et toujours plus ardu.
Le monde ancien et le monde moderne diffèrent profondément par leurs pensées et leurs modes d’existence. Les éléments nouveaux qui nous mènent ne dérivent pas de raisonnements abstraits et n’oscillent nullement au gré de nos espérances ou de nos conceptions logiques. Ils sont les résultats de nécessités que nous subissons, et ne créons pas.
L’âge actuel ne diffère point de ceux qui l’ont précédé, par les rivalités et les luttes, car ces dernières naissent de passions qui ne varient guère. La différence réelle porte principalement sur la dissemblance des facteurs qui font aujourd’hui évoluer les peuples. C’est ce point essentiel que je vais essayer de marquer maintenant.
Les véritables caractéristiques de ce siècle sont : d’abord, la substitution de la puissance des facteurs économiques à celle des rois et des lois. En second lieu, l’enchevêtrement des intérêts entre peuples jadis séparés et n’ayant rien à s’emprunter.
Ce dernier phénomène, d’origine relativement récente, a une importance considérable. Les peuples ne sont plus comme jadis isolés et à peu près dénués de relations commerciales. Ils vivent tous les uns des autres et ne pourraient subsister les uns sans les autres. L’Angleterre serait vite réduite à la famine si elle était entourée d’un mur empêchant l’arrivée des matières alimentaires qu’elle va chercher au dehors et paie avec d’autres marchandises.
Ces conditions nouvelles d’existence permettent de pressentir que dans tous les grands mouvements industriels et commerciaux qui transforment la vie des nations, créent la richesse sur un point, la pauvreté sur d’autres, l’influence des gouvernements, si considérable autrefois, devient chaque jour plus faible. Convaincus eux-mêmes de leur impuissance, ils suivent les mouvements et ne les dirigent plus. Les forces économiques sont les vrais maîtres et dictent les volontés populaires auxquelles on ne résiste guère.
Il y a 60 ans (1850), un souverain était encore assez puissant pour décréter le libre-échange dans son pays. Aucun n’oserait même le tenter aujourd’hui. Que la protection condamnée par la plupart des économistes, soit bonne ou nuisible, il importe peu. Elle répond aux volontés populaires de l’heure présente et cette heure est entourée de nécessités trop accablantes pour que les hommes d’État songent beaucoup à l’avenir.
Ils se font d’ailleurs souvent illusion sur les conséquences de leur intervention. Ces chefs dociles d’armées très indociles, obéissent toujours et ne commandent plus.
Dans une séance du 11 mars 1910, monsieur Méline assurait devant le Sénat que le libre-échange avait ruiné l’agriculture anglaise, dont la production de blé a baissé de plus de la moitié en un demi-siècle, alors que sous le régime de la protection, la France qui, en 1892, avait un déficit alimentaire de 695 millions l’a vu disparaître et remplacé par un excédent de 5 millions, permettant d’exporter du blé au lieu d’en importer. Le célèbre économiste attribue naturellement au régime de la protection, dont il fut l’apôtre, les 700 millions que les agriculteurs retirent maintenant du sol.
On peut cependant assurer, sans crainte d’erreur, que depuis l’origine du monde aucune loi n’eut un tel pouvoir créateur. En fait, la nouvelle production agricole résulte uniquement des immenses progrès scientifiques réalisés par une agriculture qui se sentait très menacée.
Et si les Anglais n’ont pas accompli les mêmes progrès ce n’est nullement parce que le libre-échange les empêchait de lutter contre la concurrence étrangère, mais simplement parce qu’ils ont trouvé beaucoup plus rémunérateur de fabriquer des produits industriels, de la vente desquels ils retirent plus d’argent qu’il ne leur en faut pour acheter tout le blé nécessaire.
Que le régime protectionniste soit utile ou nuisible n’est d’ailleurs pas à considérer ici. Dans la politique actuelle, et c’est là justement ce que je voulais montrer, il ne s’agit pas de rechercher le meilleur, mais uniquement l’accessible. De nos jours aucun despote ne serait assez fort, je le répète, pour imposer le libre-échange ou la protection à un pays qui n’en voudrait pas. Quand les peuples se trompent, tant pis pour eux. L’expérience le leur fait savoir. Quelques hommes de génie, aidés par les circonstances arrivent parfois à remonter des courants mais leur nombre fut toujours fort petit.
Ce qui précède montre bien à quel point les facteurs de l’heure présente diffèrent de ceux du passé et permet de pressentir le peu d’influence des théories politiques sur l’évolution des peuples. Avec les progrès de la science, de l’industrie et des relations internationales, sont nés d’invisibles mais tout puissants maîtres auxquels les peuples et leurs souverains eux-mêmes doivent obéir.
Les éléments économiques de la vie des peuples constituent donc des nécessités auxquels ils sont forcés de s’adapter puisqu’ils ne peuvent s’y soustraire. À ces nécessités naturelles s’en joignent d’autres, très artificielles, qu’essaient de créer les théoriciens de la politique et les gouvernements qui les suivent. Étudions leur rôle.
Malgré toutes les ressources de leurs laboratoires, les biologistes n’ont jamais réussi à transformer une seule espèce vivante. Les légères modifications extérieures que réussit à créer l’art de l’éleveur sont sans durée et sans force.
Est-il plus facile de transformer un organisme social qu’un être vivant ? La réponse affirmative à cette question a dirigé toute notre politique depuis plus d’un siècle et la dirige encore.
La possibilité de refaire les sociétés au moyen d’institutions nouvelles sembla toujours évidente aux révolutionnaires de tous les âges, ceux de notre grande Révolution surtout. Elle apparaît aussi certaine aux socialistes. Tous aspirent à rebâtir les sociétés sur des plans dictés par la raison pure.
Mais à mesure qu’elle progresse, la science contredit de plus en plus cette doctrine. Appuyée sur la biologie, la psychologie et l’histoire, elle montre que nos limites d’action sur une société sont fort restreintes, que les transformations profondes ne se réalisent jamais sans l’action du temps, que les institutions sont l’enveloppe extérieure d’une âme intérieure. Ces dernières constituent une sorte de vêtement capable de s’adapter à une forme intérieure mais impuissant à la créer, et c’est pourquoi des institutions excellentes pour un peuple peuvent être détestables pour un autre. Loin d’être le point de départ d’une évolution politique, une institution en est simplement le terme.
Certes, le rôle des institutions et des hommes sur les événements n’est pas nul. L’histoire le montre à chaque page, mais elle exagère leur puissance et ne s’aperçoit pas qu’ils sont le plus souvent l’éclosion d’un long passé. S’ils n’arrivent pas au moment nécessaire, leur action est simplement destructrice comme celle des conquérants.
Croire qu’on modifie l’âme d’un peuple en changeant ses institutions et ses lois est resté un dogme que nous aurons à combattre fréquemment dans cet ouvrage et dont il faudra bien revenir un jour.
Les peuples latins n’en sont pas revenus encore, et c’est ce qui fait leur faiblesse. Leurs illusions sur la puissance des institutions nous a coûté la plus sanglante révolution qu’ait connue l’histoire, la mort violente de plusieurs millions d’hommes, la décadence profonde de toutes nos colonies et les progrès menaçants du socialisme. Rien n’a pu l’ébranler, ce terrible dogme et nous ne cessons de l’appliquer rigoureusement chaque jour aux malheureux indigènes tombés entre nos mains et que nous conduisons ainsi à la haine et à la révolte.
Les journaux ont fourni récemment un nouvel exemple de cet aveuglement général en reproduisant quelques extraits d’une circulaire du gouverneur de la Côte d’Ivoire à ses administrateurs. Son résultat final a été le soulèvement du pays, le massacre de plusieurs officiers et la très coûteuse nécessité d’envoyer de la métropole, des troupes nombreuses pour rétablir l’ordre. Si les Anglais ou les Hollandais gouvernaient leurs colonies avec de tels principes, depuis longtemps elles seraient perdues.
Ce document, dont je vais donner les plus saillants passages, illustre nettement notre irréductible incapacité à comprendre que l’âme d’un peuple ne se transforme pas avec des décrets et que des institutions excellentes pour un peuple peuvent être très mauvaises pour un autre et, en tout cas, inapplicables toujours.
« Il faudra, écrit ce gouverneur, que nos sujets viennent au progrès malgré eux… C’est à l’autorité à obtenir ce qui serait refusé à la persuasion… Il faudra modifier du tout au tout la mentalité noire pour nous faire comprendre… Ce que je ne veux pas, c’est que nous fassions étalage d’une sensibilité sans résultat. Dussionsnous ne pas sembler tenir compte, dès l’abord, des désirs de l’indigène, il importe que nous suivions sans faiblesse l’unique voie susceptible de nous mener au but… Je ne crois nullement qu’il faille redouter les conséquences de notre action, même lorsque celle-ci ne respectera pas des usages dont le mieux qu’on en puisse penser est qu’ils sont opposés à tout progrès. »
Ce n’est pas la mentalité noire qu’il serait urgent de modifier (si la chose dépendait de notre volonté), mais celles des administrateurs capables de signer les lignes précédentes.
Quant à l’illusion du brave gouverneur « ne redoutant nullement les conséquences de son intervention », les événements lui ont donné une rude leçon qui, malheureusement, ne profitera guère. Le propre d’une croyance fut toujours de n’être modifiable ni par l’observation, ni par le raisonnement, ni par l’expérience. Les croyances politiques ont la même ténacité que les dogmes religieux, bien qu’ils n’en possèdent pas toujours la durée.
Ce dogme de la transformation de l’âme des peuples sous l’influence des institutions est d’ailleurs indiscuté en France par tous les partis, y compris les plus conservateurs.
Les progrès de la psychologie moderne permettent d’expliquer le rôle joué par la raison dans l’organisation des sociétés, leurs croyances et leur conduite. Il est très faible bien que tous les gouvernements prétendent s’appuyer sur elle.
J’ai montré dans un autre ouvrage (Les opinions et les croyances), que contrairement aux enseignements de la philosophie classique, il existe des formes de logique fort distinctes de la logique rationnelle : la logique mystique et la logique affective notamment. Elles sont tellement séparées qu’on ne peut jamais passer de l’une à l’autre et, par conséquent, exprimer l’une en langage de l’autre.
Sur la logique rationnelle s’édifient toutes les formes de la connaissance, les sciences exactes notamment. Avec les logiques affective et mystique se bâtissent nos croyances, c’est-à-dire les facteurs de la conduite des individus et des peuples.
La logique rationnelle régit le domaine du conscient où se fabriquent les interprétations de nos actes. C’est dans le domaine du subconscient, gouverné par des influences affectives et mystiques, que s’élaborent leurs vraies causes.
L’observation montre que les sociétés sont guidées surtout par les logiques affective et mystique que la logique rationnelle ne saurait guère les influencer et encore moins les transformer.
L’âme simple des réformateurs est trop inaccessible à la genèse des choses pour comprendre que les institutions ne s’édifient pas avec des raisonnements logiques, mais cette notion est devenue évidente aujourd’hui aux hommes d’État anglais. Un de leurs ministres disait récemment, en plein Parlement, que le grand mérite de la Constitution anglaise était de n’être pas rationnelle. C’est, en effet, sa force, alors que la faiblesse des innombrables constitutions engendrées par nos révolutions, depuis un siècle, en France, est justement de n’être basées que sur la raison pure.
Cette idée restant incompréhensible à des cerveaux latins, il serait inutile d’y insister ici. Je me bornerai donc à rappeler que les religions, les gouvernements, les actes politiques, en un mot tout ce qui constitue la trame de l’existence d’un peuple, n’est jamais fondé sur des raisons. Savoir manier les sentiments pour influencer l’opinion est le vrai rôle des hommes d’État. Les apparences semblent prouver parfois qu’ils agissent souvent par la logique de leurs discours. Tout autre, en réalité, nous le verrons dans cet ouvrage, est le mécanisme de la persuasion. Les multitudes ne sont jamais impressionnées par la vigueur logique d’un discours, mais bien par les images sentimentales que certains mots et associations de mots font naître. Les propositions enchaînées au moyen de la logique rationnelle servent uniquement à les encadrer. En admettant qu’un discours simplement logique produise une conviction, elle sera toujours éphémère et ne constituera jamais un mobile d’action.
Mais si ce n’est pas la logique rationnelle qui conduit les hommes et fait évoluer leurs croyances, comment expliquer qu’au moment de la Révolution des théories uniquement déduites de la raison pure produisirent si rapidement de profonds bouleversements ?
Avant de montrer que cette contradiction n’est qu’apparente, rappelons tout d’abord que la Révolution n’eut, en réalité, qu’un seul théoricien influent, Rousseau.
L’action de Montesquieu, notable à ses débuts, devint vite très faible. Ce dernier cherchait surtout à expliquer des organisations sociales déjà existantes. Rousseau proposait de refaire une société nouvelle. Ce doux halluciné croyait que l’homme, heureux à l’état de nature, avait été dépravé et rendu misérable par les institutions. La raison exigeait donc qu’on les refit. Il était également convaincu que le vice essentiel des sociétés est l’inégalité, et que l’origine du mal social est l’antithèse de la richesse et de la pauvreté. Nécessité, par conséquent, de changer tout cela en établissant d’abord la souveraineté populaire. C’est précisément ce que ses disciples tentèrent par les moyens énergiques que l’on connaît, dès que les résistances du roi, de la noblesse et du clergé engendrèrent des violences qui les amenèrent au pouvoir. Robespierre, Saint-Just et les Jacobins cherchèrent uniquement à appliquer les théories de leur maître.
L’influence de Rousseau ne disparut nullement avec la Révolution. Monsieur Lanson fait justement remarquer que « depuis un siècle, tous les progrès de la démocratie, égalité, suffrage universel, l’écrasement des minorités, les revendications des partis extrêmes, la guerre à la richesse et à la propriété ont été dans le sens de son œuvre.
Nous verrons qu’en réalité il fut beaucoup moins un inspirateur qu’un prétexte.
La rapidité avec laquelle se propagèrent les idées de Rousseau au moment de la Révolution est frappante. Nous savons par les cahiers généraux de 1789, ce que la majorité des Français demandait alors : abolition des privilèges féodaux, lois fixes, justice uniforme, etc., c’est-à-dire à peu près ce que Napoléon réalisa par son Code. La royauté était encore universellement respectée et personne ne demandait à la supprimer.
Et cependant, trois ans plus tard les théories énoncées plus haut régnaient souverainement et la Terreur supprimait ceux qui ne les vénéraient pas.
Il semble donc qu’il y ait contradiction évidente entre ce que nous avons dit du peu d’influence des théories déduites de la raison pure, sur la marche des événements et l’action si rapide que ces théories semblèrent exercer pendant la Révolution.
Nous accentuerons encore cette contradiction en affirmant que les hommes de chaque âge sont gouvernés par un très petit nombre d’idées directrices qui s’établissent fort lentement et ne deviennent des mobiles d’actions qu’après s’être transformées en sentiments.
En réalité, la contradiction, malgré sa netteté apparente, n’existe pas. Si en effet, les idées des théoriciens de la Révolution s’implantèrent facilement dans l’âme des foules, ce n’est nullement parce qu’elles étaient nouvelles, mais uniquement parce qu’elles étaient au contraire fort anciennes. Les théories révolutionnaires ne firent que prêter l’appui des lois à des passions n’ayant jamais cessé d’exister et à des aspirations, que les nécessités sociales peuvent réprimer ou endormir, mais qui ne s’éteignent jamais.
Le peuple avait accepté la puissance royale et les inégalités de conditions, parce que maintenues par une antique armature sociale elles semblaient d’indestructibles nécessités naturelles. Dès qu’il entendit des gouvernants, auxquels le pouvoir suprême conférait un grand prestige, son despotisme devait remplacer celui des rois, que les inégalités de fortune étaient une injustice et qu’on allait lui distribuer les biens de ses anciens maîtres, il devait fatalement adopter avec enthousiasme de telles idées et considérer comme des ennemis dignes du dernier supplice ceux qui auraient pu s’opposer à la réalisation de ses appétits. Si, de nos jours, un gouvernement s’appuyant sur l’autorité de philosophes réputés, édictait des lois autorisant le meurtre et le pillage, il compterait bientôt un grand nombre de sectateurs et serait aussi applaudi que lorsqu’il proposa de s’emparer du milliard des congrégations pour le distribuer aux ouvriers et à des amis. Certes la pratique de pareilles doctrines ne subsiste pas longtemps car on découvre vite, comme il arriva après quelques années de révolution, que l’anarchie ruine et n’enrichit pas. Et alors, toujours ainsi qu’à cette époque, la nation chercherait un dictateur énergique capable de la soustraire au désordre.
On s’illusionne souvent sur le rôle utile des gouvernements et les limites de ce rôle, parce que leur puissance, très faible pour le bien, est au contraire très grande pour le mal. Il fut toujours aisé de détruire et difficile de rebâtir. Aujourd’hui, nous n’avons pas à nous défendre seulement contre les rigides nécessités économiques de l’heure présente, mais encore contre le zèle désastreux de législateurs légiférant au hasard, comme nous le montrerons bientôt, suivant les impulsions du moment. Lois, dites sociales, qui gênent de plus en plus l’industrie et n’enrichissent personne. Lois entravant l’apprentissage au point d’avoir chassé les apprentis des usines et transformé un grand nombre d’entre eux en chômeurs, voleurs et criminels, ainsi que le prouvent les rapides progrès de la criminalité infantile. Persécutions religieuses incessantes et expropriations dont le résultat final a été de diviser la France en deux peuples ennemis. Lois douanières qui, par les représailles qu’elles provoquent continuellement, finiront par supprimer entièrement notre commerce avec l’étranger, etc. Toutes ces lois créées par une raison trop courte sont des calamités artificielles qui s’ajoutent aux maux naturels dont nous sommes bien obligés de supporter le poids.
Nous n’avions, certes, pas l’idée de faire ici le procès de la raison, mais de ceux prétendant l’employer à modifier des phénomènes qu’elle ne saurait régir. C’est exclusivement sur la raison que s’édifient la science et toutes les formes de la connaissance. C’est surtout avec des sentiments et des croyances que se gouvernent les hommes et se fait l’histoire.
Chapitre 3.
Méthodes d’étude de la psychologie politique.
En psychologie politique, comme d’ailleurs dans les autres sciences, ce sont les faits d’abord, puis leur interprétation qui permettent de dégager des lois.
En politique, l’observation des faits est beaucoup plus facile que leur interprétation, c’est-à-dire que la détermination de leurs causes et la prévision de leurs conséquences. Nos armées ont été battues en 1870. Voilà un fait connu de chacun. Mais pourquoi ont-elles été battues ? Quelles réformes devraient-elles subir afin d’éviter une nouvelle défaite ? Ici les difficultés s’accumulent et les explications varient considérablement. Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner les théories contradictoires, révélées par la série de règlements militaires édictés pendant vingt ans, ou simplement les écrits des spécialistes. Si d’ailleurs l’interprétation des phénomènes sociaux était aisée, nous serions d’accord sur tout, alors qu’en réalité nous ne le sommes sur rien.
Donc, quoique les faits politiques faisant partie de la vie journalière soient d’une observation facile, la détermination de leurs causes est au contraire difficile. Elle l’est d’autant plus que les parties d’un événement dont nous prenons conscience ne sont généralement qu’un très faible fragment de l’événement lui-même.
Dans une pareille étude, la simple intuition ne saurait suffire. Des méthodes rigoureuses deviennent nécessaires. Elles sont de même ordre que celles employées dans les sciences, l’histoire naturelle notamment.
Le psychologue doit opérer un peu comme le naturaliste qui, mettant en relief par une analyse attentive les réalités cachées sous de trompeuses apparences, réunit ensemble des phénomènes d’aspect dissemblable. Ainsi arrive-t-il à classer la baleine avec les mammifères au lieu de la considérer comme un poisson. Pour l’observateur superficiel, la baleine paraît évidemment plus rapproché du requin que d’un écureuil et c’est cependant avec ce dernier qu’on doit la comparer. En politique, malheureusement, les apparences seules frappent et non les relations cachées.
Les généralités qui précèdent montrent que la première difficulté de la psychologie politique est de découvrir les facteurs rapprochés ou lointains des événements et de ne pas attribuer à une seule cause, comme on le fait généralement, ce qui est le résultat de plusieurs.
Je ne saurais trop insister sur cette difficulté. Pour en prouver l’importance, je vais prendre un cas concret relativement assez simple, l’extension du socialisme, et par la seule énumération de quelques-uns des facteurs ayant déterminé cette extension, mettre en évidence leur complexité.
À la base du socialisme, on trouve d’abord un élément fondamental : l’Espérance. Espérance d’améliorer son sort et de se créer un avenir heureux.
Un tel facteur possède assurément une grande puissance. À lui seul, pourtant, il ne fournirait qu’une explication bien incomplète du problème, l’espoir d’améliorer sa destinée ayant constitué de tout temps un des principaux mobiles de l’activité des hommes.
Nous irons plus loin en remarquant qu’autrefois il était beaucoup moins nécessaire qu’aujourd’hui d’améliorer sa vie, puisqu’elle devait l’être dans un monde futur, sur la réalité duquel on ne gardait aucun doute, alors qu’on n’y croit guère aujourd’hui. Ce que l’homme espérait d’une autre existence n’est recherché maintenant qu’ici-bas. L’explication de l’extension du socialisme commence ainsi à se préciser davantage.
Un nouvel élément d’interprétation apparaîtra si l’on observe que le socialisme, dont la forme humanitaire s’accentue chaque jour, devient une religion remplaçant celles en voie de disparaître. La psychologie moderne enseigne que le sentiment religieux, c’est-à-dire la vénération du mystère et le besoin de se soumettre à un credo capable d’orienter nos pensées, est une tendance irréductible de l’esprit.
L’apôtre socialiste est un clérical ayant changé le nom de ses dieux. Son âme demeure saturée d’une religiosité ardente. Le journal L’Humanité du 30 novembre 1909, nous apprend que le jeune professeur à la Sorbonne qui ouvrit, récemment, la première séance de l’École socialiste, « adressa, comme il convenait, une invocation émue à la déesse Raison ! »
Les facteurs psychologiques que nous venons d’indiquer présentent un caractère général les rendant applicables à tous les peuples. Or, il est visible que le socialisme prend, d’un pays à l’autre, des formes diverses. Certains éléments d’interprétation doivent donc s’ajouter encore aux précédents.
Nous trouverons tout d’abord le rôle de la race, c’està-dire des dispositions héréditaires des nations. Elles diffèrent profondément et c’est pourquoi le mot socialisme est une étiquette commune traduisant des aspirations très dissemblables. Comment pourraient-elles être de même nature chez des peuples d’instincts opposés, ceux des États-Unis, par exemple, comptant exclusivement sur leur énergie, leur initiative individuelle, et ceux dominés, comme les Latins, par l’irrésistible et perpétuel besoin de la protection d’un maître ?
En dehors des aptitudes de race, un autre facteur psychologique capital intervient encore : le passé. Il est évident que des peuples centralisés depuis des siècles sous la main d’un État réglementant les moindres détails de leur vie sociale, industrielle, commerciale et même religieuse, ne sauraient posséder les mêmes aspirations, les mêmes tendances, que de jeunes nations n’ayant derrière elles qu’un passé politique très court, incapable par conséquent, de peser lourdement sur elles.
Le collectivisme étatiste, qui nous enserre de plus en plus, fut pratiqué en réalité de tout temps par nos monarchies, et c’est pourquoi les peuples latins y reviennent facilement. Les minutieuses réglementations de Colbert formeraient un excellent chapitre d’un traité de socialisme étatiste.
L’État étant considéré aujourd’hui comme une divinité protectrice, tous les partis, toutes les classes, devaient naturellement lui demander d’intervenir dans leurs affaires et défendre leurs intérêts. Ce furent d’abord les industriels qui le prièrent de les protéger, afin de les enrichir, par des droits de douanes, des primes, des subventions, etc. On détruisait évidemment ainsi la concurrence, mais en paralysant du même coup toute initiative et, par conséquent, tout progrès.
Devenues puissantes par le nombre, les classes ouvrières réclamèrent à leur tour la protection de l’État, mais, cette fois, contre les maîtres de l’industrie. En leur cédant, on entra davantage dans la voie socialiste ouverte par le protectionnisme.
Pour satisfaire de croissantes exigences, l’État s’engagea dans le chemin de l’arbitraire despotique et des spoliations : retraites ouvrières obligatoirement payées par les patrons, c’est-à-dire charité forcée à leurs dépens, rachat des chemins de fer, et extension progressive des monopoles, de façon à transformer les ouvriers en fonctionnaires entretenus par l’État, etc.
Mais tout cela coûtant fort cher et l’engrenage des répercussions se déroulant fatalement, les législateurs en sont maintenant conduits à essayer de dépouiller les possédants par de lourds impôts progressifs, sans comprendre, d’ailleurs, que le petit nombre de ces privilégiés rendra dérisoires les sommes obtenues. Leur spoliation devant avoir pour conséquence ultime la ruine des grandes industries, on n’arrivera finalement ainsi qu’à l’égalité dans la misère. Ce sera le nivellement rêvé par tant d’âmes que domine la haine des supériorités.
Bien que déjà longue, notre énumération des facteurs de l’évolution socialiste ne les contient pas tous. Il faudrait rechercher encore comment les doctrines se propagent dans les multitudes, pourquoi des mots et des formules très vagues possèdent parfois tant de puissance. On se trouve alors en présence de nouveaux facteurs importants créés par la spéciale mentalité des foules.
Mais l’examen des causes de l’extension du socialisme ne serait nullement terminé par cette étude, puisqu’il sévit non seulement dans les multitudes illettrées, mais encore parmi des professeurs et des bourgeois aisés, satisfaits de leur sort.
Il devient alors nécessaire de faire intervenir d’autres facteurs psychologiques et notamment, la contagion mentale par imitation. Elle se retrouve toujours à l’aube des grandes croyances et explique leur propagation.
Si tant de facteurs agissent dans un phénomène social, il doit paraître bien difficile de doser leurs influences respectives. Le problème est ardu, en effet.
Comment le résoudre ? On le peut par deux méthodes différentes, l’une très simple, l’autre assez compliquée.
La méthode simple, et pour cette raison d’un usage général, consiste à supposer les phénomènes engendrés par une cause unique et de compréhension facile. Trouver des remèdes apparents à tous les maux devient alors aisé. Les ouvriers d’un pays se déclarent-ils mécontents de leur sort ? Décrétons un impôt sur le revenu qui permettra de dépouiller les riches pour enrichir les travailleurs. La population d’un pays est-elle stationnaire ? Établissons de lourdes charges sur les citoyens qui n’ont pas assez d’enfants. En auront-ils davantage ? Des économistes endurcis pourraient seuls en douter.
Ainsi raisonnent les politiciens à mentalité courte et leur simplisme, que j’ai dû condenser un peu dans mes exemples, nous a valu de détestables lois.
Voyons maintenant quelle méthode doit suivre l’observateur qui veut utiliser les enseignements de la psychologie politique.
Un événement social quelconque résultant le plus souvent d’un grand nombre de facteurs immédiats ou lointains, la première règle est d’apprendre à les séparer, la seconde d’évaluer exactement la valeur respective de chacun d’eux.
Ainsi opère le physicien en présence d’un phénomène pouvant dériver de plusieurs causes. Sa tâche est relativement facile, parce que des expériences répétées lui permettent de vérifier ses premières déductions. Mais, pour les phénomènes politiques, l’observation seule et non l’expérience constitue l’unique guide. Certes, les expériences sociales ne manquent pas. Elles sont même innombrables, mais indépendantes de nous et de nos volontés. Ne pouvant les renouveler, nous en sommes réduits à les interpréter. On sait trop à quelles divergences conduisent ces interprétations et dans quel discrédit la sociologie est pour cette raison tombée.
Il ne devient vraiment possible de doser la valeur d’un facteur déterminé qu’en le voyant agir d’une façon semblable dans des temps divers et chez des peuples différents, alors que tous les autres facteurs sont restés invariables. C’est un peu, on le voit, une application de la méthode dite des variations concomitantes. N’étant applicable qu’à des cas très simples on n’en dégage le plus souvent que des banalités d’utilité restreinte : l’anarchie engendre le césarisme, les peuples faibles sont conquis par les peuples forts, etc.
La dissociation des éléments générateurs d’un événement est cependant facilitée par la constatation que chaque phénomène social est habituellement le résultat de deux catégories de facteurs très distincts : les uns permanents, les autres transitoires.
Les premiers agissent d’une façon constante dans tous les phénomènes. Telle, par exemple, la race, c’est-àdire les dispositions héréditaires. Tel aussi le passé social qui comprend les sentiments religieux, politiques ou sociaux fixés dans l’âme des peuples et rendus stables par un long passé.
Les facteurs transitoires changent au contraire fréquemment, mais, agissant sur le fond peu mobile du résidu ancestral, ils en reçoivent toujours l’empreinte. C’est pour cette raison, que des peuples de races différentes soumis en même temps aux mêmes facteurs transitoires réagissent de façons diverses. Certes, l’histoire paraît souvent montrer qu’un peuple peut, au moins en apparence, transformer ses croyances, ses institutions et ses arts, mais sous les changements extérieurs le passé reparaît toujours et modifie bientôt les formes que les révolutions violentes avaient fait momentanément adopter.
Les influences de la race et du passé, habituellement négligées, parce qu’invisibles, sont en réalité les plus nécessaires à étudier. Elles dominent effectivement toute l’évolution d’un peuple. C’est ainsi, par exemple, qu’en France, sous des agitations politiques variées, nous retrouvons deux principes fixes, communs à tous les peuples latins et ayant invariablement dirigé leurs actes :
1°/ La croyance dans le pouvoir transformateur de l’État.
2°/ La confiance inébranlable dans la puissance absolue des lois.
De ces deux principes, que nous étudierons dans plusieurs chapitres, sont nés l’extension de l’Étatisme et le développement du socialisme collectiviste qui n’en est que la floraison.
Il apparaît donc indispensable pour juger des événements relatifs à un peuple de connaître les caractères de sa race et de son histoire.
En ce qui concerne la race, cette étude n’est pas très compliquée, les caractéristiques fondamentales générales étant peu nombreuses. On sait déjà beaucoup des Américains des États-Unis et de leur avenir possible lorsqu’on a observé quelques-uns de leurs caractères essentiels tels que l’énergie, la confiance dans ses propres forces, l’optimisme, le besoin de justice et de liberté personnelle, l’habitude de l’initiative suppléant l’intervention du gouvernement. Alors que certains peuples ne peuvent être étudiés sans la connaissance préalable de leur gouvernement, le citoyen des États-Unis doit au contraire être observé surtout en dehors de son gouvernement. Réduit à ses seules ressources, il progresse sans aucune aide et, à lui seul, ce caractère psychologique aurait suffi pour tracer sa destinée.
Un examen analogue des tristes républiques latines de l’Amérique, impuissantes à sortir de l’anarchie où elles végètent, montrerait également un très petit nombre de caractères psychologiques fondamentaux dominant toute leur histoire. Un peuple de métis est ingouvernable.
Donc, la connaissance des grands facteurs généraux qui déterminent, ou tout au moins orientent les autres, simplifie un peu le problème de la psychologie politique.
Il est encore très difficile cependant. Les facteurs transitoires agissant à côté des facteurs permanents sont en effet si nombreux que leur complication déroute parfois toute logique. Comment déterminer leur rôle ?
En observant qu’outre les grands facteurs irréductibles dont je viens de marquer l’action, il existe pour chaque époque un petit nombre de principes directeurs canalisant les pensées et les actes dans un même sens. C’est ainsi, par exemple, que la politique du second Empire fut orientée par le principe dit des nationalités, que le socialisme actuel évolue sous l’influence d’une idée maîtresse : l’égalisation des situations sociales sous la tutelle de l’État, etc.
Il résulte de toutes ces considérations que, dans la genèse d’un événement, figurent toujours des éléments nombreux mais d’inégale importance. Le rôle de la psychologie politique consiste précisément à savoir doser cette importance, discerner le principal et éliminer l’accessoire.
L’élimination des facteurs secondaires est aussi malaisée en politique que dans une science quelconque, la physique ou l’astronomie notamment. Elle est pourtant aussi nécessaire.
Avec les progrès scientifiques actuels, la genèse de tout phénomène apparaît infiniment complexe. La simplicité des causes n’est créée que par l’insuffisance de nos moyens d’observation. Un poids placé sur le plateau d’une balance n’est pas attiré seulement par la terre, puisque la lune et tous les autres astres du firmament agissent sur lui. Mais leurs milliers d’attractions sont si minimes en comparaison de celle exercée par notre planète qu’on n’en tient aucun compte.
Toute la sagacité du savant consiste à savoir dégager les facteurs principaux d’un phénomène et négliger les autres. Képler ne réussit à formuler ses lois qu’en mettant de côté les perturbations accessoires modifiant faiblement le cours des planètes.
Le véritable homme d’État ne procède pas différemment, mais semblable au savant encore, il doit se rappeler que tel facteur, sans importance à un moment donné, peut en acquérir à un autre. Le physicien considère comme vraie la loi de Mariotte parce qu’il néglige des éléments trop accessoires pour la modifier visiblement dans les conditions habituelles de température, mais il sait aussi que lorsque les gaz se trouvent au voisinage de leur point critique, des facteurs justement négligés d’abord deviennent maintenant prépondérants. La loi est alors inexacte et il faut lui en substituer une autre.
La notion de loi absolue, chère aux savants du dernier siècle, tend à disparaître graduellement de la science. Les principes de la psychologie politique ne sauraient assurément prétendre à plus de fixité que les lois physiques. Ils sont d’ailleurs troublés sans cesse par l’intervention d’éléments imprévus. C’est ainsi qu’à certains moments l’influence des facteurs habituels disparaît devant de brusques courants d’opinion. Si l’homme d’État en connaît le mécanisme, il peut les faire naître ou tout au moins les orienter comme y réussit Bismarck en 1870.
Ces subits mouvements d’opinion constituent une force morale, si irrésistible parfois, que nulle puissance ne parviendrait à les endiguer. Napoléon, lui-même, savait que certains courants ne se remontent pas. Plusieurs de ses lettres sont caractéristiques sur ce point. « Ce sont, écrivait-il, les faits qui parlent. C’est la direction de l’esprit public qui entraîne… Je n’ai jamais été mon maître. J’ai toujours été gouverné par les circonstances. »
La puissance, comme aussi la mobilité de ces mouvements populaires, se révèle à chaque page de notre histoire. Ils sont nombreux dans un seul siècle. L’Épopée impériale, la Restauration monarchique, le romantisme, le second Empire, l’aventure boulangiste, etc., en donnent autant d’exemples. Le Prince de Machiavel s’appelle aujourd’hui la multitude. Son pouvoir devient formidable dès que toutes les volontés s’orientent dans une seule direction. Une telle orientation ne dure d’ailleurs jamais longtemps et l’homme d’État doit le savoir encore.
Les courants populaires d’une époque sont souvent mal saisis par les hommes de cette époque. Au début de la Révolution, personne ne prévoyait l’avenir terrible qui se préparait. On l’a dit avec raison : pendant que le navire sombrait, les passagers se congratulaient du naufrage. Madame de Genlis menait les princes d’Orléans, dont elle était gouvernante, voir la démolition de la Bastille. La noblesse regardait tout ce mouvement avec autant de sympathie que notre aveugle bourgeoisie a contemplé la première grève des postiers. Alors, comme aujourd’hui, personne ne comprenait que les phénomènes psychologiques ont un enchaînement nécessaire et que chacun d’eux devient cause à son tour. Toutes ces causes accumulées dans le même sens produisent, comme en mécanique, une accélération fatale.
Nous voyons à quel point est difficile la tâche actuelle des chefs qui veulent sagement gouverner. Elle l’est d’autant plus qu’ayant une mentalité différente de la foule et obéissant à d’autres mobiles, ils ne savent pas toujours la comprendre et lui parler.
On ne connaît bien les hommes d’une classe que si l’on appartient à cette classe. C’est pourquoi les meneurs de la Confédération Générale du Travail, sortis des couches populaires, se font si parfaitement obéir. Des grands principes, des belles théories humanitaires, ils n’ont nul souci, sachant bien que les foules ne s’en préoccupent pas davantage. Inaccessibles à tout raisonnement elles acceptent sans discussion des croyances condensées en formules brèves et violentes et se soumettent sans murmures aux ordres les plus impérieux à condition qu’ils soient édictés par des hommes ou des comités revêtus de prestige.