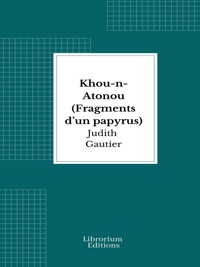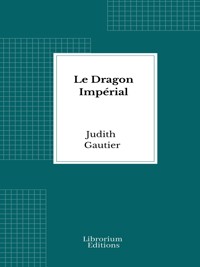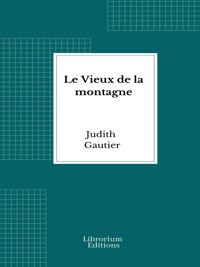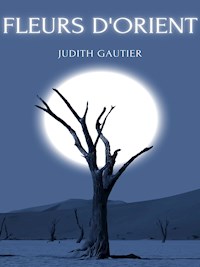0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La nuit allait finir. Tout dormait dans la belle et joyeuse Osaka. Seul, le cri strident des sentinelles, s’appelant sur les remparts, traversait, par instants, le silence que rien ne troublait plus, hors la lointaine rumeur de la mer dans le golfe.
Au-dessus de la grande masse sombre, formée par les Palais et les jardins du siogoun[1], une étoile s’effaçait lentement. Le crépuscule matinal frissonnait dans l’air. La cime des bois commençait à découper plus nettement ses ondes sur le ciel qui bleuissait.
Bientôt une lueur pâle toucha les plus hauts arbres, puis se glissa entre les branches et les feuillages et filtra jusqu’au sol. Alors, dans les jardins du prince, des allées encombrées de ronces en fleur ébauchèrent leur vaporeuse perspective ; l’herbe reprit sa couleur d’émeraude ; une touffe de pivoines vit revenir l’éclat de ses fleurs somptueuses, et un escalier blanc se dévoila à demi de la brume dans le lointain d’une avenue.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
La Sœur du Soleil
Judith Gautier
© 2025 Librorium Editions
ISBN : 9782385749132
La Sœur du Soleil
LE BOIS DE CITRONNIERS
LA BLESSURE DE NAGATO
LA FÊTE DU GÉNIE DE LA MER
LA SŒUR DU SOLEIL
LES CAVALIERS DU CIEL
LA CONFRÉRIE DES AVEUGLES
LE PARJURE
LE CHÂTEAU D’OVARI
LA MAISON DE THÉ
LE RENDEZ-VOUS
LES CAILLES GUERRIÈRES
LE VERGER OCCIDENTAL
LES TRENTE-TROIS DÎNERS DU MIKADO
LA CHASSE AU VOL
L’USURPATEUR
LES PÉCHEURS DE LA BAIE D’OSAKA
L’ÎLE DE LA LIBELLULE
LA PRINCIPAUTÉ DE NAGATO
UNE TOMBE
LES MESSAGERS
LA KISAKI
LE MIKADO
FATKOURA
LE TRAITÉ DE PAIX
CONFIDENCES
LE GRAND THÉÂTRE D’OSAKA
OMITI
DÉSORMAIS MA MAISON SERA TRANQUILLE
LA GRANDE PRÊTRESSE DU SOLEIL
BATAILLES
LE BÛCHER
I
LE BOIS DE CITRONNIERS
La nuit allait finir. Tout dormait dans la belle et joyeuse Osaka. Seul, le cri strident des sentinelles, s’appelant sur les remparts, traversait, par instants, le silence que rien ne troublait plus, hors la lointaine rumeur de la mer dans le golfe.
Au-dessus de la grande masse sombre, formée par les Palais et les jardins du siogoun[1], une étoile s’effaçait lentement. Le crépuscule matinal frissonnait dans l’air. La cime des bois commençait à découper plus nettement ses ondes sur le ciel qui bleuissait.
Bientôt une lueur pâle toucha les plus hauts arbres, puis se glissa entre les branches et les feuillages et filtra jusqu’au sol. Alors, dans les jardins du prince, des allées encombrées de ronces en fleur ébauchèrent leur vaporeuse perspective ; l’herbe reprit sa couleur d’émeraude ; une touffe de pivoines vit revenir l’éclat de ses fleurs somptueuses, et un escalier blanc se dévoila à demi de la brume dans le lointain d’une avenue.
Enfin, brusquement, le ciel s’empourpra ; des flèches de lumière, traversant les buissons, firent étinceler des gouttes d’eau sur les feuilles. Un faisan s’abattit ; lourdement une grue secoua ses ailes neigeuses et, avec un long cri, s’envola lentement dans la clarté, tandis que la terre fumait comme une cassolette et que les oiseaux, à pleine voix, acclamaient le soleil levant.
Aussitôt que l’astre divin fut monté de l’horizon, les vibrations d’un gong se firent entendre. Il était frappé dans un rythme monotone d’une mélancolie obsédante : quatre coups forts, quatre coups faibles, quatre coups forts, et ainsi toujours. C’était pour saluer le jour et annoncer les prières matinales.
Un rire jeune et sonore, qui éclata soudain, surmonta un instant ce bruit pieux, et deux hommes apparurent, sombres, sur le ciel clair, au sommet de l’escalier blanc.
Ils s’arrêtèrent un instant, sur la plus haute marche, pour admirer le charmant fouillis de broussailles, de fougères, d’arbustes en fleur, qui formait les rampes de l’escalier.
Puis ils descendirent lentement à travers les ombres fantasques que jetaient les branches sur les degrés.
Arrivés au pied de l’escalier, ils s’écartèrent vivement pour ne pas culbuter une tortue qui cheminait sur la dernière marche : la carapace de cette tortue avait été dorée, mais la dorure s’était un peu ternie dans l’humidité des herbes.
Les deux hommes s’avancèrent dans l’avenue.
Le plus jeune des promeneurs avait à peine vingt ans, mais on lui en eût donné davantage à voir la fière expression de son visage et l’assurance de son regard ; cependant, lorsqu’il riait, il semblait un enfant ; mais il riait peu et une sorte de tristesse hautaine assombrissait son front charmant.
Son costume était très simple sur une robe de crêpe gris, il portait un manteau de satin bleu sans aucune broderie ; il tenait à la main un éventail ouvert.
La toilette de son compagnon était, au contraire, extrêmement recherchée. La robe était faite d’une soie blanche, molle, faiblement teintée de bleu, comme si elle eût gardé un reflet de clair de lune ; elle tombait en plis fins jusqu’aux pieds et était serrée à la taille par une ceinture de velours noir. Celui qui la portait avait vingt-quatre ans ; il était d’une beauté parfaite ; un charme étrange émanait de la pâleur chaude de son visage, de ses yeux d’une douceur moqueuse, et surtout, de la nonchalance méprisante de toute sa personne ; il appuyait sa main sur la riche poignée d’un de ses deux sabres dont les pointes relevaient les plis de son manteau de velours noir, jeté sur ses épaules les manches pendantes.
Les deux promeneurs avaient la tête nue, leurs cheveux, tordus en corde, étaient noués sur le sommet du crâne.
— Mais enfin, où me conduis-tu, gracieux maître ? s’écria tout à coup l’aîné des deux jeunes hommes.
— Voici trois fois que tu me fais cette question depuis le palais, Ivakoura.
— Mais tu ne m’as rien répondu, gloire de mes yeux !
— Eh bien c’est une surprise que je veux te faire. Ferme les yeux et donne-moi ta main.
Ivakoura obéit, et son compagnon lui fit faire quelques pas dans l’herbe.
— Regarde à présent, dit-il.
Ivakoura ouvrit les yeux et laissa échapper un faible cri d’étonnement.
Devant lui s’épanouissait un bois de citronniers tout en fleur. Chaque arbre, chaque arbuste semblaient couverts de givre ; sur les plus hautes tiges, le jour naissant jetait des tons de rose et d’or. Toutes les branches ployaient sous leur charge parfumée, les grappes fleuries s’écroulaient jusqu’au sol, sur lequel traînaient quelques rameaux trop lourds.
Parmi cette blanche floraison d’où émanait une fraîcheur délicieuse, un tendre feuillage apparaissait çà et là par brindilles.
Vois, dit le plus jeune homme, avec un sourire, j’ai voulu partager avec toi, mon préféré, le plaisir de voir avant tout autre cette éclosion merveilleuse. Hier, je suis venu, le bois était comme un buisson de perles ; aujourd’hui, toutes les fleurs sont ouvertes.
— Je songe, en voyant ce bois, à un distique du poète des fleurs de pêcher, dit Ivakoura « Il a neigé sur cet arbre des ailes de papillons qui, en traversant le ciel matinal, se sont teintes de rose. »
— Ah s’écria le plus jeune homme en soupirant, je voudrais me plonger au milieu de ces fleurs comme dans un bain et m’enivrer jusqu’à mourir de leur parfum violent !
Ivakoura, après avoir admiré, faisait une mine un peu désappointée.
— Des fleurs plus belles encore allaient éclore dans mon rêve, dit-il, en étouffant un bâillement. Maître, pourquoi m’as-tu fait lever si tôt ?
— Voyons, prince de Nagato, dit le jeune homme, en posant sa main sur l’épaule de son compagnon, je ne t’ai pas fait lever ; tu ne t’es pas couché cette nuit !
— Que dis-tu ? s’écria Ivakoura ; qu’est-ce qui peut te faire croire cela ?
— Ta pâleur, ami, et tes yeux las.
— Ne suis-je pas toujours ainsi ?
— La toilette que tu portes serait encore trop somptueuse à l’heure du coq[2] ; et regarde ! le soleil se lève à peine, nous sommes à l’heure du lapin[3].
— Pour honorer un maître tel que toi, il n’est pas d’heure trop matinale.
— Est-ce aussi pour m’honorer, infidèle sujet, que tu te présentes devant moi armé ? Ces deux sabres, oubliés à ta ceinture, te condamnent ; tu venais de rentrer au palais lorsque je t’ai fait appeler.
Le coupable baissait la tête, renonçant à se défendre.
— Mais qu’as-tu au bras ? s’écria tout à coup le plus jeune homme en apercevant une mince bandelette blanche qui dépassait la manche d’Ivakoura.
Celui-ci cacha son bras derrière son dos et montra l’autre main.
— Je n’ai rien, dit-il.
Mais son compagnon lui saisit le bras qu’il cachait. Le prince de Nagato laissa échapper un cri de douleur.
— Tu es blessé, n’est-ce pas ! Un jour on viendra m’annoncer que Nagato a été tué dans une querelle futile. Qu’as-tu fais encore, imprudent incorrigible ?
— Lorsque le régent Hiéyas sera en ta présence, tu ne le sauras que trop, dit le prince ; tu vas apprendre de belles choses, ô illustre ami, sur le compte de ton indigne favori. Il me semble entendre vibrer déjà la voix terrible de cet homme à qui rien n’est caché : Fidé-Yori, chef du Japon, fils du grand Taïko-Sama, dont je vénère la mémoire, de graves désordres ont troublé cette nuit Osaka ! …
Le prince de Nagato contrefaisait si bien la voix de Hiéyas que le jeune siogoun ne put s’empêcher de sourire.
— Et quels sont ces désordres ? diras-tu. — Portes enfoncées, coups, tumultes, scandales. — Connaît-on les auteurs de ces méfaits ? — Celui qui conduit les autres est le seul coupable et je connais ce coupable. — Qui est-ce ? — Qui ! sinon celui que l’on trouve dans toutes les aventures, dans toutes les batailles nocturnes ; qui, sinon le prince de Nagato, la terreur des honnêtes familles, l’épouvante des gens paisibles ? Et comme tu me pardonneras, ô trop clément, Hiéyas te reprochera ta faiblesse, en la faisant sonner bien haut, afin que cette faiblesse nuise au siogoun et profite au régent.
— Mais si je me courrouçais enfin de ta conduite, Nagato, dit le siogoun, si je t’envoyais passer un an dans ta province ?
— J’irais, maître, sans murmurer.
— Oui, et qui m’aimerait ici ? dit tristement Fidé-Yori. Je vois autour de moi de grands dévouements, mais pas une affection comme la tienne mais peut-être suis-je injuste, ajouta-t-il, tu es le seul que j’aime, et c’est sans doute à cause de cela qu’il me semble n’être aimé que de toi.
Nagato leva vers le prince un regard plein de reconnaissance.
— Tu te sens pardonné par moi, n’est-ce pas ? dit Fidé-Yori en souriant, mais tâche de m’éviter les reproches du régent ; tu sais combien ils me sont pénibles. Va le saluer, l’heure de son lever est proche ; nous nous reverrons au conseil.
— Il va donc falloir sourire à cette laide figure, grommela Nagato.
Mais il avait son congé. Il salua le siogoun et s’éloigna d’un air boudeur.
Fidé-Yori continua à se promener dans l’avenue, mais il revint bientôt vers le bois de citronniers. Il s’arrêta devant lui pour l’admirer encore, et cueillit une mince branche, chargée de fleurs. Mais alors les feuillages se mirent à bruire comme sous un grand vent ; un brusque mouvement agita les branches et, entre les fleurs refoulées, une jeune fille apparut.
Le prince se recula vivement et faillit jeter un cri ; il se crut le jouet d’une vision.
Qui es-tu ? s’écria-t-il peut-être le génie de ce bois ?
— Oh ! non, dit la jeune fille d’une voix tremblante ; mais je suis une femme bien audacieuse.
Elle sortit du bois, au milieu d’une pluie de pétales blancs, et s’agenouilla dans l’herbe en tendant les mains vers le roi.
Fidé-Yori baissa la tête vers elle et la regarda curieusement. Elle était d’une beauté exquise : petite, gracieuse, comme écrasée sous l’ampleur de ses robes. On eût dit que c’était leur poids soyeux qui l’avait jetée à genoux. Ses grands yeux purs, pareils à des yeux d’enfant, étaient peureux et suppliants, ses joues, veloutées comme les ailes des papillons, rougissaient un peu, et sa petite bouche, entr’ouverte d’admiration, laissait briller des dents blanches comme des gouttes de lait.
— Pardonne-moi, disait-elle, pardonne-moi d’être en ta présence sans ta volonté.
— Je te pardonne, pauvre oiseau tremblant, dit Fidé-Yori, car si je t’avais connue et si j’avais su ton désir, ma volonté eût été de te voir. Que veux-tu de moi ? Est-il en ma puissance de te faire heureuse ?
— Ô maître ! s’écria la jeune fille avec enthousiasme, d’un mot tu peux me rendre plus radieuse que TenSio-Daï-Tsin, la fille du soleil.
— Et quel est ce mot ?
— Jure-moi que tu n’iras pas demain à la fête du Génie de la mer.
— Pourquoi ce serment ? dit le siogoun, étonné de cette étrange supplique.
— Parce que, dit la jeune fille en frémissant sous les pieds du roi, brusquement un pont s’effondrera et que, le soir, le Japon n’aura plus de maître.
— Tu as sans doute découvert une conspiration ? dit Fidé-Yori en souriant.
Devant ce sourire d’incrédulité, la jeune fille pâlit et ses yeux s’emplirent de larmes.
— Ô disque pur de la lumière s’écria-t-elle, il ne me croit pas ! Tout ce que j’ai fait jusqu’à présent n’est rien. Voici l’obstacle terrible et je n’y avais pas songé. On écoute la voix du grillon qui annonce la chaleur, on prête l’oreille à la grenouille qui coasse une promesse de pluie ; mais une jeune fille qui vous crie : Prends garde ! j’ai vu le piège, la mort est sur ton chemin on ne l’écoute pas et on marche droit au piège. Cependant, cela est impossible, il faut que tu me croies. Veux-tu que je me tue à tes pieds ? Ma mort serait un gage de ma sincérité. D’ailleurs, quand même je me serais trompée, que t’importe ! tu peux toujours ne pas aller à la fête. Écoute, je viens de loin, d’une province lointaine ; seule, sous la lourde angoisse de mon secret, j’ai déjoué les espions les plus subtils, j’ai vaincu mes terreurs et dominé ma faiblesse. Mon père me croit en pèlerinage à Kioto, et tu vois : je suis dans ta ville, dans l’enceinte de tes palais. Cependant les sentinelles sont vigilantes, les fossés larges, les murailles hautes. Vois, mes mains sont en sang, la fièvre me brûle. Tout à l’heure j’ai cru ne pas pouvoir parler tant mon cœur affaibli frémissait de ta présence et aussi de la joie de te sauver. Mais maintenant j’ai le vertige, j’ai de la glace dans le sang : tu ne me crois pas !
— Je te crois et je jure de t’obéir, dit le roi ému de cet accent désespéré ; je n’irai pas à la fête du Génie de la mer.
La jeune fille poussa un cri de joie et regarda avec reconnaissance le soleil qui s’élevait au-dessus des arbres.
— Mais apprends-moi comment tu as découvert ce complot, reprit le siogoun, et quels en sont les auteurs.
Oh ! ne m’ordonne pas de te le dire. Tout cet édifice d’infamie que je fais crouler, c’est sur moi-même qu’il croule.
Soit, jeune fille, garde ton secret ; mais dis-moi au moins d’où te vient ce grand dévouement et pourquoi ma vie est pour toi si précieuse ?
La jeune fille leva lentement les yeux vers le roi, puis elle les baissa et rougit, mais ne répondit rien. Une vague émotion troubla le cœur du prince. Il se tut et se laissa envahir par cette impression pleine de douceur. Il eût voulu demeurer ainsi longtemps, en silence, au milieu de ces chants d’oiseaux, de ces parfums, près de cette enfant agenouillée.
— Apprends-moi qui tu es, toi qui me sauves de la mort, dit-il enfin, et indique-moi la récompense digne de ton courage.
— Je me nomme Omiti, dit la jeune fille ; je ne peux rien te dire de plus. Donne-moi la fleur que tu tiens à la main, c’est tout ce que je veux de toi.
Fidé-Yori lui tendit la branche de citronnier ; Omiti la saisit et s’enfuit à travers le bois.
Le siogoun demeura longtemps immobile à la même place, soucieux, regardant le gazon foulé par le poids léger d’Omiti.
↑
Général du royaume. C’est le même titre que taïcoun : grand chef ; mais ce dernier terme n’a été créé qu’en 1854.
↑
Six heures après-midi.
↑
Six heures du matin.
II
LA BLESSURE DE NAGATO
Le prince de Nagato était rentré dans son palais.
Il dormait, étendu sur une pile de fines nattes. Autour de lui régnait une obscurité presque complète, car on avait baissé les stores et déployé de grands paravents devant les fenêtres. Quelques parois de laque noire luisaient cependant dans l’ombre et reflétaient vaguement, comme des miroirs troubles, la tête pâle du prince, renversée sur les coussins.
Nagato n’avait pu réussir à voir Hiéyas : le régent était absorbé par une affaire très urgente, lui avait-on dit. Tout heureux de cette circonstance, le jeune prince s’était hâté d’aller se reposer pendant les quelques heures qu’il avait à lui avant le conseil.
Dans les chambres voisines de celle où il dormait, les serviteurs allaient et venaient silencieusement, préparant la toilette du maître. Ils marchaient avec précaution pour ne pas faire craquer le parquet et causaient entre eux à voix basse.
— Notre pauvre maître n’a pas de raison, disait une femme âgée, en secouant des gouttes de parfum sur un manteau de cérémonie. Toujours des fêtes, des promenades nocturnes, jamais de repos ; il se tuera.
— Oh ! que non, le plaisir ne tue pas, dit un jeune garçon à la mine insolente, vêtu de couleurs vives.
— Qu’en sais-tu, puceron ? reprit la servante. Ne dirait-on pas qu’il passe sa vie en réjouissances comme un seigneur ? Ne parle pas aussi effrontément de choses que tu ne connais pas !
— Je les connais peut-être mieux que toi, dit l’enfant en faisant une grimace, toi qui n’es pas encore mariée, malgré ton grand âge et ta grande beauté.
La servante envoya le contenu de son flacon à la figure du jeune garçon, mais celui-ci se cacha derrière le disque d’argent d’un miroir qu’il frottait pour le rendre limpide, et le parfum s’éparpilla à terre. Le valet avança la tête lorsque le danger fut passé.
— Veux-tu de moi pour mari ? dit-il, tu me donneras de tes années, et à nous deux nous ferons un jeune couple !
La servante, dans sa colère, laissa échapper un éclat de voix.
— Te tairas-tu, à la fin ? dit un autre serviteur en la menaçant du poing.
— Mais il est impossible d’entendre ce jeune vaurien sans s’irriter et rougir !
— Rougis tant que tu voudras, dit l’enfant, cela ne fait pas de bruit.
— Allons, tais-toi, Loo ! dit le serviteur.
Loo fit un mouvement d’épaules et une grosse moue, puis il se remit nonchalamment à frotter le miroir.
À ce moment, un homme entra dans la salle :
— Je désire parler à Ivakoura, prince de Nagato, dit-il à haute voix.
Tous les serviteurs firent de grands gestes des mains et des bras pour imposer silence au nouvel arrivant. Loo se précipita vers lui et lui appliqua sur la bouche le chiffon dont il se servait pour frotter le miroir ; mais l’homme le repoussa violemment.
— Que signifie tout ceci ? dit-il. Êtes-vous insensés ? Je veux parler au seigneur que vous servez, au daïmio très illustre qui règne sur la province de Nagato. Prévenez-le et cessez vos grimaces.
— Il dort, dit tout bas un serviteur.
— On ne peut l’éveiller, dit un autre.
— Il est affreusement fatigué, dit Loo un doigt sur la bouche.
— Malgré sa fatigue, il sera heureux de ma venue, dit l’étranger.
— Nous avons ordre de ne l’éveiller que quelques instants avant l’heure du conseil, dit la servante.
— Ce n’est pas moi qui me risquerai à l’aller tirer de son sommeil, dit Loo, en poussant sa bouche vers son oreille.
— Ni moi, dit la vieille.
— J’irai moi-même, si vous voulez, dit le messager ; d’ailleurs, l’heure du conseil est proche : je viens de voir le prince d’Arima se diriger vers la salle des Milles-Nattes.
— Le prince d’Arima ! s’écria Loo, lui qui est toujours en retard !
— Hélas ! dit la servante, aurons-nous le temps d’habiller le maître ?
Loo fit glisser une cloison dans sa rainure et ouvrit un étroit passage il entra alors doucement dans la chambre de Nagato.
Il faisait frais dans cette chambre, et une odeur de camphre et de musc emplissait l’air.
— Maître ! maître ! dit Loo à demi voix, c’est l’heure, et puis il y a là un messager.
— Un messager ! s’écria Nagato, en se dressant sur un coude ; comment est-il ?
— Il est vêtu comme un samouraï[1] : des sabres sont passés à sa ceinture.
— Qu’il entre vite, dit le prince avec un tremblement dans la voix.
Loo alla faire signe au messager, qui se prosterna au seuil de la chambre.
— Approche ! dit Nagato.
Mais le messager ne pouvant se diriger dans cette salle obscure, Loo ploya, une feuille d’un paravent qui interceptait le jour. Une bande de lumière entra dans la chambre ; elle éclaira la délicate texture de la natte qui couvrait le plancher et fit briller sur la muraille une cigogne argentée, au cou onduleux, aux ailes ouvertes.
Le messager s’approcha du prince et lui tendit un mince rouleau de papier, enveloppé d’un morceau de soie, puis il sortit de la chambre à reculons.
Nagato déroula vivement le papier et lut ceci :
« Tu es venu, illustre, je le sais mais pourquoi cette folie et pourquoi ce mystère ? Je ne puis comprendre tes actions. J’ai reçu de graves réprimandes de ma souveraine à cause de toi. Tu sais : je traversais les jardins pour la suivre jusqu’à son palais, lorsque, tout à coup, je te vis adossé à un arbre. Je ne pus retenir un cri et, à ce cri, elle se retourna vers moi et suivit la direction de mon regard.
« Ah dit-elle, c’est la vue de Nagato qui t’arrache de pareils cris. Ne pourrais-tu au moins les retenir et me cacher le spectacle de ton impudeur ?
« Puis elle s’est retournée plusieurs fois vers toi. Le courroux de ses yeux me faisait peur. Je n’oserai pas paraître devant elle demain, et je t’envoie ce message pour te supplier de ne plus renouveler ces étranges apparitions qui ont pour moi des suites si funestes.
« Hélas ! ne sais-tu pas que je t’aime, et faut-il te le dire : je serai ta femme quand tu le voudras… Mais tu te plais à m’adorer comme une déesse de la pagode des Trente-Trois mille Trois cent Trente-Trois[2]. Si tu n’avais risqué ta vie plusieurs fois, seulement pour m’apercevoir, je croirais que tu te joues de moi. Je t’en conjure, ne m’expose plus à de pareilles réprimandes, et n’oublie pas que je suis prête à te reconnaître pour mon seigneur, et que vivre près de toi est mon plus cher désir. »
Nagato sourit et referma lentement le rouleau ; il fixa son regard sur la bande claire que la fenêtre jetait sur le plancher et rêva profondément.
Le jeune Loo était fort désappointé ; il avait essayé de lire derrière son maître, mais le rouleau était écrit en caractères chinois et sa science était prise en défaut ; il savait assez bien le kata-kana et avait même quelques connaissances de l’hira-kana, mais il ignorait, malheureusement, l’écriture chinoise. Pour cacher son dépit, il s’approcha d’une fenêtre et, soulevant un coin du store, il regarda dehors.
— Ah ! dit-il, le prince de Satsouma et le prince d’Aki arrivent en même temps ; les gens de leur suite se regardent de travers. Ah ! Satsouma passe devant. Oh ! oh ! voici le régent qui traverse l’avenue, il regarde par ici et il rit en voyant que le cortège du prince de Nagato est encore devant sa porte ; il rirait bien plus s’il savait où en est la toilette de mon maître.
— Laisse-le rire, Loo, et viens ici, dit le prince, qui avait détaché de sa ceinture un pinceau et un rouleau de papier et écrivait à la hâte quelques mots. Cours chez le roi et remets-lui ce papier.
Loo s’enfuit à toutes jambes, bousculant et renversant à plaisir ceux qui se trouvaient sur son passage.
— Et maintenant, dit Ivakoura, qu’on m’habille rapidement !
Les serviteurs s’empressèrent et le prince eut bientôt enfilé le vaste pantalon traînant qui donne à celui qui le porte l’air de marcher à genoux, et le roide manteau de cérémonie, alourdi encore par les insignes brodés sur les manches. Ceux de Nagato étaient ainsi composés : un trait noir au-dessus de trois boules, formant pyramide.
Le jeune homme, d’ordinaire si soigneux de sa parure, ne prêta aucune attention à l’œuvre des serviteurs, il ne jeta pas même un coup d’œil sur le miroir, si bien poli par Loo, lorsqu’on lui posa sur la tête le haut bonnet pointu, lié par des rubans d’or.
Aussitôt sa toilette terminée, il sortit de son palais, mais sa préoccupation était si forte qu’au lieu de monter dans le norimono, qui l’attendait au milieu des gens de son escorte, il s’éloigna à pied, traînant sur le sable son immense pantalon, et s’exposant aux rayons du soleil. Le cortège, épouvanté de cet outrage à l’étiquette, le suivit dans un inexprimable désordre, tandis que les espions, chargés de surveiller les actions du prince, s’empressaient d’aller rendre compte à leurs différents maîtres de cet événement extraordinaire.
Les remparts de la résidence d’Osaka, larges et hautes murailles, flanquées de loin en loin d’un bastion demi-circulaire, forment un immense carré qui enferme plusieurs palais et de vastes jardins. Au sud et à l’ouest, la forteresse s’appuie à la ville ; au nord, le fleuve qui traverse Osaka s’élargit et forme au pied du rempart un fossé colossal ; à l’orient une rivière plus étroite le borde. Sur le terre-plein des murailles, on voit une rangée de cèdres centenaires, à la verdure sombre, qui projettent leurs ramures plates et horizontales par-dessus les créneaux. À l’intérieur, une seconde muraille, précédée d’un fossé, enferme les parcs et les palais, réservés aux princes et à leur famille. Entre cette muraille et les remparts sont situées les habitations des fonctionnaires, des soldats. Une troisième muraille entoure le palais même du siogoun, qui s’élève sur une colline. Cet édifice se développe largement avec une simplicité architecturale pleine de noblesse. Des tours carrées à plusieurs toitures le surpassent çà et là. Des escaliers de marbre, bordés d’une légère balustrade laquée, et flanqués, à la base, de deux monstres de bronze ou de deux grands vases de faïence, montent vers les galeries extérieures ; la terrasse qui précède le palais est couverte de gravier et de sable blanc qui réverbère l’éclat du soleil.
Au centre de l’édifice s’élève une tour carrée, large, très haute et magnifiquement décorée. Elle supporte sept toits dont les angles se recourbent vers le ciel ; sur la plus haute toiture se tordent deux monstrueux poissons d’or qui resplendissent et sont visibles de tous les points de la ville.
C’est dans la partie du palais voisine de cette tour que se trouve la salle des Mille-Nattes, lieu de réunion du conseil.
Les seigneurs arrivent de tous côtés ; Ils gravissent les rampes de la colline et se dirigent vers le portique central du palais qui s’ouvre sur une longue galerie, conduisant directement à la salle des Mille-Nattes.
Cette salle, très vaste, très haute, est parfaitement vide de meubles. Des cloisons mobiles, glissant dans des rainures, l’entrecoupent et forment, lorsqu’on les fait se rejoindre, des compartiments de diverses dimensions. Mais les cloisons sont toujours largement écartées de façon à produire d’heureux effets de perspective. Ces panneaux, dans tel compartiment, sont revêtus de laque noire fleurie d’or, dans tel autre de laque rouge ou de bois de Jeseri, dont les veines forment naturellement d’agréables dessins. Ici, la cloison, peinte par un artiste illustre, a son envers tendu de satin blanc brodé de lourdes fleurs ; ailleurs, sur un fond d’or mat, un pêcher, couvert de fleurs roses, étend ses branches noueuses, ou bien, simplement, sur du bois sombre un semis inégal de points blancs, rouges, noirs, papillote aux yeux. Les nattes qui couvrent le plancher sont couleur de neige et frangées d’argent.
Les seigneurs, avec leurs larges pantalons dépassant les pieds, semblent s’avancer à genoux, et les étoffes froissent les nattes avec un bruit continu, semblable au susurrement lointain d’une cascade. Les assistants gardent d’ailleurs un religieux silence. Des hattamotos, gens d’une récente noblesse, instituée par le régent, s’accroupissent dans les angles les plus reculés, tandis que les samouraïs d’ancienne noblesse, possesseurs de fiefs et vassaux des princes, passent près de ces nouveaux anoblis en leur jetant des regards de mépris et se rapprochent sensiblement du grand store baissé, voilant l’estrade réservée au siogoun. Les Seigneurs de la terre, princes souverains dans leur province, forment un grand cercle devant le trône, laissant un espace libre pour les treize membres du conseil.
Les conseillers arrivent bientôt ; ils se saluent les uns les autres et échangent quelques mots à voix basse, puis gagnent leur place.
À gauche, présentant le profil au store baissé, s’alignent les conseillers supérieurs. Ils sont cinq, mais quatre seulement présents. Le plus proche du trône est le prince de Satsouma, vénérable vieillard au long visage, plein de bonté. Près de lui s’étale la natte de l’absent. Puis vient le prince de Sataké, qui mordille ses lèvres, tout en disposant avec soin les plis de sa toilette. Il est jeune, brun de peau ; ses yeux, très noirs, sont d’une vivacité extraordinaire. Près de lui s’installe le prince de Ouésougui, homme un peu gras et nonchalant. Le dernier est le prince d’Isida, petit de taille et laid de visage.
Les huit conseillers inférieurs, accroupis en face du trône, sont les princes d’Arima, de Figo, de Vakasa, d’Aki, de Tosa, d’Issé et de Couroda.
Un mouvement se produit du côté de l’entrée et tous les fronts se courbent vers le sol. Le régent pénètre dans la salle. Il s’avance rapidement, n’étant pas embarrassé comme les princes par les plis du pantalon traînant, et il va s’asseoir, les jambes croisées, sur une pile de nattes à droite du trône.
Hiéyas était alors un vieillard. Sa taille se voûtait faiblement ; il était large des épaules, cependant, et musculeux. Sa tête, à demi rasée, montrait à découvert un front vaste, bosselé d’arcades sourcilières proéminentes. Sa bouche mince, à l’expression cruelle et volontaire, abaissait ses coins profondément creusés ; ses pommettes étaient extrêmement saillantes, et ses yeux bridés, à fleur de tête, dardaient un regard brusque et sans franchise.
Il jeta en entrant un mauvais coup d’œil, accompagné d’un demi-sourire, vers la place laissée vide par le prince de Nagato. Mais, lorsque le store se releva, le siogoun apparut, s’appuyant d’une main sur l’épaule du jeune conseiller.
Le régent fronça le sourcil.
Tous les assistants se prosternèrent, appuyant leur front contre le sol. Lorsqu’on se releva, le prince de Nagato était à son rang comme les autres.
Fidé-Yori s’assit et fit signe à Hiéyas qu’il pouvait parler.
Alors le régent lut plusieurs rapports peu importants : nominations de magistrats, mouvement de troupes sur la frontière, changement de résidence d’un gouverneur après son règne expiré. Hiéyas expliquait brièvement et avec volubilité les raisons qui l’avaient fait agir. Les conseillers parcouraient des yeux les manuscrits, et, n’ayant pas d’objection à faire, acquiesçaient d’un geste. Mais bientôt le régent ploya tous ces papiers et les remit à un secrétaire placé près de lui ; puis il reprit la parole après avoir toussé.
— J’ai convoqué aujourd’hui cette assemblée extraordinaire, dit-il, afin de lui faire part des craintes que j’ai conçues pour la tranquillité du royaume en apprenant que la surveillance sévère, ordonnée contre les bonzes d’Europe et les Japonais qui ont embrassé la doctrine étrangère, se relâche singulièrement, et que ceux-ci recommencent leurs menées, dangereuses pour la sécurité publique. Je viens donc demander que l’on remette en vigueur la loi qui ordonne l’extermination de tous les chrétiens.
Un singulier brouhaha se produisit dans l’assemblée, mélange d’approbation, de surprise, de cris d’horreur et de colère.
— Veux-tu donc voir revenir les scènes sanglantes et hideuses dont l’épouvante est dans toutes les mémoires ? s’écria le prince de Sataké avec sa vivacité accoutumée.
— Il est étrange d’affirmer que de pauvres gens qui ne prêchent que la vertu et la concorde puissent troubler la paix d’un pays, dit Nagato.
— Le daïmio parle bien, dit le prince de Satsouma ; il est impossible que les bonzes d’Europe aient aucune influence sur la tranquillité du royaume. Il est donc inutile de les inquiéter.
Mais Hiéyas s’adressa directement à Fidé-Yori.
— Maître, dit-il, puisque l’on ne veut pas partager mes inquiétudes, il faut que je t’apprenne qu’un bruit terrible commence à circuler parmi les nobles, parmi le peuple…
Il se tut un moment pour donner plus de solennité à ses paroles.
—… On dit que celui qui est encore sous ma tutelle, que le chef futur du Japon, notre gracieux seigneur Fidé-Yori, a embrassé la foi chrétienne.
Un grand silence succéda à ces paroles. Les assistants échangeaient des regards qui disaient clairement qu’ils avaient connaissance de ce bruit qui peut-être était fondé.
Fidé-Yori prit la parole.
— Est-ce donc sur des innocents qu’il faut se venger d’une calomnie répandue par des personnes malintentionnées ? dit-il. J’ordonne que les chrétiens ne soient inquiétés d’aucune manière. Mon père, je le déplore, a cru devoir poursuivre de sa colère et exterminer ces malheureux mais, je le jure, moi vivant, il ne sera pas versé une seule goutte de leur sang.
Hiéyas fut stupéfait de l’accent résolu du jeune siogoun. Pour la première fois il avait parlé en maître et ordonné. Il s’inclina, en signe de soumission, et n’objecta rien. Fidé-Yori avait atteint sa majorité, et s’il n’était pas encore proclamé siogoun, c’était parce que Hiéyas ne se hâtait guère de déposer les pouvoirs. Celui-ci ne voulut donc pas entrer en lutte ouverte avec son pupille ; il abandonna momentanément la question et passa à autre chose.
— On m’annonce, dit-il, qu’un seigneur a été attaqué et blessé cette nuit, sur la route de Kioto. J’ignore encore le nom de ce seigneur ; mais le prince de Nagato, qui était à Kioto cette nuit, a peut-être entendu parler de cette aventure ?
— Ah ! tu sais que j’étais à Kioto, murmura le prince ; je comprends alors pourquoi il y avait des assassins sur ma route.
— Comment Nagato pouvait-il être en même temps à Osaka et à Kioto ? dit le prince de Sataké il n’est bruit ce matin, que de la fête sur l’eau qu’il y a donnée cette nuit et qui s’est si joyeusement terminée par une bataille entre les seigneurs et les matelots des rivages.
— J’ai même attrapé une égratignure dans la mêlée, dit Nagato en souriant.
— Le prince franchit en quelques heures les routes que d’autres mettraient une journée à parcourir, dit Hiéyas, voilà tout. Seulement, il ménage peu ses chevaux : chaque fois qu’il rentre au palais, sa monture s’abat et expire. Le prince de Nagato pâlit et chercha le sabre absent de sa ceinture.
— Je ne croyais pas que ta sollicitude s’étendît ainsi jusqu’aux bêtes du royaume, dit-il avec une ironie outrageante. Je te remercie au nom de mes chevaux défunts.
Le siogoun, plein d’inquiétude, jetait des regards suppliants à Nagato. Mais il semblait que ce jour-là la patience du régent fût à toute épreuve. Il sourit et ne répondit rien.
Cependant, Fidé-Yori voyait que la colère grondait dans l’âme de son ami, et, craignant quelque nouvel éclat, il mit fin à la séance en se retirant.
Presque aussitôt un garde du palais vint prévenir le prince de Nagato que le siogoun le demandait. Le prince salua amicalement plusieurs seigneurs, s’inclina devant les autres et s’éloigna sans avoir tourné la tête du côté de Hiéyas.
Lorsqu’il arriva dans les appartements du siogoun, il entendit une voix de femme, une voix irritée et gémissante à la fois. C’était de lui que l’on parlait.
— On m’a tout rapporté, disait cette voix : ton refus d’accéder aux désirs du régent, que tu as laissé insulter sous tes yeux par le prince de Nagato, dont l’insolence est vraiment incomparable ; et la patience merveilleuse de Hiéyas, qui n’a pas relevé l’insulte par égard pour toi, par pitié pour celui que tu crois ton ami, dans ton ignorance des hommes.
Nagato reconnut que celle qui parlait était la mère du siogoun, la belle et impérieuse Yodogimi.
— Mère, dit le siogoun, occupe-toi de broderies et de parures ; c’est là le domaine des femmes.
Nagato entra vivement pour ne pas être indiscret plus longtemps.
Yodogimi se retourna et rougit un peu en voyant le prince qui s’inclinait profondément devant elle.
— J’ai à te parler, dit le siogoun.
— Je me retire, alors, dit Yodogimi avec amertume, et retourne à mes broderies.
Elle traversa la chambre lentement, en faisant bruire ses longues robes soyeuses, et sortit en jetant à Nagato un étrange regard, à la fois provoquant et haineux.
— Tu as entendu ma mère ? dit Fidé-Yori.
— Oui, dit Nagato.
— Tous veulent me détacher de toi, ami ; quel peut être leur motif ?
— Ta mère est aveuglée par quelque calomnie, dit le prince ; les autres voient en moi un ennemi clairvoyant qui sait déjouer les trames ourdies contre toi.
— Je voulais justement te parler d’un complot.
— Contre ta vie ?
— C’est cela même. Il m’a été révélé d’une façon singulière, et j’ai peine à y croire. Cependant je ne puis me défendre d’une certaine inquiétude. À la fête du Génie de la mer, demain, un pont doit s’effondrer sous mes pas.
— Quelle horreur ! s’écria Nagato. Ne va pas à cette fête, au moins.
— Si je m’abstiens d’y aller, dit Fidé-Yori, j’ignorerai toujours la vérité, car le complot n’éclatera pas. Mais si je vais à la fête, continua-t-il en souriant, dans le cas où la conspiration existerait vraiment, la vérité serait un peu rude à constater.
— Certes, dit Nagato ; il faut cependant sortir du doute, il faut trouver un moyen. L’itinéraire que tu dois suivre est-il fixé ?
— Hiéyas me l’a fait remettre.
Fidé-Yori prit un rouleau de papier sur une étagère. Ils lurent « Quai du Yodo-Gava, place du Marché-aux-Poissons, route des Sycomores, plage de la Mer. Retour par la colline des Bambous, le pont de l’Hirondelle… »
— Les misérables ! s’écria Ivakoura, c’est le pont suspendu au-dessus de la vallée !
— L’endroit serait bien choisi, en effet, dit le siogoun.
— Il est certain qu’il s’agit de ce pont ; ceux qui franchissent les innombrables canaux de la ville ne t’exposeraient pas à la mort en s’écroulant sous tes pieds, mais tout au plus à un bain désagréable.
— C’est vrai, dit Fidé-Yori, et du pont de l’Hirondelle, on serait précipité sur des rochers.
— As-tu pleine confiance dans mon amitié pour toi ? dit le prince de Nagato après avoir songé un instant.
— En doutes-tu, Ivakoura ? dit le siogoun.
— Eh bien, ne crains rien, feins de tout ignorer, laisse-toi conduire et marche droit au pont. J’ai trouvé le moyen de te sauver, tout en découvrant la vérité.
— Je me fie à toi, ami, en toute sécurité.
— Alors, laisse-moi partir le temps me presse pour exécuter mon projet.
— Va, prince, je te confie ma vie sans trembler, dit le siogoun.
Nagato s’éloigna rapidement après avoir salué le roi, qui répondit par un geste amical.
↑
Noble officier au service d’un
daïmio
ou prince.
↑
Pagode située à Kioto et qui contient 33, 333 Dieux.
III
LA FÊTE DU GÉNIE DE LA MER
Le lendemain, dès l’aube, les rues d’Osaka furent pleines de mouvement et de joie. On se préparait pour la fête tout en se réjouissant à l’avance du plaisir prochain. Les maisons commerçantes, celles des artisans et des gens du peuple, largement ouvertes sur la rue, laissaient voir leur intérieur simple, meublé seulement par quelques paravents aux belles couleurs.
On entendait des voix, des rires, et, par moment, un enfant mutin s’échappait des bras de sa mère, occupée à le parer de ses plus beaux vêtements, et venait gambader et trépigner de joie sur les marches de bois descendant de la maison vers la chaussée. C’était alors avec des cris d’une feinte colère qu’il était rappelé de l’intérieur, la voix du père se faisait entendre et l’enfant allait se remettre aux mains maternelles, tout frémissant d’impatience.
Quelquefois l’un d’eux criait :
—Mère ! mère ! voici le cortège !
— Tu te moques, disait la mère, les prêtres n’ont pas seulement terminé leur toilette.
Mais, néanmoins, elle s’avançait vers la façade et, perchée par-dessus la légère balustrade, regardait dans la rue.
Des courriers nus, moins un morceau d’étoffe, nouée autour de leurs reins, passent à toutes jambes, ayant sur l’épaule une tige de bambou, qui ploie à son extrémité sous le poids d’un paquet de lettres. Ils se dirigent vers la résidence du siogoun.
Devant les boutiques des barbiers la foule s’amasse ; les garçons ne peuvent suffire à raser tous les mentons, à coiffer toutes les têtes qui se présentent. Ceux qui attendent leur tour causent gaiement devant la porte. Quelques-uns sont déjà revêtus de leurs habits de fête, aux couleurs vives, couverts de broderies. D’autres, plus soigneux, nus jusqu’à la ceinture, préfèrent terminer leur toilette après leur coiffure achevée. Des marchands de légumes, de poissons, circulent, vantant à hauts cris leurs marchandises qu’ils portent dans deux baquets, suspendus à une traverse de bois, posée sur leur épaule.
De toutes parts on orne les maisons de banderoles, d’étoffés brodées, couvertes d’inscriptions chinoises en or sur des fonds noirs ou pourpres ; on accroche des lanternes, des branches fleuries.
À mesure que la matinée s’avance, les rues s’emplissent de plus en plus de gai tumulte ; les porteurs de norimonos, vêtus de légères tuniques, serrées à la taille, coiffés de larges chapeaux, pareils à des boucliers, crient pour se faire faire place. Des samouraïs passent à cheval, précédés d’un coureur qui, tête baissée, les bras en avant, fend la foule. Des groupes s’arrêtent pour causer, abrités sous de vastes parasols, et forment des îlots immobiles au milieu de la houle tumultueuse des promeneurs. Un médecin se hâte, en s’éventant avec gravité, suivi de ses deux aides qui portent la caisse des médicaments.
— Illustre maître, n’irez-vous donc pas à la fête ? lui crie-t-on au passage.
— Les malades ne prennent point garde aux fêtes, dit-il avec un soupir, et comme il n’y en a pas pour eux, il n’y en a pas pour nous.
Sur les rives de Yodogava, l’animation est plus grande encore ; le fleuve disparaît littéralement sous des milliers d’embarcations ; les mâts dressés, les voiles encore ployées, mais prêtes à s’ouvrir comme des ailes, les tentes des cabines recouvertes d’étoffes de soie et de satin, les proues ornées de bannières dont les franges d’or trempent dans l’eau, resplendissent au soleil et tachent l’azur du fleuve de frissons multicolores.
Des bandes de jeunes femmes, aux toilettes brillantes, descendent les blanches marches des berges, taillées en gradins. Elles se dirigent vers d’élégants bateaux en bois de camphrier, rehaussés de sculptures et d’ornements de cuivre, et elles les remplissent de fleurs qui jettent de chauds parfums dans l’air.
Du haut du Kiobassi, ce beau pont qui ressemble à un arc tendu, on déploie des pièces de gaze, de crêpe ou de soie légère, des couleurs les plus fraîches et couvertes d’inscriptions. Une faible brise agite mollement ces belles étoffes que les bateaux qui vont et viennent écartent en passant. On voit resplendir au loin la haute tour de la résidence et les deux monstrueux poissons d’or qui ornent son faîte. À l’entrée de la ville, à droite et à gauche du fleuve, les deux superbes bastions qui regardent vers la mer ont arboré sur chaque tour, à chaque angle des murailles, l’étendard national blanc avec un disque rouge, emblème du soleil lorsqu’il s’élève dans les vapeurs matinales. Quelques pagodes, au-dessus des arbres, dressent sur le ciel radieux la superposition de leurs toitures, relevées des bords, à la mode chinoise.
C’est la pagode de Yébis, le génie de la mer, qui attire spécialement l’attention ce jour-là ; non que ses tours soient plus hautes et ses portes sacrées plus nombreuses que celles des temples voisins, mais de ses jardins doit partir le cortège religieux, si impatiemment attendu par la foule.
Enfin, dans le lointain, le tambour résonne. On prête l’oreille au rythme sacré, bien connu de tous : quelques coups violents, espacés, puis un roulement précipité, s’adoucissant et se perdant, puis de nouveau des coups brusques.
Une immense clameur de joie s’élève de la foule, qui se range aussitôt le long des maisons de chaque côté des rues que doit parcourir le cortège.
Les Kashiras, gardiens des quartiers, tendent rapidement des cordes qu’ils fixent à des pieux, afin d’empêcher la multitude de déborder sur la voie centrale. La procession s’est mise en marche ; en effet, elle a franchi le Torié, portique sacré, qui s’élève devant la pagode de Yébis, et bientôt elle dénie devant la foule impatiente.
Seize archers s’avancent d’abord, l’un derrière l’autre, sur deux rangs très espacés. Ils ont revêtu l’armure en lamelle de corne noire jointe par des points de laine rouge. Deux sabres sont passés à leur ceinture ; les flèches empennées dépassent leurs épaules et ils tiennent à la main un grand arc de laque noire et dorée.
Derrière eux vient une troupe de serviteurs, portant des houppes de soie au bout de longues hampes. Puis apparaissent les musiciens tartares qui s’annoncent par un réjouissant tapage. Les vibrations métalliques du gong résonnent d’instant en instant, les tambours, battus à outrance, les cymbales qui frissonnent, les conques marines, rendant des sonorités graves, les notes suraiguës des flûtes et l’éclat des trompettes déchirant l’air, forment une telle intensité de bruit que les spectateurs les plus proches clignent des yeux et sont comme aveuglés.
Après les musiciens apparaît, portée sur une haute estrade, une langouste gigantesque, chevauchée par un bonze. Des étendards de toutes couleurs, longs et étroits, portant les armoiries de la ville, sont tenus par de jeunes garçons et oscillent autour de l’énorme crustacé. Puis viennent cinquante lanciers, coiffés du chapeau rond laqué, appuyant sur leur épaule leur lance, ornée d’un gland rouge. Deux serviteurs conduisent ensuite un cheval superbement caparaçonné, dont la crinière, dressée au-dessus du col, est tressée et disposée comme une riche passementerie. Des porteurs de bannières s’avancent après ce cheval ; les bannières sont bleues et couvertes de caractères d’or. Puis s’avancent deux grands tigres de Corée, la gueule ouverte, les yeux sanglants. Parmi la foule quelques enfants poussent des cris d’effroi ; mais les tigres sont en carton, et des hommes, cachés dans chacune de leurs pattes, les font se mouvoir. Un tambour géant, de forme cylindrique, vient ensuite, porté par deux bonzes ; un troisième marche à côté et frappe fréquemment le tambour de son poing fermé.
Enfin voici sept jeunes femmes, splendidement parées, qu’un brouhaha joyeux accueille. Ce sont les courtisanes les plus belles et les plus illustres de la ville. Elles s’avancent, l’une après l’autre, majestueusement, pleines d’orgueil, accompagnées d’une servante et suivies d’un serviteur qui soutient au-dessus d’elles un large parasol de soie. Le peuple, qui les connaît bien, les désigne au passage par leur nom ou leur surnom.
— Voici la femme aux sarcelles d’argent !
Deux de ces oiseaux sont brodés sur l’ample manteau à larges manches qu’elle porte par-dessus ses nombreuses robes dont les collets sont croisés, l’un au-dessous de l’autre, sur sa poitrine ; le manteau est de satin vert, la broderie de soie blanche, mêlée d’argent ; la coiffure de la belle est traversée d’épingles énormes, en écaille de tortue, qui lui font un demi-cercle de rayons autour du visage.
— Celle-ci, c’est la femme aux algues marines !
Ces belles herbes, dont les racines de soie s’enfoncent dans les broderies du manteau, flottent hors de l’étoffe et voltigent au vent.
Puis viennent : la belle au dauphin d’or, la belle aux fleurs d’amandier, la belle au cygne, au paon, au singe bleu. Toutes posent leurs pieds nus sur de hautes planchettes en bois d’ébène qui exhaussent leur taille ; elles ont la tête hérissée d’épingles blondes et leur visage, habilement fardé, apparaît jeune et charmant sous la douce pénombre du parasol.
Derrière les courtisanes s’avancent des hommes qui portent des branches de saule ; puis tout une armée de prêtres, transportant, sur des brancards ou sous de jolis pavillons, aux toitures dorées, les accessoires, les ornements et le mobilier du temple, que l’on purifie pendant la promenade du cortège.
Enfin apparaît la châsse de Yébis, le dieu de la mer, le pêcheur infatigable, qui passe des journées entières, enveloppé d’un filet, une ligne à la main, debout sur une roche émergeant à demi de l’eau. Elle est portée par cinquante bonzes, nus jusqu’à la ceinture, et ressemble à une maisonnette carrée. Sa toiture, à quatre pans coupés, est revêtue d’argent et d’azur, bordée d’une frange de perles, et surmontée d’un grand oiseau aux ailes ouvertes.
Le dieu Yébis est invisible à l’intérieur de la châsse, hermétiquement close.
Sur un brancard est porté le magnifique poisson consacré à Yébis, l’akamé, ou la femme rouge, le préféré, d’ailleurs, de tous ceux qui aiment la bonne chère. Trente cavaliers, armés de piques, terminent le cortège.
La procession traverse la ville, suivie de toute la foule qui s’ébranle derrière elle ; elle gagne les faubourgs et, après une assez longue marche, débouche sur le rivage de la mer.
En même temps qu’elle, des milliers d’embarcations arrivent à l’embouchure du Yodogava, qui les pousse doucement vers la mer. Les voiles s’ouvrent, les rames mordent l’eau, les banderoles flottent au vent, tandis que le soleil jette des milliers d’étincelles sur l’azur des vagues remuées.
Fidé-Yori arrive aussi sur la plage, par le chemin qui longe le fleuve ; il arrête son cheval et se tient immobile au milieu de sa suite, assez peu nombreuse d’ailleurs, le régent n’ayant pas voulu écraser par le luxe royal le cortège religieux.
Hiéyas, lui, s’est fait porter en norimono comme la mère, comme l’épouse du siogoun. Il se dit malade.
Cinquante soldats, quelques porteurs d’étendards et deux coureurs forment toute l’escorte.
L’arrivée du jeune prince divise l’attention de la foule, et la procession de Yébis n’est plus seule à attirer les regards. La coiffure royale, une sorte de toque d’or de forme oblongue, posée sur la tête de Fidé-Yori, le fait reconnaître de loin.
Bientôt le cortège religieux vient défiler lentement devant le siogoun. Puis les prêtres qui portent la chàsse quittent la file et s’approchent tout près de la mer.
Alors les pêcheurs, les bateliers du rivage accourent soudain avec des cris, des sauts, des gambades, et se jettent sur ceux qui portent Yébis. Ils simulent une bataille en poussant des clameurs de plus en plus aiguës. Les prêtres feignent de se défendre, mais bientôt la chàsse passe de leurs épaules sur celles des robustes matelots. Ceux-ci, alors, avec des hurlements de joie, entrent dans la mer et promènent longtemps, au-dessus des flots limpides, leur dieu bien-aimé, tandis que des orchestres, portés par les jonques qui sillonnent la mer, font éclater leurs mélodies joyeuses. Enfin les matelots reviennent à terre, au milieu des acclamations de la foule, qui se dissipe bientôt pour retourner en toute hâte à la ville, où bien d’autres divertissements s’offrent encore à elle : spectacles en plein air, ventes de toutes sortes, représentations théâtrales, banquets et libations de saké.
Fidé-Yori quitte la plage à son tour, précédé par les deux coureurs et suivi de son cortège. On s’engage dans une petite vallée fraîche et charmante, et l’on prend un chemin qui, par une pente très douce, conduit au sommet de la colline. Ce chemin est complètement désert. D’ailleurs, depuis la veille, on en a interdit l’accès au peuple.
Fidé-Yori songe au complot, au pont qui doit s’écrouler et le précipiter dans un abîme. Il y a pensé toute la nuit avec angoisse ; mais, sous ce soleil si franchement lumineux, au milieu de cette nature paisible, il ne peut plus croire à la méchanceté humaine. Cependant, le chemin choisi pour revenir au palais est singulier. « On prendra cette route afin d’éviter la foule, » a dit Hiéyas ; mais il n’y avait qu’a interdire une autre voie au peuple, et le roi eût pu rentrer au château sans faire ce bizarre détour.
Fidé-Yori cherche des yeux Nagato. Il ne peut le découvrir. Depuis le matin il l’a fait demander vingt fois. Le prince est introuvable.
Une angoisse douloureuse envahit le jeune siogoun. Il se demande tout à coup pourquoi son cortège est si restreint, pourquoi il n’est précédé que de deux coureurs il regarde derrière lui, et il lui semble que les porteurs de norimonos ralentissent le pas.
On atteint le faîte de la colline, et bientôt le pont de l’Hirondelle apparaît au bout du chemin. En l’apercevant, Fidé-Yori, par un mouvement involontaire, retient son cheval ; un battement précipité agite son cœur. Ce pont frêle est audacieusement jeté d’une colline à l’autre sur le val très profond. La rivière, rapide comme un torrent, bondit sur des roches avec un bruit sourd et continu. Cependant le pont semble comme de coutume s’appuyer fermement sur les roches plates qui se projettent au-dessous de lui.
Les coureurs avancent d’un pas ferme. Si le complot existe, ceux-là ne le connaissent point. Le jeune roi n’ose pas s’arrêter ; il croit entendre encore les paroles de Nagato :
« Marche sans crainte vers le pont. »
Mais la voix suppliante d’Omiti vibre aussi, à son oreille, il se souvient du serment qu’il a prononcé. Le silence de Nagato surtout l’épouvante. Que de choses ont pu entraver le projet du prince ! Entouré d’espions habiles qui surveillent ses moindres actions, il a peut-être été enlevé et mis dans l’impossibilité de correspondre avec le roi. Toutes ces pensées emplissent tumultueusement l’esprit de Fidé-Yori ; la dernière supposition le fait pâlir ; puis, par une de ces bizarreries de la pensée, fréquentes dans les situations extrêmes, il se souvient subitement d’une chanson qu’il chantait lorsqu’il était enfant, pour se familiariser avec les sons principaux de la langue japonaise. Machinalement il la récite :
« — La couleur, le parfum s’évanouissent. Qu’y a-t-il dans ce monde de permanent ? Le jour passé a sombré dans les abîmes du néant. C’était comme le reflet d’un rêve. — Son absence n’a pas causé le plus léger trouble. »
— Voilà ce que j’apprenais étant enfant, se dit le roi, et aujourd’hui je recule et j’hésite devant la possibilité de mourir.
Honteux de sa faiblesse, il rendit les rênes à son cheval.
Mais alors un grand bruit se fit entendre de l’autre côté du pont et, tournant brusquement l’angle du chemin, des chevaux emportés, la crinière éparse, les yeux sanglants, apparurent, traînant après eux un chariot chargé de troncs d’arbres ; ils se précipitèrent vers le pont, et leurs sabots furieux sonnèrent, avec un redoublement de bruit, sur le plancher de bois.
À la vue de ces chevaux, venant vers elle, toute la suite de Fidé-Yori poussa des cris d’épouvante ; les porteurs abandonnèrent les norimonos, les femmes en sortirent terrifiées, et réunissant leur ample robe, s’enfuirent en toute hâte. Les coureurs, qui déjà posaient le pied sur le pont, firent volte-face et Fidé-Yori, instinctivement, se rejeta de côté.
Mais, tout à coup, comme une corde trop tendue qui se rompt, le pont éclata avec un grand fracas ; il ploya d’abord par le milieu, puis releva brusquement ses deux tronçons en envoyant de toutes parts une pluie de débris. L’attelage et le char s’abîmèrent dans la rivière dont l’eau rejaillit en écume jusqu’au faite de la colline. Pendant quelques instants un cheval resta suspendu par ses harnais, se débattant au-dessus du gouffre mais les liens se rompirent et il tomba. La rivière tumultueuse commença à pousser vers la mer les chevaux, les troncs d’arbres flottants et les débris du pont.
— Ô Omiti ! s’écria le roi, immobile d’effroi, tu ne m’avais pas trompé ! Voici donc le sort qui m’était réservé. Sans ton dévouement, douce jeune fille, mon corps brisé serait roulé à cette heure de rocher en rocher.
— Eh bien maître, tu sais ce que tu voulais savoir. Que penses-tu de mon attelage ? s’écria tout à coup une voix près du roi.
Celui-ci se retourna, il était seul, tous ses serviteurs l’avaient abandonné mais il vit une tête surgir de la vallée, il reconnut Nagato qui gravissait rapidement l’âpre côte, et fut bientôt près du roi.
— Ah ! mon ami mon frère ! dit Fidé-Yori, qui ne put retenir ses larmes. Comment ai-je pu inspirer tant de haine ? Quel est le malheureux que ma vie oppresse et qui veut me chasser du monde ?
— Tu désires savoir qui est cet infâme, tu veux le nom du coupable ? dit Nagato les sourcils froncés.
— Le sais-tu, ami ? dis-le-moi.
— Hiéyas !