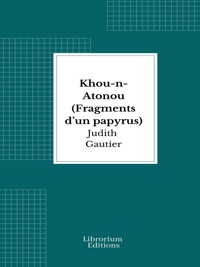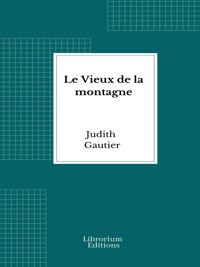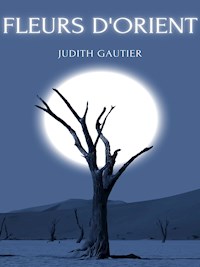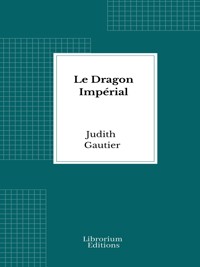
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
C’était dans le grand champ de Chi-Tse-Po, à trente lis de Pei-King. Le vent de la troisième lune secouait les arbres, les arbres peu nombreux, car il n’y avait qu’un orme dans ce champ, à côté d’un néflier.
Vers l’orient s’élevaient les dix étages retroussés d’une pagode au delà de laquelle apparaissait une pagode encore, plus vague et plus lointaine. C’était tout ; l’œil pouvait s’emplir d’espace et arriver sans halte à la ligne vaporeuse et rose de l’horizon.
Sous le néflier un homme était assis, riant à la lumière qui blanchissait la plaine d’un bout à l’autre, sans intervalle ni hésitation, et parfois grelottant un peu malgré les trois robes somptueuses dont il était vêtu ; car le soleil des jours de printemps réchauffe beaucoup moins qu’il n’éclaire, et les retours de froidures sont les plus sensibles au corps, comme le reproche de celui qu’on croyait ami blesse le cœur plus douloureusement.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
LE
DRAGON IMPÉRIAL
par
JUDITH GAUTIER
© 2025 Librorium Editions
ISBN : 9782385749156
TA-KIANG SE RÉVOLTE CONTRE LA TERRE
PEI-KING
LA PRUDENCE DE KO-LI-TSIN
LA SECTE DU LYS BLEU
CELUI QUI VIENT N’EST PAS CELUI QU’ON ATTEND
LE POISSON JAUNE
LA VILLE ROUGE
LA MAIN QUI TIENT LE SABRE N’EST PAS CELLE QUI A FRAPPÉ
LE BAMBOU PERCE, LA POIX BRULE ET L’ACIER FOUETTE
LES PIEDS DU PENDU
LES AILES DU DRAGON
L’HÉRITIER DU CIEL
ROSES, PERLES, FLEURS
LA CIGOGNE VOYAGEUSE
LE DRAGON VOLANT
KO-LI-TSIN TROUVE UN AMI DIGNE DE LUI
LE TIGRE DE JADE
LES ÂNES NE SAVENT PAS S’ILS PORTENT DE L’OR OU DU FER
TA-KIANG SE RÉVOLTE CONTRE LE CIEL
LES BEAUX CHEMINS NE VONT PAS LOIN
LA VALLÉE DU DAIM BLANC
IL EN EST DE LA VILLE COMME DE LA MER : LE VENT QU’IL FAIT DÉCIDE DE TOUT
LA FORCE TREMBLE ET L’ORGUEIL DOUTE
YO-MEN-LI
LE POU-SAH ROUGE
LE PAVILLON DES TULIPES D’EAU
LE DRAGON IMPÉRIAL
KANG-SHI
LE COUCHER DU DRAGON
À
LA MÉMOIRE DE MON PÈRE
THÉOPHILE GAUTIER
LE
DRAGON IMPÉRIAL
CHAPITRE I
TA-KIANG SE RÉVOLTE CONTRE LA TERRE
Nul n’ignore que si l’ombre d’un homme prend la forme d’un dragon qui suit humblement les pas de son maître, cet homme tiendra un jour dans sa main la poignée de jade du sceptre impérial.
Mais nulle bouche ne doit s’ouvrir pour révéler le miracle qu’ont vu les yeux ; car la destinée serait renversée et une nuée de malheurs descendrait du ciel.
C’était dans le grand champ de Chi-Tse-Po, à trente lis de Pei-King. Le vent de la troisième lune secouait les arbres, les arbres peu nombreux, car il n’y avait qu’un orme dans ce champ, à côté d’un néflier.
Vers l’orient s’élevaient les dix étages retroussés d’une pagode au delà de laquelle apparaissait une pagode encore, plus vague et plus lointaine. C’était tout ; l’œil pouvait s’emplir d’espace et arriver sans halte à la ligne vaporeuse et rose de l’horizon.
Sous le néflier un homme était assis, riant à la lumière qui blanchissait la plaine d’un bout à l’autre, sans intervalle ni hésitation, et parfois grelottant un peu malgré les trois robes somptueuses dont il était vêtu ; car le soleil des jours de printemps réchauffe beaucoup moins qu’il n’éclaire, et les retours de froidures sont les plus sensibles au corps, comme le reproche de celui qu’on croyait ami blesse le cœur plus douloureusement.
Cet homme, jeune encore et d’agréable mine, était singularisé au plus haut point par l’extrême mobilité de ses traits qui ne laissaient aucun sentiment inexprimé, se tendant, se ridant, s’allongeant ou s’épanouissant sous les diverses influences d’un esprit sans doute très prompt ; ses petits yeux, que tour à tour couvraient et découvraient des paupières clignotantes, roulaient avec tant de vitesse tant de pensées joyeuses, malignes ou bizarres, qu’ils faisaient songer par leur palpitant éclat au miroitement du soleil sur l’eau ; et sa bouche bien faite, toujours entr’ouverte par quelque sourire, laissait voir deux rangées de jolies dents blanches, gaies de luire au grand jour et de mêler leurs paillettes claires aux étincelles du regard. Tout cet être était délicat, fluet ; on pressentait des dextérités infinies dans la frêle élégance de ses membres ; il devait monter aux arbres comme un singe et franchir les rivières comme un chat sauvage ; ses petites mains étroites, un peu maigres, aux ongles plus longs que les doigts, étaient certainement capables de tisser des toiles d’araignées ou de broder une pièce de vers sur la corolle d’une fleur de pêcher.
Comme lui-même, ses vêtements étaient clairs, pailletés, vivaces : sur deux robes de crêpe grésillant il portait un surtout en damas rosâtre qu’ourlait une haute bordure de fleurs d’argent et que serraient à la taille les enlacements d’une écharpe frangée, d’où pendait un petit encrier de voyage à côté d’un rouleau de papier jaune ; un grand collet de velours tramé d’argent lui couvrait les épaules, et, sur son chapeau de velours noir, à grands bords relevés, qu’ornaient un effilé rouge et une mince plume verte, le bouton de corail rose uni des lettrés de première classe se dressait fièrement comme la crête d’un jeune coq.
Quant à ses noms, qu’il devait à son bon goût, car le fait de son existence était la seule chose par laquelle il fût induit à croire qu’il avait probablement eu des parents, ils se composaient de trois syllabes aimables qui faisaient le bruit d’une petite pièce d’argent remuée dans un plat de cuivre, et son métier, si l’on peut dire que Ko-Li-Tsin eût un métier en effet, était celui des gens qui n’en pratiquent point d’autre que de causer agréablement à tout propos et d’improviser des poèmes chaque fois qu’un sujet favorable se présente à leur esprit. Son enfance avait joué dans les rues d’un village, profitant sans ennui des leçons d’un vieux lettré charitable, qui, dans de longues promenades, lui empruntait de la gaieté et lui donnait de la science ; sa jeunesse rieuse, aventureuse, rarement besogneuse grâce aux libéralités des personnes, innombrables dans ce temps, qui aimaient la poésie, courait de ville en ville, de province en province, au gré de cent désirs futiles. Pourquoi se trouvait-il à cette heure dans la solitude mélancolique des campagnes ? Pour l’amour d’une jeune fille qu’il n’avait jamais vue. Un jour (quelques lunes avaient crû et décru depuis ce jour) Ko-Li-Tsin, qui résidait alors dans le Chen-Si, fut prié à dîner, avec plusieurs personnes de distinction, chez le mandarin gouverneur de la ville. Celui-ci, vers la fin du repas, découvrit à ses convives qu’il était dans le dessein de donner sa fille unique en mariage à quelque poète très savant, ce poète fût-il pauvre comme un prêtre de Fô et eût-il les cheveux rouges comme un méchant Yé-Kiun. Après avoir vanté les grâces et les vertus de son enfant, non sans vider un grand nombre de tasses, l’aimable gouverneur déclara même que celui d’entre les jeunes hommes ses hôtes, qui, en l’espace de huit lunes, composerait le plus beau poème sur un noble sujet de philosophie ou de politique, deviendrait certainement son gendre et, par suite, s’élèverait, sous sa protection, aux postes les plus enviés. Ko-Li-Tsin, en rentrant chez lui, s’était immédiatement mis en devoir d’assembler des rythmes et des consonances ; mais, au lieu de chanter les gloires d’un empereur ou d’éclaircir quelque obscure question de morale, il dépeignit dans ses vers le charme des nattes noires mêlées de perles, des sourcils fins comme des traits de pinceau et du sourire timide et doux que ne pouvait manquer d’avoir la fille du mandarin. Les jours suivants, Ko-Li-Tsin ne réussit pas mieux à diriger son inspiration dans la voie indiquée. Qu’était-ce donc qui le rendait distrait à ce point ? Ce pouvaient être les mille bruits et les aspects de la rue joyeuse qui s’agitait sous ses fenêtres. Il espéra que dans le calme des champs son esprit serait plus réfléchi et plus sérieux, et, tirant de sa bibliothèque les Annales historiques, avec les livres des philosophes, il se réfugia dans le pays de Chi-Tse-Po. Là, s’abritant, la nuit, dans une cabane solitaire, et, le jour, errant au soleil dans la belle plaine immense, il entreprit résolument la tâche prescrite. Hélas ! les grands épis souples et les blés de riz entr’ouverts, et les marguerites étoilant l’herbe lui fournirent trop de comparaisons neuves et charmantes avec la future épouse qu’il entrevoyait en rêve pour qu’il pût composer le moindre quatrain philosophique ou historique. L’automne puis l’hiver s’écoulèrent. Cependant il ne perdit point courage. Chaque matin il s’éveillait avec la conviction intime qu’il pourrait, le soir, réciter aux étoiles son poème achevé. Et voilà par quelle suite de circonstances Ko-Li-Tsin grelottait au soleil, le premier jour de la troisième lune, dans le champ désert de Chi-Tse-Po, sous un néflier.
À quelques pas de lui, sous l’orme, un laboureur bêchait ; il ne sentait certainement pas ce dernier souffle de l’hiver qui faisait frissonner Ko-Li-Tsin, et, par instants, il essuyait du revers de sa manche son visage en sueur ; car bien des fois déjà sa bêche s’était enfoncée sous la pression de son pied pour ressortir brillante de la terre noire et humide.
Ce paysan, âgé de vingt ans à peine, était d’un aspect farouche : fort et hautain, il avait l’air d’un cèdre ; son front ressemblait à la lune sinistre d’un ciel d’orage ; ses longs sourcils obscurs s’abaissaient comme des nuages pleins de tempêtes ; de tyranniques puissances roulaient dans ses yeux sombres, et les lèvres, souvent ensanglantées par des dents furieuses, témoignaient des pensées féroces qui mordaient son cœur. Cependant il était beau comme un dieu, bien qu’il fût terrible comme un tigre brusquement apparu au détour d’un chemin.
Il avait pour tout costume une courte chemise en coton bleu sur un pantalon de même étoffe, un chapeau de paille claire, retroussé comme le toit d’un pavillon, et, à ses pieds nus, des souliers à larges semelles ; mais ces vêtements vulgaires, tout dorés par le soleil, étaient splendides, et paraient le jeune laboureur tout autant que l’aurait pu faire la robe de brocart jaune, traversée de dragons d’or, que porte dans la Ville Rouge l’éblouissant Fils du Ciel.
Depuis quelques instants il bêchait avec rage, fouillant, tranchant, déchirant le sol pierreux. Cette furie déplut au lettré Ko-Li-Tsin, qui attendait patiemment sous son arbre une pensée philosophique propre à être mise en vers de sept caractères.
— Laboureur, demanda-t-il, comment te nommes-tu ?
— Ta-Kiang, répondit le jeune homme d’une voix rude et sans interrompre sa violente besogne.
— Eh bien ! Ta-Kiang, dit Ko-Li-Tsin, je te conseille de ne pas mettre autant de colère dans ton travail.
Puis il rêva un instant, en comptant sur ses doigts, et, fidèle à sa coutume invétérée d’appuyer ses moindres discours par des improvisations poétiques, il ajouta, parlant en vers :
Ô jeune laboureur qui maltraites la terre, si la terre a de la rancune, elle te donnera d’affreux épis contrefaits !
Et tes blés de riz, au lieu de sourire coquettement, seront semblables à des bouches édentées ;
Si bien que les poètes, en quête de comparaisons gracieuses, se trouveront singulièrement désorientés.
Cesse donc, ô jeune laboureur, de brutaliser la terre bienfaisante !
— La terre ! Je la hais, dit Ta-Kiang en mordant sa bouche. Tu penses que je la creuse afin de me nourrir ? Tu te trompes. Je la frappe comme je frapperais un ennemi, esclave sous mon talon. Ce sont des blessures que je lui inflige avec ce fer, et, si elle pouvait prendre un corps, comme je dévorerais sa chair et comme je boirais son sang avec délices !
— Eh ! qu’as-tu donc, qu’as-tu donc ? dit Ko-Li-Tsin. Il faut se résigner au sort que le ciel nous a fait. Vois, je suis poète, est-ce que je me plains ?
En ce moment Ta-Kiang heurta un caillou de sa bêche avec un tel courroux qu’elle se brisa dans un pétillement d’étincelles.
— Tant mieux ! cria-t-il. Ah ! terre détestée, je me suis trop souvent courbé vers ta face triste et noire ; je respire depuis trop longtemps le parfum malsain des plaies que je fais ; c’est assez. Tu me reprendras un jour, terre vorace ; alors tu me rongeras et tu me détruiras ; mais jusqu’à ce jour du moins tu ne me verras plus, car je veux tourner désormais mon visage vers le ciel salutaire, vers le grand ciel salutaire et lumineux !
Ta-Kiang se dressa fièrement et, croisant ses bras sur sa poitrine, il se mit à marcher avec agitation.
— Prends garde ! s’écria Ko-Li-Tsin en riant de tout son cœur ; prends garde au mauvais génie qui te conseille la révolte ! car, un, deux, trois, quatre, ajouta-t-il en comptant sur ses doigts :
Les méchants Yé-Kiuns nous montrent souvent du doigt un diamant qui scintille sous le soleil au fond d’un précipice ;
Nous descendons pleins de joie et dédaignant les piqûres des ronces, mais le soleil se cache, et à la place du diamant il n’y a plus qu’un caillou humide.
Honteux et tristes nous remontons péniblement ; les mauvais Génies, pendant notre absence, ont mis le feu à notre maison et dérobé notre sac d’argent.
Le poète cessa tout à coup de parler, il jeta sa main sur sa bouche comme pour intercepter un cri. Ta-Kiang venait de passer devant lui, et au soleil, l’ombre du laboureur s’était déformée : ce n’était plus le reflet d’un être humain qui se dessinait bleuâtre sur la terre grise, mais c’était le reflet gigantesque d’un dragon. Or Ko-Li-Tsin n’ignorait pas que « si l’ombre d’un homme prend la forme d’un dragon qui suit humblement les pas de son maître, cet homme tiendra un jour dans sa main la poignée de jade du sceptre impérial ». Le poète fut donc sur le point de pousser un grand cri de surprise, mais il le retint sagement, parce qu’il savait aussi que « nulle bouche ne doit s’ouvrir pour révéler le miracle qu’ont vu les yeux ; car la destinée serait renversée et une nuée de malheurs descendrait du ciel. »
Ta-Kiang continuait de marcher, levant vers le ciel un front superbe.
— Frère, dit Ko-Li-Tsin encore stupide d’étonnement, tu auras raison de faire ce que tu te proposes. Pardonne-moi si j’ai ri tout à l’heure ; je n’avais pas vu ton front.
— Adieu donc, dit Ta-Kiang.
Et il s’éloigna à grands pas.
Non loin de là, dans un pli à peu près insensible du terrain, reluisait un petit lac qui semblait d’acier bleu ; étoilé de nélumbos, encadré de bambous souples qui se penchaient gracieusement au moindre souffle, il disparaissait presque tout entier sous des entrelacements de minces tiges et sous des parasols de larges feuilles envahissantes, de sorte que le ciel y trouvait à peine une petite place pour se mirer.
Ses cheveux mêlés aux feuilles et ses petits pieds nus chaussés d’herbes humides, une jeune fille trempait dans l’eau de jeunes bambous qu’elle venait de cueillir et les rangeait ensuite dans une corbeille, tout en chantant un joli chant rapide.
C’était une enfant de quinze ans, toute charmante, un peu farouche ; son tendre front avait la douceur du premier croissant de la lune, et sa bouche fleurissait plus délicieusement qu’une petite rose pleine de soleil ; mais ses grands yeux noirs, sous leurs longs cils brillants, avaient cette expression hardie et sauvage qui étonne dans les yeux d’une hirondelle que l’on vient de prendre.
Son costume de paysanne ne manquait pas de quelque recherche. Sur un large pantalon orange, elle portait une robe de lin couleur œufs de cane, liserée de noir ; et quelquefois, coquette, elle interrompait son travail pour aller cueillir une fleur rose ou bleue qu’elle piquait dans ses longues nattes, en penchant son visage vers l’eau.
Tout à coup elle tressaillit ; la tête renversée en arrière, elle prêtait l’oreille à un son lointain.
— Comme je reconnais vite le bruit de ses pas ! dit-elle. Je vais aller au-devant de lui.
Cependant elle ne bougea point.
— Cet empressement serait peu convenable ; il vaut mieux que je feigne de ne pas l’avoir entendu venir.
Et, rougissante, elle continua son travail et sa chanson.
Ta-Kiang apparut bientôt. Écrasant les bambous sous la fermeté de ses pas, il s’approcha de la jeune fille qui tournait vers lui un visage plein de sourires.
— Voici Ta-Kiang, dit-elle, qui a laissé sa bêche pour venir un instant rire avec Yo-Men-Li, sa fiancée, près du petit lac des bambous.
— J’ai, en effet, laissé ma bêche, répondit Ta-Kiang, mais c’est pour ne plus la reprendre ; je suis venu voir ma fiancée, mais c’est afin de lui dire que je vais partir pour toujours.
— Partir ! répéta Yo-Men-Li avec surprise et comme prononçant une parole dont le sens lui aurait été inconnu.
— Oui, affirma Ta-Kiang.
— Pourquoi essayes-tu de me faire peur ? dit-elle avec un sourire indécis. Il ne se peut pas que tu penses sérieusement à quitter ta fiancée.
— Ma fiancée prendra un autre laboureur pour époux, et son cœur m’oubliera quand ses yeux auront cessé de me voir.
— C’est donc vrai ! cria-t-elle ; et des larmes soudaines obscurcirent ses yeux. Tu t’en vas, tu me laisses, et méchant, tu me conseilles de choisir un autre fiancé ! Ah ! crois-tu que jamais je puisse…
Yo-Men-Li s’interrompit brusquement ; son visage prit une expression d’épouvante admirative, et ses larmes, en un instant, se séchèrent ; car elle venait d’apercevoir dans le lac clair le reflet net d’un dragon, et tout aussi bien que le poète Ko-Li-Tsin, elle savait que « si l’ombre d’un homme prend la forme d’un dragon qui suit humblement les pas de son maître, cet homme tiendra un jour dans sa main la poignée de jade du sceptre impérial. »
— Pars, pars, dit-elle alors, tandis qu’une fière joie gonflait son cœur douloureux. Tu seras riche, tu seras glorieux, et Yo-Men-Li se réjouira solitairement de ton bonheur.
— Adieu donc, jeune fille, dit Ta-Kiang.
Et il se dirigea rapidement vers sa cabane.
Large et basse, sous un vieux toit en paille de sorgho, la cabane sordide, entourée d’une palissade où séchaient quelques linges pendus, se montra bientôt à lui, dans un coin fauché du champ.
Il poussa la porte et entra. La nuit se faisait déjà entre les quatre murs de terre de la triste demeure car elle n’avait qu’une seule fenêtre aux carreaux de corne, jadis diaphane, maintenant épaissie de poussière. Avec Ta-Kiang entra un peu de jour : un vieil homme, jaune et usé, frottait une faux d’un caillou dur ; une femme, plus vieille, faisait cuire du riz pour le repas du soir, devant un petit feu de racines, chiche et fumeux.
— Parents vénérés, dit Ta-Kiang, j’ai formé une résolution : je quitterai ce soir le champ de Chi-Tse-Po, parce que je veux conquérir la richesse et la renommée, afin de soulager et de consoler votre vieillesse.
Il se tut, prévoyant des colères et des résistances, mais sa grande ombre miraculeuse s’étalait sur le sol dans l’angle clair que produisait L’entre-bâillement de la porte.
— J’approuve la résolution que t’inspire Koan-In elle-même ! bégaya le vieux père dont un grand frisson secoua les membres tremblants.
— Pars, élève-toi, triomphe et méprise tes parents inutiles ! dit la mère qui sentait son cœur battre d’épouvante et d’orgueil.
Tous deux étaient tombés à genoux.
— Que faites-vous ? demanda Ta-Kiang, surpris de les voir en cette posture.
— J’ai laissé choir, dit le père, le caillou dont j’aiguise ma faux.
La mère dit :
— Je cherche une pièce de cuivre qui s’est échappée de mes doigts dans la cendre.
Et si les deux vieillards mentaient ainsi, c’est qu’ils connaissaient, comme le poète Ko-Li-Tsin et Yo-Men-Li la vannière, ces paroles d’un sage ancien : « Nulle bouche ne doit révéler le miracle qu’ont vu les yeux, car la destinée serait renversée et une nuée de malheurs descendrait du ciel. »
Trois heures plus tard, comme le soir tombait, le laboureur Ta-Kiang quitta pour toujours la cabane située dans un coin fauché du grand champ de Chi-Tse-Po, et, monté sur un lourd cheval, qui traînait d’ordinaire la charrette où s’entassent les gerbes de blé de riz, il commença de marcher dans la plaine, vers l’horizon.
Où allait-il ? où tendait son élan ? il n’aurait pas pu le dire. La cataracte ignore dans quel gouffre elle se précipite ; la flèche impétueuse ne sait pas quel cœur elle va percer. Mais il sentait que la détente irrésistible dont il était lancé le décochait vers un but certain et que sa volonté s’adaptait à la destinée. Or, son désir, indéfini encore, était immense. Ses vieux parents, sa cabane, Yo-Men-Li, qu’était-ce que cela ? Le passé, l’oubli, la fumée d’un feu éteint ; il voyait s’allumer l’avenir. D’ailleurs, fatal, il ne concevait ni espérance ni joie, ayant la certitude et l’orgueil. Avant l’entreprise il jouissait du succès. Ses grandeurs étaient en lui, virtuelles. Des batailles futures se tordaient, furieuses dans le champ de sa pensée ; il sentait déjà sur sa tête comme un poids de couronne, et ses mains tenaient un grand faisceau de puissances et de victoires.
Cependant il traversait solitairement le champ de Chi-Tse-Po, sur un vieux cheval las, à la tête humble, au pas boiteux.
La nuit était venue. Une dernière lueur s’éteignait du côté de l’occident. La plaine semblait une mer obscure et immobile.
Ta-Kiang, dans l’ombre, dévia du chemin où il s’était engagé. « Lorsque les Bouddhas vous égarent, pensa-t-il, ils vous mettent dans la bonne route. » Mais son cheval marchait avec peine dans les terres fraîchement remuées et buttait à chaque pas. Le voyageur tourna la tête dans l’espérance d’apercevoir un sentier ; il vit dans les ténèbres deux personnes à cheval qui s’avançaient vers lui.
— Qui vient là ? cria-t-il en faisant halte.
— Frère, dit une voix qui était celle de Ko-Li-Tsin, je t’aime, permets-moi de m’associer à ta fortune. Un esprit ingénieux et un dévouement attentif ne sont pas des compagnons inutiles.
— Je t’accepte pour serviteur, répondit Ta-Kiang d’un ton hautain.
— Ô toi dont je ne suis plus la fiancée, dit une voix de femme, veux-tu que je te suive comme une servante ? Si tu me repousses, je vais subitement mourir, pareille à une plante saisie par la gelée.
— Pauvre petite, emmène-la, insinua le poète.
Mais Ta-Kiang dit avec rudesse :
— Je n’ai pas besoin qu’une femme me suive.
— Une femme ! s’écria Yo-Men-Li en résistant aux larmes qui lui montaient aux yeux. J’ai revêtu les habits de mon jeune frère et j’ai pris un cœur d’homme en même temps que ce costume d’homme. S’il faut du courage pour te servir, j’en aurai plus qu’un guerrier ; s’il faut de l’adresse et de la ruse, je serai plus adroite qu’un voleur et plus rusée qu’un juge ; s’il faut mourir, je mourrai, et, morte, s’il faut revenir des pays d’en haut pour te servir encore, sois tranquille, j’en reviendrai.
Yo-Men-Li parlait d’un ton ferme. Ta-Kiang songea qu’une femme hardie peut accomplir de grands travaux.
— Si tu le veux, sois ma servante, dit-il en poussant son cheval en avant.
— Attends, dit Ko-Li-Tsin, j’ai encore quelques mots à te dire.
— Parle, mais hâte-toi.
— Oh ! dit le poète, je serai bref. Il y a quelques lunes, pendant mon séjour dans la ville de Tong-Tchou, qui est certainement une ville remarquable par la beauté de sa pagode, de ses remparts, de sa tour à sept étages, et par la laideur de ses bonzes, il y a quelques lunes, donc, je fis la connaissance d’une très jeune veuve, que je n’hésiterais pas à proclamer la plus jolie des femmes si je ne connaissais Yo-Men-Li, ta servante, et si le gouverneur du Chen-Si n’avait pas une fille destinée à devenir l’épouse du lettré Ko-Li-Tsin dès qu’il aura trouvé une pensée philosophique propre à être mise en vers de sept caractères.
— Abrège, dit Ta-Kiang.
— C’est ce que je fais. J’eus le bonheur de rendre à l’époux de cet aimable personne un signalé service d’ami, en consolant sa femme inconsolable de la perte qu’elle avait faite. Je la consolai, dis-je, en d’aimables entretiens égayés par les improvisations réjouissantes que m’inspire communément mon naturel enjoué.
Ta-Kiang fit un geste d’impatience, mais le poète n’y prit point garde.
— Un, deux, trois, quatre, dit-il en comptant sur ses doigts.
Un matin une jeune pivoine crut qu’il fallait mourir parce que la lune s’était éteinte ;
Mais le soleil joyeux vint rire au-dessus d’elle, et la jeune pivoine, oublieuse de la lune, s’épanouit avec tendresse.
— Je me lasse, dit Ta-Kiang.
— D’écouter les vers que j’improvise ? Cela ne saurait être. Enfin, reconnaissante d’avoir retrouvé en ma compagnie ses sourires d’autrefois, la jeune veuve voulut, quand je partis, me donner en souvenir d’elle une large ceinture pleine de liangs d’or. Je me défendis d’abord d’accepter, objectant que la joie d’avoir obligé une si gracieuse femme me récompensait au delà de mes mérites ; mais elle insista de telle façon que, dans la crainte de lui déplaire, je dus recevoir son présent.
— Achèveras-tu ? cria Ta-Kiang.
— Je n’ai pas tiré un seul liang de cette ceinture, continua Ko-Li-Tsin ; ne la refuse pas, car l’argent est utile pour voyager au loin.
— Tu pouvais m’épargner le récit, dit Ta-Kiang en acceptant la ceinture.
Yo-Men-Li, timidement, reprit la parole.
— Je ne possède qu’une bien faible somme, murmura-t-elle. Depuis longtemps je l’amassais ; elle était destinée à acheter mes habits de noces ; mais maintenant je ne me marie plus. Si Ta-Kiang daigne la recevoir des mains de sa servante, Yo-Men-Li sera très heureuse.
Elle versa une petite poignée d’or dans la main de celui qui avait été son fiancé. Ta-Kiang cria :
— Partons !
Les trois aventuriers se mirent en marche. Ils se dirigèrent silencieusement vers une colline lointaine, au delà de laquelle passe la route qui conduit à Pei-King. La lune, large et claire, montait à l’horizon. Derrière Ta-Kiang, l’ombre démesurée d’un dragon s’étendait d’un bout à l’autre de la plaine, comme si elle avait voulu embrasser le monde de ses grands anneaux déroulés.
CHAPITRE II
PEI-KING
Un voyageur traversait une grande plaine, non loin du Fleuve Blanc, et
c’était à l’heure où la lune s’allume mélancoliquement dans le crépuscule du soir, et il vit une grande lueur du côté de l’orient.
« Oh ! oh ! se dit-il, voici un pays étrange, un pays certainement plus étrange que tous les pays où j’ai voyagé jusqu’à ce jour ; car, ici, c’est à l’orient que le soleil se couche. »
Et s’adressant à un homme, qui harcelait d’un aiguillon de bambou un troupeau de buffles noirs : « Quel est donc ce pays, dit-il, où le soleil se couche du côté de l’orient ? »
« — Sou-Tong-Po lui-même n’a jamais vu de pays où le soleil se couche du côté de l’orient, et ce que tu prends pour le coucher miraculeux d’un astre, c’est la splendeur de Pei-King », dit le pâtre.
De coteau en coteau, de vallée en vallée, le voyage fut long. Le soleil se leva, se coucha, se leva. Point d’auberge sur la route ; on mangeait à cheval, on dormait sur la dure. Impassible, Ta-Kiang conversait avec ses pensées ; Yo-Men-Li, exténuée, montrait des sourires et cachait des larmes ; Ko-Li-Tsin lui-même parlait peu. Ils atteignirent péniblement la plaine sablonneuse qui environne Pei-King, plaine monotone, bosselée de dunes mouvantes, où le regard ne rencontre rien pour se poser, jusqu’aux collines d’un bleu laiteux de l’horizon et palpite, ébloui et las, comme un oiseau sur l’Océan. Enfin, tandis que le soir tombait pour la troisième fois depuis leur départ, ils aperçurent une gigantesque muraille qui barrait le ciel, noire à sa base, rougeoyante à son faîte. C’était le premier rempart de la Capitale du Nord. Haut, crénelé, ténébreux sur la clarté, il masquait les feux du soleil qui se couchait derrière la ville ; mais les rayons triomphants débordaient le mur sombre, et de chaque créneau jaillissaient des flammes.
Flanqué de lourdes tours carrées qui saillissent hors du mur, le rempart quadrangulaire qui cerne Pei-King de sa fierté puissante, projette de loin en loin un bastion en forme de demi-hexagone, dont chaque face se creuse d’une longue galerie voûtée et dont la plate-forme s’exhausse d’un pavillon de bois pourpre où, sur deux terrasses superposées, des soldats attentifs veillent près des embrasures, fermées, en temps de paix, par des panneaux rouges, sur lesquels sont peintes des gueules de canons, qui cachent les vrais canons de bronze vert.
Les trois voyageurs, depuis longtemps épiés, à travers les balustrades à jour des terrasses, par les yeux perçants de la méfiance vigilante, choisirent, pour entrer dans la ville, la galerie centrale du bastion qui faisait face à leur arrivée. C’était celle qu’on nomme la Porte qui Salue le Sud.
— Arrêtez ! cria une sentinelle.
Ils firent halte.
— Qui êtes-vous ?
Ko-Li-Tsin répondit :
— Ta-Kiang, laboureur ; Yo-Men-Li, vannier ; Ko-Li-Tsin, poète. Le poète, ajouta-t-il, c’est moi.
— D’où venez-vous ?
— Du champ de Chi-Tse-Po.
— Où allez-vous ?
— À Pei-King.
— Passez.
Les aventuriers se hâtèrent vers une longue avenue, nommée Avenue du Centre, qui s’ouvre au delà de la Porte qui Salue le Sud et traverse la Cité Chinoise, la première des quatre cités dont se compose la Capitale du Nord. Ta-Kiang était en tête. Il entra fièrement dans Pei-King. Il n’avait pas parlé depuis trois jours. Il dressa le front, et dit :
— Il me semble que j’ai conquis cette ville.
L’Avenue du Centre, qui s’éloigne large et directe, est pavée de grandes dalles, disjointes et effondrées, que les roues des lourds chariots défoncent et brisent de plus en plus et dont les ornières et les gouffres infligent de bien cruels cahots à ceux qui passent en voiture.
Après quelques corps de garde et des postes de douaniers, apparaissent, face à face, à droite le Temple du Ciel, qui est rond, à gauche, le Temple de la Terre, qui est carré. Leurs magnifiques jardins, plantés de cèdres, de saules, de jujubiers, et bordés d’un mur rose à crête émaillée de jaune, laissent voir à travers les branches, des dômes couleur d’azur, des murs dont l’émail bleu est parsemé d’étoiles d’or et de hardis escaliers d’albâtre.
Après ces riches frondaisons, qui projettent leur ombre sur l’avenue, des maisons rares, humbles, basses, aux toits de tuiles ternes, aux étroites fenêtres treillagées de roseaux, aux portes en saillie, que protègent mal de minces auvents d’ardoises, se dispersent parmi des terrains cultivés et tournent de ci, de là, sans règle, leurs petites façades grises. Mais, à mesure qu’on pénètre plus avant dans la Cité, les maisons se rapprochent, s’exhaussent et s’alignent ; les façades se revêtent de laque, des galeries finement découpées circulent autour des corniches, et les toitures, à chaque angle, se décorent de dragons ou d’oiseaux fantastiques ; on était dans un chemin, on se trouve dans une rue. L’Avenue du Centre, naguère monotone et traversée à peine par quelques paysans, se colore et se peuple ; une triple porte triomphale apparaît. Des banderoles multicolores frissonnent, attachées à des poteaux de bois rouge. Cent boutiques projettent verticalement leurs enseignes jaunes, bleues, argentées. Bruyantes et populeuses, des rues s’ouvrent sur la voie principale et y déversent leurs passants. Mille gens sortent de leurs maisons. On piétine dans la poussière on se coudoie, on crie. Des groupes de plaisants se forment çà et là, écrivant sur les murs des sentences facétieuses ou d’impertinentes épigrammes adressées à quelque grand dignitaire, et la foule autour d’eux les approuve et se pâme de rire. Des deux côtés de l’avenue, devant les maisons, des marchands de ferrailles, de poissons, de gibier de Mongolie, des ravaudeurs, ont dressé des baraques afin d’y installer leurs industries, ou s’abritent simplement sous de grands parasols carrés, bleus, gris, blancs, roussâtres ; ils vocifèrent, hurlent, chantent, imitent des cris d’animaux, choquent des tams-tams, secouent des clochettes, et font claquer des claque-bois, pour attirer l’attention des chalands qui se pressent entre deux rangs d’étalages bariolés. Des cuisiniers ambulants activent sans relâche le feu de leurs fourneaux ; le riz fume, la friture grésille, et plus d’un gourmand se brûle le bout des doigts. Un barbier saisit un passant, qui ne s’attendait guerre à cette agression, et, roulant autour de sa main la longue natte du patient, le renverse en arrière et lui rase le crâne avec vélocité. Des bandes de mendiants gémissent à tue-tête ; une troupe de musiciens fait un tapage assourdissant ; un orateur, monté sur une borne, s’égosille, tandis que des volailles égorgées glapissent aigrement et que des forgerons battent le fer, et que des marchands d’eau poussent leur cri aigu en laissant quelquefois tomber sur le dos de la foule le contenu de leurs vastes seilles.
Des chameaux à grands poils fauves, en longues files, reliés entre eux par la même corde attachée à l’anneau de leur narine, passent d’un air digne, scandant leur marche sur les tintements de la cloche pendue au cou de celui qui est en tête, et dont on perçoit de loin la claire et sonore vibration.
À droite, à gauche, les rues transversales roulent tout autant de gens et de vacarme dans plus de poussière et dans plus d’encombrement. Artère principale à son tour, chacune d’elles reçoit les flots tumultueux de vingt ruelles tributaires. Les principales embouchures ont lieu dans de grands carrefours où s’entassent des sacs de riz et de blé, des monceaux de fruits, des montagnes de légumes et d’immenses quartiers de viande crue. Au-dessus des victuailles, parfois, dans des cages de bois suspendues à des poteaux, apparaissent, hideuses, des têtes de criminels récemment exécutés ; souvent les cages sont brisées, effondrées, et les têtes, retenues seulement par leurs nattes, se balancent horriblement, verdâtres, grimaçantes, effroyables. Meng-Tze a dit : « Il faut des exemples à la foule. » En suivant jusqu’au bout les rues transversales, les mille piétons arriveraient aux faubourgs latéraux de la Cité Chinoise, quartiers spacieux et peu bruyants où des maisons rustiques rampent misérablement dans de petits champs plantés de choux et de riz, où des enfants chétifs, sordides, loqueteux, et quelques chiens efflanqués, furetant dans des tas d’immondices, peuplent seuls des chemins défoncés. Mais les cohues ne se prolongent guère au delà des marchés ; gens affairés ou promeneurs curieux se hâtent, leurs affaires terminées ou leur curiosité satisfaite, de s’engager dans les longs passages tortueux qui, des carrefours, vont rejoindre obliquement l’Avenue du Centre. Ces passages, couloirs étroits, se signalent aux passants par les odeurs fétides et la vapeur noirâtre qu’exhale leur entrée obscure. Mal éclairé, de quelques lampes qui fument et tremblotent, enduit d’une boue glissante où sont épars des débris informes, des tessons, des morceaux de vieux souliers, des loques inconnues, leur terrain se bosselle périlleusement entre deux rangées d’affreux taudis branlants, construits de planches qui proviennent de démolitions et qui montrent encore çà et là un angle sculpté ou une ancienne dorure déshonorée par cent macules. Ce sont des boutiques, et, sous le prétexte de faire commerce d’objets d’art anciens, des brocanteurs y entassent d’horribles vieilleries poussiéreuses : porcelaines fêlées, pots écornés, costumes déteints, pipes noircies, bronzes bossués, fourrures mangées des vers, engins de pêche rompus, bottes moisies, arcs sans cordes, piques sans pointes, sabres sans poignées. Blottis, enfoncés, engloutis dans ces encombrements de viles antiquailles, les marchands s’efforcent de ne pas étouffer entièrement ; au-dessus de chaque étalage, se dresse une vieille tête jaune, pointue, au crâne pelé, aux yeux cerclés d’immenses lunettes, qui célèbre sans relâche d’une voix glapissante les rares splendeurs de la boutique. Mais l’acre fumée des lampes chatouille si désagréablement la gorge, les loques décolorées qui se balancent en guise d’enseigne et semblent des rangées de pendus, sont pleines de vermines si évidentes, que le passant le moins délicat résiste à l’éloquence des brocanteurs et se hâte de continuer son chemin vers l’Avenue du Centre, claire, bruyante, directe, où les poumons se peuvent emplir d’air pur, les oreilles de bruits joyeux, et où le regard embrasse tant d’aspects souriants depuis la Porte du Sud, par laquelle on débouche de la plaine, jusqu’à la Porte de l’Aurore, creusée dans le long mur transversal qui termine la populaire Cité Chinoise.
La Porte de l’Aurore qui donne entrée dans l’élégante Cité Tartare, est précédée d’un fossé souvent à sec, et d’un pont de marbre blanc que d’exquises balustrades à jour partagent en trois ; le chemin du milieu est réservé à l’empereur, qui y passe rarement ; d’ordinaire il est envahi par les mendiants : ils s’y installent et l’encombrent, si bien que ce pont est nommé : Pont des Mendiants. Là, des êtres hâves et décharnés grouillent au soleil, étalent leurs plaies, implorent la charité, ou bien font la chasse à leur vermine, ils jouent aux dés leurs misérables loques, se dépouillant si complètement, parfois, qu’ils sont réduits, pour s’en faire un pagne, à nouer une brique à une ficelle.