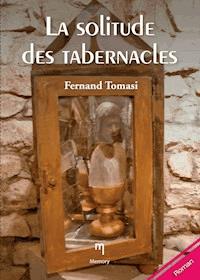
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Memory
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Comment réagir lorsque la maladie prend le dessus ? Découvrez le combat de Laure dans ce roman poignant.Laure, jeune veuve, a découvert dans la sculpture le sens et le but de sa vie. Elle engage dans sa passion la totalité de son énergie, de son temps, de ses aptitudes... Elle tombe gravement malade et demande à André, son meilleur ami, et qui a toujours été silencieusement amoureux d'elle, de revenir du Canada pour passer quelque temps en sa compagnie. André revient et retrouve son amie, plus fragile que jamais avec sa maladie, mais de plus en plus plongée dans la profondeur de son être, de sa passion, qui la conduit à des hauteurs spirituelles rares, lui offrant un regard différent sur les êtres et les choses de ce monde. Ce récit se construit petit à petit, uniquement au travers des courriers échangés entre les deux protagonistes, courriers retrouvés et mis bout à bout par un cousin, René, bien plus tard, et quand « tout est rentré dans l’ordre ». Il a pu alors se permettre des ajouts et réflexions personnels pour créer le présent livre qui est un aboutissement vrai et cependant très agréable à découvrir. Et surtout, n'oublions pas d'apprécier le très bel écrin de poésie et d'amour dans lequel l’auteur, avec une grande finesse de plume, a niché son roman. Une belle leçon de vie sous forme de roman épistolaire À PROPOS DE L'AUTEURFernand Tomasi est originaire d’Orsinfaing dans la commune de Habay, en Belgique. Il a été professeur de français et d’histoire dans les cours secondaires. Mais la sculpture est sa passion depuis l’enfance. L’atelier le Haut-Fer dans l’ancienne scierie Wavreil à Meix-devant-Virton est ouvert lors de ses expositions ou à la demande. La sculpture a toujours été pour lui un dialogue avec le bois, la pierre, le marbre et les mots.EXTRAITC’est un devoir de me pencher sur l’existence de mon cousin André et de son amie Laure.Professeur de français, je m’applique à étudier les qualités littéraires des écrivains. Pour transmettre des techniques éprouvées à mes élèves. Quelques-uns sont parvenus à se faire remarquer par leurs publications.Ecrire pour atteindre à une gloriole éphémère auprès des connaisseurs ne m’a jamais décidé à m’immobiliser, plume à la main, devant des pages blanches.Toute mon énergie est canalisée vers l’aide que je dois à ces jeunes à la découverte d’eux-mêmes, de la vie et des arts capables de les enthousiasmer. Comme le mercure s’amalgame à l’or, la création ramasse en elle tous les déchets de la vie, petits bouts de joies avortées, promesses non tenues, blessures multiples provenant de l’oubli et même de la volonté de faire mal. Il reste à chauffer l’ensemble au foyer de l’enthousiasme pour que se dissipe le côté négatif et que brille l’or de la poésie du regard.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En une seule pensée créatrice revivent mille nuits d’amour oubliées qui en font la grandeur et le sublime.
Ceux qui se joignent au cours des nuits, qui s’enlacent, dans une volupté berceuse, accomplissent une œuvre grave.
Ils amassent douceurs, gravités et puissances pour le chant de ce poète qui se lèvera et dira d’inexprimables bonheurs.
Lettres à un jeune poète. Rainer-Maria Rilke
C’est un devoir de me pencher sur l’existence de mon cousin André et de son amie Laure.
Professeur de français, je m’applique à étudier les qualités littéraires des écrivains. Pour transmettre des techniques éprouvées à mes élèves. Quelques-uns sont parvenus à se faire remarquer par leurs publications.
Ecrire pour atteindre à une gloriole éphémère auprès des connaisseurs ne m’a jamais décidé à m’immobiliser, plume à la main, devant des pages blanches.
Toute mon énergie est canalisée vers l’aide que je dois à ces jeunes à la découverte d’eux-mêmes, de la vie et des arts capables de les enthousiasmer. Comme le mercure s’amalgame à l’or, la création ramasse en elle tous les déchets de la vie, petits bouts de joies avortées, promesses non tenues, blessures multiples provenant de l’oubli et même de la volonté de faire mal. Il reste à chauffer l’ensemble au foyer de l’enthousiasme pour que se dissipe le côté négatif et que brille l’or de la poésie du regard.
Tous les enfants sont nos enfants et je continuerai à les aider à grandir.
Je veux sauver le souvenir de deux amis : j’ai recueilli notes écrites, pensées fugaces qui me viennent en des moments de vide. Que peut-on faire avec les éclats de vie de plusieurs êtres qu’on rencontrait peu et dont les émotions, les élans, les erreurs, les peurs, les souffrances me sont parvenus en écritures décousues ?
Épisodes partagés avec Laure et André. Enfance dans le même village endormi par les travaux lents de la campagne. Accents d’accordéon de fête. Habillé de dimanche, j’entrais dans la luminère de la salle de bal, porté par les ritournelles de l’instrument.
Je m’asseyais à l’écart pour embrasser la salle d’un seul regard et privilégier le spectacle.
Je balayais des yeux les danseurs de gauche à droite puis de droite à gauche. Je méditais le déplacement des corps. Du pied qui abandonne l’appui du sol et s’envole jusqu’au prochain temps de la mesure. L’équilibre des couples enlacés était pour moi symbole du miracle de la vie, du déplacement des planètes et des astres dans l’espace infini. Tout cela me disait la grandeur du moment présent.
– Tu danses avec moi, me demandait Laure ?
Je la regardais, l’âme retournée de la voir belle, vivante. Les joues rosies par l’effort physique.
Je craignais le monde féminin. Je ne parviendrais jamais à l’harmonie avec une femme belle et troublante. Je n’avais jamais vu de femme nue. Pouvait-on vraiment connaître une poitrine de femme sans l’avoir dévêtue, touchée, caressée ? Que devenait le visage de celle qui acceptait le jeu des corps ? Je ne connaissais du sexe que les propos audacieux de garçons grossiers.
J’éludais son invitation avec le prétexte de mon incapacité de danser. Je rêvais de mouvements vertigineux qui m’auraient soulevé de terre, qui auraient été transcendance du déplacement horizontal et vertical.
Laure me fixait intensément. Reproche ? Conscience que jamais nous ne réaliserions une harmonie de joies terrestres.
S’éloignait la déesse d’un dieu que je n’étais pas.
Les études supérieures dans des écoles différentes nous ont séparés. Les confidences de l’âge mûr nous ont rapprochés. Puis c’étaient des mots brefs de mon cousin André envoyés de l’autre rive de l’Atlantique.
Un inconnu m’a envoyé pages de journal, lettres, mots brefs. Bribes significatives, méditées ou griffonnées à la hâte.
Je lis sa relation de treize jours du printemps 1995, dans notre région natale du sud du pays :
Je croyais diriger mes jours, les orienter, en tirer les joies du travail bien fait. Je savourais une solitude monotone. Qu’était l’amitié ? Je n’avais que des subordonnés polis, quelques relations par la Sodec, société d’Etat qui, au Québec, gère, programme et organise les manifestations culturelles de la « Belle Province ».
Laure vivait seule après la disparition de son mari en 93.
– René, je t’invite chez moi avec quelques amis.
La soirée commence dans l’euphorie.
Puis quelques propos, critiques voire amers. Ils vous aident à grandir. Seules les flatteries ne servent à rien. Elles endorment, laissent croire en des valeurs frelatées. Les méchancetés flagellent : fouet de l’ambition et de l’envie de grandir intérieurement. L’intelligence véritable permet de créer son propre bonheur, sans rien exiger des autres.
Laure était vraie, occupée à construire son bonheur dans la chaleur de sa création.
Pierre-Alain tient le crachoir. Habitué aux discours, il remplace le dialogue par de longues tirades. Parole fluide, répétitive, souvent ampoulée. Signe d’inquiétude, manque de confiance dans des capacités réelles ? Pour la réussite, il a confondu qualités et brillant superficiel.
Cailles farcies où graisse tendre équilibre le doux-amer des cerises du nord. Plat de pierre ollaire déniché chez un ami italien.
– Vous les artistes, vous êtes prétentieux, vous vous croyez meilleurs que les autres. Les journaux ne parlent que de vous. Ras le bol de ces vantardises.
Trop marqué par le médoc, le discoureur n’a pu se retenir, conscient de ses incapacités, cimentées de ses échecs, de ses tentatives de briller par combines avec des amis aussi paumés que lui. Encensoir de béatification passé d’une main à l’autre.
– Marie-Jo fait de belles aquarelles. Ma petite femme suit des cours chez un grand maître.
Je m’étonne de cette contradiction. Les artistes ne valent rien, mais « ma femme est une vraie artiste ».
Pierre-Alain met tout en doute et affirme des choses contradictoires. Il a tâté à la politique et en a acquis cette manière de parler. Laure est mal à l’aise, blessée par ses propos.
– L’art doit respecter la tradition, la perspective.
Laure répond sur un ton ferme : « L’art, c’est la liberté de dire les choses fortement. L’expression se moque des formes anciennes. La beauté n’a rien à voir avec le joli. L’art est transmission d’expériences profondes, poursuivies dans la solitude sans compromission avec qui que ce soit. « Toute beauté est terrible » écrit Rilke dans les « Élégies de Duino ».
Cette remarque blesse le politicien manqué. Il a drainé des voix vers de plus malins. Il avait avoué à Laure sa déception de n’avoir pu devenir député, sénateur. On lui a donné des sucettes pour le faire taire.
Un homme « cultivé » peut-il imposer ses idées à cette femme qui a voué toutes ses forces à la création ? Au contraire, qu’il l’interroge sur sa conception de l’activité artistique.
– Nous ne sommes pas du même monde, a conclu Marie-Jo, la femme du « politicien ».
Laure, d’un ton froid et décidé, répond qu’elle souhaite ne plus les voir. Je sens la colère sous ses mots mesurés. Elle ajoute : « Tu étais aussi pauvre que moi et tu t’es agité dans tous les sens pour te faire pousser au derrière, pour aboutir à quoi ? »
Marie-Jo insiste : « Laure, tu me déçois. »
Laure ne voulait plus les voir. Ne plus jamais les inviter ni à ses expositions ni chez elle.
Témoin, j’ai compris que ces gens étaient creux, ne parlaient que d’eux-mêmes, de leurs voyages, de leurs amis haut placés, de leurs réceptions et de leur manque d’argent dû à des dépenses en réceptions somptuaires, en vins recherchés et en vêtements de soirée auxquels ils accordent plus de valeurs qu’à l’amitié, au travail secret et efficace, à la solitude active.
J’ai fait un rapport bien pessimiste de cette soirée. Protéger Laure, mon admiration du travail de Laure, sa dignité de ne jamais mendier qu’on l’encense m’ont poussé à noircir l’attitude de ces « amis ».
J’ai reparlé de cette soirée avec Laure. « Je leur permets de me critiquer. On ne peut se crêper le chignon qu’entre amis ou entre frères et sœurs. Avec des étrangers, avec des gens qu’on ne fréquente pas, c’est impossible. Peut-on se cogner à des meubles qu’on n’approche jamais ? »
« J’ai téléphoné à ces amis le lendemain. J’ai proposé à Marie-Jo d’exposer avec moi dans une galerie parisienne qui m’a invitée. Nous nous partagerions la salle. Ce serait une sorte de complémentarité entre ses aquarelles colorées et mes sculptures sobres, sévères. Elle a décidé de ne pas m’accompagner. »
« Je me suis retrouvée seule face à un public exigeant, enthousiaste. Je n’ai averti aucun journaliste de notre région. Ce fut une expérience heureuse pour moi. Elle m’enfonçait encore plus dans la solitude. »
Laure a repris le ton de l’amitié avec ces amis de longue date. On pourrait l’accuser de faiblesse. « Je médite la solution de tendre l’autre joue. Est-ce humiliant ? » m’a-t-elle expliqué.
Journal d’André.
Vendredi 20 avril.
Nous venons de survoler le Labrador. Par le hublot, je ne vois rien. Nuit totale. Notre courbe de vol aborde l’Atlantique.
L’avion, à près de neuf cents kilomètres heure, fait naître le jour.
Depuis Mirabel, le Québec est resté invisible sous sa double couverture de neige et de nuit.
Premiers icebergs avec légers éclats blanc rosé. Le soleil va se lever. L’horizon, papier humide, absorbe cette couleur aquarelle.
L’Océan se laboure de banquise éclatée. Le Boeing 747 hâte la récolte du jour.
Nous atterrirons vers 8 heures trente à Zaventem. Nous serons déjà le vingt et un avril. Mystère du vieillissement plus rapide quand on se dirige vers l’est.
J’étais fier de mon engagement comme assistant à l’université de Québec. J’allais partager avec les jeunes architectes ma conception de la restauration des bâtiments anciens. Puis j’ai changé d’activité.
Ma voisine de gauche est plongée dans la lecture. Elle me parle dès le décollage. Je sors mon carnet de notes et commence à griffonner. Sans parole, j’ai reconquis ma solitude. Pourquoi ne pas risquer la rencontre ?
Absent depuis plus de vingt ans, je ne suis pas revenu lors du décès de mes parents. Mon cousin René s’est occupé de tout.
Les premiers pionniers fuyaient les dettes, les poursuites judiciaires, une vie sans honneur, d’autres, des déceptions personnelles. Victime de la réussite de mes études, je n’ai pas trouvé en Belgique le travail pour lequel j’ai été formé.
Comme les émigrants, je suis parti sans femme. Je n’ai emporté avec moi que le souvenir de Laure, enfant, adolescente.
Pourquoi rentrer quelques jours ? Treize en tout. Pour interrompre la monotonie de ma vie montréalaise ? Plus variée que celle de Québec, mon premier séjour ? Ville blessée de la conquête anglaise, rancune entretenue envers la France, qui n’est pas venue à son secours.
Comment Laure a-t-elle connu mon adresse rue Saint-Denis ? Par René peut-être ?
Je suis fatigué de suivre mes amis canadiens dans leurs escapades en Gaspésie. Je la connais sur le bout des doigts. Ses forêts d’arbres agressés par la tordeuse me dépriment. Rien ne m’attire plus dans ces vallées ravagées par les castors. Je ne vais plus pêcher le saumon dans la Matapedia. Fini aussi les pêches miraculeuses au travers de la glace. Ces distractions sont pauvres jeux pour oublier. J’ai envie de me promener sous les chênes et les hêtres de notre Ardenne.
Je veux pénétrer à nouveau la vie dense de notre province aux espaces réduits parsemés de villages, de fermes isolées et de villes jouets.
Laure m’a écrit.
Elle me dit que son mari est mort. Depuis deux ans déjà. Son mariage a été un échec.
« Je ne sais plus où je vais… J’ai l’impression de manquer d’air… Pourquoi t’ai-je laissé tomber ? »
Je n’ai répondu qu’un mois plus tard. Je lui parlais de mon travail absorbant. Adjoint au responsable culturel du Québec, je devais réaliser des exploits contre les programmes impossibles, les vedettes indisponibles qu’il faut remplacer par d’autres stars aussi en vue. Il fallait choisir les salles de spectacle, en discuter la location, les aménager selon les besoins. Engager des professionnels pour les derniers perfectionnements. Contacter les responsables des restaurations, anciens collègues de travail, pour sauver quelque moulin abandonné digne de devenir centre d’interprétation.
Je lui décrivais la région. Froidement comme cela se doit pour un pays glacial plus de la moitié de l’année. Dire autre chose aurait été un mensonge. J’avais envie de lui présenter la vallée du Saint-Laurent comme une banalité. Je me suis censuré. J’ai trahi mon émotion à propos d’un séjour dans une ancienne maison de Saint-Germain de Kamouraska. Une maison hantée. Elle appartient à un ami. De la fenêtre de la chambre, j’ai une vue en pente douce vers le fleuve par-dessus les trois rangs de terre distribués à l’arrivée des premiers colons par le seigneur chargé d’organiser la vie au nom du roi de France.
Bond en Europe, médecine contre la grisaille de ma vie. Claque qui peut-être m’éveillera.
J’osais à nouveau prononcer son nom : « Laure ». Etait-ce avec plaisir ? Ou comme on goûte une boisson longtemps enfermée dans sa bouteille ? Comme un test de mes réactions ?
Il y avait cet homme, Robert. Qu’elle avait fini par préférer. Toujours blagueur. Parsemant son langage de paroles lestes. Laure riait. Robert avait l’argent facile. Je l’accusais d’acheter mon amie avec de la fausse monnaie. Malgré tout, j’aimais les rires de Laure. Avec moi, elle restait sérieuse. Je m’exprimais peu. Fruit d’une éducation sévère, je ne me permettais aucun mot, aucun geste équivoques. Jamais je n’aurais osé la toucher. Robert lui passait, en public, la main dans ses longs cheveux blonds. Elle écartait à peine la tête de la menace prochaine des caresses. « Laisse-moi tranquille », disait-elle d’une voix sensuelle qui révélait plus son plaisir que la gêne.
Elle s’était éloignée de moi. Elle avait disparu.
La femme doit être le miracle de la vie. Celle qui invite, reçoit, fait le cadeau d’elle-même. En être rejeté est encore une joie, teintée de tristesse, de la savoir libre d’agir.
Je croyais qu’il me suffisait de travailler, d’obtenir les meilleurs résultats scolaires pour qu’elle s’accrochât à moi, qu’elle me dît son besoin de moi. Mon attitude respectueuse n’était au fond qu’une trahison, un manque de compréhension de ses besoins.
Nous contournons les Iles Britanniques par l’est. Nous survolons les plates-formes de pompage de la Mer du Nord. Au bout de la courbe, Bruxelles. Nous atterrirons dans une heure.
Me voici en Afrique avec Laure. Nous nous promenons le long d’un fleuve très large. Nous pataugeons dans la vase des rives. Nos vêtements sont déchirés. Des oiseaux invisibles crient de longues plaintes dans les cimes. Des piroguiers remontent le courant le long des bords. Ils jettent à l’eau des corps nus tailladés de blessures. Puis nous devons enjamber des cadavres décomposés à peine soutenus par la charpente des os visibles. L’air est chargé d’une forte odeur de café brûlé. Dans l’épaisseur des palmiers, les bâtiments d’une mission, surmontés d’un clocher avec croix, achèvent de se consumer. Des enfants vêtus de blanc maculé de rouge s’entassent contre un mur au bas d’une fenêtre. Laure porte un immense bassin de tôle émaillée sur la tête. Un capitaine le dépasse de la queue et de la tête. Une gueule pleine de dents en lames de couteau. Elle se tourne vers moi. Ses seins nus sont noirs. Tout son corps est noir. Ses cheveux sont crépus. Mais je sais que c’est Laure. Elle me dit : « Suis-moi, je vais te montrer le chemin ». Je me retrouve avec elle, main dans la main, sur la pente qui conduit à l’école. Elle a son visage rose, des yeux bleus immenses et de longues tresses blondes.
Une femme noire se penchait sur moi, me secouait le bras. « Veuillez attacher votre ceinture, nous allons atterrir. » Elle s’est éloignée après m’avoir gratifié d’un large sourire.
A Zaventem, pluie glacée. Tout paraît sale. Pourquoi un voyage semblable ?
Un orval, c’est un peu le Luxembourg, ses forêts, ses lieux de méditation. Ma bière est froide. J’en tire moins de plaisir que chez Léon à Montréal. Chez lui, c’est la bière du pays perdu. Le train tarde. Je change à Namur. Je revois le quartier de la gare, la rue des Brasseurs, l’église Saint-Loup.
La gare est en reconstruction. Les passages au-dessus des quais sont en matériau brut avec les empreintes surréalistes des pattes d’un pigeon en promenade dans le béton frais. Le surréalisme est une réalité de tous les jours. Il suffit d’en prendre conscience. L’horloge de la façade n’a pas d’aiguilles.
Mon voyage est lui-même une illusion : roman, film, expérience virtuelle ?
Marbehan. Gare « Maurice Grevisse ». Souvenirs scolaires, accord des participes passés, concordance des temps.
J’irai à Fleurcamp, loger à l’Hôtel de la Frontière.
Demain, je téléphonerai à Laure pour l’avertir de mon retour.
Est-il possible de tout recommencer ? Il y aura toujours ce Robert, ses éclats de rire, ses blagues qui finissaient par m’irriter ? Tout mon amour, tout le sérieux de mon regard sur Laure balayés par des propos de mauvais goût.
Je l’aurais empoisonné, je l’aurais guetté en bordure de forêt un jour de chasse, je lui aurais envoyé une balle de gros calibre en pleine tête, à bout portant. Autre solution moins dangereuse, mais combien douloureuse : m’écarter de leur bonheur, fuir au plus loin, me passionner pour ma profession.
Le Québec recrutait des francophones dans différentes professions. Je m’étais engagé dans l’enseignement. J’avais suivi des cours de gestion et ma carrière avait pris une nouvelle direction.
Laure était ma voisine. Je jouais avec elle depuis l’enfance. Ma mère me montrait une photo d’elle et de moi bébés. Nus sur la même couverture dans le jardin. Comme si charnellement notre sort était déjà lié.
Nous allions à l’école ensemble. Conduits par sa mère ou la mienne. Devenus « grands », nous montions la route empierrée, la main dans la main. Nous nous surveillions l’un l’autre. À la récréation, nous mangions ensemble nos biscuits ou nos fruits. Nous croquions la même pomme, dans une béatitude de paradis terrestre. Elle apprenait bien. Nous partagions la première place de la classe à tour de rôle. Alors que les autres élèves recevaient des punitions, j’étais un petit garçon privilégié. Je jouissais de cette impunité avec Laure sous le regard paternel du vieil instituteur. Oh ! La douceur d’être compris par une personne âgée qui investit dans la grandeur par son attention à des enfants, chez qui elle a deviné le destin qui les investit !
Quand avons-nous cessé de nous tenir la main pour nous rendre à l’école ? Etait-ce dû aux moqueries des autres ? À des allusions grossières dont je ne saisissais pas le sens ? Je voulais avant tout qu’on ne salît pas l’image que je portais en moi de ma petite amie.
Le rythme coulé des roues métalliques sur les rails est celui d’une pensée continue. Je poursuivrai mon journal pendant ce séjour européen. Pour mieux analyser chaque geste, chaque événement, pour transformer la solitude en force.
J’ai effacé dans ma vie mythes, croyances, adhésion à quelque parti par respect pour la réalité visible, concrète. N’existe que ce que je touche, sens, respire. Tout le reste est le fruit de ma pensée. Mon esprit porte tout en lui. J’y trouve ma grandeur et mes limites.
Je reconnais la nécessité de se raccrocher à une foi en quelque chose. À chacun de choisir librement en évitant les promesses de récompenses ou les menaces de punitions.
Je suis un atome de planète. Une poussière errante de l’univers. Je suis sorti de ce vaste tourbillonnement. Je m’y fondrai à nouveau un jour proche.
La femme est une rencontre risquée mais riche. Deux poussières unies pour le voyage.
Dimanche 22 avril.
Je viens de me lever. Un rien de soleil dans un ciel encore bien malade. Quelques flocons de neige tourbillonnent dans l’air calme. Je n’ai pas envie de sortir.
J’ai bien dormi. Je vais sauter le petit déjeuner. On le sert jusqu’à 10 heures. Il reste une quinzaine de minutes. Je me recouche.
– Pouvez-vous passer par Sommetoute, avais-je demandé au chauffeur de taxi ?
Personne dans les rues. C’est dimanche. Les enfants sont en congé. Les paysans attendent le retour de la douceur printanière. Je ne me suis pas arrêté devant la maison de Laure. Rien n’a changé dans mon village natal. J’ai détourné mes regards de ma maison vendue après la mort des parents survenue le même mois. La maison de Laure, repeinte, est toujours flanquée de son vaste hangar couvert de tôles. Seul changement : des arbustes décoratifs remplacent les machines agricoles rouillées.
Je n’ai pas téléphoné à Laure. Je me suis endormi très tôt. Je n’ai pas encore éliminé les effets du décalage horaire.
Qu’est-elle devenue depuis vingt ans ? Bien en chair, une solide santé de fille de paysan ? Elle n’a rien dit de ses occupations. Serais-je sauveur de son ennui de veuve ?
« Mon mari est mort, me voilà seule. Reviens, je t’en supplie ».
J’ai répondu : « Un jour, je reviendrai. Pour toi ». Réponse ambigüe certainement.
Je suis revenu. Pas tout de suite. Elle ne me mènera pas par le bout du nez. Communier à sa solitude comme à une pomme ?
Je suis là. Je dors. Après je téléphonerai.
Elle n’a pas donné son numéro. Invitation par politesse ? Appel au secours, erreur qu’elle regrette déjà ? Conscience d’avoir mal agi envers moi ?
Pendant le repas de midi, j’ai demandé l’annuaire téléphonique.
Steak tartare, pommes dauphines, haricots verts. Saint-émilion grand cru de 75. Pas de dessert. Un cappuccino à l’italienne. Lait mousseux, trois sucres.
Courte sieste. Demi-sommeil avec scènes de chasse à l’orignal. Avec un ami, mort depuis longtemps, d’un cancer qu’il avait caché à tout le monde. Il était parti refusant toute visite.
Rêve idiot : Je n’ai jamais chassé, comme je n’ai jamais mis les pieds en Afrique. L’animal me regardait, paisible comme une vache. Je tirais et le coup ne partait pas. J’étais sur la route, l’avant du véhicule écrasé par les sept cents kilos de l’animal en travers du capot.
« Ah ! tabarnacle, ça pouvait ête bin pire ! » Pourquoi mon ami disait cela ? Je ne sais pas.
Je suis parti à Artcourt en taxi pour revenir avec la voiture de location.
A dix-huit heures, j’ai pris le téléphone : 063/57…
Trois sonneries. Quatre. Cinq. On décroche.
– Laure…
Elle a simplement dit son prénom. Je reconnais sa voix. Ton sûr avec vibration de chant profond.
– C’est André, je suis revenu. Je suis à l’hôtel de la Frontière, à Fleurcamp.
Silence. Tout hésite entre possible et irréalisable.
– Viens ce soir, je t’attends.
Me voilà devant sa maison.
Vingt-trois heures. Je ne peux dormir. J’écris. Je tiens ma promesse de ne pas perdre les événements du jour. Mes émotions fortes ne peuvent sombrer qu’en écriture.
Elle ouvre la porte, ne dit rien. Moi non plus. Nous nous regardons, visages arrimés l’un à l’autre. On vient de se quitter. Elle est la même : pas plus épaisse, pas moins blonde. Peau claire sur blessure cachée ? Yeux sombres sur profondeur abyssale pour m’engloutir ?
– Entre vite, il fait froid. Elle resserre le châle sur ses épaules. Geste qui me rappelle sa mère.
Ses paroles ressuscitent vingt années, par petits éclats de mots. Icebergs que l’imagination reconstruit en banquise avec masses sombres noyées dans l’eau salée.
Elle a les mains endurcies au travail manuel. Aucun bijou aux doigts. Pas d’alliance. Pas de collier, pas de boucles d’oreille. Sous le châle, qu’elle pose sur un fauteuil, elle porte des vêtements de teinte grisâtre : équipée pour une aventure en brousse. Tenue de chasse pour tromper le gibier ?
Le salon est toujours le même. Meubles rustiques de bois sombre avec mémoire des faits quotidiens. Nefs solides pour affronter vagues, rapides et tourbillons. Le décor a changé. L’âme a créé de nouveaux besoins. Tableaux aux murs. Sculptures dans des angles discrets. Livres et revues sur les tables et les guéridons. Nourriture régulière de l’âme. Ils ne sont pas rangés. Prêts à venir au secours, à rendre le service de l’échange. Je lis sur des franges finement usagées, l’attouchement des doigts qui reprennent le chapitre à son interruption.
– Que bois-tu ?
– Un thé.
C’est celui que j’aime l’après-midi. Un earl-grey parfumé.
Nous ne disons rien. Nous avons trop à dire.
– Je savais que tu viendrais.
D’un ton très naturel, sans émotion apparente, elle avoue sa victoire.
– Je devais revenir.
Et d’un petit ton ironique, j’ajoute :
– Il faut bien que quelqu’un te surveille.
Elle se tait. Le temps passe. Je la regarde, elle me regarde avec l’œil lumineux, confiant.
Je ne l’ai jamais quittée : je l’ai portée en moi, à peine assoupie.
Je n’ai jamais arrondi mon bras sur sa hanche avec appui sur le galbe du corps. Est-il ferme ou tendrement tiède ? Ces pensées me troublent plus que toute rencontre fortuite de femme pendant vingt ans d’exil. Dans le froid de ce frigo de l’âme.
Comment franchir la profonde crevasse qui nous a éloignés ?
– Robert est mort quand ?
– Voilà deux ans déjà. Il était sorti avec des collègues après une fête à l’école. Il avait fortement gelé ce huit décembre. Il a dérapé et percuté un arbre de la côte de Grandplan dans la montée après le village. Le robinier était à peine blessé par ce choc. La voiture était enroulée autour de l’arbre.
Ton récitatif. Quelles ont été ses réactions dans ce drame ?
– Je n’ai pas vécu avec lui. Très vite, le froid s’est installé entre nous. Je ne riais plus à ses histoires.
Il a pris l’habitude de sortir, de boire avec ses collègues. Il m’a fallu vivre pour moi.
J’ai vendu la ferme et les bêtes à la mort de mes parents. Je n’ai gardé que l’habitation et le hangar attenant. Maman est morte la première. Elle ne disait rien. Je savais qu’elle souffrait de me voir triste. Papa l’a suivie huit jours après. Ils ne pouvaient vivre l’un sans l’autre. Le travail leur suffisait parce qu’ils ne cherchaient que le bien-être de l’autre. Je m’étonne encore de cette étrange coïncidence : tes parents et les miens sont morts la même année. A quelques semaines d’intervalle. Ils se fréquentaient beaucoup. Ils étaient comme deux couples mariés l’un à l’autre. Ils ont toujours collaboré dans leurs travaux agricoles. L’échec de mon mariage les avait blessés.
Laure ne disait rien de mon absence aux obsèques de mes parents. Mon retour devait l’étonner d’autant plus.
Un robinier ? Arbre importé par Robin, jardinier du roi Henri IV. Un arbre venu d’Amérique ? Mon amour de Laure aurait-il jeté un mauvais sort à Robert ? Cet arbre était venu depuis longtemps du nouveau continent pour réaliser mon crime ? Arbre aux aguêts où j’avais imaginé lui décharger un coup de fusil.
Puis après un long silence :
– Je peux vivre sans travailler. La vente de l’exploitation m’a rapporté une petite fortune.
Je le devinais puisque, moi-même, j’avais cédé tous les biens hérités au même acheteur que le sien. Les propriétés étaient réunies comme nos parents et nous-mêmes l’avions été.
– Peut-on vivre sans rien faire ?
– Non bien sûr.
Elle n’a rien ajouté.
– Le froid t’a bien conservé.
Le ton n’avait rien de moqueur. Il attendait que je m’engage dans des explications plus sérieuses.
– Je travaille pour le Ministère de la Culture du Québec. Je suis le bras droit du grand patron. Je voyage beaucoup surtout depuis que mon chef a eu des ennuis cardiaques. Tout doucement, je vais prendre le relais. Je le devine au respect que tous ont pour moi.
– Es-tu heureux ?
– Je ne me pose même pas la question.
– Mange avec moi, ce soir.
Quelques larmes se préparaient dans ses yeux brillants. Sincères, je pense. Mélange d’émotions, souvenir des déceptions, de l’absence de celui qu’on aimait depuis l’enfance et qu’on a perdu.
Risque de le perdre encore alors qu’il est là présent, provisoirement. Retenu au loin par la nécessité de vivre.
– Excuse-moi. Je voudrais me mettre à l’aise.





























