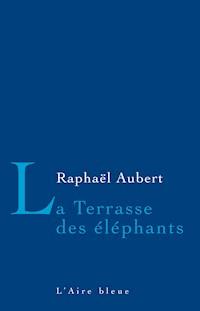
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions de l'Aire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Se déroulant sur près d’un demi-siècle en Suisse, en France, au Cambodge et au Vietnam, La Terrasse des éléphants est le roman de la rencontre et du destin
Un homme et une femme, qui se sont connus dans leur enfance et ne se sont plus jamais revus durant de longues années, peuvent-ils demeurer liés ? Qu’est-ce qui, en dépit de tout, unit les êtres ? Est-on maître de sa vie ? Ou n’est-ce encore qu’une illusion ?
Le héros de
La Terrasse des éléphants, Raphaël Santorin, a été correspondant de guerre au Vietnam où il a assisté à la fin du régime de Saigon. Alors qu’il est parvenu à un âge où l’on dresse le bilan de sa vie, ce passé, malgré les années écoulées, continue de le hanter. Un rêve le ramène aux Hautes Terres, la maison familiale qui a tellement compté dans sa vie, où il est conduit à une étrange découverte. Elle fait ressurgir du néant la figure de Laure, le grand amour de son enfance. Dès cet instant les événements vont s’enchaîner mystérieusement jusqu’à lui faire remettre ses pas dans ceux du passé.
Un livre envoûtant au style alerte
EXTRAIT
Peu lui importait que la chaleur fût lourde et qu’il transpirât à grosses gouttes sous ses vêtements qui poissaient d’humidité. Il avait fini par ne plus y prendre garde, retrouvant au contraire les gestes appris dans ce qui lui semblait appartenir à une autre vie. Et c’était presque machinalement, sans y penser, qu’il épongeait d’un bref revers de manche son front ruisselant.
Cela le ramenait plusieurs décennies en arrière. Il se revoyait dans le petit bureau sans air transformé en étuve par la mousson, et qu’il avait occupé durant les derniers mois de la guerre alors que l’on se battait déjà autour de Xuan Loc et dans la Plaine des Joncs, et que Saigon n’était plus qu’un immense paquebot à la dérive prenant l’eau de toute part.
CE QU’EN PENSE LA CRITIQUE
« Un roman qui est une vraie réussite. Un voile d'étrangeté enveloppe cette histoire, comme si une puissance invisible et ironique avait décidé de se jouer d'un personnage persuadé d'être maître de sa destinée. D'une écriture mesurée, harmonieuse, hostile à l'idée de produire des « effets »,
La Terrasse des éléphants est un livre subtilement enroulé sur lui-même. C'est un roman de l'irrépressible retour. Retour vers l'Asie. Retour à l'enfance. Retour sur soi... Lecteur avisé de Proust, Raphaël Aubert poursuit lui aussi une quête entre le temps perdu et le temps retrouvé. »
- Michel Audétat, L’Hebdo
A PROPOS DE L’AUTEUR
Prix de littérature 2014 de la Fondation vaudoise pour la culture, Raphaël Aubert a publié plusieurs essais remarqués sur Balthus, Malraux et Picasso. Il est également l’un des auteurs du
Dictionnaire Malraux (CNRS, 2011). Son roman,
La Terrasse des éléphants, a connu un très grand succès. Ses dernières parutions aux Editions l’Aire en 2014 sont
Cet envers du temps et
Sous les arbres et au bord du fleuve
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’auteur remercie Kamila Regent et Pierre Jaccaudqui l’ont accueilli en résidence d’écrituredans leur maison de Saignon en Luberon, au printemps 2008,où ce roman a été en partie rédigé.
« Sagesse : le plus grand effort humain pour sedéfendre contre son expérience.– Ou pour la justifier…– Il y a aussi, parfois, d’autres façons d’échapper… »
ANDRÉ MALRAUX
PROLOGUE
Peu lui importait que la chaleur fût lourde et qu’il transpirât à grosses gouttes sous ses vêtements qui poissaient d’humidité. Il avait fini par ne plus y prendre garde, retrouvant au contraire les gestes appris dans ce qui lui semblait appartenir à une autre vie. Et c’était presque machinalement, sans y penser, qu’il épongeait d’un bref revers de manche son front ruisselant.
Cela le ramenait plusieurs décennies en arrière.
Il se revoyait dans le petit bureau sans air transformé en étuve par la mousson, et qu’il avait occupé durant les derniers mois de la guerre alors que l’on se battait déjà autour de Xuan Loc et dans la Plaine des Joncs, et que Saigon n’était plus qu’un immense paquebot à la dérive prenant l’eau de toute part.
Autant dire : une tout autre époque de sa vie. A des années lumière de son existence présente, mais qui soudain lui apparaissait étonnamment proche.
Peut-être parce qu’au fil des jours, il redécouvrait combien il avait aimé passionnément ce coin d’Asie. Et combien sans doute il lui restait intimement attaché, à la manière d’une vieille maîtresse avec qui on a rompu depuis longtemps, mais à laquelle on continue de penser avec un mélange d’affection et de reconnaissance.
Dès l’escale de Singapour où un autre avion l’attendait pour Siem Réap, lorsqu’il avait été fumer une cigarette sur l’une des terrasses dominant le tarmac, la vue du ciel cotonneux traversé des premières lueurs de l’aube l’avait rempli d’une sorte d’exaltation. Ensuite il y avait eu le premier tuk-tuk à l’arrivée, le concert des klaxons, la foule féline et disciplinée, les marchés avec leurs étals débordant de fruits multicolores jusque sur les trottoirs, la touffeur lourde mêlée à l’âcre odeur de bonbon acidulé des gaz d’échappement des voitures et des motos.
Tout ce qui rendait cette partie du monde si banalement différente en même temps qu’étrangement familière et qu’il retrouvait intacte, comme s’il ne l’avait jamais quittée.
L’Asie lui avait fait défaut et il se demandait à présent pourquoi il n’y était pas revenu plus tôt. A qui lui aurait posé abruptement la question, il aurait répondu, sans réfléchir, que cela ne s’était pas trouvé. Que la roue de la vie avait tourné. C’était bien sûr vrai. Ce n’était pourtant pas si simple.
Il y avait eu le contrecoup de la fin de la guerre qui l’avait obligé à revenir en Europe. L’écroulement d’un monde qui avait malgré tout été le sien et des quelques certitudes qui allaient avec. Il lui avait fallu du temps, à la manière d’une longue convalescence. L’Asie, il avait cherché à l’oublier. Mais sans y parvenir, maintenant il s’en rendait compte. Et puis il y avait eu cet appel du destin et la succession d’événements qui l’avait conduit jusqu’ici.
A quoi bon y penser ?
Plusieurs heures encore le séparaient de son rendezvous. Et plutôt que de demeurer à se morfondre à son hôtel, il avait repris une fois de plus le chemin du grand temple qu’il avait pourtant visité à maintes reprises. Mais ne disait-on pas que c’était à ce moment-là de la journée qu’il fallait s’y rendre ? C’était écrit dans tous les guides.
Il appréciait tout particulièrement cette heure tardive qui précède la fin du jour quand tout semble s’immobiliser. Un sentiment qu’il éprouvait plus fortement ici, sous ces latitudes, lorsque le ciel devient blanc avant de virer brusquement au noir et que s’allument les premières étoiles. Encore quelques minutes, alors ce serait la nuit. Une nuit de théâtre qui tombait ici presque d’un seul coup, et ce serait fini.
L’heure des songes qui annonce celle des dieux.
Avec l’obscurité bruissante d’insectes et de mille cris indistincts, ceux-ci redeviendraient maîtres des cours, des chapelles et des tours du vaste complexe sacré, rendu pour quelques heures aux chauves-souris voletant de corniche en corniche et à l’imprévisible rituel des geckos le disputant sur les façades au ballet immobile des devata toutes occupées de leur liturgie céleste.
Après être monté quelques marches et avoir franchi un portique de pierre, il s’engagea dans l’immense galerie.
Seule une étroite bande le long du mur aveugle était encore éclairée par les derniers éclats du soleil rusant avec la rangée de piliers carrés qui supportaient la voûte. Au-delà, c’était l’exubérance luxuriante de bouquets d’arbres qui avaient poussé jusque dans l’enceinte même du temple, palmiers, fromagers et aréquiers, dont les cimes hérissées se dressaient dans le crépuscule comme autant de sentinelles bienveillantes.
Malgré la pénombre qui mangeait peu à peu tout, il n’eut pas besoin de chercher.
Presque au centre de la galerie, sur le mur où s’étirait un vaste bas-relief, une silhouette au corps délié, ses quatre bras déployés en éventail, esquissait un pas de danse. Il s’approcha davantage effleurant d’une main la muraille finement ouvragée.
Le visage était orienté vers la droite comme tourné en lui-même, figé dans un imperceptible et tout à la fois impénétrable sourire ; l’un des bras tenait haut une sorte de boomerang en forme de disque tandis qu’un autre brandissait ce qui évoquait aussi bien un sceptre qu’une massue.
C’était Vishnou, le Seigneur de la Providence. Celui qui embrasse l’univers pour le protéger de son étreinte bienveillante.
Je te vois avec tes multiples bras, tes visages, tes yeux
Avec ta forme de toutes parts illimitée.
Je ne te vois ni fin, ni milieu, ni commencement,
Ô Seigneur universel et omniforme.
Comme la première fois qu’il l’avait contemplé, bien que ce sourire de pierre ne lui fût nullement destiné, il lui semblait que c’était à lui seul qu’il s’adressait :
Ô Dieu, je vois en ton corps
Tous les dieux aussi bien que les divers groupes d’êtres.
Tu es l’Impérissable, le suprême à connaître.
Tu es l’Immuable, le Gardien de l’éternelle Loi.
Il émanait une telle douceur de ce visage que luimême se sentait gagné par une sorte de paix qui faisait taire la sourde inquiétude mêlée d’impatience qui était la sienne depuis son arrivée au Cambodge quelques jours plus tôt. Jusqu’aux raisons qui l’y avaient amené, auxquelles il n’avait cessé de songer et qui, à cet instant, lui semblaient de bien peu de poids. Ecume vite résorbée, bulles à peine écloses et déjà évanouies, lorsque les rêves, comme les vagues, refluent avec le retrait de la nuit.
Les pieds du danseur s’appuyaient sur une montagne en forme de cône stylisé. Elle-même reposait sur la carapace d’une tortue, autour de laquelle s’enroulait un serpent.
Le corps de l’animal, du côté de la queue, était supporté par une interminable procession de dieux tirant tous ensemble ainsi qu’ils l’auraient fait d’une corde, alors que la partie vers la gueule du serpent était tenue par une cohorte de démons eux aussi arqueboutés dans un égal et symétrique effort.
Le sculpteur anonyme avait représenté là l’un des épisodes les plus fameux de la mythologie hindoue.
Au commencement du monde, cernés par la famine et la vieillesse, redoutant leur fin proche, dieux et démons se rendirent tous ensemble auprès de Brahmâ pour lui demander de leur procurer l’amrita, la liqueur d’immortalité.
Comme celui-ci réfléchissait, Vishnou se leva et dit : « Que les dieux et les démons assemblés prennent pour baratte le mont Mandara et le plongent dans le vase de l’Océan. L’Océan baratté, la liqueur d’immortalité apparaîtra.
– Mais comment ferons-nous pour mettre en mouvement le mont Mandara ? » s’inquiétèrent dieux et démons.
– Le roi des serpents vous aidera à le soulever », répondit Vishnou, « et le roi des tortues servira de point d’appui au fond de l’océan ».
Il fut fait ainsi que Vishnou l’avait ordonné. Le Mandara fut la partie mobile de la baratte et le serpent Vasuki la corde.
Les démons s’emparèrent aussitôt de la tête du serpent alors que les dieux, plus avisés, se saisirent de la queue. Car bientôt de la bouche du serpent, tiraillée en tous sens par les démons, s’échappèrent des exhalaisons de fumées et d’étincelles.
C’était du venin qui sortait de la bouche du Seigneur Vasuki, qui mélangé à l’eau, sous l’effet du barattement, se changea bientôt en poison violent. Dieux et démons furent brûlés et s’enfuirent au loin découragés.
Voyant cela, Brahmâ songea alors à Shiva, le dieu terrible au trident, le dieu des dieux.
Shiva, à qui nulle pensée n’échappe, accourut aussitôt et, pour sauver le monde, accepta d’absorber ce poison dévorant comme le feu. Et par amour pour le monde, il le conserva dans sa gorge qui devint bleue. C’est pourquoi depuis ce temps-là, on l’appelle Gorge bleue.
Ayant recouvré leur courage, dieux et démons se remirent à la tâche.
Ainsi donc les dieux eux-mêmes n’échappaient pas au cycle fatal des renaissances et des destructions puisqu’il avait fallu le sacrifice de Shiva. Même pour les dieux, la vie n’était qu’une illusion, n’était que la traversée des apparences débouchant inexorablement sur la mort. Que dire alors des humains ? De simples fétus de paille ballottés de toute part et que les premières pluies de mousson balayaient.
Et pourtant il avait tellement cru lui-même à sa propre vie ; il avait tellement cru qu’elle lui appartenait, qu’il tenait son destin entre ses mains. Qu’il était libre d’en disposer à sa guise alors qu’il ne voulait tout simplement pas voir qu’il descendait déjà le fleuve, dont les eaux, depuis longtemps, l’avaient emporté.
Chaque jour l’éloignait un peu plus de lui-même. De ce qu’il avait cru qu’il était, de cette image orgueilleuse de lui-même qu’il s’était forgée. Il se sentait comme derrière une vitre. Et il avait beau taper au carreau avec le désespoir d’un forcené, tout ce qu’il apercevait c’était seulement des ombres indistinctes. Des silhouettes. Voilà ce qu’il était devenu, une silhouette, une ombre informe que ses propres yeux ne reconnaissaient plus. Et maintenant il avait peur de lui-même.
Il lui fallait néanmoins remonter le fleuve, revenir à la source pour tenter d’en inverser le cours. C’était évidemment impossible. Mais quel autre choix s’offrait à lui ? N’était-ce pas d’abord pour cela qu’il se trouvait dans ce pays ?
Bien sûr, s’il avait entrepris ce voyage, c’était avant tout pour la revoir, elle. Cette femme qui n’avait cessé de lui faire signe, désormais il en avait la certitude, depuis les jours enfuis de l’enfance. Mais de leurs retrouvailles à venir, dont il avait hâte maintenant tout en les redoutant, n’attendait-il pas autre chose ? Comme une révélation qui l’aurait concerné d’abord lui et lui seul et qui le restituerait à lui-même.
Au-dessous de la théorie des dieux et des démons supportant le corps du serpent, se déployait une longue frise festonnée mêlant plantes aquatiques et animaux fabuleux. Lézards, poissons, monstres des abysses, qui semblaient se tordre de douleur, en proie aux convulsions d’une inexplicable agonie.
Dès que Shiva eut avalé le poison, les dieux et les démons se réjouirent et reprirent leur besogne. Mais bientôt, pareil au fracas de la foudre, s’éleva un grand vacarme provenant du fond de l’Océan que barattaient dieux et démons.
Ecrasées par la montagne en mouvement, les espèces marines périrent par milliers ; de grands arbres peuplés d’oiseaux s’abattaient des sommets de la montagne et de leur frottement naquit un feu dévorant. Celui-ci brûla tigres et éléphants ainsi que toutes sortes d’animaux.
Cette étrange apocalypse d’avant le temps faisait ressurgir en lui les visions d’autres incendies, visions qui revenaient périodiquement le hanter.
Celles de la jungle sur les hauts plateaux, explosant sous l’effet du napalm en lentes bulles de feu multicolores montant droit dans le ciel ; celles des maisons de villages changées en torches, monstrueux champignons à la beauté vénéneuse tandis que des coulées de lave grillaient tout sur leur passage, les bêtes comme les humains, s’insinuant dans les caches, les tranchées, les souterrains.
Il revoyait les images de corps brûlés que diffusaient alors à chaque bulletin d’information les télévisions, magmas de chairs à peine reconnaissables. Les enfants nus et faméliques, maigres silhouettes affolées courant en tout sens en quête d’un improbable abri.
Combien de tonnes de bombes avait-on déversé sur l’Indochine, y compris ici, au Cambodge, et durant combien d’années ?
Cela avait commencé avec la guerre française, cela s’était poursuivi avec la guerre américaine. Du nord du Vietnam, au Tonkin, où il s’était allumé, l’incendie avait peu à peu embrasé tout le sud, l’Annam, la Cochinchine, avant de se propager à l’ensemble de la péninsule, jusqu’au Laos et au Cambodge.
Pour la seule province de Kompong Cham, au printemps 1970, en quatorze semaines, les bombardiers américains B 52 avaient effectué trois mille six cents sorties.
Trois mille six cents !
Quels dieux mauvais s’étaient donc acharnés sur cette portion de planète en ordonnant cet inimaginable déluge de feu et de destruction ? Pourquoi ? Au nom de quels incompréhensibles et obscurs desseins ?
Et puis il y a avait eu les déportations, les habitants de Phnom Penh poussés dans la jungle par des gosses fanatisés, les malades traînés sur leurs lits et à qui on avait arraché les perfusions. Il y avait eu les exécutions, les massacres. Le génocide. Et elle ? Comment avait-elle traversé toutes ces années ? Comment avait-elle pu survivre à cet enfer ? Et d’ailleurs pouvait-on en revenir ?
Il ferma les yeux. Il ne voulait pas l’imaginer.
Alors, avec l’eau des nuages, Indra, le dieu qui fait descendre l’eau du ciel, le meilleur des dieux, éteignit ce feu.
Mille sèves et beaucoup d’essences de fleurs se mélangèrent à l’Océan. Grâce à ces sucs dissous et à l’or des sommets, l’eau de l’Océan devint lait et le lait, beurre clarifié.
Depuis que dieux et démons avaient mis en mouvement le mont Mandara, il s’était écoulé des milliers d’années. Dieux et démons dirent à Brahmâ : « Nous sommes fatigués, ô Brahmâ. Voilà trop longtemps que nous barattons l’Océan, et la liqueur d’immortalité ne vient toujours pas ! »
Alors Brahmâ s’adressant une nouvelle fois au dieu Nârâyana déclara : « Donne leur la force, Vishnou, tu es leur ultime recours ! » Celui-ci répondit : « Je donne la force à tous ceux qui participent à ce grand œuvre. Que dieux et démons barattent et fassent tourner le Mandara ! »
Encouragés par Nârâyana, dieux et démons redoublèrent de courage et tous ensemble brassèrent vigoureusement les eaux de l’Océan. Alors, semblable au soleil, sortit de l’Océan la lune sereine et calme. Sitôt après, apparut le joyau Kaustubha né de la liqueur d’immortalité, splendide, qui alla orner la poitrine de Vishnou. Naquirent l’arbre du paradis et Surabhi, la vache miraculeuse. Surgit ensuite, né de la liqueur d’immortalité, Airavana, le Roi des éléphants aux quatre défenses formidables.
Du Mandara ébranlé tombèrent des éclats et de ces éclats naquirent six cent quatre-vingts millions de nymphes. Toujours jeunes, immortelles et belles, aux formes capables de rendre fou tout mortel qui les apercevrait.
Enfin voici que, glorieux, Dhanvantari, le médecin des dieux, jaillit de l’Océan brandissant la fiole blanche qui contenait la liqueur d’immortalité.
Sur la muraille, au-dessus des dieux et des démons tout occupés à baratter l’Océan, les Apsara, les nymphes célestes, se livraient à un ballet enfiévré.
A chacune d’elles, le sculpteur avait prêté les mêmes traits et les mêmes gestes. Il les avait représentées les bras levés, un genou ployé, arborant la même coiffe trinitaire et ceintes du même pagne. Silhouettes graciles et aériennes qui paraissaient se démultiplier à l’infini le long de la paroi.
Si le monde d’en bas se confondait avec la destruction et la violence, le monde d’en haut, lui, n’était que paix et volupté.
Bien sûr il connaissait ces corps et ces visages. Pourtant à chaque fois le même charme opérait et il se laissait bercer par l’harmonie parfaite des gestes, le chant de paix et d’humanité qui semblait en émaner, comme si de la muraille même naissait une musique inconnue.
C’est alors qu’il réalisa que depuis un bon moment déjà une mélopée troublait bel et bien le silence. Il se rappela que tout à côté de la galerie, presque au pied du temple, en contrebas, quasi dissimulée sous les arbres, s’élevait une petite pagode, moderne celle-là.
Il lui sembla reconnaître le chant.
Hommage à toi Seigneur, Toi le sans nature propre
En toi point de naissance, point d’allée ni de venue
Tu n’es ni être ni non être, ni permanent ni impermanent,
Ni éternel ni non éternel, hommage à toi le sans-dualité.
C’était un hymne bouddhique ainsi qu’il avait dû en entendre autrefois dans les temples du Laos puis plus tard à Saigon. Il aurait aimé s’abandonner à ce chant qui, comme le sourire de Vishnou ou la danse des Apsaras, résonnait inexplicablement en lui à la manière d’un lointain appel, et avait le don de l’apaiser.
La galerie était maintenant presque entièrement plongée dans l’ombre. Il ne pouvait s’attarder davantage ; il devait partir. Après avoir adressé un ultime regard à la muraille où dieux et démons poursuivaient leur étrange tir à la corde, il gagna la sortie, franchissant à nouveau les quelques degrés du porche.
Il se retrouva bientôt sur l’interminable chaussée de pierre qui conduisait au-delà des douves enserrant l’immense quadrilatère du temple. Il se retourna.
La silhouette sombre et dentelée des tours d’Angkor Vat flamboyait dans l’or du couchant. Puis ce fut fini ; la nuit d’Asie recouvrit tout.
Depuis longtemps, les touristes avaient déserté les lieux et avec eux tout le petit peuple qui gravitait autour, marchands de souvenirs, de fruits et de boissons. Il lui fallait pourtant trouver un moyen de retourner en ville. Là où il avait rendez-vous, il ne pouvait aller à pied. Mais il avait beau regarder vers l’endroit où les chauffeurs de tuk-tuk avaient l’habitude d’attendre leurs clients, il n’y avait personne. Il décida de patienter, il n’avait guère d’autre choix. Un taxi finirait bien par passer, quand il entendit un bruit de moteur.
Venant de l’agglomération, une moto-taxi arrivait à vive allure. Sans même qu’il eût besoin de lui faire signe, l’engin obliqua vers lui. Ayant arrêté sa machine, le chauffeur mit pied à terre, le salua les mains jointes sur sa poitrine et lui dit : « Monsieur Raphaël Santorin ? On m’a demandé de venir vous chercher ».
Comment savait-elle ?
Comment savait-elle où il se trouvait à cette heure ? Car c’était bien sûr elle qui l’envoyait. Qui d’autre pouvait avoir pensé à lui adresser ce petit homme sans âge, au visage couvert de rides évoquant la peau d’un fruit fripé, le corps légèrement fléchi en signe de respect, et qui attendait qu’il prît place ?
Mais ces dernières semaines avaient été marquées par tant d’événements auxquels il n’avait fait qu’obéir presque en aveugle, jusqu’à son départ précipité pour le Cambodge, que plus rien désormais ne pouvait le surprendre. Peut-être, se disait-il, était-il tout simplement en train d’apprendre la confiance.
Aussi, est-ce sans mot dire qu’il s’installa à l’arrière du tuk-tuk alors que le conducteur mettait déjà en marche et lançait son véhicule pétaradant sur la route.
PREMIÈRE PARTIECarnets de Raphaël Santorin
Avertissement
Les pages qui suivent remplissent deux carnets reliés de toile noire portant la mention d’une papeterie du quartier Montparnasse à Paris, carnets retrouvés dans les effets de leur propriétaire dans un hôtel de Phnom Penh. Si nous nous sommes résolus à rendre public leur contenu, c’est qu’elles éclairent bien des points d’ombre de ce récit. Rédigé d’une fine écriture, ce texte, divisé en trois chapitres, ne comporte ni date ni titre. A diverses précisions qu’il contient, il semble toutefois avoir été écrit durant l’année 2004 ou au tout début 2005. A la lecture de ces pages, il est apparu qu’elles formaient un ensemble déjà littérairement très élaboré et d’une belle tenue. C’est pourquoi il nous a semblé qu’il pouvait être publié sous sa forme initiale, sans autre commentaire que cet avertissement. Si nous lui avons donné ce titre, c’est seulement en raison de son support matériel. Titre ayant le mérite de l’objectivité, ne risquant en aucune façon d’orienter ou d’influencer par avance le lecteur éventuel.
L. D.
I
Depuis combien de temps ne suis-je pas revenu aux Hautes Terres ?
Il doit bien s’être écoulé quatre ans, peut-être même cinq. La dernière fois, ce devait être peu avant la mort du vieil Abran.
Maladroitement accrochée à la pente, la route se hisse paresseusement jusqu’au sommet. Pour l’avoir tant de fois empruntée naguère quand je me rendais encore régulièrement aux Hautes Terres, je réalise à nouveau que j’en connais chaque virage et presque tous les pièges. Moi qui ordinairement n’aime guère conduire, j’en éprouve aujourd’hui presque de la satisfaction. Encore quelques kilomètres et ce sera l’entrée du mauvais chemin à flanc de montagne dominant la vallée et qui mène au domaine.
Jamais, pourtant, comme en cette fin d’après-midi d’automne, les sapins au bord de la route ne m’ont semblé si sombres, leur âpre silhouette s’inscrivant avec une précision de calligraphe sur le ciel presque trop lumineux. Et si rares, les hêtres déjà chargés d’or éclairant de loin en loin les trouées de maigres prairies à l’herbe déjà rase d’avoir été beaucoup pâturée. Mais peut-être est-ce que je me trompe, peut-être ne fais-je que projeter.
Peut-être n’est-ce que le reflet exacerbé de ce qui m’encombre depuis cette nuit et que la route familière ne fait qu’aviver. Fatras de pensées errantes et contradictoires mêlées à d’anciennes questions, dont je sais maintenant qu’elles n’ont cessé de m’habiter à la manière d’une blessure mal cicatrisée parce que je n’ai jamais pris la peine vraiment de les élucider.
Ainsi je me suis souvent demandé ce qui avait bien pu pousser les Santorin à s’établir ici il y a deux siècles, dans cet endroit désolé. Si c’était l’isolement qu’ils recherchaient et même l’austérité, ils auraient pu tout aussi bien choisir une île bretonne ou quelque lande déserte, la famille comptant deux branches, l’une française, l’autre helvétique. Mais ce flanc de montagne, cette vallée retirée, qu’est-ce qui les y avait conduits ?
On a bien essayé de m’expliquer que les Santorin furent autrefois maîtres de forge, possédant plusieurs fabriques dans la région, qu’ils y formèrent même l’une des familles les plus importantes. Que Les Hautes Terres représentaient d’une certaine manière leur fief, la marque tangible de leur ascension sociale.
Cette raison, tant de fois répétée par ma grand-mère et mon père pour une fois à l’unisson, mais peut-être précisément avec un peu trop d’empressement et une insistance suspecte, cette raison ne m’a jamais complètement satisfait. D’autant qu’il y a belle lurette que les ateliers sont passés dans d’autres mains. Ne subsistent que Les Hautes Terres – mais pour combien de temps encore ? – comme le souvenir usé d’une lointaine splendeur un peu vaniteuse. Ou est-ce plutôt le signe par trop tangible d’un remord ?
Pourquoi les Santorin s’y sont-ils tellement accrochés ?
J’ai longtemps pensé que c’était par orgueil. Par volonté plus ou moins proclamée d’afficher une autre appartenance autant à leurs propres yeux qu’à ceux des habitants de la région auxquels ils ont toujours pris grand soin d’éviter de se mêler. Leur surnom, après tout, n’était-il pas les « Très hauts » et pas seulement en raison de la position dominante de la maison ?
A présent, je ne sais plus.
Pour ma grand-mère, en tout cas, il eût été tout simplement inconcevable de résider ailleurs qu’aux Hautes Terres où elle avait toujours vécu au point de finir par s’identifier complètement avec elles, jusqu’à en devenir la châtelaine jalouse. Et lorsqu’elle avait quitté Les Hautes Terres, c’était seulement pour l’autre monde, le destin ayant permis qu’elle ait pu y demeurer jusqu’à son dernier souffle, servie par le vieil Abran, presque aussi âgé qu’elle, qui lui aussi allait y rester quasi jusqu’à la fin, prenant tout naturellement le relais de sa maîtresse pour se muer à son tour en gardien ombrageux des Hautes Terres.





























