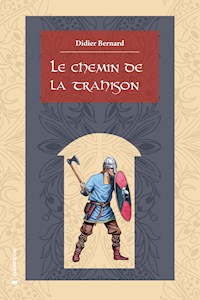Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: La trilogie de l'abbaye de Grandmont
- Sprache: Französisch
Durant ce XIVe siècle, l’engagement pour la possession des territoires à l’Ouest de l’Europe a commencé. La France et l’Angleterre sont en guerre pour cent ans. Cette guerre est sporadique avec parfois la pause d’une saison. Entre deux traités, les « mercenaires », les « prostitués » de la violence s’engagent au plus offrant. Les routiers peuvent se battre au nom de la France un jour et le lendemain s’allier à l’Angleterre. Durant les trêves, ils errent de pillages en razzias pour leur subsistance.
À l’abbaye de Grandmont, on prie pour que cessent les inepties de la guerre. Plus bas, dans la vallée, à la Jonchère, Marc, un trublion en mal de reconnaissance va joindre une bande de ces mercenaires. Il participera avec les armées du prince Edouard d’Angleterre, le « prince noir », à la destruction totale de la cité de Limoges et au sac de la basilique des moines d’Etienne de Muret, ses proches voisins.
Tout au long de cette histoire, on assiste à la lente déchéance de Marc qui emprunte un chemin bien tortueux pour tenter de conquérir la fille de son cœur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Didier BERNARD
La trilogie de l’abbaye de Grandmont,Les grandes batailles de la vicomté de Limoges,
Le chemin de la trahison
TomeII
LEJEU
Le ruisseau bordé d’iris n’était pas très large. Il coulait ses eaux vives sous le ciel bleu du printemps éclatant. L’air du jour était cristallin et le vent portait la promesse de belles journées à venir. Les subtils parfums des fleurs jaunes et violettes qui couvraient les prés flottaient dans l’atmosphère de cette journée de mai. Quelques arpents en contrebas des murs du village, là où commençaient les champs plats bordés de haies claires, des femmes s’affairaient au bord de l’eau. Sous le toit du lavoir, à l’abri du soleil déjà haut, elles éclaboussaient de bruits mouillés les chants des loriots et des grives.
Rien ne laissait penser, à la Jonchère, qu’une guerre pouvait exister. Rien ne semblait pouvoir troubler cette belle matinée. Les lavandières de la Jonchère, comme tous les sujets du Limousin, auraient dû obéir au roi Charles V, le Français. La belle saison calme semblait confirmer cet entendement.
Hélas, Edouard, le prince anglais, duc d’Aquitaine, vassal de la France ici, montrait quelque agacement à cet ordre : lui aussi était chez lui, en ce quatorzième siècle de l’histoire chrétienne. C’est son père, le roi d’Angleterre qui possédait le duché d’Aquitaine. Edouard de Woodstock, dit le prince noir, ne semblait pas prêt à assumer ses obligations sur le continent. La France et l’Angleterre avaient signé un traité bâclé à Brétigny. La guerre qui avait commencé dans l’absence de droit référent ne s’était pas éteinte complètement, et tout le monde en Limousin se trouvait bien en peine de nommer le souverain licite.
Les terribles mercenaires, les guerriers de la fange, couraient la campagne. Les routiers de tout poil, de tous pays, même du plus proche, étaient en attente d’une bataille rangée, d’un engagement ferme auprès de l’une ou l’autre des factions. Ils profitaient de l’équivoque sur la souveraineté de la région. Ils rançonnaient les gueux suivant l’humeur, au nom de l’un ou l’autre camp. Dieu merci, à la Jonchère, on n’avait eu vent que des troisièmes couteaux qui menaient leurs voleries de façon dispersée, maladroite, sans ordre ni envergure pour l’instant. Les petites bandes de malandrins se faisaient souvent corriger par les braves bougres des villages attaqués.
L’Amélie était au bout des bacs de pierre, vers le dernier poteau de bois soutenant le toit de tuiles rouges qui couvrait le lavoir de la Jonchère, aux pieds des monts d’Ambazac sous l’abbaye de Grandmont. À genoux, penchée vers l’eau, elle pointait sa grosse croupe couverte d’épais jupons noirs. On ne pouvait pas se tromper. N’importe qui, ici, connaissait le rude postérieur de la maîtresse laveuse. Ces dernières années, toutes les razzias tapageuses des routiers au service des Anglais ou de du Guesclin n’avaient pu réduire au silence la virulente bonne femme. Elle avait toujours fait reculer, à grands coups de battoir, le freluquet qui aurait voulu la défaire. Elle se mêlait, lors des échauffourées de paillades, au milieu des hommes les plus téméraires du bourg. Il émanait de cette forte femelle, une sorte d’invulnérabilité reconnue et crainte dans la contrée. Le personnage faisait partie des murs. Il semblait né avec la ville et ornait son histoire. La bougresse se fichait bien de l’Anglais ou du Français, tout ce qui n’était pas jonchariot méritait à ses yeux d’être battu et noyé s’il avait quelque velléité à l’encontre des ouailles du village. Elle menait ses lavandières comme sa vie, avec la même fermeté.
Après, à droite, à la deuxième pierre, il y avait la Justine, elle disparaissait en bleu sombre, maigrelette, anonyme, se fondant dans l’ombre moite, parmi les autres filles de la lessive.
Marc les observait depuis la bute en contre-haut. Un peu plus vers lui, agenouillée devant une petite planche de granit rose, il distingua le flanc de Marie. C’était un ventre de jeune chatte ; les ellipses de ce corps félin ondulaient, parfaites et cohérentes dans le combat que la belle lavandière menait avec grâce contre les linges qu’elle peinait à battre et à noyer.
–Marie !
Le jeune homme l’appela timidement, bien trop mollement depuis l’escalier de pierres moussues qui entaillait le talus avant la descente vers le lavoir. La belle n’avait pu l’entendre, l’Amélie donnait du battoir à pleine volée juste à côté. Marc reniflait à présent, en rasant le mur, les chélidoines et les scolopendres qui poussaient dans la chaux des joints des pierres qui le protégeaient encore des regards. L’émoi troublait les sens du garçon. Il voyait déjà sa désirée se relever, marcher vers lui, dans un songe éblouissant, elle essuyait son front de la sueur du labeur, en souriant, d’un geste serein, et puis… Elle était encore là-bas, la tâcheronne ! À genoux devant sa besogne, à tordre les draps. Elle n’entrait pas dans le rêve du garçon. Il osa encore, un peu plus fort en passant la tête plus franchement au dehors de l’escalier :
–Eh ! Marie !
La grosse cheftaine avait l’ouïe fine et protégeait ses jouvencelles à la manière d’une louve maîtresse de meute. L’Amélie chercha du regard derrière elle et aperçut le visage du puceau au sortir de l’escalier. Elle se releva d’un coup, menaçante, le battoir à la main. Les nénuphars, derrière elle, se refermèrent.
–Va-t’en ! Le jeunio, y’a du linge à faire là, et les gars n’y sont point idoines !
Il recula, piteux, il n’y avait que cela à faire pour l’instant : quitter le domaine des femmes. Le lavoir était bien le seul endroit où elles étaient chez elles, les femelles. Aucun homme ne leur discutait le droit, là, au bord de la rivière. Et lui, beau, jeune et fringant, il perdait pied, comme on le fait dans l’eau qu’on ne maîtrise pas. On ne pouvait rien de mâle en ce lieu. Aucun homme ordinaire n’y venait habituellement. Il grimpa quatre à quatre les marches glissantes et appuya encore une fois, d’un peu plus loin, depuis la butte, peut-être plus pour narguer la grosse Amélie que pour appeler sa désirée :
–Marie ! cria-t-il, goguenard
La fille ne se retourna même pas, laissant la réponse à la matriarche qui s’engouffrait derrière l’intrus. Le culot du garçon tomba en miettes comme les éclats d’une potiche qu’on brise par accident. L’énorme lavandière courait vers le trublion, le battoir haut. Marc prit ses jambes à son cou et gagna la route qui montait vers la ville. La rage fit bouillonner le garçon mis à mal dans son orgueil.
–Je ne vais quand même pas taper sur cette vieille !
Il se rassura ainsi, dans sa tête d’indestructible fils encore collé au cul de sa mère, car il n’était pas sûr de prendre le dessus face à la costaude Amélie. Un pigeon traversa le ciel bleu, une brindille au bec et se cabra en roucoulant devant son nid au-dessus des yeux du Marc. Le puceau haletait.
–Marie, merde ! Elle est belle, un jour, sûr, j’en ferai ma femme, dit-il en serrant les poings. Et puis, elle a des hanches à faire des garnements ! Ponds ton œuf, ma belle ! Je t’en apporterai, moi ! De la paille ! De la vraie, de la riche, jaune de soleil ! Comme l’autre emplumé,là !
Les cris effarouchés de la vieille qui n’avait pas abandonné la poursuite et qui débouchait à présent de l’escalier en bas de la route arrêtèrent là les pensées folâtres du galapiat. Il courut encore un peu pour fuir la matrone, la mettre en sueur, faire semblant d’avoir vraiment peur et finir son errance saugrenue. Les lilas blancs étaient en fleurs, le loriot ne se taisait plus, partout l’air embaumait et donnait l’envie de faire des folies. Alors, pourquoi pas la Marie ? Aujourd’hui, tout de suite ! Pourquoi pas ? Marc baissa la tête, les choses ne semblaient pas malheureusement, aussi simples et l’Amélie paraissait prête à le rappeler avec force au jeune homme. Autrefois, la câlinerie était facile, on rentrait tard à la maison en grand fracas, en criant bien haut :
–J’ai engrossé la Marguerite !
Ou une autre. Son père l’avait fait ainsi. La famille riait, et le reste venait, simplement. Maintenant, il fallait se plier au protocole de la populace que le garçon ne comprenait pas. Tout d’abord, il fallait que le village entier se rende compte et accepte la fréquentation des futurs fiancés, que les anciens réalisent ensuite que deux jeunes se plaisaient, puis il fallait encore que les parents soient d’accord, qu’ils se reconnaissent du même acabit, qu’ils se rencontrent longtemps, qu’ils causent « sous », terre à travailler ou échoppe à partager. Enfin, seulement, le curé pouvait arranger les affaires. Marc n’avait pas cette patience.
–C’était si simple, avant… Je la veux ! Merde ! Autrefois, je n’aurais eu qu’à la forcer un peu, comme disent les vieux, conclut le jeune à bout de souffle.
Lassé, vexé, déçu, dépité, de n’avoir pas pu décrocher un regard de sa belle, il orienta ses pas vers le bourg. L’Amélie criait encore, mais à bonne distance. Il longea, pensif, le chemin de terre bordé de joncs. Il franchit les murs par la porte du bas de la ville qui arc-boutait son granit usé. Il releva la tête. Les maisons de la rue montant vers l’église s’imbriquaient les unes aux autres comme pour mieux soutenir la misère des occupants. Le soleil ne pénétrait pas dans les ruelles encore envahies par la boue laissée par les pluies de l’hiver. La pierre grise n’évoquait pas dans la tête du Marc, la couleur de son avenir. C’était triste, ici, à la Jonchère. Les nuances du printemps s’effaçaient dès les abords de la ville franchis, comme pour en punir les habitants. Il devait exister ailleurs d’autres bourgs faits avec d’autres cailloux, plus lumineux, des murs moins tordus, d’autres croyances, des modes de vie différents, des esprits meilleurs, des fleurs partout sur les fenêtres, des rêves qu’on n’osait pas encore ici, dans ce qui lui semblait être, de plus en plus, un trou à rats mouillés. Aucun mur n’était d’aplomb dans ce village, rien n’était aligné, tout semblait avoir été agencé par des animaux. Il se retourna et aperçut à travers l’arc de la porte, plus bas sur la route, l’Amélie, fatiguée, qui avait baissé les bras et s’en retournait à son linge.
–Je vais fiche le camp de ce fatras de baraques ! Et vous verrez bien ! À mon retour je serai riche, fort, fait chevalier des jonchers, j’épouserai la Marie, qui sait ? Je vous mettrai tous à genoux ! Tas de gueux !
La Gabie, dite « Elbaude », pointa son nez à la porte d’une masure du haut de la rue. Marc reconnut la silhouette de sa mère. Le domicile était une petite échoppe dont l’étal était abaissé. On ne pouvait plus le tenir relevé, des planches grossièrement ajustées et peintes de sang de bœuf auraient dû clore la béance de la boutique du tripier aux heures de fermeture, mais elles avaient vieilli et s’étaient déformées avec le temps et donc, Jean, le viandier, à cause des carences du volet, n’avait plus à barrer le soir, ni à ouvrir le matin. La triperie ne fermait donc jamais ; à toute heure on pouvait y négocier un abat. Le rez-de-chaussée était bâti en dur, et de belles pierres grises laissaient croire que le tenancier possédait quelque argent. Mais dès qu’on levait les yeux, on remarquait que l’étage n’était qu’un travers de torchis que les intempéries avaient déformé. Il ne fallait pas mener son regard plus haut : la mansarde du grenier commençait à se dégarnir de son chaume et s’imbriquait de plus en plus en travers de la maison voisine.
Au pied de cette ruine à venir, la mère traînait son pas. Elle ressemblait à ces sorcières des bois, dans les histoires que contaient à Marc, les guetteurs de l’abbaye de Grandmont, quand le puceau les surprenait à braconner sur les flancs du puy de Sauvagnac dans les bois de Malty. Elle avait des cheveux gris-jaune collés par la crasse. Elle rabattait par des gestes brusques, ses haillons graisseux, sur sa piteuse personne. Elle n’avait plus qu’une dent noire, en haut, qui blessait sa lèvre pendante, du bas. Elle marchait courbée, penchée, pliée sous le poids de sa vie. Elle ne parlait jamais. Elle criait, elle aboyait toujours après son ivrogne de mari ou son bon à rien defils.
–Ah, te v’là ! Ben qu’est-ce-tu f’sais ?
–J’étais au lavoir…
–Ah ben ! V’là mieux, main’nant ! Y va au lavoir ! Ah ! Non, mais ! Vous savez ! Y va me tuer ! jappa la Gabie en disparaissant dans le noir de l’escalier de lacave.
Elle portait une cruche à la main sans doute destinée à remplir la panse du Jean, son mari, le père, qui devait déjà, vu l’heure, avoir liquidé au moins un boisseau de piquette.
Marc baissa la tête, les yeux et l’âme. Il savait qu’il n’était pas un bon garçon aux yeux de sa mère. Il ne savait rien faire. D’après elle, aucun des métiers de main : la terre, le fer, le bois, le pain, la viande, le cuir, ou encore l’argile, ne lui étaient accessibles. Ni les besognes de glèbe, de fabrique, ni les occupations d’art, les mots ou les chants ne lui étaient convenables ; et quand bien même aurait-il eu toutes ces capacités, la mère avait décidé, sans doute pour le garder auprès d’elle, qu’il ne servait à rien d’autre que d’occuper ses craintes et ses désirs. Le fils ne pouvait donc que traîner les rues, perdre son temps et reluquer, l’âge venant, les belles jeunes filles.
La Gabie Elbaude aurait au moins pu, par la grâce de St Etienne qu’elle priait jour et nuit, avoir pour son gamin la minime affection qu’on porte à un enfant : un jour, elle aurait pu lui parler normalement. Il l’aurait aimée dans un petit moment de tendresse… Mais le fils, sans doute guidé par le diable quand il échangeait avec sa mère, n’était pas prêt à servir le premier pas et rajoutait toujours un peu d’huile sur le feu qui brûlait en permanence entre lui et la marâtre.
–Je ne mange pas ce soir ! Je ne vais pas à votre fête du mois de Marie non plus ! Je fais le charivari du guet de Grandmont !
Il venait de se souvenir qu’il avait parié avec un routier de Grandmont qu’il pourrait leur fournir des jeux pour égayer leur bacchanale mensuelle, comme l’autorisait le coutumier de l’abbaye. Cette bribe de mémoire cueillie dans la brise folle qui courait sa tête allait orienter sa journée.
–Au Diable ! Au diable ! cria la vieille désespérée, depuis le noir du caveau, encore, feignant de ne pas montrer le moindre intérêt pour les activités d’un rejeton intenable.
Elle comprit cependant que son fils s’était fait admettre dans la bande des routiers à l’estage de l’abbaye. Et que cela, enfin, lui donnait un statut. Il n’était pas des meilleurs, mais, en mère à bout de patience, elle conclut sommairement qu’elle n’aurait plus à être responsable, aux yeux des villageois, de ce gamin bon à rien que lui avait inoculé son mari, un soir de beuverie sur les bords de la rivière, il y avait seize printemps. Enfin, le gnome foutait le camp ! Et les tracas qu’il engendrait, avec !
Elle réalisa aussi sans doute qu’elle risquait de perdre son beau petit garçon, celui qu’elle défendait bec et ongles quand les autres mères le mettaient en cause dans les incidents de la vie ordinaire du village. Au moins, il ne serait pas avec une autre femme ce soir !
Le fils avait disparu dans l’escalier de sa mansarde sans doute pour y chiper quelques bricoles de rapines. Quand il réapparut devant l’échoppe, les poches pleines, la Gabie l’apostropha, craignant à la fois qu’il parte ou qu’il reste.
–Vas-y don ! Et n’r’viens pas ! J’dirai aux filles d’ici qu’t’es parti avec les bandits. Vas-ydon !
Il y eut une hésitation dans les pas du garçon. Il avait fortement envie de faire le contraire de ce que lui ordonnait sa mère. Mais son échec à l’instant, au lavoir, fit qu’il suivit l’injonction contrariante de la Gabie. On ne voulait pas qu’il s’approche de Marie ? Qu’à cela ne tienne. La Marie, il l’aurait ! Tôt ou tard. De toute façon sa vie n’allait pas sans celle de la belle. Il avait d’autres détours dans son esprit pour arriver à ses fins, des pires, qu’on lui enjoignait finalement d’épouser. Le mauvais fils s’échappa des griffes maternelles, une dernière fois peut-être, comme guidé par une girouette affolée dans le vent mauvais, une girouette de chiffons, une figurine sur un balai, avec des cheveux gris, sales, agglutinés par le gras des boyaux.
Marc marcha un peu à reculons en narguant la Gabie, puis il enfila en courant la rue montant à la porte-Nord de la ville. Une fois en dehors des murs, il emprunta la rude côte, celle qui menait à l’abbaye de Grandmont par Sauvagnac. Là-bas il allait rencontrer, ce soir, des guerriers avinés, de pauvres gars, pas plus sociables que lui, des paillers en service. De pauvres bougres venus de très loin pour certains, des gars qui ne connaissaient rien de ce que pouvait être la vie en cité. Ils n’avaient jamais que tué, pillé, ripaillé, assiégé, ri, bu, voyagé, souffert, plus ou moins, sans savoir pourquoi, au service de tel ou tel fortuné de l’instant, au hasard des rencontres du chemin, de la route des routiers, de leurs vies de chien, de bons à rien. De ces gens, Marc savait seulement, pour les avoir parfois accompagnés lors de leurs braconnages, qu’ils n’étaient ni meilleurs ni pires que lui. Ce qui l’intriguait, c’est qu’au cours des parlottes de baguenaude avec eux, il avait appris que certains glorieux mercenaires avaient su mériter d’un noble donneur d’ordre et s’étaient vu octroyer des droits et des terres. Il arrêta sur ce point ses élucubrations : voilà pourquoi tout à l’heure il n’avait pas contrarié les vœux de sa vieille. Il eut là, d’un coup, comme une révélation divine : il venait d’effleurer le moyen de devenir grand seigneur sans jamais s’être échiné. Il pouvait envisager son avenir grandiose par la seule voie qui ne demandait pas d’être né dans une grande famille pour tenir l’épée sur quelque terre. Il sentit venir, de plus en plus précisément, une chance de quitter fièrement la Jonchère, de devenir seigneur, de mettre à genoux sa belle Marie, de rendre sa mère coupable, vassale et servile, et enfin d’être reconnu à sa juste valeur par tous ces misérables Jonchariots. Il était urgent de mettre de l’ordre dans cette caboche de jeuniot, il fallait aller à l’essentiel, il fallait devenir un grand routier ! Quels qu’en soient les sacrifices immédiats. Il arrêta son pas, un frisson lui parcourut l’échine. Son capuchon usé de gamin chétif venait de tomber sur le chemin. Les bras noueux du jeune homme avaient d’un coup pris du saillant sous la lumière blanche du soleil.
Il reprit sa marche plus lentement. Un avenir prenait forme, l’espoir d’une réussite se dessinait vraiment. L’hypothèse qu’il pourrait un jour mettre tout son petit monde à sa botte et en particulier la Marie faisait sens. Il fallait être à Grandmont ce soir, et passer avec brio l’épreuve de la cooptation dans la bande des routiers. Il se sentait capable, on l’avait invité, il avait tous les atouts dans ses poches. La Marie l’attendrait au bal. Il reculait pour sauter bien plus loin. Il réalisa même que l’Amélie avait eu raison de le chasser du lavoir. Il n’avait rien à faire avec les gens du village, il pensait plus haut, et méprisait déjà, en seigneur impitoyable, les serfs de la Jonchère.
Le soleil brillait vraiment comme en juillet. Les jonquilles étaient déjà flétries sur le chemin de l’abbaye. Les genêts passaient fleurs et répandaient une forte odeur de pisse de chat. Ils encombraient une voie que Marc aurait aimée plus brillante, en cadence avec son avancée. Le sentier était sec, l’herbe ne mouillait même pas le cuir des chausses. Les parfums de musc éveillaient des instincts d’été. Marc huma les effluves de ses aisselles dans l’effort, ça sentait le mâle victorieux dans les grandes chaleurs. L’éther ambiant incitait au rêve. Il y aurait la fournaise, la gloire, le triomphe, une grande chose, un jour, pour lui. Et là tout de suite, il se sentait prêt à entamer son nouveau destin. Après l’exploit indiscutablement à venir, sa Marie se jetterait à ses pieds et en grand seigneur il daignerait l’épouser, non sans avoir pendu, juste avant, cet abruti, ce grenouillât de bénitier de Jacques, le gros fils de l’énorme Amélie, qui lorgnait la même belle de bien trop près ; comme l’autre vieux, aussi, le citadin, le gras drapier Aymard, qui n’hésitait pas à saisir la main de la belle Marie pour sentir mieux le linge lors des livraisons au marché. Il fallait qu’un jour Marc mette la puissance qui battait en lui, au service de sa cause qui bouleverserait le monde. Il n’avait cependant pas la moindre idée de la forme que prendrait ce cataclysme. Mais le jour semblait proche, là, très bientôt.
Il sauta une pierre, en traversant un ruisseau, et hop ! Sur l’autre pierre… Celle-là était bien à une brasse au moins, et sans mettre le pied. L’autre, là… Oh ! Là ! Au moins deux brasses, et petite, et ronde… Hop ! Il était dessus. Comme sur la Marie quand il aura gagné sa terre. Marc devait devenir célèbre, aborder de grandes routes, s’approcher des villes dont parlaient les colporteurs, voisiner l’Anglais ou d’autres seigneurs, de Limoges, Toulouse, Bordeaux et devenir méritant à leur côté : mériter la seigneurie des Jonchers !
La tête de Marc bouillonnait.
Les ronces poussaient vite en cette saison, et le chemin n’avait été que peu fréquenté. Les églantiers piquants avaient envahi toute la largeur de la route. Cette sente restait la côte la plus difficile vers l’abbaye. La Jonchère en souffrait. C’est sans doute à cause de cela qu’elle s’était tournée vers les Marchois du Dognon et les Français. La voisine Ambazac, sur la route de Limoges tournée vers l’Aquitaine et les Anglais, plus sous la pente douce de l’abbaye, aurait dû profiter du relief et prospérer, en tirant les bénéfices des échanges entre la congrégation des moines grandmontains et la ville de Jeanne de Penthièvre, régente après la mort de son époux, le vicomte de Limoges. Ambazac ne profitait de rien, l’abbaye gardait tout, son prieur ne pensait qu’au rayonnement de son ordre et s’apprêtait même à avaler les dernières terres d’Ambazac. À Limoges, un consulat dirigeait la ville et ne se préoccupait pas beaucoup des campagnes si ce n’est pour l’approvisionnement. La vicomtesse avait été écartée du pouvoir sur ses terres et ruminait sa déchéance dans un petit château en Bretagne.
Le chemin de Marc devenait moins broussailleux, plus large. Enfin il distingua le haut des bâtiments de l’abbaye. Ces pierres ressemblaient un peu plus à ce qu’il imaginait digne de son avenir. C’était grand et les toits de plomb bleuté reflétaient le soleil. Ça fourmillait de gens en beaux habits lors des grandes messes ; oui, il lui semblait que quelque part, là, il aurait sa chance. Jusqu’à présent on l’avait toujours écarté quand il arrivait si près. Il s’était arrêté pour rêver un peu plus, le regard fixé sur la croix d’acier qui dominait le sommet de la basilique sous le soleil éclatant. Aujourd’hui, il avait dans ses poches des jeux pour amuser le guet. Il avait mis du temps à comprendre comment franchir l’obstacle du prime estage. C’est à ce moment attendu qu’un gars à la gueule de travers surgit de l’ombre du bois. Le colosse hirsute, de deux brasses de haut, pesant au moins une barrique pleine, lui piqua sa lance dans le dos, en bon exécutant.
–Tu vas aller où, commeça ?
–Je viens à l’abbaye sans intention, j’ai des amis du guet en place qui font le charivari ce soir et qui cherchent des jeux ! tenta d’appuyer un Marc un peu secoué malgré tout par la vision du monstre qui le tenait engarde
–Qui ?
–Fayemendi, et l’autre là, celui qui a les cheveuxroux…
Le jeune, impressionné par la laideur du personnage, tentait de rassembler tous ses esprits pour retrouver un aplomb indispensable à sa démarche. Le monstre recula sa lance.
–Ah, tu dire l’Edoin ?
–C’estça.
Le guet planta l’arme à son pied et gratta sa barbe blonde. Il ôta son casque ; il était encore plus hideux ainsi. Les grands yeux bleus n’étaient pas très bien alignés, ses cheveux ressemblaient à la filasse sale des tripiers. Le nez monstrueux semblait avoir été brisé à maintes reprises, les lèvres avaient également été malmenées autrefois. Sa peau claire avait mal supporté le soleil, le vin, et les coups. Ses oreilles décollées témoignaient des rudes échauffourées auxquelles le gars avait dû être mêlé. Elles étaient comme grignotées par des rats. Le géant puait le suint et le vinaigre.
–Je savoir pas si Edoin est retourné de la taverne Ambazac, c’est très beaucoup vrai, ce soir il ya…
Il fit le geste, en relevant le coude et mima de grandes goulées.
–Toi montes des Jonchères ?
–Oui, et ce soir j’aimerais bien rester, je pourrais faire le feu entre deux tours de guet et tenir la vinasse au chaud sans qu’elle bouille… J’ai des jeux !
Le Jonchariot reprenait un peu de sa verve.
–Ah ! Toi ti tiens des… petites « flip-flip » ?
Le pailler fit mine de souffler dans ses doigts et de jeter des choses en vrac sur une table. Quand le guet avait droit au charivari, le dimanche de la dernière décade du mois, il espérait bien jouer aux dés et aux cartes. Les gardes n’avaient même pas à chercher de quoi égayer les nuits de charivari avec des plaisirs normalement interdits par le roi, même à ses nobles sujets. Les routiers en faction arrivaient toujours à trouver des pourvoyeurs de jeux plus ou moins honnêtes, mais toujours bien accueillis et même parfois engagés dans la troupaille.
–Oui, j’ai des dés et même des cartes… Je les ai volées à la foire des ânes aux Billanges.
Marc sortit les jeux de la poche de son sarrau. Le pailler en contrôla la validité et le renseigna unpeu.
–Va là, hop ! Par porte celliers… Pas petite porte senestre, malheureux ! Va bien dans, pfuit ! Tourne comme ça, hop ! Le Fayemendi cuve dans coin cour à chevaux. Dis à lui que moi t’a laissé aller, et pfuit !
Marc, encore tout remué par cette rencontre, salua le géant qui avait pris les jeux avec lui et qui retournait déjà à son estage derrière un gros buis figurant une des bornes du domaine des moines grandmontains. Marc souffla fort devant lui. Cette fois, on ne l’avait pas rejeté à coups de trique, comme lors de ses précédentes tentatives pour approcher l’abbaye. Il avait fait des progrès. Il continua son chemin. Jamais il n’avait côtoyé le domaine de Muret d’aussi près. Grandmont plantait à présent devant lui son inaccessible basilique, la ferveur des moines devait rester à l’abri des turpitudes du monde. On n’autorisait au visiteur qu’un espace de service autour des écuries, des caves, et des réfectoires. Le jeune ne percerait pas le sanctuaire ce soir, mais il allait s’inscrire dans le lieu. « Pas petite porte senestre ! », certes mais « porte d’entrée » quand même !
Marc entra par la porte des celliers grande ouverte, à droite après le grand portail. Elle donnait sur une grande cour. Dans le coin Ouest, sur un tas de paille, le Fayemendi était effectivement étendu. Il tenait à peine dans sa main lâche, la bride d’une pauvre bourrique, au soleil depuis sans doute pas mal de temps. Elle suait en mâchonnant de la paille, n’osant réveiller le bougre qui la tenait encore. Marc saisit le cuir des guides et mit la jument à l’abri sous un préau. Il allait approcher un seau d’eau tiré vivement du cuvier de la fontaine au coin de la cour quand l’aviné esquissa un geste de retour à la conscience. Le routier se frotta le visage et crispa lesyeux.
–Ah ! Merde… Le Jonchariot ! T’es déjàlà ?
–Ben oui, j’ai amené les dés, et même les cartes ! Et j’ai passé votre guet sans encombre !
–Que Saint-Étienne me damne ! T’as réussi à convaincre le grand de te laisser entrer ?
–Je t’avais bien dit que je monterais, tu vois, votre guet est percé. Les écuyers du coin ne sont pas si vigilants que ça, non plus, on peut réussir à leur prendre ce qu’on veut quand on est malin, même leurs jeux de riches malhonnêtes !
Marc tendit la main et aida un Fayemendi bien engourdi à se relever. Ils allèrent s’asseoir plus loin, à l’ombre, près de la fontaine. Après un boire salutaire, le jeune s’expliqua.
–Bon, t’y as pas cru, hein ? Mais moi je savais que le Brandusus, le sénéchal du Dognon, ce gros mou, avait des cartes. D’Espagne, paraît-il. Aux Billanges, à la foire j’ai laissé croire, en pleine partie, que sa petite aimée était prise sous une charrette à l’entrée du bourg. Tu parles ! Les gens s’agitaient parce qu’un aviné s’était fait renverser par une chevauchée de jeunes abrutis, mais personne en réalité, ne savait ce qui se passait… C’est là, ma ruse ! Dans la pagaille, profiter de l’instant, dire n’importe quoi, ce qui m’arrange, c’est comme ça que j’ai subtilisé les cartes. Ils ont tous quitté la table, mais y ont oublié les cartons : mon intérêt. Pour le reste, tu avais raison : avec des jouets ! Le guet négocie facilement ! Même le géant qui pue n’a riendit…
–Faudrait pas qu’on se fasse voir avec des objets pareils ! Et lesdés ?
–C’est le Kiaudou qui me les a trouvés contre une pinte de blanc de Bourgogne, de « Bourbon Lancy », que j’ai volée aux Martin. Les bons Martin vendaient ce qu’ils avaient de leur cave sur un bel étal à la frairie. Voler aux Martin c’est pas rien ! Tu vois, je suis un malin. Cet imbécile de Kiaudou peut s’approcher de la tour du Dognon quand il pêche sur la Bobilance. Il sait que le vieux Guy de Foucault jette ses dés aux latrines quand ils le font perdre. Il suffit de trier dans la merde…
–T’es un futé, toi ! Un fourbe, même ! T’es bien de la trempe des bons routiers !
–Des dés en ivoire ! Laisse-moi rester ce soir. Allez ! Je t’ai prouvé mon courage et ma… Bonne foi… Je serai sage, je ne m’occuperai que du feu et duvin…
Fayemendi était amusé, le gamin qu’il avait en face semblait assez culotté et motivé pour joindre la compagnie des guets de Grandmont, au moins pour le charivari de ce soir. Voler des cartes à un seigneur, objets rares, précieux et interdits, était quand même un exploit.
–Des dés merdeux ! Il faudra taire le détail ! Tu sais mettre la cannelle, au moins ? Le miel, l’angélique et la cardamome au bouillant ?
–Il ne faut pas faire bouillir le vin, sinon il perd de son esprit et rend la fête insipide.
–Bien ! Petit. Je vois que tu sais mener la marmite, alors on va attendre l’Edoin qui arrive d’en bas avec une demi-barrique de vinasse… J’espère quand même que tu as lavé les dés comme il faut !
Ils avancèrent un peu après les gros murs de l’abbaye, sur la route d’Ambazac à la rencontre d’Edoin qui ne devait pas tarder à arriver. Ils se confiaient, confirmant l’amitié naissante et la convergence d’esprit qui les avait liés une semaine avant, dans les chemins de la pierre branlante entre la Jonchère et Grandmont. Le dimanche d’avant, les deux compères s’étaient cognés sur ce versant des monts, dans les bois de Malty. Le pailler y relevait ses collets et Marc y posait les siens. Ils étaient tombés nez à nez et n’avaient pu que partager leur terrain de braconnage. Le premier avait fait part de la fête à venir à Grandmont et le petit s’était fait fort de leur fournir de quoi jouer si on le conviait. Le lundi, Marc avait réfléchi : et si la Marie se présentait à la Jonchère au bal du mois de Marie le même jour justement. Et si elle le choisissait comme cavalier pour caroler le branle ? Alors, toute la semaine, il avait passé son temps à essayer de la croiser, de la rencontrer, de lui parler. Rien n’avait marché. Même au lavoir, là, il aurait dû réussir ! Jamais un homme ne s’était aventuré dans l’intimité toute féminine des sciences des linges.
Rien !
Et le Jacques, le fils de la grosse Amélie, restait favori pour soulever la belle.
Pis, le drapier riche, aussi, qui passait chaque lundi, semblaient avoir les faveurs de la mère, la vieille Guilbaude qui suçait la robe des pitoyables seigneurs de la Jonchère, les vieux Bondelli du Vignaud que Marc avait failli faire virer bredin dans ses jeunes années de galapiat.
Fis ! Des gens de la Jonchère et de vieux souvenirs ; Marc avait renoncé à une conquête compliquée et s’était laissé glisser sur le chemin commode. En ce dimanche, il y avait aussi le charivari du guet de Grandmont, et tant pis pour le bal des jonchers et la Marie. Elle aurait, de toute façon, tout le temps de le reconnaître quand il deviendrait seigneur. Trouver des jouets comme le lui avait suggéré Fayemendi, c’était simple, ça ne dépendait que de lui et pour ce qui relevait seulement de sa haute personne, le jeune se sentait compétent. Jusqu’à preuve du contraire, ça lui avait réussi. Ce soir il allait rencontrer les gens de la corvée d’estage, savoir un peu ce qui se tramait dans la région, entendre dire, écouter, profiter, proposer ses services, et, qui sait ? Pouvoir entrer dans une escouade du guet de Grandmont ? Grandmont : l’abbaye des Plantagenêt, l’abbaye des rois, le grandiose si proche et si fermé, l’indispensable passage vers l’avenir lumineux que Marc voulait vivre. Le fils du chaircuitier avait franchi une étape : il accompagnait à présent un gars du guet et il restait au feu, cesoir.
L’Edoin jura en frappant la vieille mule qui peinait sous le soleil tombant. Elle ne tirait pourtant qu’un modeste tonneau sur un chariot trop grand.
–Allez, la bourrique ! On y est ! Encore un arpent et tu bois… Moi aussi j’ai soif !
–Oh là ! L’Edoin ! s’exclama Fayemendi
–Qu’est-ce que tu fabriques avec l’abruti des jonchers ? répondit l’autre qui avait relevé lesyeux
–Il nous apporte le jeu et reste avec nous, j’ai là, un bon cuiseur devin !
–Tu m’étonnes un peu, mais… soit. À Ambazac, ils deviennent fous ! Le vin est à deux vieux sols la demie ! Ils veulent des francs à présent ! Et je ne parle pas des épices… J’ai dû laisser mes sandales neuves de chez l’Adrien ! Et je remonte dans la pierre chaude, piedsnus !
Fayemendi faillit rigoler. Il se ressaisit et décida du lieu de la beuverie : un coin à l’abri du vent, une enclave dans les saules qui entouraient le champ ras en regard du portail de l’abbaye, un peu à l’écart des maisons. La bourrique fut donc acculée là. Ils déchargèrent le tonneau, le calèrent sur une vieille souche et le mirent en tire. Ils goûtèrent tout de suite un peuet…
–Il est bon ! Va ranger la bourrique, Jonchariot ! Et commence à rassembler du bois pour le feu. Y’a des pierres là, et je t’apporte la marmite, le miel et les épices, dit l’Edoin au Marc en enfilant le pas du Fayemendi vers la grand-porte de l’abbaye.
Marc s’occupa alors à remettre la mule à l’écurie, à ranger le chariot dans la cour des celliers, scrupuleusement, comme le lui avait ordonné le rouquin du guet. Puis il s’enfonça dans les bois pour ramasser du gros bois mort. Quand il en eut de quoi tenir un siège, il monta un trépied, une potence de triques vertes, noua les bois en haut avec du lierre et entoura le foyer de pierres. Il désagrégea du bois pourri bien sec, sur une écorce de pin. Il saupoudra d’étoupe et de fibre d’amadou, qu’il tenait toujours au fond de la poche haute de son sarrau, au sec. Il tourna alors vigoureusement une baguette de hêtre en l’appuyant fort sur ce plateau. Il cracha dans ses mains et fit pivoter, à grande vitesse en frottant entre ses paumes, l’axe qui devait faire naître la flamme. En bas, sur l’écorce, une chaleur se dégageait, puis l’étoupe fuma et enfin la sciure étincela. Alors Marc souffla sur l’écorce, il ajouta un peu d’herbes sèches, une flamme jaillit. Il encastra la combustion sous le fagot du foyer. En moins d’une prière, un beau feu crépitait, prêt à bouillir n’importe quel marmiton. Le plus difficile était réalisé, il ne restait qu’à alimenter les flammes. Marc avait entassé de quoi chauffer et éclairer une bonne nuit. Il s’autorisa alors à engloutir le vieux pain rassis que lui avait lancé l’Edoin, tout à l’heure, avant de lui confier sa mission.
L’abbaye de Grandmont, l’œuvre de Saint Etienne de Muret, s’illuminait elle aussi. Des moines avaient allumé les torches et garni les brasiers. On entendait, derrière les murs, les chants d’une messe, celle d’avant la nuit qui tombait. Marc initiait le début de son chemin, il se leva face à cette grande bâtisse de pierres, comme pour mieux mesurer quelque chose qu’il estimait enfin à la mesure de sa personne. Il avait vue sur l’enceinte de la monumentale basilique ; un premier pas était franchi vers le faste auquel il aspirait. Marc épiait à travers le portail de l’abbaye ouvert, le va-et-vient des moines. Il côtoyait l’autre monde, celui qu’il allait avoir à déflorer. Il prenait son temps dans les préliminaires. Cet après-midi, déjà, et tout à l’heure dans la cour des celliers, le Jonchariot avait déjà mis un pied à l’intérieur du périmètre sacré, mais ce n’était pas vraiment encore le sanctuaire, rien qu’une aire de service, comme l’écurie attenante où il avait fermé la bourrique, tout le monde pouvait encore y errer en anonyme sans intérêt. « Pas petite porte senestre ». Il fallait encore quelques efforts pour vaquer dans les jardins du cloître, et un peu plus pour voir le retable de la basilique, il paraît qu’il était tout en or, avec sept chasses pleines de reliques des saints. Pour l’instant, il savait aussi que dès la discrète porte à gauche franchie, un moine appellerait un gent d’arme, et qu’il se retrouverait devant le prieur Adémar avec un choix difficile : le service d’une celle de Grandmont n’importe où sur le royaume en pauvre convers, ou les geôles de Limoges en attendant une place dans l’armée des consuls ou du comte de la Marche, ou pire, un retour sur les terres de la Jonchère avec, à la clé, une petite question du seigneur du Dognon. La petite question c’était un interrogatoire musclé : on se faisait battre, triturer à la braise ou au fouet par le tourmenteur. Quand on avait prouvé qu’on ne voulait rien de mal aux bonshommes de Grandmont, on était bien fatigué ou flottant tout blanc dans le Taurion avec des yeux glauques de poisson mort. On ne rigolait pas avec la haute justice du prieur. Simplement, on ne rentrait pas à Grandmont ; il fallait laisser les bonshommes en paix, à leur prière pour sauver le monde. Marc réalisa qu’il aurait à patienter, et sans doute pour la première fois de sa vie, entamer une démarche sophistiquée.
Sous son crâne de tout puissant gamin, il osa rêver, aussi, qu’un jour il entrerait ici à cheval, directement par la grand-porte au levant, celle de la Basilique, et qu’on s’inclinerait devant le Seigneur des Jonchers.
–Et les paillers ? Le Fayemendi et l’Edoin, ils y sont bien entrés par la « petite porte senestre », eux, tout à l’heure ? Qu’ont-ils de plus que moi ? Que savent-ils ? Plus quemoi ?
Le privilège naît de la connaissance. Lui, ne savait pas encore et ne pouvait donc, à l’heure, percevoir le monde de l’abbaye. Il suffisait juste de venir à l’érudition de Fayemendi, pour tenir le droit d’arpenter le ceint des saints, mériter une parole d’un seigneur. Cela ne sembla pas inabordable au Jonchariot, qui jeta un peu de bois dans la flamme pour faire voler quelques escarbilles vers les étoiles, et manifester sa joie devant ce constat.
Un peu plus tard, le guet fut libéré par les moines qui venaient de donner les consignes pour l’estage de la nuit à venir. Certes, on était le dernier dimanche du mois et la garde avait droit au charivari, bien au dehors des murs évidemment. Elle devait assurer cependant, comme le décrivait le coutumier de l’abbaye, une permanente vigilance avant les messes de none et matines afin de sécuriser les abords de la maison de Saint Etienne. Marc vit passer la troupe de gardes par le grand portail, en grand désordre ; il se demanda comment un des centres du monde chrétien pouvait tenir la sérénité grâce à ces gueux qui lui ressemblaient fortement. Il y avait maldonne, il suffisait de croire en soi pour joindre l’inaccessible, rien n’était finalement déterminé comme auraient voulu lui laisser entendre les pauvres imbéciles de la Jonchère. Les grandes aventures des grandes personnes dans le grand monde commençaient là, à quelques brasses et il n’était pas insurmontable de s’y inscrire.
Il y avait maintenant, autour du feu que Marc avait poussé un tantinet à la nuit tombée, une dizaine de soldats : des bras cassés, des Jean foutre, des gueules biaisées : des paillers. Ils étaient à la solde de Gérald de Montcocu et de son fils, Meilhot, seigneurs d’Ambazac. Ils devaient protéger l’abbaye des incursions possibles des soudards du prince anglais qui pourrait bien ravager la région sous peu. Tout le monde le disait en espérant que les ragots conjureraient le sort. Tous les paysans de la contrée savaient aussi qu’il était de mise, pour un conquérant Anglois ou autre, dans ce genre de belligérance, de faire tester le terrain à piller par quelques routiers sans âmes : à la connaissance des forces de la résistance, donc à l’évaluation du gain, on décidait, ou non, de risquer la vie des troupes plus nobles. Edouard d’Angleterre, le Prince Noir, avait effectivement l’intention de régler quelques comptes aux Français dans les parages, il laissait ses bandes divaguer dans le Limousin et éprouver le pays. La ville de Compreignac avait déjà goûté de la barbarie des bandits partisans de l’Anglais. Le Prince Noir, lui, bien au chaud dans son castel à Cognac, attendait les nouvelles. Les précautions du prieur de Grandmont étaient donc bien justifiées, car même si le souverain anglais respectait sans doute beaucoup les bonshommes on ne pouvait évaluer ce qui se tramait dans la tête d’un capitaine routier en campagne plus ou moins en service, l’histoire l’avait démontré.
Ils étaient dix autour du feu, on ne peut plus dépareillés. Marc reconnut le mal disant qui lui avait piqué les flancs. C’était un Picard qui avait un peu de difficulté avec la langue d’oc et ses collègues en riaient, lui faisant répéter plusieurs fois ses mauvais mots pour s’en fendre les babines davantage. Il était bon bougre et s’exécutait, en rajoutant parfois, quand il ne savait plus, un sifflet bref : « pfuit ! » qui remplaçait le mot manquant. Il y avait aussi trois gascons, apparemment très à l’aise dans le renoncement à toute tâche, quelques incapables notoires des environs et les deux acolytes du Midi que Marc connaissait déjà : le Fayemendi et l’Edoin
–Allez ! Petit, bourre la marmite et que la chauffe commence !
Marc s’appliqua. Pour les besognes de fête, il avait toujours su, comme si l’instruction de ces labeurs, chez lui, avait été donnée par les dieux avant sa naissance. Il dosa à sa convenance les affaires précieuses dans la piquette. À la première goutte, tous les présents n’émirent que compliments. Marc était fait pour ça, pour les réjouissances, le gain facile, il ne voulait pas monter à l’échelle du noble mérite, il supposait qu’il existait une voie rapide et facile vers le sommet, il se disait que les oiseaux ne peinent pas pour atteindre le haut de la colline, il suffisait de les imiter : voler !
None finissait. On interrompit la partie de dés. Le Picard en fut tout marri, les petits « flip -flip » étaient en train de lui rapporter plus que la solde du mois. Il mit barre sur tous. Il en avait le droit. On s’arrêtait, mais le jeu reprendrait à ce point, sans pénalité. Les Gascons jetèrent les cartes précieuses en tas, sans plus de considération. Les paillers se levèrent et partirent par groupes de deux ou trois fouiner les buissons des alentours, plus sûrs d’y trouver des crapauds qu’autres routiers, mais c’était la règle, il fallait bien faire, et conjurer les intentions du Prince Noir gonflées dans les rumeurs portées par le vent qui courait la lande. Marc, une fois seul, en profita pour recharger un peu le feu et emplir à nouveau le marmiton de piquette. Il avait à peine plongé la boule à miel dans le pot pour son office qu’une ombre se glissa de l’enceinte de l’abbaye vers le feu que le Jonchariot avait fait plus éclairant.
–Fayemendi ?
–Ah ! Non ! C’est pas un guetteur ! À l’heure qu’il est, ils sont au « fauteuil » là-haut, au flanc du soleil levant, sur les monts ! C’est le vieux faure de l’abbaye, j’ai senti les nuages de ton vin en sortant de la boutique, je me suis dit que ça ne ferait pas de mal à ma gorge… Je peux ? Si tu veux bien évidemment, finit-il par dire en esclaffant un crachat gras dans lefeu.
Le vieil homme s’était assis sur le bois de la souche à côté du tonneau. Marc força un peu sur le miel pour tuer l’enrouement du vieux, il dosa un peu plus son poivre et mit deux bois de cannelle pour dégager mieux les vieux poumons encrassés par les fumées.
–Le fais pas bouillir, malheureux ! Ça vaudrait plus rien !
Marc retira un peu le chaudron.
–Vous venez de l’abbaye, grand-père ?
–J’y suis né ! Et mon père, mon grand-père aussi… On ne sait que taper la ferraille, la petite ferraille, les outils, les modestes bricoles… Rien quoi. Et toi ? T’es qui pour suivre des abrutis pareils ? Y’a du labeur dans les forges du coin, tu f’rais un bon faurissou ! Tu sais mener un feu, et t’as l’air costaud !
–Je viens des jonchers, là-bas, personne ne me veut comme apprenti, on dit que je suis bon à rien, ma mère le pense aussi…
–Et ton père ?
Marc fut surpris par la question. Désorienté, il se souvint : un jour, il devait avoir six ou sept ans, le Jean l’avait invité à pousser de la chair moelleuse qui sentait bien l’ail et le persil dans les boyaux pour faire des saucisses ça lui avait bien plu. À l’époque, la boutique marchait bien et le père ne buvait pas le matin. Mais la mère et la grand-mère étaient entrées comme des furies dans la boutique et avaient tiré le gamin par la manche, reprochant au père les traces de gras sur le beau sarrau tout neuf du gamin.
–Le Jean ? Il ruine sa viande à trop boire ; les chalands fuient les mouches de l’échoppe, plus personne n’achète ses abats, il ne brade plus que pour l’esprit du vin… Et moi, je ne veux pas de sa vie… Vendre des boyaux ne me paraît pas un avenir…
Marc avait appelé son père : « le Jean »… Cela choqua le vieux. Il commença à comprendre à qui il avait à faire.
–Le fer te dit rien ?
–Je ne voudrais pas finir avec vos humeurs de graillons
–Qui se ressemble s’assemble, si tu veux perdre ta vie, t’as bien choisi tes compères. Mais c’est curieux, tu as la tignasse et les yeux clairs, tu me rappelles un jeune que racontaient les vieux, un puceau auvergnat…
Le guet rentra de sa ronde sans avoir eu à trucider du monarque anglais
–Ha ! Ben, voyez qui est là ! Notre « faurissâilleux » !
–Taillandier ! Fayemendi, taillandier !
–Si tu veux l’ancêtre ; mais pousse un peu tes vieilles côtes, on a une partie de dés en cours et le Picard est en train de nous ruiner…
–Bah ! Un peu, j’ai trois plus que l’Edoin et deux sur les sous que toi dois toucher, « pfuit », de Prieur.
Le Picard progressait.
–Que doit toucher de Prieur… Joue ! ajouta l’Edoin.
La partie s’enflamma et les godets de vin épicé se succédaient dans la ferveur. Les Gascons avaient repris leurs cartes en attendant matines.
–Vous disiez quoi ? Faur… Taillandier, tout à l’heure, je ressemblais àqui ?
–Tout à l’heure ? Ah ! Oui, l’histoire de l’Alvernha. Il y a longtemps, mon grand-père et puis mon père me le racontèrent. Un ancien convers des débuts de l’abbaye, un apôtre de Muret lui-même, amena ici un jeune faure. Un flanque rien qui ne savait que courir les filles des émailleurs de la grande ville de Limoges. Dieu l’en punit grandement ! Le seigneur n’aime pas les gens qui se détournent de leur tâche ici-bas. La femme qu’il prit et la fille qu’il lui fit périrent dans un fléau. Il tomba chez les soldats de Limoges et dans la boisson aussi, puis se retrouva, on ne sait comment chez les moines Grandmontains, à Vincennes. On l’avait perdu. Mais pour qui côtoie les bonshommes du bon Saint-Étienne, le destin peut prendre d’étranges chemins…
L’ancêtre développa, trop heureux de prendre la parole pour une fois et de mener à son tour la légende des forgerons de l’abbaye. Le vieux affirmait le ton au fur et à mesure du déroulement de l’histoire incroyable des faures de Grandmont qu’il venait de résumer. Il prenait de longues pauses affirmatives pour avaler le vin chaud. Le guet s’était mis à l’écouter comme on écoute aux fontaines les sornettes des colporteurs. Les mains rigides et crevassées du vieil Anselme, incrustées du poussier de l’acier, volaient dans la lumière du feu. Il triturait un bout de trique de saule, s’en servait comme un sceptre pour appuyer son histoire que tout le monde suivait à présent. Les dés ne roulaient plus, les cartes n’étaient plus abattues, on écoutait, bouche molle, la fable du faure. L’aïeul avait retrouvé une voix claire. Le récit du vieux dominait la rumeur de la nuit printanière. Même le vent dans les arbres avait cessé d’agiter les feuilles légères. Le conteur rajoutait de sordides détails pour capter l’attention de son public particulier, il mimait les massacres en dessinant de grands cercles de sa tige de saule qui fendait l’air tiède dufeu.
–On retrouva le gars : l’Alvernha, l’héritier des savoirs du plus grand faure de Grandmont, dans tous les coups menés face aux Anglais en Limousin
Le vieux leva sa tige de bois dans l’obscurité violette à la façon d’une croix sacrée. Il s’époumonait à présent comme un curé en fin de sermon enflammé.
–Par on ne sait quel hasard, comme je vous l’ai conté, il frappa là, assomma ici, visa encore ailleurs… Mais, à chaque fois, un Plantagenêt y laissa sapeau…
Il laissa le silence tomber sur ce mystère, il soufflait, il était en sueur. Il reprit son calme et insista en tendant son godetvide.
–Oui, un roi… À chaque fois… Les deux Henri et le Richard…
–Et après ? Osa Marc de plus en plus concerné et complètement pris dans l’histoire,
Le vieux s’esclaffa, et faillit en mourir étouffé derire.
–Faut se méfier des puceaux bons à rien ! Ceci dit, il portait une épée antique ! Pas une cuillère à miel ! Ha ! Ha ! Et il ne venait pas des bas-fonds des jonchers ! dit-il en se rasseyant près dufeu.
Le guet partit du même fou rire devant la moue énervée du jeune qui avait gobé l’histoire comme si c’était la sienne. La deuxième marmite était vide, et le bois vert des potences commençait à faiblir, les liens de lierre avaient pris feu en haut. Marc arrosa le tout et refit une troisième fois le plein du chaudron. Les jeux avaient repris. L’esprit du vin avait à présent mis de la chaleur dans les relations de la bande pourtant mâtinée au possible. Le Picard parlait l’oc presque couramment. Le vieux devenait maître faure, comme ses aïeux. Il savait presque les secrets de la forge des Wisigoths et montrait les gestes de sa baguette. Les Gascons ressassaient leurs très grandes batailles et leurs faits d’armes. Marc n’avait rien bu et touillait la marmite, furieux de la moquerie, de sa comparaison peu flatteuse avec l’Alvernha. Pourtant, l’histoire du vieux forgeron l’intriguait, ça résonnait très fort chez lui : un jeune, sans rien, était devenu un héros. Quand le vieux faure se leva et salua la bande pour regagner sa maison, Marc bondit, et le prit à part, en le tirant par la manche un peu dans le noir, il lui dit à l’oreille :
–Maître faure… Ce petit, cette épée, l’épée antique du jeune que vous racontiez, elle estoù ?
–Oh ! Fiche-moi la paix ! C’est encore une longue histoire…
–Dites-moi ! Vous racontez si bien !
–Humf ! Quand L’Alvernha a eu tué son dernier Plantagenêt, la mort l’a cueilli lui aussi, lors d’une bagarre toute bête avec des paillers venant de Saint-Léonard, son bran n’était pas si magique que ça ! Il aurait dû zigouiller aussi, le Jean sans Terre, d’après la prophétie, mais…. On l’a enterré dans notre cimetière, quand même… Je dois reconnaître que c’est pas rien d’être inhumé à Grandmont !
Le forgeron fit l’effort de se dégager, mais Marc lui empoigna à nouveau le bras. Les paillers occupaient à nouveau leur peu d’esprit aux jeux. Depuis que la troisième marmite égayait les parties, les avinés avaient du mal à garder la tête aux levées des cartes et riaient beaucoup. Le Picard avait tout perdu de son avance et les Gascons discutaient des aubaines et des déconvenues des donnes, plus personne n’était vraiment conscient, et le fait que le vieux soit prisonnier de la poigne du Marc qui le traînait par la manche dans le noir ne fut même pas remarqué par les soudards étendus autour du feu. Une inquiétude soudaine envahit le vieux forgeron qui ne pouvait plus à présent compter sur un secours immédiat.
–Tu vas quand même pas me tourmenter, avec l’histoire de l’Alvernha ?
–Dites-m’en plus sur ce gars ! appuya Marc, déterminé, qui allongeait le pas, traînant le vieux dans le noir du chemin avant le portail
–Ces histoires, c’est pas des choses pour toi, va courir tes belles de la Jonchère. L’Alvernha était dans l’abbaye, toi, t’es un étranger, et moi je suis trop vieux, je vais me coucher… Mais t’es un fameux bouilleur devin !
Le compliment ne troubla pas la main ferme du jeune des jonchers. Le vieux se sentit obligé de poursuivre :
–Tiens ! Je tousse même plus ! Et puis, c’était il y a longtemps tout ça, c’est des histoires de vieilles soutanes, toi, t’es jeune, alors cours !
Le vieux cahota vers l’arche. Marc ne lâcha pas le bras, ils franchirent ensemble le portail de l’abbaye. Ils se dirigèrent à droite, dans l’allée, à l’extérieur de l’aire des services. Il y avait là de petites maisons où logeaient des gens indispensables à l’abbaye ; mais ces gueux n’étaient pas vraiment dans l’illumination de Grandmont eux non plus. Marc était certain qu’un éclairage insupportable l’accompagnait, les gens d’armes vrais, de l’abbaye, les hommes de Meilhot de Montcocu allaient surgir du noir et le colleter, il s’incrusta dans le flanc du vieux faure pour ne paraître plus qu’un. Ils entrèrent dans la forge d’Anselme quasiment enlacés. L’antre du faure était un abri qui protégeait momentanément Marc du regard de la loi. La lueur du foyer guida les pas du Marc, elle était encore rougeoyante au fond de la maison. En face du mur soutenant la cheminée, il y avait la couche du batteur de fer. Marc accompagna le vieil homme dans sa chute sur la paillasse et se retourna. Dans la pénombre que diffusait un feu mourant, il distingua la planche de la hotte de l’âtre, une lampe à huile semblait y être posée. Il plongea vers le brasier faible une poignée de tiges de bouleau sec qu’il avait tirée d’un fagot sur le côté du foyer. Il enflamma les brindilles, se releva et tenta d’allumer la mèche du lumignon sur l’étagère du fronton. La lumière se fit dès que le bois enflammé toucha la mèche huilée, et tout de suite, brilla de mille feux, à côté de la lampe, un gros cristalbleu…
–C’est quoi ?
Le vieux ne répondit pas, le vin lui avait décontracté le palais et le bougre ronflait déjà. Marc esquissa un sourire et franchit l’huis tel un serpent. Il courut dans l’allée, poussé par la peur de se faire surprendre, mais rien n’arriva.