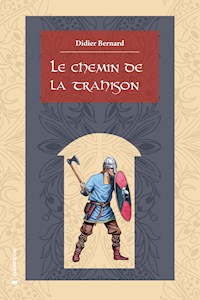Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: La trilogie de l'abbaye de Grandmont
- Sprache: Französisch
En cette fin de XVIe siècle, les Français vont s’entre-tuer durant les huit guerres de religion. Proportionnellement, ces guerres firent autant de victimes que la Grande Guerre de 14-18. Durant plus de 30 ans, catholiques et protestants se livrèrent aux pires des massacres afin de tenter d’imposer aux autres leurs façons de mener la liturgie.
Une des grandes batailles de ces longues guerres eut lieu à La-Roche-l’Abeille, dans le sud de la vicomté de Limoges.
L’abbaye de Grandmont, la maison mère de l’ordre de Muret faillit bien disparaître tant elle fut malmenée par le hobereau local partisan de la réforme. Aux toutes fins des empoignades, elle fut même occupée par les huguenots du seigneur de Saint-Germain–Beaupré.
Un petit garçon, Martin Payot, va être enlevé par les troupes réformistes de Coligny lors de la bataille de la Roche-l’Abeille, il grandira durant ces longues années de guerre et devra surmonter bien des peines. Beau, fort, intelligent, il trouvera cependant un moyen extraordinaire pour mettre en résonance sa vie et ses idées.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Didier BERNARD
La trilogie de l’abbaye de Grandmont,Les grandes batailles de la vicomté de Limoges,
Le cimetière des huguenots
TomeIII
La lecture deDieu
Martin était un gamin vif, un petit Limousin habitué aux rythmes des saisons très marquées dans sa rude province. Il vivait à la Roche-la-Belle. Le village tenait son nom d’un affleurement insolite de pierres verdâtres au milieu des champs de la paroisse. Les paysans ne cultivaient pas les parcelles trop arides autour des roches serpentines qui saillaient là. La bruyère et les épineux y poussaient donc naturellement. Sur ce désert, les villageois entretenaient simplement des ruches qui donnaient un excellent miel sauvage. Les prairies et les bosquets d’un horizon gentiment vallonné et un peu plus fertile, complétaient le paysage.
Comme bien des « Lémosis », Martin Payot avait froid en hiver. Trop froid pour dormir seul sur sa paillasse, même bien couvert de l’incontournable édredon boursouflé de duvet de canard. Alors durant la veillée, il faisait durer les moments de bonne chaleur du feu de cheminée que seuls, normalement, les vieux étaient autorisés à partager. Il s’allongeait en filou, dans le « cantou », au pied de sa mère qui menait des travaux de laine. Les hommes, invités pour la veillée, entrelaçaient des éclisses de ronces pour fabriquer des « panissous » à la lumière de l’âtre. Le feu rayonnait doucement à la hauteur du sol en terre battue. L’ardeur des bonnes braises rouges du bon bois des « gorces » réchauffait là, comme il fallait, le petit du minotier de la Roche-la-Belle.
Au printemps, juste après les dernières giboulées, sous le soleil neuf, le chérubin était le premier du village à ramasser les coucous jaunes des talus et à porter son bouquet fièrement arraché, jusque sur la table de la maison. Il cueillait ces fleurs sur le chemin, au bord de la rivière qui arrosait de sa bienfaisance la vie de la famille.
Quand l’été se faisait brûlant, après les moissons, il attendait la fin du jour travaillé par le gueux aux champs. Il allait alors jusqu’au moulin où œuvrait son père. Il glissait, en malandrin, ses mains ouvertes sous la bouche du blutoir qui donnait la meilleure des fleurs de farine. Son plaisir était de soutirer au meunier paternel un peu de sa bonne poudre de froment, toute chaude encore du frottement des meules. Il portait alors précautionneusement son larcin à sa maman qui, avec un œuf et un peu du lait de ses chèvres, confectionnait une ou deux crêpes merveilleuses. Elle les cuisait dans le fond du précieux caquelon de cuivre hérité des vieux de la parentèle.
À l’automne, la recherche du cèpe, dont il avait appris à reconnaître le dodu, la couleur et le parfum, l’emmenait toujours plus loin de ses repaires, vers des recoins inconnus de plus en plus écartés de son logis. Ces escapades lui permettaient à présent de bien maîtriser ses lieux de vie. Il commençait même à profiter de la science des raccourcis : il savait à présent qu’il n’était pas utile de suivre les hauteurs pour rejoindre Beauplat ; quand on était dans le grand bois, on pouvait piquer vers la rivière, c’était plus fatigant, mais on gagnait du temps.
Le logis des Payot, un peu au-dessus du moulin de la Gorce, avait la réputation d’être une bonne maison. La jeune mère élevait le fils dans la modeste chaumière sur une petite tenure qui produisait de quoi faire vivre le foyer. Des légumes variés poussaient au jardin, quatre poules pondaient bien dans le poulailler, quelques lapins grignotaient des trognons au clapier et deux chèvres paissaient tranquillement dans l’enclos à l’arrière de la masure. Le père Payot, malheureusement, ne possédait pas le moulin. Il s’y usait courageusement la couenne en bon ouvrier pour le sire de la Roche-la-Belle, qui, en retour, lui fichait une paix appréciée en ignorant : les ponctions de farine, les pêches frauduleuses dans le bief et les braconnages en amont de la grand-roue ou dans les bois du domaine…
La région venait de traverser de lourdes épreuves. Les aléas du ciel et des épidémies n’avaient pas épargné le Sud de la vicomté de Limoges.
Mais, jamais, ici, on n’avait eu l’occasion de voir des soldats encombrer le paysage et amener les catastrophes de la guerre. On n’avait pas besoin, ici, des cataclysmes martiaux. Le dénuement ordinaire accablait suffisamment les besogneux des villages chaquejour.
Alors, ce matin de juin 1569, la gent du pays arédien était anéantie. Les troupes du duc Henri d’Anjou, le frère du roi de France, avaient depuis quelques jours, petit à petit, pris place dans la contrée. De nombreux militaires occupaient dorénavant tous les environs. Ils avaient posé de gros canons autour de la ferme de Beauplat, un peu en haut de la masure des Payot, vers le village de la Roche-la-Belle. De très gros canons : il avait fallu pas moins de seize chevaux pour en hâler un seul en haut de la butte. Ces monstres de bronze campaient leurs gueules grandes ouvertes devant les bâtiments de la grande ferme où avait pris place le commandement du duc et de ses alliés, les Italiens dupape.
Les hommes commis au ravitaillement de tout ce monde écumaient les campagnes et prélevaient tout ce qui pouvait se manger. Lors des saisies dans les fermes, les soudards se montraient moins amis qu’annoncé par les curés des paroisses autour de Saint-Yrieix. Après la peste, qui dernièrement déjà avait ruiné les environs, les besoins en vivres de cette halte militaire allaient accabler encore un peu plus le pays. La maladie abominable, dont le souvenir était encore vif ici, avait épargné les proches de Martin, mais les récoltes, par la suite, avaient été mauvaises sur la tenure familiale. Le moulin avait trop peu tourné pour que le père Payot gagne son écot. L’été naissant ne paraissait pas non plus des plus prometteurs. Il pleuvait depuis un bon moment, à fines gouttes certes, mais il pleuvait. La Roche-la-Belle voyait tous ses habitants fuir en catastrophe vers le Nord, vers la grand-ville de la province, avant la monstrueuse bataille qui se dessinait de plus en plus précisément céans. Il régnait, autour de la ville de Saint-Yrieix, l’insupportable atmosphère d’une apocalypse imminente.
Les Payot n’avaient pas pu suivre ceux qui étaient partis chercher refuge vers Limoges. Ils avaient été sommés de demeurer là, plantés au milieu du champ du désastre à venir. Le père avait été réquisitionné pour faire tourner le moulin. Il devait moudre de la farine pour la troupe cantonnée autour de Beauplat, au grand dam de la mère qui ne savait plus comment empêcher son fils de fricoter avec les gens de guerre si bien habillés, si attirants. Elle aurait bien aimé fuir, elle aussi et emmener son petit loin des soldats, mais elle avait dû rester là en bonne épouse, à surveiller son marmouset au milieu du chaudron de l’enfer. Elle en pleurait dès son réveil.
Ce matin, le turbulent Martin avait réussi à s’échapper. Il avait quitté comme un chat fourbe la chaumière familiale. Le garçon avait escaladé la barge au-dessus de l’étable. Il avait sauté de haut, par la petite porte du fenil juste garni de foin neuf pour l’hiver des chèvres. Il était tombé sur la cabane des lapins en contrebas. Il avait traversé la cour et passé le « quièdou » aussi vivement qu’un lièvre. Il était fier. Il grimpait à présent la colline en face de sa maison à vives jambes, pour mesurer de la hauteur de ses six ans combien il y avait d’hommes. Il n’en avait jamais vu autant rassemblés. Il avait déjà croisé quelques gens d’armes ces derniers jours, mais à présent leur nombre avait considérablement augmenté. Ces soldats dont l’accoutrement était couvert de chemises rouges ne lui semblaient pas méchants. Ils rigolaient et partageaient avec lui quelques victuailles parfois, des fraises des bois ou des grains de seigle encore verts. Ils parlaient bizarrement et sentaient mauvais. C’est tout ce qui avait frappé l’esprit du petit jusque là. Le gamin savait aussi que ces militaires étaient là pour le défendre, lui et les autres ouailles du hameau. C’est ce que braillaient à tous les vents ceux qui allaient à l’église du curé. Ces gens d’armes plaisaient à Martin, ils étaient courageux, paraissaient forts, indestructibles. Le rejeton avait confiance en ces puissants soldats. Il n’avait pas jugé bon de suivre les injonctions maternelles. Les jurons de son père qui lui promettait la fessée à l’ortie s’il désobéissait à sa mère n’avaient pas suffi pas non plus à lui faire entendre raison. Martin refusait de rester enfermé, il voulait voir les militaires, les canons, les fusils et n’avait pas peur. Ses petits mollets nerveux, crispés dans sa course vers le Puy Chétif, le montraient bien, ce matin.
–« Reviens ! Martin ! Reviens ! »
Non, Martin n’allait sûrement pas rentrer au bercail, il fallait qu’il voie, c’était plus fort que lui. Alors il courait, ignorant l’appel de sa mère aux abois.
Arrivé en haut de la colline, à la lisière du bois donnant sur le vallon vers Saint-Yrieix, le brave gamin fut d’un coup pétrifié. Son cœur se mit à battre très fort. Son arrogance s’évapora illico. De l’autre côté, en haut du versant d’en face, arrivaient par les chemins débouchant des forêts, autant, sinon plus de cavaliers et de fantassins que ceux dont il avait déjà pu mesurer l’abondance. Visiblement ils n’étaient pas du même camp. Ils n’étaient pas habillés pareil. Ceux-là s’étaient couverts de blanc, certains de jaune et de noir. De ce que le chenapan pouvait entendre, parce que les fantassins étaient déjà très près, leur langage était encore plus étrange. Il regarda vers le bas, vers sa maison. Il était trop tard pour tenter de rentrer sans être vu par ces attaquants forcément mauvais. Le garnement se cacha dans la souche creuse d’un châtaignier et essaya de se couvrir de toutes les choses qu’il pouvait attraper autour de lui. Martin découvrait à l’instant les affres de la faiblesse.
Les envahisseurs passaient à présent bruyamment près du terrier où s’était enfoui le jeune Payot. Ces soldats marchaient vivement, de lourds chevaux tirant des canons faisaient trembler le sol de leurs gros sabots. Tous ces gens descendaient vers le ruisseau du moulin. Martin entendit, peu après ce terrifiant défilé, les premiers cris de charge, les cliquetis des épées et les cris des hommes qui donnaient l’assaut. Il saisit bien également les hurlements désespérés de ceux qui tombaient, blessés ou pire. Puis les armes à feu firent crépiter leurs éclatements en rafales. Il se boucha les oreilles quand tonna la couleuvrine. C’était donc ça, la guerre : les clameurs, la fumée, l’odeur de poudre, les hurlements des mourants, les cris épouvantables des hommes qui perdent une partie d’eux-mêmes : la fin du monde. Des milliers d’hommes s’entre-tuaient sur les flancs de la colline de Beauplat là où, hier encore, il cueillait, des rosés des prés. Martin Payot était terrorisé et n’osait plus bouger dans l’antre qui ne le protégeait qu’à moitié. Ses frêles petits bras tremblaient, il pleurait de frayeur, il claquait des dents. Il voulait sa maman, là, tout de suite et son sein chaud qui efface tous les problèmes. Sa mère s’était tue. On ne l’entendait plus appeler son fils au milieu du fracas.
Cette triste histoire avait débuté le 31 octobre 1517, en Saxe. Un homme nommé Martin Luther avait placardé sur la porte de l’église de Wittenberg, 95 thèses en profond désaccord avec la liturgie du pape et plus particulièrement avec « le commerce des indulgences ».
Le « commerce des indulgences » : ce précepte de l’Église catholique disait qu’un péché pouvait s’absoudre en confession, par des dons, de l’argent, ou simplement une reconnaissance de tort et une promesse de pénitence. Les capitaines ou les soudards français, suisses ou encore génois, de retour des guerres d’Italie en profitèrent largement, tant ils avaient sans doute à se faire pardonner pour espérer le paradis, au pis le purgatoire. Ces gens avaient des ressources, des fortunes volées çà et là. Leur argent, même un peu sale, était trébuchant. Le paiement de leurs « indulgences » arrangeait tous les partis : les coupables et ceux qui donnaient l’absolution. Les uns se sentaient délivrés de leur fardeau à bon compte, les autres devenaient plus riches, donc plus puissants.
Pour le frère augustin Martin Luther qui ressentait autrement les textes saints, Dieu seul pouvait décider de qui entre au paradis ou en enfer. Il ne pouvait appartenir à un prélat d’en décider à la place du créateur moyennant quelque richesse : si on avait été auteur d’un dommage, il fallait être responsable de ses fautes et désirer les réparer. L’aveu, le dédommagement financier ne suffisaient pas pour obtenir la grâce de Dieu. On devait, aux yeux du nouvel objecteur, revenir sur ce que la religion catholique avait admis depuis le IIIe siècle et gravé dans le marbre au XIIe. Il fallait repenser le « commerce des indulgences » qui devenait problématique depuis que des papes comme Jules II ou Léon X en avaient généralisé la pratique pour financer les travaux de la Basilique Saint-Pierre à Rome. Pour Martin Luther, Dieu n’était pas à vendre.
Les convertis de Luther réclamaient l’altérité et revendiquaient sept grandes différences :
•d’abord en ce qui concernait l’autorité du pape : aucune institution ne pouvait se prévaloir d’un « pouvoir plénier, suprême, immédiat et universel » comme le stipulaient les catholiques. Pour les réformés, « tout baptisé était prophète, prêtre et roi », la hiérarchie entre les croyants n’existaitpas ;
•aussi, l’intermédiaire du confesseur semblait inutile : la reconnaissance de ses fautes devait se faire directement avec Dieu ;
•encore, l’eucharistie était un symbole : personne ne pouvait croire que le pain que l’on recevait lors des offices était le corps du Christ ;
•quant au baptême : il devait être un acte volontaire, un enfant ne pouvait donc le recevoir ;
•il semblait également à ces nouveaux interprètes des écrits saints qu’il était impossible que Marie soit restée vierge, ils la priaient donc avec plus de distance et seulement parce qu’elle était la mère de Jésus de Nazareth ;
•les saints ? Pour les nouveaux croyants, les évoquer relevait de l’idolâtrie ;
•enfin, le purgatoire était une interprétation bien trop tirée par les cheveux par des évêques séniles. Pour les adeptes de la réforme, il était certain que dès la mort, le jugement de Dieu tombait inexorablement.
Au départ, les catholiques et le pape lui-même acceptèrent la controverse. Par la bulle « Exsurge Domine » du 15 juin 1520, le Pape Léon X entra en négociation avec Luther, il lui demanda de corriger 41 « erreurs » dans ses 95 thèses, mais ne les rejeta pas toutes enbloc.
Martin Luther brûla publiquement la bulle du Pape et entra en conflit ouvert avec l’Église catholique. Le séditieux fut excommunié au début de1521.
Le souverain de France, François 1er ne prit pas offense de ces nouvelles orientations religieuses, il protégea même les gens qui optaient pour cette autre façon de pratiquer la foi. Marguerite de Navarre, sa sœur avait déjà embrassé les thèses de la Réforme et dans le pays, des groupes de prélats discutaient calmement de la relecture des évangiles.
C’est sans doute à ce moment de l’histoire que les diplomates brillèrent par leur absence.
Les radicaux du nouveau culte devinrent plus prosélytes. Ils allèrent jusqu’à détruire des objets ostentatoires du culte romain dans des églises traditionnelles. Ils voulaient amener un peu de l’ascétisme de la vie du Christ dans des lieux de prière qu’ils estimaient galvaudés. Pire, le 17 octobre 1534 des enragés placardèrent, à Paris et dans plusieurs villes du royaume, des écrits qui bafouaient l’autorité « de droit divin » duroi.
C’en était trop pour François 1er, qui prit, cette fois, fait et cause pour l’Église catholique et se lança dans une entreprise de purge violente contre les adeptes de la Réforme de Martin Luther.
En réponse à la répression, lesdits réformés, dans l’ombre, se remirent au travail et redoublèrent d’opiniâtreté. Les assertions de Luther gagnèrent du terrain partout dans la chrétienté et plus particulièrement dans le royaume de France. Un enfant du pays, Jean Calvin, un adepte influent des thèses neuves, partit se réfugier en Suisse. De là, il entreprit de former et renvoyer à ses compatriotes, des cohortes de nouveaux prêcheurs pour convertir les gens à la nouvelle façon d’adorer Dieu et Jésus Christ.
Les royaumes chrétiens, bousculés par cette révolution, durent se pencher davantage sur la nature de leur foi. La guerre ridicule de la France contre l’empire de Charles Quint s’essoufflait. Les deux camps adoptaient le constat clair qu’il ne pouvait y avoir de vainqueur indiscutable et qu’il valait mieux, tout simplement, cesser les hostilités. L’empereur des Romains germaniques, le « Ch’Arlequin » comme on le moquait, le vieil adversaire du monarque français fut amené à signer un traité de paix à Crépy-en-Laonnois avec son ennemi de toujours.
En 1545, François 1er n’eut donc plus vraiment besoin du soutien des soldats protestants fidèles à Luther, des réfractaires du Vaudois, du Lubéron et d’autres régions du Sud. Des gens qui vivaient encore sous l’emprise de l’esprit « cathare ». Alors, le roi fit promulguer l’édit de « Mérindol », un texte qui condamnait les protestants luthériens et autres « sectateurs » et récompensait leurs délateurs. Des barons de Provence et d’Occitanie se chargèrent de la basse besogne : vingt-trois villages acquis aux réformés furent détruits. Trois cents personnes, dont beaucoup de femmes et d’enfants furent persécutés, violés et même assassinés. Plus de six cents hommes furent envoyés aux galères. Le fait fut justifié par le roi sur le compte simple de la gestion de l’ordre dans le royaume, mais n’apparut pas dans les pays comme lié aux problèmes de l’existence de la nouvelle religion ni à un acte de guerre.
Il n’y eut pas de réaction chez les réformés dans les régions plus au Nord. Même si les fidèles de Martin Luther semblaient être à présent assez nombreux et influents en France pour lier des alliances avec l’étranger et montrer leur puissance. Les princes allemands et suisses soutenaient la Réforme. L’Angleterre également était prête à donner des moyens. Les protestants ne pouvaient pas encore répondre en force aux exactions du roi François, mais ils y travaillaient, avec l’espoir qu’un jour ils pourraient se défendre militairement, à armes égales contre les tenants de l’Église catholique traditionnelle.
Quelques saisons s’égrainèrent sans trop de troubles et le royaume de France se portait plutôt bien. Bernard Palissy, un maître potier, venait de mettre au point « l’émail blanc » jusqu’à présent l’apanage des lointains Orientaux. Les châteaux devenaient de grandes demeures confortables, et l’artisanat profitait des nouvelles façons d’œuvrer avec des outils plus performants et de nouveaux matériaux. Les temps à venir devaient s’annoncer radieux en France.
Mais, le roi de ce grand pays souffrait depuis quelque temps d’un mal qui commençait à menacer sérieusement son maintien au pouvoir et donc la défense assurée de l’Église catholique romaine. Déjà, à Crépy-en-Laonnois, pour signer la paix, il y avait trois ans à présent, François avait dû voyager allongé sur une litière. Heureusement, Charles Quint ne semblait guère de santé plus brillante : une goutte terrible empêchait le Habsbourg de marcher, il était étendu lui aussi. La guerre des vaillants s’achevait en paix de grabataires. De retour à Rambouillet, heureux de conclure son règne sur un traité de paix, François dut quand même s’aliter. De plus en plus fatigué et souffrant, il ne se releva plus. Enfin, il dut se résoudre à sa fin prochaine.
Les deux camps religieux vinrent se toiser autour du lit de l’agonisant. La cour comptait des adeptes dans les deux obédiences.
Le roi prit cependant son temps pour cesser de vivre. Il tenait à conseiller longuement son héritier : Henri le deuxième, en pleine force de l’âge,lui.
Fin mars 1547, les médecins dirent : « Le roi de France a une veine rompue et pourrie dessous les parties basses. Nous désespérons de sa longue vie. La veine est celle de laquelle dépend la vie de l’homme et que, si elle se rompt, elle le suffoquera. »
Le 31 mars, entre une heure et deux, la grande personne de François 1er roi de France mourut, emportée dans la puanteur par une infection généralisée suite à d’immondes abcès à l’anus.
Son fils Henri, une fois intronisé, mit d’abord un ordre certain au palais. Il avait été bien éclairé par son illustre père. Il amena un peu de rigueur, tant dans le train de vie de la cour, que la levée des impôts ou de la menée des guerres. Son engagement contre les protestants fut encore plus violent que celui de son géniteur. Les réformés, dont le nombre ne cessait de croître, furent dès lors considérés comme des apostats. Le 2 juin 1559, le nouveau roi promulgua l’édit d’« Ecouen » qui faisait des protestants, des hérétiques. Ceux-ci avaient le choix : la fuite ou la mort. On remit à la mode le credo des « inquisiteurs » médiévaux. On confia à des prélats endurcis le soin d’exécuter les sentences, à des gens comme Mathieu Ory, un pur et dur de l’Église romaine. Henri II s’entoura également des frères « de Guise », François, comte de Lorraine et Charles, archevêque de Reims, tous deux prêts à mourir crucifiés pour le pape. Il s’associa aussi à des personnes de confiance comme l’amiral de Coligny, honnête jusqu’au bout des ongles.
Henri II, après seulement quelques mois de règne, tenait fermement les rênes du pays et seuls les problèmes liés à la nouvelle liturgie lui donnaient encore du fil à retordre. On désigna les nouveaux croyants par le terme de « huguenots », en référence, pour certains, aux fidèles d’un certain « Hugues de Besançon », prêcheur plus calviniste que Calvin lui-même. D’autres disaient que le nom venait de l’allemand « eidgenosse » : « lié par serment ». En tout cas, le mot « huguenot » était à présent connu de tous les sujets du roi de France.
Le roi semblait fort, mais il était, comme tout un chacun, à la merci du sort. Au plein été 1559, au crépuscule d’une journée torride, un tournoi marquant des festivités pour la fin des guerres d’Italie arrivait à son terme. Les spectateurs commençaient à se retirer. C’est alors qu’Henri, étonnamment, se disposa à entrer à son tour en lice. Malgré quarante ans d’âge, il tenait à prouver ce soir, sa vigueur, à sa chère maîtresse Diane de Poitiers dont il portait les couleurs.
Catherine de Médicis, son épouse légitime, plus ou moins imposée à Henri par le Pape lui-même, eut de mauvais pressentiments. Même bafouée une nouvelle fois devant la favorite d’Henri, elle fit demander à son mari de ne pas jouter. Aussi curieusement que cela puisse paraître, elle l’aimait et craignait pour la personne royale de son époux. Peine perdue.
Après une première passe réussie, le brillant monarque fit dire à la reine qu’il s’accordait une dernière lance. Il salua avec insistance Diane de Poitiers, son amoureuse, et repassa devant la reine le regard hautain. Son adversaire était un jeune homme, le comte Gabriel de Montgomery. Le puceau n’en menait pas large, c’est sans doute pour cela qu’il se concentra davantage. Au second choc, Henri II tomba à terre. Sa visière ne l’avait pas protégé comme il fallait. Un morceau de la lance du jouvenceau s’était fiché dans l’œil gauche du roi. Henri II gisait à présent au sol, agité de soubresauts sous les yeux horrifiés de son épouse Catherine. La reine demanda à Diane de Poitiers de quitter la lice sur le champ et de ne plus jamais reparaître à la cour. Les meilleurs chirurgiens furent requis pour soigner le souverain. Parmi eux l’illustre Ambroise Paré et le chirurgien attitré du roi d’Espagne, André Vésale. Mais rien n’y fit. On s’acharna encore jusqu’à la nuit avec tous les moyens possibles pour soigner Henri. Le mal était trop profond. Quelque temps après la fièvre gagna et l’état du souverain se dégrada. Onze jours après l’accident, le roi mourut.
Avec Henri II, la France était restée la fille aînée de l’église de Rome, au moins dans les conversations à la cour, car partout ailleurs on sentait bien que le pays était au bord de la guerre civile. Le clan des Guise, très proche du pouvoir, imposait des mesures des plus autoritaires contre le protestantisme. Les martyrs furent nombreux ; celui de Monsieur Anne du Bourg marqua les esprits. Cette exécution impressionna et choqua tout particulièrement Coligny qui appréciait l’esprit rare de la victime qu’il connaissait bien. On pendit le malheureux puis on le brûla. Or, ce monsieur n’avait rien d’un hérétique, bien au contraire. Coligny, dont l’esprit rigoureux le rapprochait de plus en plus de la nouvelle religion, franchit le pas. Il se fit « réformé », protestant, huguenot, calviniste. Avec cette conversion irrévocable, le camp royal et catholique perdait un sérieux atout.
François II, fils aîné d’Henri II et de Catherine de Médicis, monta donc sur le trône. Il avait quinze ans. Il resta monarque à peine plus d’une année. De santé fragile, il mourut juste avant ses dix-sept ans, d’un « abcès derrière l’oreille », sans avoir apparemment consommé son mariage avec Marie Stuart. Peu avant le drame, on avait envoyé un Limousin, le marquis de Saint Germain Beaupré sur l’île anglaise, pour marier la belle symboliquement à la place du souffreteux roitelet. La stabilité du royaume de France semblait bien mal affirmée, mais malgré la brièveté de son règne, le jeune roi, sous la houlette des Guise, eut assez de temps pour accentuer, à son tour, la répression envers les protestants. La France était à présent déchirée et bien diminuée : en face des Guise, catholiques fervents, se dressaient deux princes de sang : Condé et Navarre. Les deux descendants des grandes lignées des rois de France avaient dérivé dans leur croyance, ils s’étaient laissé convaincre comme Coligny et soutenaient de plus en plus ouvertement les protestants. Les deux camps ne souhaitaient plus qu’une chose : en venir aux mains.
À la mort trop vite venue de François II, ce fut Charles IX, son jeune frère qui accéda au pouvoir. Il avait dix ans seulement. C’est donc sa mère Catherine de Médicis qui prit les rênes du pays. Elle s’employa de toutes ses forces à apaiser les tensions entre les deux factions religieuses. Mais à chaque fois qu’on semblait s’orienter vers un accord, l’un ou l’autre camp demandait réflexion pour jeter à nouveau un peu plus d’huile sur le feu lors du retour à la table des négociations. Se profilait, de plus en plus inexorablement, le spectre d’un embrasement général. En 1562 l’édit de « Saint-Germain-en-Laye » permit aux protestants de se livrer à leur culte dans les campagnes et les faubourgs des villes. En mars 1562, à peine trois mois passés, une assemblée protestante se tint à Wassy, à l’intérieur d’une ville du fief du duc de Guise. Ce dernier s’y rendit pour rappeler la loi du roi qui interdisait une telle manifestation. Il reçut un accueil pour le moins chahuté. Furieux, il quitta sa ville et rameuta ses troupes d’assaut. Le bilan de la bataille fut lourd. On releva cinquante morts chez les protestants, dont des femmes et des enfants et cent cinquante blessés dans les deux confessions.
La guerre pour imposer une croyance n’avait rien à voir avec la guerre autour de la dispute d’un territoire. Les raisons de la haine se montraient beaucoup plus profondes. On touchait à l’absolu. On pouvait donc aller jusqu’à l’extrême dans l’horreur. La raison disparaissait, on tuait par conviction. On éliminait celui qui semblait inepte au culte qu’on avait choisi d’adopter, on tuait l’autre avec l’impression de nettoyer le ciel et de mériter davantage de Dieu ! La querelle pouvait se tenir sur un grand champ de bataille ou simplement sur la place de l’église entre voisins de village.
Les catholiques romains défendaient bec et ongles leurs traditions, sûrs de leurs forces armées, mais les réformés avaient à présent suffisamment d’alliés et de moyens pour entretenir des troupes capables de riposter. Ainsi commença, en France, en cette fin de XVIe siècle, la difficile période de l’histoire des huit guerres de religion. Le pays, déjà très irréconciliable, devint une lice épouvantable où s’étripèrent les Français entre eux, des croyants épris d’un dieu d’amour ou dittel.
La Première Guerre s’étendit à tout le royaume. Elle fut marquée par des violences barbares dans un camp comme dans l’autre. Les crimes les plus notables furent à mettre à l’actif du baron des Adrets en Dauphiné et en Provence, pour les protestants. Les catholiques de Blaise de Montluc ne furent pas en reste et mirent la Guyenne à feu et à sang. Fin 1562, la bataille de Dreux, qui vit s’affronter les troupes de Condé et celles du connétable de Montmorency, se termina à l’avantage des forces royales et catholiques. Quelques semaines après, le duc François de Guise profita de sa supériorité et posa alors le siège devant Orléans, ville tenue par les protestants. C’est là qu’il trouva la mort. Un certain Poltrot de Méré lui tira un coup de pistolet dans ledos.
Après de réels faits de guerre et de nombreux massacres, une paix fut quand même négociée entre le prince protestant Louis de Condé et le serviteur du roi, le connétable Anne de Montmorency le 19 mars1563.
La trêve ne dura pas longtemps. Les chefs huguenots se décidèrent à reprendre les armes dès l’automne 1567. Ils avaient une forte inquiétude devant l’influence grandissante du cardinal de Lorraine, Charles de Guise, le frère de l’assassiné d’Orléans, sur le jeune roi Charles IX. Les protestants entamèrent donc préventivement la deuxième guerre de religion. Plusieurs villes du Midi furent prises par les huguenots. À la Saint-Michel, le 30 septembre 1567, ce fut la « Michelade » : un massacre des notables catholiques de la ville de Nîmes mené par des réformés de la région. À Paris, assiégée par l’armée réformée, les soldats du roi, en revanche, trucidèrent tout ce qui semblait protestant. L’armée de Condé s’empara de Saint-Denis le 10 novembre 1567, mais la bataille se termina à l’avantage des royaux et des suppôts du pape dans une boucherie épouvantable. Le connétable de Montmorency, le grand catholique y fut mortellement blessé, lui aussi par un coup de feu dans le dos, tiré par Robert Stuart. Le sort semblait s’acharner sur le camp de la tradition romaine. À l’issue de longues négociations, une paix fut signée le 23 mars 1568, parl’édit de « Longjumeau »qui confirmait l’édit d’« Amboise », un autre édit tout aussi inutile par ces temps où tout le monde ne souhaitait que détruire « l’autre », l’hérésiarque : le « mal croyant ».
Tous ces grands capitaines, prêts à mourir pour une liturgie, appartenaient pourtant à une même famille de sang : le protégé du roi, Anne de Montmorency, était l’oncle de Coligny, mais allié des Guise, chef des extrémistes catholiques. L’amiral, le neveu ennemi, lui, s’acoquina avec les princes de sang : Louis de Condé, descendant de Saint Louis, et un autre héritier des Bourbons : Henri de Navarre. Ensemble, ils étaient les premiers chefs protestants. La religion divisait dans les familles les plus modestes comme dans les plus grandes.
La paix de Longjumeau dura 5 mois. Les Guise avaient repris place à la cour et Marie de Médicis n’avait plus confiance en la parole des protestants. Une troisième guerre ne faisait plus de doute. Les étrangers des deux obédiences nouèrent des alliances avec les dignitaires de la religion qu’ils souhaitaient voir pratiquée en France : Philippe II d’Espagne, le pape Pie V et le duc de Toscane confortèrent les catholiques. Le prince d’Orange et le duc de Bavière, Wolfgang des Deux Ponts, financés par la cour d’Angleterre, soutinrent les protestants. Les reîtres allemands, ces mercenaires à cheval armés de pistolets furent engagés par les deux camps au plus offrant sur l’instant. Les lansquenets, ces brutes teutonnes qui s’engageaient de la même façon, furent aussi mis à contribution des deux côtés. Alors, lorsque l’armée des Italiens qui volait au secours des catholiques entra dans la vallée du Rhône, Louis de Condé et Gaspard de Coligny qui se tenaient sur les terres catholiques de Bourgogne se trouvèrent d’un coup bien menacés. Ils firent accélérer le pas de leurs soldats vers des pays plus amicaux. Ils foncèrent vers le Sud-Ouest, vers la côte atlantique. Là-bas on était sûr du soutien du pays. C’est à La Rochelle, ville réformée, que Jeanne d’Albret et son fils Henri de Navarre rejoignirent le gros des troupes protestantes, après avoir fait l’effort de quitter leurs Pyrénées chéries. C’est là, également que le camp huguenot rassemblé attendit les renforts allemands du duc des Deux-Ponts qui avaient dû traverser le Rhône juste après les Italiens papistes. Les groupes armés des différentes factions se reniflaient à travers la France, n’osant poser un champ de bataille clair. Il y avait bien des escarmouches un peu partout dans le royaume, mais pas de bataille décisive qui engageait vraiment un avenir de vainqueur ou de vaincu définitif.
À Jarnac en mars 1569, lors d’une échauffourée avec une avant-garde de chevaux légers du duc de Guise, Louis de Condé, pourtant dans la force de l’âge, tomba de cheval. La jambe cassée, il demanda grâce et voulut se rendre. On l’assassina directement par un coup de pistolet dans la nuque, tiré par le courageux Joseph François de Montesquiou. Une nouvelle règle venait d’être établie entre les belligérants au service de Dieu : on ne faisait plus de prisonniers. On abattait les vaincus d’un coup de pistolet dans le dos, immédiatement, avant de parlementer. Le combat au nom de Dieu avait fait disparaître les politesses de la vieille chevalerie et les règles du combat à la loyale.
Après ce décès inattendu, Jeanne d’Albret promut alors son fils, Henri de Navarre et son neveu Henri de Condé, chefs des armées. La manœuvre était maligne, car le roi de France se retrouvait de ce fait, face à deux princes de sang. Il lui devenait difficile, dès lors, de s’attaquer à sa propre maison, à ceux qui pouvaient prétendre un jour à sa succession.
Les deux héritiers avaient seize et dix-sept ans, ils n’étaient pas aguerris. C’est Coligny, le représentant affermi des calvinistes qui mena les affaires et qui prit la décision de descendre au plus vite vers le Quercy pour une jonction sans dommage avec ses alliés des pays réformés. Il comptait y attendre les Allemands dans la campagne calme des environs du Limousin.
Wolfgang de Bavière, duc des Deux-Ponts, après avoir ruiné Measne, le Grand-Bourg et Bénévent avait bifurqué vers le Sud de Limoges. Il n’avait pas affronté les reîtres catholiques du duc d’Anjou à la Souterraine, il savait que ses propres soudards venaient du même pays que ceux du camp d’en face et qu’ils n’étaient pas encore sous contrat, alors il valait mieux éviter de possibles fraternisations. L’affrontement aurait pu être des plus désolant. Il fonça vers le lieu de rendez-vous avec les huguenots français et occupa La Jonchère un instant, puis il coupa la Vienne à Saint-Priest-Taurion, le 9 juin 1569. Il devait joindre Coligny à Châlus pour lui porter main forte. Les abbayes du coin, Solignac notamment, furent largement pillées sans vergogne au passage de la troupe des mercenaires teutons en besoin de ravitaillement.
Une partie de l’armée royale et catholique avait fait l’effort de couper le probable passage des Allemands vers Saint-Léonard. Le reste de la troupe papiste était remontée vers Bellac pour couper la route de la Saintonge au cas où. En glissant entre les deux veilles de guet, les mercenaires allemands au service des réformés joignirent leurs alliés sans encombre à Nexon. L’armée catholique du duc Henri d’Anjou, du roi Charles IX et de leur mère Catherine de Médicis était flouée, bernée. Wolfgang de Bavière, duc des Deux Ponts rencontra l’amiral de Coligny à une petite lieue des Cars, juste après la ville de Limoges évitée précautionneusement. Il y eut, ce soir-là, une beuverie générale pour fêter cette petite victoire. La méprise des catholiques y fut grandement moquée. Coligny fit percer beaucoup de barriques qu’on traînait depuis La Rochelle et d’autres, prises dans les abbayes saccagées.
Il y avait ce soir, grande ripaille à Nexon et on chantait le Tourdion :
Quand je bois du vin clairet
Ami tout tourne, tourne, tourne, tourne
Aussi désormais jebois
Anjou ou Arbois
Chantons et buvons, à ce flacon faisons la guerre
Chantons et buvons, amis, buvons donc !
Wolfgang de Bavière, duc des Deux Ponts après avoir trop chanté et surtout trop bu, se mit à suffoquer. Il se plaignit de douleurs dans la poitrine et tomba d’un coup raide mort dans les bras du prince de Nassau. L’événement amena la stupeur dans la troupe des reîtres. Pourtant on ne pouvait que constater les faits, les mercenaires huguenots d’outre-Rhin n’avaient plus dechef.
La faucheuse n’avait pas béni de camp. Elle sabrait à la tête, des deux côtés. Ce soir, à la cantine chez les protestants, on pouvait déplorer la chute de deux commandants : la mort de Louis de Condé à Jarnac il y avait peu, et celle de Wolfgang des Deux Ponts à Nexon, à l’instant. Ces décès furent l’occasion pour les divers gens de l’armée protestante de se rapprocher un peu de compatir ensemble.
On enterra les entrailles du duc des Deux-Ponts à Nexon. On embauma le corps et on fit porter la dépouille de l’Allemand à Angoulême, en attendant des jours meilleurs pour des obsèques régulières en pays saxon.
Coligny devait composer maintenant avec Wolrad de Mansfeld, le successeur du duc des Deux-Ponts à la tête des alliés allemands. L’amiral présenta au nouveau commandant des mercenaires les deux chefs de la confédération, les deux Henri, les deux princes trop jeunes : Condé et Navarre. Les reîtres de l’armée protestante d’outre-Rhin leur prêtèrent allégeance dans les règles, sansplus.
Les paysans limousins ne s’opposèrent pas aux occupants qui ne se montraient pas malveillants. Le camp protestant, remanié à neuf s’installa donc sans anicroche dans le Sud de la vicomté de Limoges.
Le camp des catholiques avait manœuvré à mauvais escient. Il s’était un peu embourbé autour de Couzeix. Les hommes de cette troupe, fatigués, essayaient à présent de reprendre un peu de force après leurs courses inutiles pour arrêter les soutiens des protestants. Les mercenaires allemands des catholiques réalisaient qu’ils avaient mal choisi leur parti et regrettaient sans doute leur choix. Maintenant, ces gens attendaient d’être payés avant de marcher contre des volontaires de leur propre pays en tout point leurs semblables.
Le comte des Cars, François de Peyrusse, gouverneur du Limousin, ne fit pas grand-chose, lui non plus, pour gêner l’installation de Coligny autour de la cité de Saint-Yrieix. Il fuit même la région pour emmener sa famille à l’abri d’une guerre probable, à une bonne dizaine de lieues du conflit, à Gimel. Le personnage était fourbe, versatile et peu digne de confiance, il combattait aux côtés du duc Henri d’Anjou, mais le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne faisait pas de zèle face aux « parpaillots ». Il connaissait Jeanne d’Albret, la protestante, et l’appréciait. Bien sûr, les consuls de Limoges avaient franchement opté pour le roi, mais pour le reste, dans la région, les soutiens aux catholiques étaient beaucoup moinssûrs.
Coligny et ses alliés arrivèrent sous les portes de Saint-Yrieix, le 8 juin 1569. C’était une belle cité bien à l’abri dans ses murs. Même si les faubourgs avaient été pris d’emblée, il apparut aux conquérants qu’il faudrait un long siège pour faire tomber la ville. Après des pourparlers vains, le feu fut mis aux portes. Un groupe d’assaillants réussit alors à passer les murailles avec la complicité de quelques habitants encerclés favorables à la Réforme. Grâce à cette trahison, le siège, finalement, s’avéra inutile. Suffisamment d’hommes convaincants purent entrer dans la cité pour affirmer la prise en main de la ville. Saint-Yrieix déposa les armes. Alors, les bandes mercenaires se payèrent des efforts endurés dans l’après-midi pour faire ouvrir les embrasures de l’endroit. Ils pillèrent et saccagèrent scrupuleusement les maisons des Arédiens fidèles à l’Église romaine. Parmi les habitants, des adeptes calvinistes les dénonçaient sans remords. Les soudards de Coligny traînèrent les malheureux catholiques de la ville vers le puits de la place du Foirail et y jetèrent leurs prisonniers cueillis à l’instant : hommes, femmes et enfants. Le 14 juin la principale cité au Sud de Limoges était aux mains des protestants et de leurs alliés, à quelques lieues du quartier général des catholiques du roi et de son armée.
Les princes huguenots arrivèrent en Saint-Yrieix le 18 juin, après la prise de la ville. Henri de Navarre fut logé dans une maison en face du portail Sud du grand moutier. C’était une belle demeure. On aménagea la chambre princière à l’arrière de la résidence, au premier étage, une fenêtre donnait sur des jardins. Les autres jeunes précieux, Condé et d’Aubigné furent hébergés également dans de grandes maisons saisies aux bourgeois de la ville. Même si l’entente avec les mercenaires allemands n’était pas toujours des meilleures, l’armée des deux princes réformés était bien établie dans la place et pouvait reprendre quelques forces en attendant de pied ferme la grande bataille contre des catholiques qui n’avaient même pas pu déloger une arrière-garde huguenote à Aix. On se reniflait encore et les escarmouches alentour faisaient quelques victimes.
Du côté de l’armée royale et de l’église romaine traditionnelle du jeune duc Henri d’Anjou, frère du roi, un autre gamin de dix-huit ans, l’allant était moins certain. La troupe traînait la patte, bien des soldats étaient malades, trop mal nourris. Le duc d’Aumale menaçait de se retirer avec ses régiments. Henri d’Anjou et sa reine mère Catherine de Médicis n’avaient pas pris les bonnes décisions. Ils avaient laissé passer les renforts allemands pour Coligny, par contre, l’appui des Italiens envoyés par le Pape se faisait attendre.
Les soutiens catholiques dépêchés depuis Rome avaient suivi des chemins difficiles. Après avoir traversé non sans mal les montagnes du centre de la France, la pluie les avait englués du côté de Bujaleuf. La reine mère était allée en personne s’assurer de la vaillance des arrivants, mais elle avait un peu déchanté devant ce qu’elle avait vu à Saint-Léonard. Les Italiens de Santa-Fiora étaient affamés, l’intendance de Philippe Strozzi, un cousin de Catherine de Médicis, avait du mal à suivre le train, avec des chariots inadaptés aux mauvais chemins du Limousin. Le comte de Santa-Fiora, après bien de la peine, était arrivé quand même à rassembler ses soldats dans les alentours de Pierre-Buffière, c’est là que les fidèles de la famille royale : la reine Catherine de Médicis, les ducs d’Anjou, d’Aumale, de Montpensier, de Guise, et Strozzi purent enfin les passer en revue. L’opération remit un peu de baume au cœur des nouveaux alliés autour des valeurs de l’église du Pape et du roi de France. Après des pourparlers houleux, les capitaines de l’armée royale finirent par convaincre tout ce qui restait de la troupe et surtout les reîtres allemands catholiques de marcher encore. Les commandants savaient que pour Dieu, on peut tout demander aux simples gens. Mais l’affaire ne fut pas chose facile, les mercenaires mouraient de faim. Dans ce tracas, Henri d’Anjou réussit quand même à prendre son cantonnement à la Roche-la-Belle le 23 juin. Catherine de Médicis fit route vers le Nord. Elle partit rejoindre son autre fils, le roi Charles IX qui avait pris cour en Orléans. Le jeune duc Henri d’Anjou se retrouva bien seul, et bien jeune, ce soir à la Roche-la-Belle. Il ordonna une prise de position sur le versant Sud du village dans un hameau nommé Beauplat. Il y installa son coucher, derrière une puissante artillerie posée là par des mercenaires Suisses.
Deux armées allaient se rencontrer dans ce petit village du Sud de la vicomté de Limoges, vingt-cinq mille protestants allaient affronter presque autant de catholiques. Des gens de tous pays allaient se battre ici : Français de toutes provinces, Italiens romains et toscans, Suisses, Allemands de Bade, de Palatinat et de Nassau, Wallons et Flamands sans doute mêlés d’Espagnols. Une bataille des nations entremêlées allait avoir lieu, là, dans ce pauvre coin du Limousin au non d’un même Dieu prié par tous indistinctement pour leur donner la victoire.
De son repaire de Saint-Yriex, Coligny fit parvenir au duc d’Anjou, une offre de paix inacceptable qui demandait entre autres « la liberté de foi ». Les courriers partirent dans la campagne sur des chevaux légers qu’on avait drapés de linges blancs. Le duc d’Anjou laissa passer les plénipotentiaires. Sa réponse fut sans surprise. Le frère du roi refusa l’offre bien entendu. En réalité cette expédition n’avait pas pour objectif de parlementer, elle avait simplement permis aux envoyés calvinistes de noter que les défenses des catholiques étaient négligées et que les chemins qui menaient à la Roche-la-Belle n’étaient pas impraticables, même si certains avaient été barricadés à l’aide de piques de châtaignier. Les éclaireurs huguenots connaissaient à présent les obstacles à une avancée militaire. Ils avaient aussi bien senti le manque de ravitaillement de la troupe catholique. Les protestants avaient la défaite de Jarnac à venger. Les mercenaires allemands, les reîtres et les lansquenets qui se battaient pour la Réforme devaient se dégourdir les jambes et la tête. Ils étaient chauds, payés et avaient assez bien mangé. Les envoyés-espions conseillèrent à Coligny d’attaquer tout de suite.
Le vingt-cinq juin au matin, Coligny quitta son cantonnement de Saint-Yrieix et fit marcher son avant-garde à travers les chemins de campagne, à couvert sous les bois, vers les collines de la Roche-la-Belle. Il allait y débusquer les catholiques du roi Charles IX commandés par son frère Henri d’Anjou. L’amiral avait bien l’intention de détruire la famille des Valois et toute la liturgie du pape qu’elle défendait.