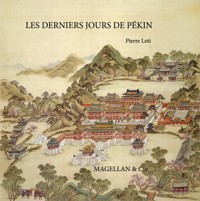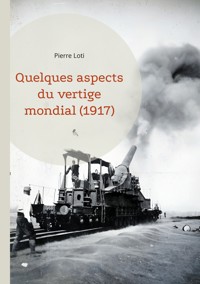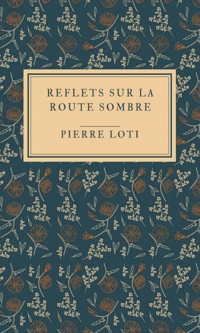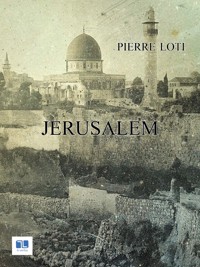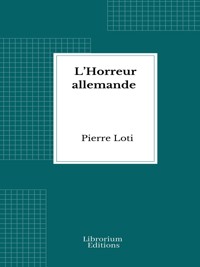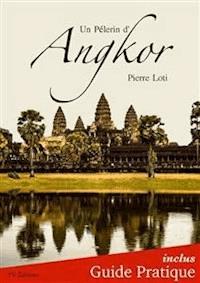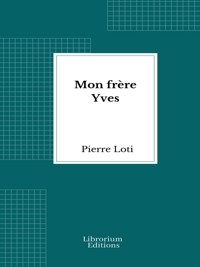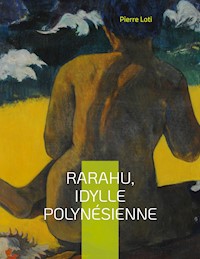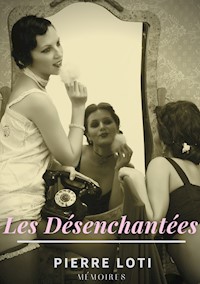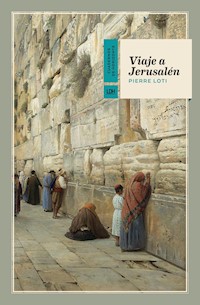Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"""La troisième jeunesse de madame Prune"" est un roman captivant de l'écrivain français Pierre Loti. Ce livre nous plonge dans l'univers fascinant et énigmatique de madame Prune, une femme d'âge mûr qui décide de vivre une nouvelle jeunesse.
Madame Prune, veuve depuis peu, se retrouve seule dans sa grande maison. Mais au lieu de se laisser abattre par la solitude et la tristesse, elle décide de prendre un nouveau départ. Elle se lance dans une aventure inattendue, à la recherche de sa propre identité et de sa place dans le monde.
Au fil des pages, nous suivons madame Prune dans ses rencontres surprenantes et ses voyages exotiques. Elle découvre des lieux enchanteurs, des cultures différentes et des personnages hauts en couleur. Elle se confronte à ses peurs, ses doutes et ses désirs les plus profonds.
Pierre Loti nous offre un récit empreint de poésie et de sensibilité. À travers le personnage de madame Prune, il explore les thèmes de la renaissance, de la quête de soi et de la liberté. Ce livre nous invite à réfléchir sur notre propre existence et à oser vivre pleinement, peu importe notre âge.
""La troisième jeunesse de madame Prune"" est un véritable hymne à la vie et à la résilience. Pierre Loti nous transporte dans un univers empreint de magie et de mystère, où les frontières entre le réel et l'imaginaire s'estompent. Ce roman est une ode à la beauté de l'âge et à la force de l'esprit humain.
Extrait : ""L'horreur d'une nuit d'hiver, par coup de vent et tourmente de neige ; au large, sans abri, sur la mer échevelée, en plein remuement noir. Une bataille, une révolte des eaux lourdes et froides contre le grand souffle mondial qui les fouaille en hurlant ; une déroute de montagnes liquides, soulevées, chassées et battues, qui fuient en pleine obscurité, s'entrechoquent, écument de rage."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À mes chers compagnons du Redoutable, en souvenir de leur bonne camaraderie pendant nos vingt-deux mois de campagne, je dédie ce livre, où j’ai voulu seulement noter quelques-unes des choses qui nous ont amusés, sans insister jamais sur nos fatigues et nos peines.
Ce n’est qu’un long badinage, écrit au jour le jour, il y a trois ans bientôt, alors que les Japonais n’avaient pas commencé d’arroser de leur sang les plaines de la Mandchourie. Aujourd’hui, malgré la brutalité de leur agression première, leur bravoure incontestablement mérite que l’on s’incline, et je veux saluer ici, d’un salut profond et grave, les héroïques petits soldats jaunes tombés devant Port-Arthur ou vers Moukden. Mais il ne me semble pas que le respect dû à tant de morts m’oblige d’altérer l’image qui m’est restée de leur pays.
P. LOTI.
Janvier 1903.
Samedi, 8 décembre 1900.
L’horreur d’une nuit d’hiver, par coup de vent et tourmente de neige, au large, sans abri, sur la mer échevelée, en plein remuement noir. Une bataille, une révolte des eaux lourdes et froides contre le grand souffle mondial qui les fouaille en hurlant ; une déroute de montagnes liquides, soulevées, chassées et battues, qui fuient en pleine obscurité, s’entrechoquent, écument de rage. Une aveugle furie des choses, – comme, avant les créations d’êtres, dans les ténèbres originelles ; – un chaos, qui se démène en une sorte d’ébullition glacée…
Et on est là, au milieu, ballotté dans la cohue de ces masses affreusement mouvantes et engloutissantes, rejeté de l’une à l’autre avec une violence à tout briser ; on est là, au milieu, sans recours possible, livré à tout, de minute en minute plongeant dans des gouffres, plus obscurs que la nuit, qui sont en mouvement eux aussi comme les montagnes, qui sont en fuite affolée, et qui chaque fois menacent de se refermer sur vous.
On s’est aventuré là-dedans, quelques centaines d’hommes ensemble, sur une machine de fer, un cuirassé monstre, qui paraissait si énorme et si fort que, par temps plus calme, on y avait presque l’illusion de la stabilité ; on s’y était même installé en confiance, avec des chambres, des salons, des meubles, oubliant que tout cela ne reposerait jamais que sur du fuyant et du perfide, prêt à vous happer et à vous engloutir… Mais, cette nuit, comme on éprouve bien l’instinctive inquiétude et le vertige d’être dans une maison qui ne tient pas, qui n’a pas de base… Rien nulle part, aux immenses entours, rien de sûr, rien de ferme où se réfugier ni se raccrocher ; tout est sans consistance, traître et mouvant… Et en dessous, oh ! en dessous, vous guettent les abîmes sans fond, où l’on se sent déjà plonger à moitié entre chaque crête de lame, et où la grande plongée définitive serait si effroyablement facile et rapide !…
Dans la partie habitée et fermée du navire, – où, bien entendu, les objets usuels, en lamentable désarroi, se jettent brutalement les uns sur les autres, avec des poussées et des repoussées stupides, – on était jusqu’à cette heure à peu près à couvert de la mouillure des lames, et le grand bruit du dehors, atténué par l’épaisseur des murailles de fer, ne bourdonnait que sourdement, avec une monotonie sinistre. Mais voici, au cœur même de ce pauvre asile, si entouré d’agitation et de fureur, un bruit soudain, très différent de la terrible symphonie ambiante, un bruit qui éclate comme un coup de canon et qui s’accompagne aussitôt d’un ruissellement de cataracte : un sabord vient d’être défoncé par la mer, et l’eau noire, l’eau froide, entre en torrent dans nos logis.
Pour nous, peu importe ; mais, tout à l’arrière du cuirassé, il y a notre pauvre amiral, cette nuit-là entre la vie et la mort. Après les longues fatigues endurées dans le golfe de Petchili, pendant le débarquement du corps expéditionnaire, on l’emmenait au Japon pour un peu de repos dans un climat plus doux ; et l’eau noire, l’eau froide envahit aussi la chambre où presque il agonise.
Vers une heure du matin, là-bas, là-bas apparaît un petit feu, qui est stable, dirait-on, qui ne danse pas la danse macabre comme toutes les choses ambiantes ; il est très loin encore ; à travers les rafales et la neige aveuglantes, on le distingue à peine, mais il suffit à témoigner que dans sa direction existe du solide, de la terre, du roc, un morceau de la charpente du monde. Et nous savons que c’est la pointe avancée de l’île japonaise de Kiu-Siu, où nous trouverons bientôt un refuge.
Avec la confiance absolue que l’on a maintenant en ces petites lueurs, inchangeables et presque éternelles comme les étoiles, que les hommes de nos jours entretiennent au bord de tous les rivages, nous nous dirigeons d’après ce phare, dans la tourmente où les yeux ne voient que lui ; sur ses indications seules, nous contournons des caps menaçants, qui sont là mais que rien ne révèle tant il fait noir, et des îlots, et des roches sournoises qui nous briseraient comme verre.
Presque subitement nous voici abrités de la fureur des lames, la paix s’impose sur les eaux, et, sans avoir rien vu, nous sommes entrés dans la grande baie de Nagasaki. Les choses aussitôt retrouvent leur immobilité, avec la notion de la verticale qu’elles avaient si complètement perdue ; on se tient debout, on marche droit sur des planches qui ne se dérobent plus ; la danse épuisante a pris fin, – on oublie ces abîmes obscurs, dont on avait si bien le sentiment tout à l’heure.
À l’aveuglette, le grand cuirassé avance toujours dans les ténèbres, dans le vent d’hiver qui siffle et dans les tourbillons de neige ; transis de froid et de mouillure, nous devons être à présent à mi-chemin de cet immense couloir de montagnes qui conduit à la ville de madame Chrysanthème.
En effet, d’autres feux par myriades commencent à scintiller, de droite et de gauche sur les deux rives, et c’est Nagasaki, étagée là en amphithéâtre, – Nagasaki singulièrement agrandie, à ce qu’il me semble, depuis quinze ans que je n’y étais venu.
Le bruit et la secousse de l’ancre qui tombe au fond, et la fuite de l’énorme chaîne de fer destinée à nous tenir : c’est fini, nous sommes arrivés ; dormons en paix jusqu’au matin.
Demain donc, au réveil, quand le jour sera levé, le Japon, après quinze années, va me réapparaître, là tout autour et tout près de moi. Mais j’ai beau le savoir de la façon la plus positive, je ne parviens pas à me le figurer, sous cette neige, dans ce froid et ces ténèbres de décembre, – mon arrivée de jadis, ici-même, ne m’ayant laissé que des souvenirs de voluptueux été, de chaude langueur : tout le temps des cigales éperdument bruissantes, une ombre exquise, une nuit verte criblée de rayons de soleil, d’admirables verdures partout suspendues et retombant des hauts rochers jusque sur la mer…
Dimanche, 9 décembre 1900.
Réveillé tard, après une telle nuit de grande secouée, j’ouvre mon sabord, pour saluer le Japon.
Et il est bien là, toujours le même, à première vue du moins, mais uniformément feutré de neige, sous un pâle soleil qui me déroute et que je ne lui connaissais point. Les arbres verts, qui couvrent encore les montagnes comme autrefois, cèdres, camélias et bambous, sont poudrés à blanc, et les toits des maisonnettes de faubourg, qui grimpent vers les sommets, ressemblent dans le lointain à des myriades de petites tables blanches.
Aucune mélancolie de souvenir, à revoir tout cela, qui reste joli pourtant sous le suaire hivernal ; aucune émotion : les pays où l’on n’a ni aimé ni souffert ne vous laissent rien. Mais c’est étrange, au seul aspect de cette baie, quantité de choses et de personnages oubliés se représentent à mon esprit : certains coins de la ville, certaines demeures, et des figures de Nippons et de Nipponnes, des expressions d’yeux ou de sourire. En même temps, des mots de cette langue, qui semblait à jamais sortie de ma mémoire, me reviennent à la file ; je crois vraiment qu’une fois descendu à terre je saurai encore parler japonais.
Au soleil de deux heures, la neige est partout fondue. Et on voit mieux alors toutes les transformations qui se dissimulaient ce matin sous la couche blanche.
Çà et là des tuyaux d’usine ont coquettement poussé, et noircissent de leur souffle les entours. Là-bas, là-bas, au fond de la baie, le vieux Nagasaki des temples et des sépultures semble bien être resté immuable, – ainsi que ce faubourg de Dioudjendji que j’habitais, à mi-montagne ; – mais, dans la concession européenne, et partout sur les quais nouveaux, que de bâtisses modernes, en style de n’importe où ! Que d’ateliers fumants, de magasins et de cabarets !
Et puis, où sont donc ces belles grandes jonques, à membrure d’oiseau, qui avaient la grâce des cygnes ? La baie de Nagasaki jadis en était peuplée ; majestueuses, avec leur poupe de trirème, souples, légères, on les voyait aller et venir par tous les vents ; des petits athlètes jaunes, nus comme des antiques, manœuvraient lestement leurs voiles à mille plis, et elles glissaient en silence parmi les verdures des rives. Il en reste bien encore quelques-unes, mais caduques, déjetées, et que l’on dirait perdues aujourd’hui dans la foule des affreux batelets en fer, remorqueurs, chalands, vedettes, pareils à ceux du Havre ou de Portsmouth. Et voici de lourds cuirassés, des « destroyers » difformes, qui sont peints en ce gris sale, cher aux escadres modernes, et sur lesquels flotte le pavillon japonais, blanc orné d’un soleil rouge.
Le long de la mer, quel massacre ! Ce manteau de verdure, qui jadis descendait jusque dans l’eau, qui recouvrait les roches même les plus abruptes, et donnait à cette baie profonde un charme d’éden, les hommes l’ont tout déchiqueté par le bas ; leur travail de malfaisantes fourmis se révèle partout sur les bords ; ils ont entaillé, coupé, gratté, pour établir une sorte de chemin de ronde, que bordent aujourd’hui des usines et de noirs dépôts de charbon.
Et très loin, très haut sur la montagne, qu’est-ce donc qui persiste de blanc, après que la neige est fondue ? Ah ! des lettres, – japonaises, il est vrai, – des lettres blanches, longues de dix mètres pour le moins, formant des mots qui se lisent d’une lieue : un système d’affichage américain ; une réclame pour des produits alimentaires !
Mardi, 11 décembre.
Un soleil d’arrière-automne, chaud sans excès, lumineux comme avec nostalgie, tel, à cette saison, le soleil au midi de l’Espagne ; un soleil idéal, s’attardant à dorer les vieilles pagodes, à mûrir les oranges et les mandarines des jardinets mignards…
De peur d’être trop déçu, j’ai préféré attendre ce beau temps-là, pour quitter mon navire et faire ma première visite au Japon.
Donc, aujourd’hui seulement, surlendemain de mon arrivée, me voici errant au milieu des maisonnettes de bois et de papier, un peu désorienté d’abord par tant de changements survenus dans les quartiers voisins de la mer, et puis me reconnaissant davantage aux abords des grands temples au fin fond du vieux Nagasaki purement japonais.
Quoi qu’on en ait dit, il existe bien toujours, ce Japon lointain, malgré le vent de folie qui le pousse à se transformer et à se détruire. Quant à la mousmé, je la retrouve toujours la même, avec son beau chignon d’ébène vernie, sa ceinture à grandes coques, sa révérence et ses petits yeux si bridés qu’ils ne s’ouvrent plus ; son ombrelle seule a changé : au lieu d’être à mille nervures et en papier peint, la voilà, hélas ! en soie de couleur sombre, et baleinée à la mode occidentale. Mais la mousmé est encore là, pareillement attifée, aussi gentiment comique, et d’ailleurs innombrable, emplissant les rues de sa grâce mièvre et de son rire. Du côté des hommes, les gracieux chapeaux melons et les petits complets d’Occident ne sont pas sensiblement plus nombreux que jadis ; on dirait, même que la vogue en est passée.
Comme c’est drôle : j’ai été quelqu’un de Nagasaki, moi, il y a longtemps, longtemps, il y a beaucoup d’années !… Je l’avais presque oublié, mais je me le rappelle de mieux en mieux, à mesure que je m’enfonce dans cette ville étrange. Et mille choses me jettent au passage un mélancolique bonjour, avec une petite gerbe de souvenirs, – mille choses : les cèdres centenaires penchés autour des pagodes, les monstres de granit qui veillent depuis des âges sur les seuils, et les vieux ponts courbes aux pierres rongées par la mousse.
Des bonjours mélancoliques, disais-je… Mélancolie des quinze ans écoulés depuis que nous nous sommes perdus de vue, voilà tout. Par ailleurs, pas plus d’émotion que le jour de l’arrivée : c’était donc bien sans souffrance et sans amour que j’avais passé dans ce pays.
Ces quinze années pourtant ne pèsent guère sur mes épaules. Je reviens au pays des mousmés avec l’illusion d’être aussi jeune que la première fois, et, ce que je n’aurais pu prévoir, bien moins obsédé par l’angoisse de la fuite des jours ; j’ai tant gagné sans doute en détachement que, plus près du grand départ, je vis comme s’il me restait au contraire beaucoup plus de lendemains. En vérité, je me sens disposé à prendre gaîment notre séjour imprévu dans cette baie, qui est encore, à ce qu’il semble, l’un des coins les plus amusants du monde.
Sur le soir de cette journée, presque sans l’avoir voulu, je suis ramené vers Dioudjendji, le faubourg où je demeurais : l’habitude peut-être, ou bien quelque attirance inavouée des sourires de madame Prune… Je monte, je monte, me figurant que je vais arriver tout droit. Mais, qui le croirait ? dans ces petits chemins jadis si familiers, je m’embrouille comme dans un labyrinthe, et me voici tournant, retournant, incapable de reconnaître ma demeure.
Tant pis ! ce sera pour un autre jour, peut-être. Et puis, j’y tiens si peu !
Jeudi, 13 décembre.
J’ai eu le plaisir de rencontrer ce matin au marché madame Renoncule, ma belle-mère, à peine changée ; ces quinze ans n’ont pour ainsi dire pas altéré les beaux restes que je lui connaissais, et nous nous sommes salués sans la moindre hésitation.
Elle a été on ne peut plus aimable, et m’a convié à un grand dîner, où je dois revoir quantité de belles-sœurs, de nièces et de cousines. En outre, elle m’a appris que sa fille, madame Chrysanthème, était très avantageusement établie, dans une ville voisine, mariée en justes noces à un M. Pinson, fabriquant de lanternes en gros ; toutefois le ciel se refuse, hélas ! à bénir cette union, qui demeure obstinément stérile, et c’est le seul nuage à ce bonheur.
Le dîner de famille, auquel je n’ai pas cru devoir refuser de prendre part, promet d’être nombreux et cordial. Mon fidèle serviteur Osman, que j’ai présenté comme un jeune cousin, y assistera aussi. Mais ma belle-mère qui, dans les situations les plus délicates, ne perd jamais le sentiment des nuances, a jugé plus convenable que monsieur et madame Pinson n’y fussent point conviés.
Samedi, 15 décembre.
Je m’ennuyais aujourd’hui dans Motokagomachi, – qui est la rue élégante et un peu modernisée de la ville, la rue où quelques boutiques s’essaient à avoir des glaces, des étalages à l’européenne ; je m’ennuyais, et l’idée m’est venue, pour me distraire, de recourir aux guéchas, comme nous faisions jadis…
Des guéchas, pour sûr il devait y en avoir encore, bien que, au Japon, tout s’en aille. Et je m’en suis ouvert à l’homme-coureur qui, depuis un moment, me voiturait de toute la vitesse de ses jambes musclées et trapues :
– Monsieur, m’a-t-il répondu, je vais vous conduire dans une de nos maisons-de-thé les plus élégantes, qui s’appelle la « Maison de la Grue », et l’on s’empressera de contenter votre caprice.
(Je prie que l’on ne s’y trompe pas : dans cette appellation, le mot grue [ o tsuru ] ne désigne qu’un oiseau.)
C’est tout à côté de Motokagomachi, dans une ruelle ; on entre par un petit portique d’apparence comme il faut ; on traverse un bijou de petit jardin où il y a des montagnes naines, des rocailles de poupée, des vieux arbres en miniature ; et la Maison de la Grue est au fond, très accueillante et très discrète. Comme les Européens n’y fréquentent guère, elle a conservé sa minutieuse propreté japonaise ; je me déchausse en entrant, et deux servantes, à mon aspect, tombent à quatre pattes, le nez contre le plancher, suivant la pure étiquette d’autrefois, que je croyais perdue. Au premier étage, dans une grande pièce blanche qui est vide et sonore, on m’installe par terre, sur des coussins de velours noir, et on se prosterne à nouveau pour attendre mes ordres.
Voici. Je désire louer pour une heure une guécha, c’est-à-dire une musicienne, et une maïko, c’est-à-dire une danseuse. C’est très bien : on va prévenir deux de ces dames, qui habitent le quartier et travaillent d’ordinaire pour la maison.
En attendant qu’elles viennent, la dînette obligatoire m’est apportée avec mille grâces, sur des amours de petits plateaux… Décidément, il existe encore, mon Japon de jadis, celui du temps de Chrysanthème et du temps de ma jeunesse ; je reconnais tout cela, les tasses minuscules, les bâtonnets en guise de fourchette, le réchaud de bronze dont les poignées figurent des têtes de monstre, – et surtout les révérences, les petits rires engageants, les continuelles minauderies des servantes.
Mais j’avais connu ces choses à la splendeur de l’été ; or, je les retrouve en décembre, et l’hiver de l’année, – peut-être aussi l’hiver de ma vie, – me rendent leur mièvrerie par trop triste, intolérablement triste…
Qu’on se dépêche de m’amener ces dames. Je gèle et je m’ennuie, là tout seul, pieds nus sur ces nattes blanches. Un petit vent, rafraîchi à la neige, passe en gémissant entre les panneaux de papier qui servent de murailles ; à part ma dînette, posée à terre, et mes coussins de velours noir, rien dans cette vaste chambre, rien qu’un frêle bouquet là-bas, dans un vase, sur un trépied de laque, – un bouquet d’un goût exquis, j’en conviens ; mais c’est égal, cette nudité absolue est pour me geler davantage encore. J’ai froid, froid jusqu’à l’âme ; je me sens ridicule et pitoyable, accroupi au milieu de la solitude qu’est cette chambre. Vite, qu’on m’amène ces dames, ou je m’en vais !
– Patience, monsieur, me dit-on avec mignardise ; patience, on lisse leur chignon, elles se parent !
Pour me donner le change sur la lenteur de cette toilette, on m’apporte un par un divers accessoires : d’abord la guitare à long manche, enveloppée d’une housse en crépon rouge, et la spatule d’ivoire pour en gratter les cordes ; ensuite un coffre léger, – en laque, il va sans dire, – contenant les masques variés de la danseuse, ses fleurs en papier de riz, ses banderoles de soie ; tout son petit bagage de saltimbanque raffinée, exotique, extra-lointaine.
Enfin, des froufrous dans l’escalier, des rires d’enfants, des pas légers qui montent : « Les voilà, monsieur, les voilà ! » Il était temps, j’allais me lever pour partir.
Entre d’abord une frêle créature, un diminutif de jeune fille, en longue robe de crépon gris souris, avec une ceinture rose fleur-de-pêcher, nouée par-derrière et dont les coques ressemblent aux ailes d’un papillon géant qui se serait posé là. C’est mademoiselle Matsuko, la musicienne, qui se prosterne ; le hasard m’a bien servi, car elle est fine et jolie.
Ensuite paraît le plus étrange petit être que j’aie jamais vu dans mes courses par le monde, moitié poupée et moitié chat, une de ces figures qui, du premier coup, se gravent, par l’excès même de leur bizarrerie, et que l’on n’oublie plus. Elle s’avance, en souriant du coin de ses yeux bridés ; sa tête, grosse comme le poing, se dresse invraisemblable, sur un cou d’enfant, un cou trop long et trop mince, et son petit corps de rien se perd dans les plis d’une robe extravagante, à grands ramages, à grands chrysanthèmes dorés. C’est mademoiselle Pluie-d’Avril, la danseuse, qui se prosterne aussi.
Elle avoue treize ans, mais, tant elle est petite, menue, fluette, on lui en donnerait à peine huit, n’était parfois l’expression de ses yeux câlins et drôles où passe furtivement, entre deux sourires très enfantins, un peu de féminité précoce, un peu d’amertume. Telle quelle, délicieuse à regarder dans ses falbalas d’Extrême-Asie, déroutante, ne ressemblant à rien, indéfinissable et insexuée.
Je ne m’ennuie plus, je ne suis plus seul ; j’ai rencontré le jouet que j’avais peut-être vaguement désiré toute ma vie : un petit chat qui parle.
Avant que la représentation commence, je dois faire les honneurs de ma dînette à mes impayables petites invitées ; donc, sachant depuis longtemps les belles manières nipponnes, je lave moi-même, dans un bol d’eau chaude, apporté à cet usage, la tasse en miniature où j’ai bu, j’y verse quelques gouttes de saki, et les offre successivement aux deux mousmés ; elles font mine de boire, je fais mine de vider la coupe après elles, et nous échangeons de cérémonieuses révérences : l’étiquette est sauve.
Maintenant, la guitare prélude. Le petit chat s’est levé, dans les plis de sa robe mirifique ; du fond de sa boîte de laque, il retire des masques, se choisit une figure qu’il ne montre pas, l’attache sur son minois comique en me tournant le dos, et brusquement se refait voir !… Oh ! quelle surprise !… Où est-il, mon petit chat ?… Il est devenu une grosse bonne femme, à l’air si étonné, si naïf et si bête que l’on ne se tient pas d’éclater de rire. Et il danse, avec une bêtise voulue qui est vraiment du grand art.
Nouvelle volte-face, nouveau plongeon dans la boîte à malice, choix d’un nouveau masque attaché prestement, et réapparition à faire frémir… Maintenant c’est une vieille, vieille goule, au teint de cadavre, avec des yeux à la fois dévorants et morts dont l’expression est insoutenable. Cela danse tout courbé, comme en rampant ; cela conserve des bras de fillette qui, tout le temps fauchent dans l’air, de grandes manches qui s’agitent comme des ailes de chauve-souris. Et la guitare, sur des notes graves, gémit en trémolo sinistre…
Quand la mousmé ensuite, sa danse finie, laisse tomber son masque affreux pour faire la révérence, on trouve d’autant plus exquise, par contraste, son amour de petite figure.
C’est la première fois qu’au Japon je suis sous le charme… Je reviendrai souvent dans la « Maison de la Grue ».
18 décembre.
J’ai revu aujourd’hui ce jardinet de madame Renoncule, ma belle-mère, dont le seul aspect suffisait jadis à me donner le spleen.
Et je l’ai revu tout pareil, aussi maladif, dans sa pénombre, entre ses vieux murs. Ses arbres nains, qui paraissaient déjà centenaires, n’ont ni changé, ni grandi d’une ligne. Tel bouquet de petits cèdres avortons, que je me rappelle si bien, de petits cèdres qui n’ont pas deux pieds de haut, se mire toujours dans le lac en miniature, dont la surface est ternie de poussière. La même teinte, verdâtre et comme moisie, est restée aux rocailles nostalgiques, dans les recoins sans soleil…
Il y a toujours un étonnement à retrouver, dans des pays très éloignés, et après de longues années qui ont été remplies pour vous d’agitations et de courses par le monde, à retrouver de pauvres petites choses demeurées immuables, d’infimes petites plantes qui continuent de végéter aux mêmes places.
20 décembre.
À mon précédent séjour, il y a quinze ans, on ne voyait d’ivrognes au Japon que les matelots d’Europe. Maintenant les matelots japonais s’y sont mis, à l’alcool ; à peu près semblables à ceux de chez nous, sauf leur figure plate et jaune, portant le même col bleu et le même bonnet, ils vont bras dessus, bras dessous, chantant et titubant par les rues. Quantité d’autres personnages, en robe nipponne, se grisent aussi le dimanche et se battent dans les cabarets.
En fait de maisons-de-thé, celles-là seules qui sont très élégantes et très fermées, qui n’admettent que de purs Japonais et quelques étrangers de marque, celles-là seules ont gardé la tradition : minutieuse propreté blanche, grandes salles où il n’y a rien, raffinement extrême dans l’absolue simplicité.
Mais toutes les autres, ouvertes à qui veut entrer, sont devenues sales et empestent l’absinthe. On y est admis sans se déchausser, en gros souliers boueux ; plus de nattes immaculées par terre, plus de coussins pour s’asseoir ; des chaises et des tables de cabaret ; sur les étagères, au lieu des gentilles porcelaines pour dînettes de poupées, aujourd’hui des alignements de bouteilles, du whisky, du brandy, du pale-ale ; tous les poisons d’Angleterre et d’Amérique, déversés chaque jour à pleins paquebots, sur le vieil empire du Soleil Levant.
Et pourtant le Japon existe encore. À certaines heures, dans certains lieux, on le retrouve si intact et si japonais, qu’il semble n’avoir subi qu’une atteinte superficielle. Cette grande baie singulière où nous sommes, entre ses hautes montagnes aux dentelures excessives, ne cesse point d’être un réceptacle d’inépuisables étrangetés. Nagasaki, malgré ses lampes électriques et la fumée de ses usines, est encore, au fond, une ville très lointaine, séparée de nous par des milliers de lieues, par des temps et des âges.
Si son port est ouvert à tous les navires et à toutes les importations d’Occident, du côté de la montagne elle a gardé ses petites rues des siècles passés, sa ceinture de vieux temples et de vieux tombeaux. Les pentes vertes qui l’entourent sont hantées par ces milliers d’âmes ancestrales, auxquelles on brûle tant d’encens chaque jour ; elles n’ont pas cessé d’être le tranquille royaume des morts ; les mystérieux symboles, les stèles de granit, les bouddhas en prière s’y pressent du haut en bas, parmi les cèdres et les bambous. Et tout cet immense lieu de recueillement et d’adoration, comme suspendu au-dessus de la ville, jette son ombre sur les drolatiques petites choses qui se passent en bas. Dans Nagasaki, n’importe où l’on se promène et l’on s’amuse, toujours, au-dessus de soi l’on sent cet amas de pagodes et de cimetières, étagés parmi la verdure ; chaque rue qui s’éloigne de la rive, chaque rue qui monte finit toujours par y aboutir, et on rencontre fréquemment d’extraordinaires cortèges qui s’y rendent, accompagnant quelque Nippon défunt que l’on conduit là-haut, là-haut, dans une gentille chaise à porteurs…
23 décembre.
J’ai retrouvé madame Prune, et je l’ai retrouvée libre et veuve !… Ça, par exemple, ç’a été une émotion…
J’étais monté par hasard vers Dioudjendji, ne pensant point à mal, quand tout à coup un tournant de sentier, un vieil arbre, une pierre, m’ont reconnu au passage d’une façon saisissante : ces choses avaient été jadis quotidiennement inscrites dans mes yeux ; j’étais à deux pas de mon ancienne demeure…
J’y suis allé tout droit, et je l’ai revue toujours la même, malgré cet air de vétusté qu’elle n’avait point encore au temps où je l’habitais. Sans hésiter, glissant la main entre les barreaux du portail, j’ai fait jouer la fermeture à secret pour entrer dans le jardin… Madame Prune était là, dans un négligé qui lui a été pénible, la pauvre chère âme que je n’aurais pas dû surprendre, le chignon sans apprêts, vaquant à quelques menus soins de ménage. Et tel a été son trouble de me revoir, qu’il ne m’est plus possible de mettre en doute la persistance de son sentiment pour moi.
Voici trois années, paraît-il, que M. Sucre a payé son tribut à la nature ; à quelque cent mètres au-dessus de sa maison, il repose dans l’un des cimetières de la montagne. La veuve conserve pieusement les reliques de l’époux qui sut puiser dans son art tant de détachement et de philosophie : l’encrier de jade, que j’ai tout de suite reconnu, avec la maman crapaud et les jeunes crapoussins ; les lunettes rondes ; et enfin la dernière étude qui sortit, inachevée, de cet habile pinceau, un groupe de cigognes, il va sans dire.
Quant à mademoiselle Oyouki, depuis plus de dix ans elle est mariée, établie à la campagne, et mère d’une charmante famille.
Et madame Prune, en baissant les yeux, a insisté sur cette liberté et cette solitude du cœur, que sa nouvelle situation lui laisse.
20 décembre.
Ceux-là seuls qui ont le sens du chat pourront me suivre et me comprendre dans le développement de ma passion pour la petite mademoiselle Pluie-d’Avril, professionnelle de danse nipponne.