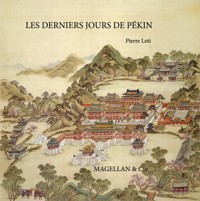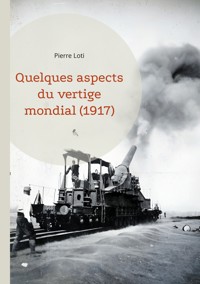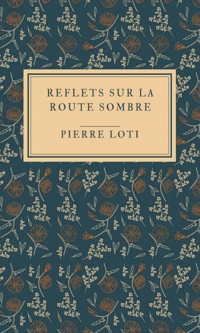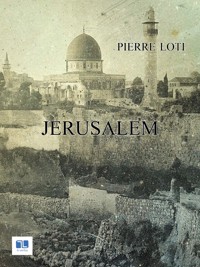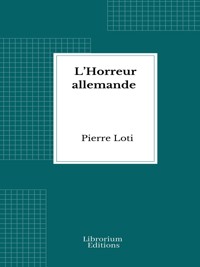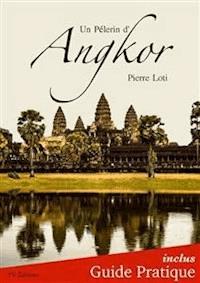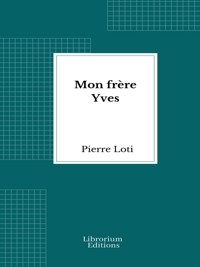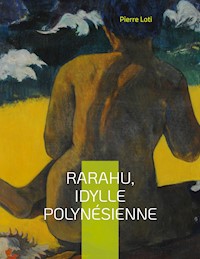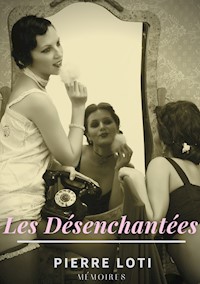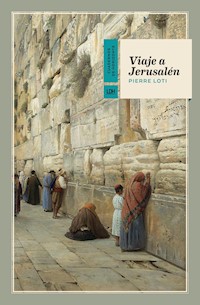Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : "Ramuntcho" est un roman de Pierre Loti qui plonge le lecteur dans le Pays basque à la fin du XIXe siècle. L'histoire suit Ramuntcho, un jeune homme passionné par la pelote basque, un sport emblématique de sa région. Ramuntcho vit dans un village pittoresque, où il partage son temps entre les parties de pelote et la contrebande, une activité clandestine mais commune dans cette région frontalière. Son amour pour Gracieuse, la fille d'une famille respectée du village, se heurte aux traditions et aux attentes sociales. Gracieuse est promise à un autre, un mariage arrangé par sa mère, qui souhaite la voir entrer dans les ordres. Le roman explore les dilemmes de Ramuntcho, tiraillé entre son amour pour Gracieuse et son devoir envers sa famille et sa communauté. Loti dépeint avec précision le paysage et les coutumes du Pays basque, offrant une immersion dans une culture riche et complexe. À travers des descriptions poétiques et une narration introspective, Loti aborde des thèmes universels tels que l'amour, le devoir, et la quête d'identité. "Ramuntcho" est à la fois une déclaration d'amour à une région et une réflexion sur les tensions entre tradition et modernité. L'AUTEUR : Pierre Loti, de son vrai nom Louis Marie-Julien Viaud, est né le 14 janvier 1850 à Rochefort, France. Officier de marine de formation, Loti a parcouru le monde, ce qui a profondément influencé son oeuvre littéraire. Ses voyages lui ont permis de découvrir des cultures variées, qu'il a dépeintes avec une grande sensibilité dans ses romans. Loti est connu pour son style poétique et ses descriptions évocatrices, qui transportent le lecteur dans des lieux exotiques et mystérieux. Parmi ses oeuvres les plus célèbres, on trouve "Pêcheur d'Islande" et "Madame Chrysanthème". "Ramuntcho", publié en 1897, est l'un de ses romans les plus personnels, inspiré par ses séjours dans le Pays basque. Loti a été élu à l'Académie française en 1891, une reconnaissance de son talent littéraire. Sa vie personnelle était marquée par une quête constante d'identité et de sens, reflétée dans ses écrits. Pierre Loti est décédé le 10 juin 1923 à Hendaye, laissant derrière lui une oeuvre riche et variée qui continue d'inspirer les lecteurs et les écrivains du monde entier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
PREMIÈRE PARTIE
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
Chapitre XX
Chapitre XXI
Chapitre XXII
Chapitre XXIII
Chapitre XXIV
Chapitre XXV
Chapitre XXVI
Chapitre XXVII
DEUXIÈME PARTIE
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
DÉDICACE
A MADAME V. D’ABBADIE,
qui commença de m’initier au pays basque, en
l’automne 1891.
Hommage d’affectueux respect,
PIERRE LOTI
Ascain (Basses-Pyrenées), Novembre 1896.
PREMIÈRE PARTIE
I
Les tristes courlis, annonciateurs de l’automne, venaient d’apparaître en masse dans une bourrasque grise, fuyant la haute mer sous la menace des tourmentes prochaines. A l’embouchure des rivières méridionales, de l’Adour, de la Nivelle, de la Bidassoa qui longe l’Espagne, ils erraient au-dessus des eaux déjà froidies, volant bas, rasant de leurs ailes le miroir des surfaces. Et leurs cris, à la tombée de la nuit d’octobre, semblaient sonner la demi-mort annuelle des plantes épuisées.
Sur les campagnes pyrénéennes, toutes de broussailles ou de grands bois, les mélancolies des soirs pluvieux d’arrière-saison descendaient lentement, enveloppantes comme des suaires, tandis que Ramuntcho cheminait par le sentier de mousse, sans bruit, chaussé de semelles de cordes, souple et silencieux dans sa marche de montagnard.
Ramuntcho arrivait à pied de très loin, remontait des régions qui avoisinent la mer de Biscaye, vers sa maison isolée, qui était là-haut dans beaucoup d’ombre, près de la frontière espagnole.
Autour du jeune passant solitaire, qui montait si vite sans peine et dont la marche en espadrilles ne s’entendait pas, des lointains, toujours plus profonds, se creusaient de tous côtés, très estompés de crépuscule et de brume.
L’automne, l’automne s’indiquait partout. Les maïs, herbages des lieux bas, si magnifiquement verts au printemps, étalaient des nuances de paille morte au fond des vallées, et, sur tous les sommets, des hêtres et des chênes s’effeuillaient. L’air était presque froid ; une humidité odorante sortait de la terre moussue, et, de temps à autre, il tombait d’en haut quelque ondée légère. On la sentait proche et angoissante, cette saison des nuages et des longues pluies, qui revient chaque fois avec son même air d’amener l’épuisement définitif des sèves et l’irrémédiable mort, – mais qui passe comme toutes choses et qu’on oublie, au suivant renouveau.
Partout, dans la mouillure des feuilles jonchant la terre, dans la mouillure des herbes longues et couchées, il y avait des tristesses de fin, de muettes résignations aux décompositions fécondes.
Mais l’automne, lorsqu’il vient finir les plantes, n’apporte qu’une sorte d’avertissement lointain à l’homme un peu plus durable, qui résiste, lui, à plusieurs hivers et se laisse plusieurs fois leurrer au charme des printemps. L’homme, par les soirs pluvieux d’octobre et de novembre, éprouve surtout l’instinctif désir de s’abriter au gîte, d’aller se réchauffer devant l’âtre, sous le toit que tant de millénaires amoncelés lui ont progressivement appris à construire. – Et Ramuntcho sentait s’éveiller au fond de soi-même les vieilles aspirations ancestrales vers le foyer basque des campagnes, le foyer isolé, sans contact avec les foyers voisins ; il se hâtait davantage vers le primitif logis, où l’attendait sa mère.
Çà et là, on les apercevait au loin, indécises dans le crépuscule, les maisonnettes basques, très distantes les unes des autres, points blancs ou grisâtres, tantôt au fond de quelque gorge enténébrée, tantôt sur quelque contrefort des montagnes aux sommets perdus dans le ciel obscur ; presque négligeables, ces habitations humaines, dans l’ensemble immense de plus en plus confus des choses ; négligeables et s’annihilant même tout à fait, à cette heure, devant la majesté des solitudes et de l’éternelle nature forestière.
Ramuntcho s’élevait rapidement, leste, hardi et jeune, enfant encore, capable de jouer en route, comme s’amusent les petits montagnards, avec un caillou, un roseau, ou une branche que l’on taille en marchant. L’air se faisait plus vif, les alentours plus âpres, et déjà ne s’entendaient plus les cris des courlis, leurs cris de poulie rouillée, sur les rivières d’en bas. Mais Ramuntcho chantait l’une de ces plaintives chansons des vieux temps, qui se transmettent encore au fond des campagnes perdues, et sa naïve voix s en allait dans la brume ou la pluie, parmi les branches mouillées des chênes, sous le grand suaire toujours plus sombre de l’isolement, de l’automne et du soir.
Pour regarder passer, très loin au-dessous de lui, un char à bœufs, il s’arrêta un instant, pensif. Le bouvier qui menait le lent attelage chantait aussi ; par un sentier rocailleux et mauvais, cela descendait dans un ravin baigné d’une ombre déjà nocturne.
Et bientôt cela disparut à un tournant, masqué tout à coup par des arbres, et comme évanoui dans un gouffre. Alors Ramuntcho sentit l’étreinte d’une mélancolie subite, inexpliquée comme la plupart de ses impressions complexes, et, par un geste habituel, tout en reprenant sa marche moins alerte, il ramena en visière, sur ses yeux gris très vifs et très doux, le rebord de son béret de laine.
Pourquoi ?… Qu’est-ce que cela pouvait lui faire, ce chariot, ce bouvier chanteur qu’il ne connaissait même pas ?… Évidemment rien… Cependant, de les avoir vus ainsi disparaître pour aller se gîter, comme sans doute chaque nuit, en quelque métairie isolée dans un bas fond, la compréhension lui était venue, plus exacte, de ces humbles existences de paysan, attachées à la terre et au champ natal, de ces vies humaines aussi dépourvues de joies que celles des bêtes de labour, mais avec des déclins plus prolongés et plus lamentables. Et, en même temps, dans son esprit avait passé l’intuitive inquiétude des ailleurs, des mille choses autres que l’on peut voir ou faire en ce monde et dont on peut jouir ; un chaos de demi-pensées troublantes, de ressouvenirs ataviques et de fantômes venait furtivement de s’indiquer, aux tréfonds de son âme d’enfant sauvage…
C’est qu’il était, lui, Ramuntcho, un mélange de deux races très différentes et de deux êtres que séparait l’un de l’autre, si l’on peut dire, un abîme de plusieurs générations. Créé par la fantaisie triste d’un des raffinés de nos temps de vertige, il avait été inscrit à sa naissance comme « fils de père inconnu « et ne portait d’autre nom que celui de sa mère. Aussi ne se sentait-il pas entièrement pareil à ses compagnons de jeux ou de saines fatigues.
Silencieux pour un moment, il marchait moins vite vers son logis, par les sentiers déserts serpentant sur les hauteurs. En lui, le chaos des choses autres, des ailleurs lumineux, des splendeurs ou des épouvantes étrangères à sa propre vie, s’agitait confusément, cherchant à se démêler… Mais non, tout cela, qui était l’insaisissable et l’incompréhensible, restait sans lien, sans suite et sans forme, dans des ténèbres…
A la fin, n’y pensant plus, il recommença de chanter sa chanson : elle disait, par couplets monotones, les plaintes d’une fileuse de lin dont l’amant, parti pour une guerre éloignée, tardait à revenir ; elle était en cette mystérieuse langue euskarienne dont l’âge semble incalculable et dont l’origine demeure inconnue. Et peu à peu, sous l’influence de la mélodie ancienne, du vent et de la solitude, Ramuntcho se retrouva ce qu’il était au début de sa course, un simple montagnard basque de seize à dix-sept ans, formé comme un homme, mais gardant des ignorances et des candeurs de tout petit garçon.
Bientôt il aperçut Etchézar, sa paroisse, son clocher massif comme un donjon de forteresse ; auprès de l’église, quelques maisons étaient groupées ; les autres, plus nombreuses, avaient préféré se disséminer aux environs, parmi des arbres, dans des ravins ou sur des escarpements. La nuit tombait tout à fait, hâtive ce soir, à cause des voiles sombres accrochés aux grandes cimes.
Autour de ce village, en haut ou bien dans les vallées d’en dessous, le pays basque apparaissait en ce moment comme une confusion de gigantesques masses obscures. De longues nuées dérangeaient les perspectives ; toutes les distances, toutes les profondeurs étaient devenues inappréciables, les changeantes montagnes semblaient avoir grandi dans la nébuleuse fantasmagorie du soir. L’heure, on ne sait pourquoi, se faisait étrangement solennelle, comme si l’ombre des siècles passés allait sortir de la terre. Sur ce vaste soulèvement qui s’appelle Pyrénées, on sentait planer quelque chose qui était peut-être l’âme finissante de cette race, dont les débris se sont là conservés et à laquelle Ramuntcho appartenait par sa mère…
Et l’enfant, composé de deux essences si diverses, qui cheminait seul vers son logis, à travers la nuit et la pluie, recommençait à éprouver, au fond de son être double, l’inquiétude des inexplicables ressouvenirs.
Enfin il arriva devant sa maison, – qui était très élevée, à la mode basque, avec de vieux balcons en bois sous d’étroites fenêtres, et dont les vitres jetaient dans la nuit du dehors une lueur de lampe. Près d’entrer, le bruit léger de sa marche s’atténua encore dans l’épaisseur des feuilles mortes : les feuilles de ces platanes taillés en voûte qui, suivant l’usage du pays, forment une sorte d’atrium devant chaque demeure.
Elle reconnaissait de loin le pas de son fils, la sérieuse Franchita, pâle et droite dans ses vêtements noirs, – celle qui jadis avait aimé et suivi l’étranger ; puis, qui, sentant l’abandon prochain, était courageusement revenue au village pour habiter seule la maison délabrée de ses parents morts. Plutôt que de rester dans la grande ville là-bas, et d’y être gênante et quémandeuse, elle avait vite résolu de partir, de renoncer à tout, de faire un simple paysan basque de ce petit Ramuntcho qui, à son entrée dans la vie, avait porté des robes brodées de soie blanche.
Il y avait quinze ans de cela, quinze ans qu’elle était revenue, clandestinement, à une tombée de nuit pareille à celle-ci. Dans les premiers temps de ce retour, muette et hautaine avec ses compagnes d’autrefois par crainte de leurs dédains, elle ne sortait que pour aller à l’église, la mantille de drap noir abaissée sur les yeux. Puis, à la longue, les curiosités apaisées, elle avait repris ses habitudes d’avant, si vaillante d’ailleurs et si irréprochable que tous l’avaient pardonnée.
Pour accueillir et embrasser son fils, elle sourit de joie et de tendresse ; mais, silencieux par nature, renfermés tous deux, ils ne se disaient guère que ce qu’il était utile de se dire.
Lui, s’assit à sa place accoutumée, pour manger la soupe et le plat fumant qu’elle lui servit sans parler. La salle, soigneusement peinte à la chaux, s’égayait à la lueur subite d’une flambée de branches, dans la cheminée haute et large, garnie d’un feston de calicot blanc. Dans des cadres, accrochés en bon ordre, il y avait les images de première communion de Ramuntcho, et différentes figures de saints ou de saintes, avec des légendes basques ; puis la Vierge du Pilar, la Vierge des angoisses, et des chapelets, des rameaux bénits. Les ustensiles du ménage luisaient, bien alignés sur des planches scellées aux murailles ; – chaque étagère toujours ornée d’un de ces volants en papier rose, découpés et ajourés, qui se fabriquent en Espagne et où sont invariablement imprimées des séries de personnages dansant avec des castagnettes, ou bien des scènes de la vie des toréadors. Dans cet intérieur blanc, devant cette cheminée joyeuse et claire, on éprouvait une impression de chez soi, un tranquille bien-être, qu’augmentait encore la notion de la grande nuit mouillée d’alentour, du grand noir des vallées, des montagnes et des bois.
Franchita, comme chaque soir, regardait longuement son fils, le regardait embellir et croître, prendre de plus en plus un air de décision et de force, à mesure qu’une moustache brune se dessinait davantage au-dessus de ses lèvres fraîches.
Quand il eut soupé, mangé avec son appétit de jeune montagnard plusieurs tranches de pain et bu deux verres de cidre, il se leva, disant :
« Je m’en vais dormir, car nous avons du travail pour cette nuit.
– Ah ! demanda la mère, et à quelle heure dois-tu te réveiller ?
– A une heure, sitôt la lune couchée. On viendra siffler sous la fenêtre.
– Et qu’est-ce que c’est ?
– Des ballots de soie et des ballots de velours.
– Et avec qui vas-tu ?
– Les mêmes que d’habitude : Arrochkoa, Florentino et les frères Iragola. C’est comme l’autre nuit, pour le compte d’Itchoua, avec qui je viens de m’engager… Bonsoir, ma mère !… Oh ! nous ne serons pas tard dehors, et, sûr, je rentrerai avant l’heure de la messe… »
Alors, Franchita pencha la tête sur l’épaule solide de son fils, avec une câlinerie presque enfantine, différente tout à coup de sa manière habituelle ; et, la joue contre la sienne, elle resta longuement et tendrement appuyée, comme pour dire, dans un confiant abandon de volonté : « Cela me trouble encore un peu, ces entreprises de nuit ; mais, réflexion faite, ce que tu veux est toujours bien ; je ne suis qu’une dépendance de toi, et toi, tu es tout… »
Sur l’épaule de l’étranger, jadis, elle avait coutume de s’appuyer et de s’abandonner ainsi, dans le temps où elle l’aimait.
Quand Ramuntcho fut monté dans sa petite chambre, elle demeura songeuse plus longtemps que de coutume avant de reprendre son travail d’aiguille… Ainsi, cela devenait décidément son métier, ces courses nocturnes où l’on risque de recevoir les balles des carabiniers d’Espagne !… D’abord il avait commencé par amusement, par bravade, comme font la plupart d’entre eux, et comme en ce moment débutait son ami Arrochkoa dans la même bande que lui ; ensuite, peu à peu, il s’était fait un besoin de cette continuelle aventure des nuits noires ; il désertait de plus en plus, pour ce métier rude, l’atelier en plein vent du charpentier, où elle l’avait mis en apprentissage, à tailler des solives dans des troncs de chênes.
Et voilà donc ce qu’il serait dans la vie, son petit Ramuntcho, autrefois si choyé en robe blanche et pour qui elle avait naïvement fait tant de rêves : contrebandier !… Contrebandier et joueur de pelote, deux choses d’ailleurs qui vont bien ensemble et qui sont basques essentiellement.
Elle hésitait pourtant encore à lui laisser suivre cette voie imprévue. Non par dédain pour les contrebandiers, oh ! non, car son père, à elle, l’avait été ; ses deux frères aussi ; l’aîné tué d’une balle espagnole au front, une nuit qu’il traversait à la nage la Bidassoa, le second réfugié aux Amériques pour échapper à la prison de Bayonne ; l’un et l’autre respectés pour leur audace et leur force… Non, mais lui, Ramuntcho, le fils de l’étranger, lui, sans doute, aurait pu prétendre à l’existence moins dure des hommes de la ville, si, dans un mouvement irréfléchi et un peu sauvage, elle ne l’avait pas séparé de son père pour le ramener à la montagne basque… En somme, il n’était pas sans cœur, le père de Ramuntcho ; quand fatalement il s’était lassé d’elle, il avait fait quelques efforts pour ne pas le laisser voir et jamais il ne l’aurait abandonnée avec son enfant, si, d’elle-même, par fierté, elle n’était partie… Alors ce serait peut-être un devoir, aujourd’hui, de lui écrire, pour lui demander de s’occuper de ce fils…
Et maintenant l’image de Gracieuse se présentait tout naturellement à son esprit, comme chaque fois qu’elle songeait à l’avenir de Ramuntcho ; celle-là, c’était la petite fiancée que, depuis tantôt dix ans, elle souhaitait pour lui. (Dans les campagnes encore en arrière des façons actuelles, c’est l’usage de se marier tout jeune, souvent même de se connaître et de se choisir dès les premières années de la vie.) Une petite aux cheveux ébouriffés en nuage d’or, fille d’une amie d’enfance à elle, Franchita, d’une certaine Dolorès Detcharry, qui avait toujours été orgueilleuse – et qui était restée méprisante depuis l’époque de la grande faute…
Certes, l’intervention du père dans l’avenir de Ramuntcho serait un appoint décisif pour obtenir la main de cette petite – et permettrait même de la demander à Dolorès avec une certaine hauteur, après les rivalités anciennes… Mais Franchita sentait un grand trouble la pénétrer tout entière, à mesure que se précisait en elle la pensée de s’adresser à cet homme, de lui écrire demain, de le revoir peut-être, de remuer cette cendre… Et puis, elle retrouvait en souvenir le regard si souvent assombri de l’étranger, elle se rappelait ses vagues paroles de lassitude infinie, d’incompréhensible désespérance ; il avait l’air de voir toujours, au-delà de son horizon à elle, des lointains de gouffres et de ténèbres, et, bien qu’il ne fût pas un insulteur des choses sacrées, jamais il ne priait, lui donnant ce surcroît de remords de s’être alliée à quelque païen pour qui le ciel resterait fermé. Ses amis, d’ailleurs, étaient pareils à lui, des raffinés aussi, sans foi, sans prière, échangeant entre eux, à demi-mots légers, des pensées d’abîme… Mon Dieu, si Ramuntcho à leur contact allait devenir comme eux tous ! – et déserter les églises, fuir les sacrements et la messe !… Alors, elle se remémorait les lettres de son vieux père, – aujourd’hui décomposé dans la terre profonde, sous une dalle de granit, contre les fondations de son église paroissiale, – ces lettres en langue euskarienne qu’il lui adressait là-bas, après les premiers mois d’indignation et de silence, dans la ville où elle avait traîné sa faute : « Au moins, ma pauvre Franchita, ma fille, es-tu dans un pays où les hommes sont pieux et vont régulièrement aux églises ?… » Oh ! non, ils n’étaient guère pieux, les hommes de la grande ville, pas plus les élégants dont le père de Ramuntcho faisait sa compagnie, que les plus humbles travailleurs du quartier de banlieue où elle vivait cachée ; tous, emportés par un même courant loin des dogmes héréditaires, loin des antiques symboles… Et Ramuntcho, dans de tels milieux, comment résisterait-il ?
D’autres raisons encore, moindres peut-être, l’arrêtaient aussi. Sa dignité hautaine qui là-bas, dans cette ville, l’avait maintenue honnête et solitaire, se cabrait vraiment à l’idée qu’il faudrait reparaître en solliciteuse devant son amant d’autrefois. Puis, son bon sens supérieur, que rien n’avait jamais pu égarer ni éblouir, lui disait du reste qu’il était trop tard à présent pour tout changer ; que Ramuntcho, jusqu’ici ignorant et libre, ne saurait plus atteindre les dangereuses régions de vertige où s’était élevée l’intelligence de son père, mais plutôt qu’il languirait en dessous comme un déclassé. Et enfin un sentiment presque inavoué à elle-même gisait très puissant au fond de son cœur : la crainte angoissée de le perdre, ce fils, de ne plus le guider, de ne plus le tenir, de ne plus l’avoir… Alors, en cet instant des réflexions décisives, après avoir hésité durant des années, voici que de plus en plus elle inclinait à s’entêter pour jamais dans son silence vis-à-vis de l’étranger et à laisser couler humblement la vie de son Ramuntcho près d’elle, sous le regard protecteur de la Vierge, des saints et des saintes… Restait la question de Gracieuse Detcharry… Eh bien, mais elle l’épouserait quand même, son fils, tout contrebandier et pauvre qu’il allait être ! Avec son instinct de mère un peu farouchement aimante, elle devinait que cette petite était déjà prise assez pour ne se déprendre jamais ; elle avait vu cela dans ses yeux noirs de quinze ans, obstinés et graves sous le nimbe doré des cheveux… Gracieuse épousant Ramuntcho pour son charme seul, envers et contre la volonté maternelle !… Ce qu’il y avait de rancuneux et de vindicatif dans l’âme de Franchita se réjouissait même tout à coup de ce plus grand triomphe sur la fierté de Dolorès…
Autour de la maison isolée où, sous le grand silence de minuit, elle décidait seule de l’avenir de son fils, l’Esprit des ancêtres basques flottait, sombre et jaloux aussi dédaigneux de l’étranger, craintif des impiétés, des changements, des évolutions de races ; – l’Esprit des ancêtres basques, le vieil Esprit immuable qui maintient encore ce peuple les yeux tournés vers les âges antérieurs ; le mystérieux Esprit séculaire, par qui les enfants sont conduits à agir comme avant eux leurs pères avaient agi, au flanc des mêmes montagnes, dans les mêmes villages, autour des mêmes clochers…
Un bruit de pas ; maintenant dans le noir du dehors !… Quelqu’un marchant doucement en espadrilles sur l’épaisseur des feuilles de platane en jonchée par terre… Puis, un coup de sifflet d’appel… Comment, déjà !… Déjà une heure du matin !…
Tout à fait résolue à présent, elle ouvrit la porte au chef contrebandier avec un sourire accueillant que celui-ci ne lui connaissait pas :
« Entrez, Itchoua, dit-elle, chauffez-vous…, tandis que je vais moi-même réveiller le fils. »
Un homme grand et large, cet Itchoua, maigre avec une épaisse poitrine entièrement rasé comme un prêtre, suivant la mode des Basques de vieille souche ; sous le béret qu’il n’ôtait jamais, une figure incolore, inexpressive, taillée comme à coups de serpe, et rappelant ces personnages imberbes, archaïquement dessinés sur les missels du XVe siècle. Au-dessous de ses joues creusées, la carrure des mâchoires, la saillie des muscles du cou donnaient la notion de son extrême force. Il avait le type basque accentué à l’excès ; des yeux trop rentrés sous l’arcade frontale ; des sourcils d’une rare longueur, dont les pointes, abaissées comme chez les madones pleureuses, rejoignaient presque les cheveux aux tempes. Entre trente ans ou cinquante ans, il était impossible de lui assigner un âge. Il s’appelait José-Maria Gorostéguy ; mais, d’après la coutume, n’était connu dans le pays que sous ce surnom d’Itchoua (l’aveugle) donné jadis par plaisanterie, à cause de sa vue perçante qui plongeait dans la nuit comme celle des chats.
D’ailleurs, chrétien pratiquant, marguillier de sa paroisse et chantre à voix tonnante. Fameux aussi pour sa résistance aux fatigues, capable de gravir les pentes pyrénéennes durant des heures au pas de course avec de lourdes charges sur les reins.
Ramuntcho descendit bientôt, frottant ses paupières encore alourdies d’un jeune sommeil, et, à son aspect, le morne visage d’Itchoua fut illuminé d’un sourire. Continuel chercheur de garçons énergiques et forts pour les enrôler dans sa bande, sachant les y retenir, malgré des salaires minimes, par une sorte de point d’honneur spécial, il s’y connaissait en jarrets, en épaules, aussi bien qu’en caractères, et il faisait grand cas de sa recrue nouvelle.
Franchita, avant de les laisser partir, appuya encore la tête un peu longuement contre le cou de son fils ; puis, elle accompagna les deux hommes jusqu’au seuil de sa porte, ouverte sur le noir immense, – et récita pieusement le Pater pour eux, tandis qu’ils s’éloignaient dans l’épaisse nuit, dans la pluie, dans le chaos des montagnes, vers la ténébreuse frontière…
II
Quelques heures plus tard, à la pointe incertaine de l’aube, à l’instant où s’éveillent les bergers et les pêcheurs.
Ils s’en revenaient joyeusement, les contrebandiers, leur entreprise terminée.
Partis à pied, avec des précautions infinies de silence, par des ravins, par des bois, par de dangereux gués de rivière, ils s’en revenaient comme des gens n’ayant jamais rien eu à cacher à personne, en traversant la Bidassoa, au matin pur, dans une barque de Fontarabie louée sous la barbe des douaniers d’Espagne.
Tout l’amas de montagnes et de nuages, tout le sombre chaos de la précédente nuit s’était démêlé presque subitement, comme au coup d’une baguette magicienne. Les Pyrénées, rendues leurs proportions réelles, n’étaient plus que de moyennes montagnes, aux replis baignés d’une ombre encore nocturne mais aux crêtes nettement coupées dans un ciel qui déjà s’éclaircissait. L’air s’était fait tiède, suave, exquis à respirer, comme si tout à coup on eût changé de climat ou de saison, – et c’était le vent de Sud qui commençait à souffler, le délicieux vent de Sud spécial au pays basque, qui chasse devant lui le froid, les nuages et les brumes, qui avive les nuances de toutes choses, bleuit le ciel, prolonge à l’infini les horizons, donne, même en plein hiver, des illusions d’été.
Le batelier qui ramenait en France les contrebandiers poussait du fond avec sa perche longue, et la barque se traînait, à demi échouée. En ce moment, cette Bidassoa, par qui les deux pays sont séparés, semblait tarie, et son lit vide, d’une excessive largeur, avait l’étendue plate d’un petit désert.
Le jour allait décidément se lever, tranquille et un peu rose. On était au 1er du mois de novembre ; sur la rive espagnole, là-bas, très loin, dans un couvent de moines, une cloche de l’extrême matin sonnait clair, annonçant la solennité religieuse de chaque automne. Et Ramuntcho, bien assis dans la barque, doucement bercé et reposé après les fatigues de la nuit, humait ce vent nouveau avec un bien-être de tous ses sens ; avec une joie enfantine, il voyait s’assurer un temps radieux pour cette journée de Toussaint, qui allait lui apporter tout ce qu’il connaissait des fêtes de ce monde : la grand-messe chantée, la partie de pelote devant le village assemblé, puis enfin la danse du soir avec Gracieuse, le fandango au clair de lune sur la place de l’église.
Il perdait peu à peu conscience de sa vie physique, Ramuntcho, après sa nuit de veille ; une sorte de torpeur, bienfaisante sous les souffles du matin vierge, engourdissait son jeune corps, laissant son esprit en demi-rêve. Il connaissait bien d’ailleurs ces impressions et ces sensations-là, car les retours à pointe d’aube, en sécurité dans une barque où l’on s’endort, sont la suite habituelle des courses de contrebande.
Et tous les détails aussi de cet estuaire de la Bidassoa lui étaient familiers, tous ses aspects, qui changent suivant l’heure, suivant la marée monotone et régulière… Deux fois par jour le flot marin revient emplir ce lit plat ; alors, entre la France et l’Espagne, on dirait un lac, une charmante petite mer où courent de minuscules vagues bleues, et les barques flottent, les barques vont vite ; les bateliers chantent leurs airs des vieux temps, qu’accompagnent le grincement et les heurts des avirons cadencés. Mais quand les eaux se sont retirées, comme en ce moment-ci, il ne reste plus entre les deux pays qu’une sorte de région basse, incertaine et de changeante couleur, où marchent des hommes aux jambes nues, où des barques se traînent en rampant.
Ils étaient maintenant au milieu de cette région-là, Ramuntcho et sa bande, moitié sommeillant sous la lumière à peine naissante. Les couleurs des choses commençaient à s’indiquer, au sortir des grisailles de la nuit. Ils glissaient, ils avançaient par à-coups légers, tantôt parmi des velours jaunes qui étaient des sables, tantôt à travers des choses brunes, striées régulièrement et dangereuses aux marcheurs, qui étaient des vases. Et des milliers de petites flaques d’eau, laissées par le flot de la veille, reflétaient le jour naissant, brillaient sur l’étendue molle comme des écailles de nacre. Dans le petit désert jaune et brun, leur batelier suivait le cours d’un mince filet d’argent qui représentait la Bidassoa à l’étale de basse mer. De temps à autre, quelque pêcheur croisait leur route, passait tout près d’eux en silence, sans chanter comme les jours où l’on rame, trop affairé à pousser du fond, debout dans sa barque et manœuvrant sa perche avec de beaux gestes plastiques.
En rêvant, ils approchaient de la rive française, les contrebandiers. Et là-bas, de l’autre côté de la zone étrange sur laquelle ils voyageaient comme en traîneau, cette silhouette de vieille ville qui les fuyait lentement, c’était Fontarabie ; ces hautes terres qui montaient dans le ciel avec des physionomies si âpres, c’étaient les Pyrénées espagnoles. Tout cela était l’Espagne, la montagneuse Espagne, éternellement dressée là en face et sans cesse préoccupant leur esprit : pays qu’il faut atteindre en silence par les nuits noires, par les nuits sans lune, sous les pluies d’hiver ; pays qui est le perpétuel but des courses dangereuses ; pays qui, pour les hommes du village de Ramuntcho, semble toujours fermer l’horizon du Sud-Ouest, tout en changeant d’apparence suivant les nuages et les heures ; pays qui s’éclaire le premier au pâle soleil des matins et masque ensuite, comme un sombre écran, le soleil rouge des soirs…
Il adorait sa terre basque, Ramuntcho, – et ce matin-là était une des fois où cet amour entrait plus profondément en lui-même. Dans la suite de son existence, pendant les exils, le souvenir de ces retours délicieux à l’aube, après les nuits de contrebande, devait lui causer d’indéfinissables et très angoissantes nostalgies Mais son amour pour le sol héréditaire n’était pas aussi simple que celui de ses compagnons d’aventure. Comme à tous ses sentiments, comme à toutes ses sensations, il s’y mêlait des éléments très divers. D’abord l’attachement instinctif et non analysé des ancêtres maternels au terroir natal, puis quelque chose de plus raffiné provenant de son père, un reflet inconscient de cette admiration d’artiste qui avait retenu ici l’étranger pendant quelques saisons et lui avait donné le caprice de s’allier avec une fille de ces montagnes pour en obtenir une descendance basque…
III
Onze heures maintenant, les cloches de France et d’Espagne sonnant à toute volée et mêlant par-dessus la frontière leurs vibrations des religieuses fêtes.
Baigné, reposé et en toilette, Ramuntcho se rendait avec sa mère à la grand-messe de la Toussaint. Par le chemin jonché de feuilles rousses, ils descendaient tous deux vers leur paroisse, sous un chaud soleil qui donnait l’illusion de l’été.
Lui, vêtu d’une façon presque élégante et comme un garçon de la ville, sauf le traditionnel béret basque, qu’il portait de côté, en visière sut ses yeux d’enfant. Elle, droite et fière, la tête haute, l’allure distinguée, dans une robe d’une forme très nouvelle ; l’air d’une femme du monde, sauf la mantille de drap noir qui couvrait ses cheveux et ses épaules : dans la grande ville jadis, elle avait appris à s’habiller et du reste, au pays basque où cependant tant de traditions anciennes sont conservées, les femmes et les filles des moindres villages ont toutes pris l’habitude de se costumer au goût du jour, avec une élégance inconnue aux paysannes des autres provinces françaises.
Ils se séparèrent, ainsi que l’étiquette le commande, en arrivant dans le préau de l’église, où des cyprès immenses sentaient le Midi et l’Orient. D’ailleurs, elle ressemblait du dehors à une mosquée, leur paroisse, avec ses grands vieux murs farouches, percés tout en haut seulement de minuscules fenêtres, avec sa chaude couleur de vétusté, de poussière et de soleil.
Tandis que Franchita entrait par une des portes du rez-de-chaussée, Ramuntcho prenait un vénérable escalier de pierre qui montait le long de la muraille extérieure et conduisait dans les hautes tribunes réservées aux hommes.
Le fond de l’église sombre était tout de vieux ors étincelants, avec une profusion de colonnes torses, d’entablements compliqués, de statues aux contournements excessifs et aux draperies tourmentées dans le goût de la Renaissance espagnole. Et cette magnificence du tabernacle contrastait avec la simplicité des murailles latérales, tout uniment peintes à la chaux blanche. Mais un air de vieillesse extrême harmonisait ces choses, que l’on sentait habituées depuis des siècles à durer en face les unes des autres.
Il était de bonne heure encore, et on arrivait à peine pour cette grand-messe. Accoudé au rebord de sa tribune, Ramuntcho regardait en bas les femmes entrer, toutes comme de pareils fantômes noirs, la tête et le costume dissimulés sous le cachemire de deuil qu’il est d’usage de mettre pour aller aux églises. Silencieuses et recueillies, elles glissaient sur le funèbre pavage de dalles mortuaires où se lisaient encore, malgré l’effacement du temps, des inscriptions en langue euskarienne, des noms de familles éteintes et des dates de siècles passés.
Gracieuse, dont l’entrée préoccupait surtout Ramuntcho, tardait à venir. Mais, pour distraire un moment son esprit, un convoi s’avança en lente théorie noire ; un convoi, c’est-à-dire les parents et les plus proches voisins d’un mort de la semaine, les hommes encore drapés dans la longue cape que l’on porte pour suivre les funérailles, les femmes sous le manteau et le traditionnel capuchon de grand deuil.
En haut, dans les deux immenses tribunes qui se superposaient le long des côtés de la nef, les hommes venaient un à un prendre place, graves et le chapelet à la main : fermiers, laboureurs, bouviers, braconniers ou contrebandiers, tous recueillis et prêts à s’agenouiller quand sonnerait la clochette sacrée. Chacun d’eux, avant de s’asseoir, accrochait derrière lui à un clou de la muraille sa coiffure de laine, et peu à peu, sur le fond blanc de la chaux, s’alignaient des rangées d’innombrables bérets basques.