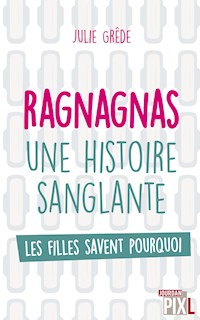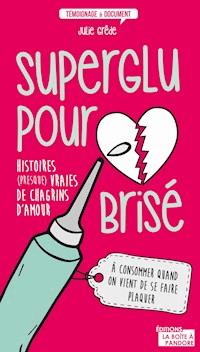Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jourdan
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Curieuses histoires
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Et si on comparait les dessins animés dessins avec les oeuvres originales dont ils sont tirés ?
Et si Walt (de là-haut) avait décidé de passer en revue ses longs métrages inspirés de contes et de les comparer aux oeuvres originales... Serait-il obligé de conclure que les contes cruels écrits à l’origine pour préparer les enfants à un monde difficile sont devenus, sous son regard, des contes de fées pour endormir nos enfants ? Dans les « vrais contes », ceux dont s’inspirent régulièrement Walt et ses successeurs, les happy ends ne sont pas du tout légion. Les morales sont sans concession, cruelles.
Saviez-vous que...
- Chez Andersen, la petite sirène n’épouse pas le prince Éric ? Délaissée, elle devient écume plutôt que de sacrifier celui qu’elle aime.
- La Blanche-Neige du conte n’a que 7 ans et que si sa belle-mère désire ses poumons, et non son coeur, c’est pour s’en goinfrer ?
- La Belle au Bois dormant n’est pas embrassée, mais violée par son prince dans son sommeil ? De cette « union » naîtront des jumeaux… que sa belle-mère cannibale tentera de dévorer.
- Les belles-soeurs de Cendrillon n’hésitent pas à se mutiler les pieds à l’aide d’un couteau de boucher afin de les faire entrer dans la pantoufle de vair ?
- Pinocchio est loin d’être un gentil petit garçon ? Il laisse Gepetto se faire emprisonner pour maltraitance et écrabouille Jiminy Cricket à l’aide d’un maillet…
Et non, désolé, ils ne vécurent pas heureux jusqu’à la fin des temps !
Grâce à cet ouvrage, découvrez ce qu'étaient à l'origine les contes de fées qui ont bercé notre enfance : des histoires cruelles destinées à préparer les enfants à un monde difficile.
EXTRAIT
Si vous n’êtes pas lassés de m’écouter… conter, poursuivons avec le conte des Grimm. Nous avons toujours ce roi et cette reine qui se languissent d’avoir un enfant… quand une fille arrive. Les « marraines » sont ici des « femmes sages » du royaume et sont non pas sept, mais treize. Douze seulement sont invitées au baptême parce que le couple royal ne possède que douze assiettes en or. Ces braves femmes offrent des dons à l’enfant : la Vertu, la Beauté, la Richesse… Lorsque la onzième invitée a fait son don, la non-invitée débarque. Elle est vexée et lance sa malédiction : la piqûre au fuseau et la mort en résultant. Vient alors le tour de la douzième femme sage, elle tourne son offrande de telle sorte qu’elle adoucit le sort qui vient d’être lancé : la princesse ne mourra pas, mais dormira cent ans.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Julie Grêde, après des études de lettres, devient libraire pendant plusieurs années avant de se consacrer à l’écriture. Les histoires, les livres, les contes et légendes bercent sa vie depuis toujours. Elle a décidé de les retrouver dans leur version originale.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© La Boîte à Pandore
Paris
http ://www.laboiteapandore.fr
La Boîte à Pandore est sur Facebook. Venez dialoguer avec nos auteurs, visionner leurs vidéos et partager vos impressions de lecture.
ISBN : 978-2-39009-114-1 – EAN : 9782390091141
Toute reproduction ou adaptation d’un extrait quelconque de ce livre par quelque procédé que ce soit, et notamment par photocopie ou microfilm, est interdite sans autorisation écrite de l’éditeur.
Julie Grêde
La véritable histoire des contes de fées
Ce que Walt ne nous a jamais dit
J’aimais les fées et les princesses qu’on me disait n’exister pas
Jacques Brel
À tous les professeurs qui m’ont inspirée
Singulièrement, à mon premier professeur de latin, Monsieur Bihet, qui m’a fait ce compliment, guère tombé dans l’oreille d’une sourde :
« Julie, tu es dangereuse, tu vendrais des chapeaux melon à des Chinois dans le désert. »
Je m’y emploie. Chaque jour. Juré !
Prélude
Quelque part au paradis, dans une université prestigieuse…
—Le nouveau : Pardonne-moi, je débarque. Ça ne fait que deux jours que je suis là. J’aimerais comprendre… C’est lui qui donne le cours… en personne… c’est le vrai ?
—La déléguée de classe : Je vois, tu débarques débarques ! Oui, c’est lui qui donne ce cours ! Mais je suis choquée, tu as dû faire forte impression au purgatoire si tu es ici dès ton deuxième jour. C’est Ze top ! Certains triment toute leur mort pour avoir la chance de s’inscrire à ce séminaire.
—Le nouveau : Je ne comprends rien, vraiment.
—La déléguée de classe : Le cours ne commence que dans dix minutes, file-moi ton programme.
Il lui donne la feuille, maintenant chiffonnée et un peu poissée de la sueur de sa paume, qu’il triture depuis une heure.
—La déléguée de classe : Donc, tu as opté pour un cursus littéraire avec… des options très cools, dis-moi. Aujourd’hui, là tout de suite, tu as Walt, puis Technique poétique avec Arthur… Cet aprèm, tu commences avec Littérature nordique, c’est un cours qui n’a que quelques années… c’est donné par Stieg. Un peu froid au premier abord, mais sympa. Ce soir, tu as une initiation au deltaplane, je ne connais pas le prof. Et tu finis ta journée avec un autre séminaire… Merde, tu as réussi à t’inscrire aux conférences de Sigmund ! T’as vraiment une chance de dingue !
Cette déléguée de classe était sympathique et pleine de bonne volonté mais le p’tit nouveau n’y comprenait toujours miette.
—Le nouveau : Ok, mais tu peux m’en dire plus sur le cours qu’on attend, là ?
—La déléguée de classe : C’est un cours passionnant, paraît-il, ça fait deux décennies que je suis sur liste d’attente. Je suis hyper excitée. C’est un séminaire sur les contes… « avant, pendant, après Walt », by Walt lui-même. Une tuerie, le gars parle merveilleusement bien de lui…
—Le nouveau : Ce n’est pas un peu prétentieux et… peu objectif ?
—La déléguée de classe : Vraiment, t’es toujours en plein débarquement toi. L’humilité et le sens de l’équité, c’est bon pour les vivants. On est au-dessus de ça, ici. C’est le cas de le dire !
Elle rit à sa propre blague.
—Le nouveau : D’accord. Merci de ton aide.
Le p’tit nouveau à lui-même :« Je vais arrêter d’essayer de comprendre ce qui se passe ici-haut. Aller à ce cours et juger sur pièce. Ces gens sont trop bizarres, ça doit être la mort qui fait ça… » Il esquisse un sourire et un signe à la fille puis suit ceux qui se sont mis à entrer dans l’amphithéâtre.
[Note de l’auteur : Comme vous l’aurez compris avec ce prélude, la forme que va prendre ce livre est particulière. Entre imaginaire et réalité. De vraies infos rendues sous une configuration qui se veut originale et ludique. Un séminaire donné par Walt au paradis.
Je n’ai malheureusement pas pu aller interviewer l’artiste, là-haut… Le Walt – et les autres personnages – mis en scène dans ce séminaire est mon Walt, celui d’une auteure qui l’aime et tente de le comprendre, de l’appréhender, de le restituer dans ses nuances. Les faits mentionnés sont véridiques, les sentiments et avis sont parfois extrapolés.
Ces choses étant posées, je vous souhaite une jolie lecture, un joli voyage au creux de mon imaginaire qui a été forgé, entre autres, par Walt.]
Première heure
Un Américain en Europe
L’auditoire est plein. Il est… bariolé de gens de tous types, de tous âges, tous mêlés dans un brouhaha d’impatience et de curiosité.
Le silence se fait, il est là. Walt. Comme on l’attend, dans un de ces vieux costumes gris et démodés. Une énergie discrète. Un volcan de rires en sommeil. Il est suivi par une petite demoiselle qui transporte une pile de dossiers et de livres à l’équilibre incertain. Un jeans, un T-shirt, des All Stars, les joues trop pleines, des lunettes en écaille roses. Elle serait on ne peut plus différente de celui qu’elle accompagne si elle n’était rieuse et extrêmement sympathique au premier coup d’œil.
Walt est au cœur de la fosse, mais dos à son public, il regarde la jeune fille s’installer à un bureau sur sa gauche puis mettre en place un rétroprojecteur. Après quelques minutes, elle s’exclame :
—Alléluia, ça marche !
Walt sourit et se tourne vers son auditoire. Chacun retient son souffle.
—Walt : Bonjour ! Tout d’abord, laissez-moi vous présenter Miss Lili, qui sera mon assistante pour ce cours, sans qui tout ceci ne serait pas possible. Elle déborde d’un enthousiasme communicatif, je me dois de vous prévenir.
Comme vous le savez, ce séminaire s’intitule « Ce que Walt ne vous dit pas » et il a cette petite particularité que c’est moi-même, ledit Walt, qui vous raconterai tout ce que je n’ai jamais dit jusque-là. Je vais principalement vous parler des contes que j’affectionne et qui ont inspiré beaucoup de mes films. Mais je vais aussi m’évoquer moi-même, tout comme les adaptations de mon Studio, la mort n’étant plus le temps de la modestie.
Aujourd’hui, pour ce premier cours, il va d’ailleurs être beaucoup question de moi. Vous me pardonnerez, je l’espère, ou, en tout cas, tairez vos récriminations.
Il me faut d’abord démentir une rumeur tenace : non, je n’ai pas été cryogénisé. Je n’aurai donc plus jamais l’occasion de m’exprimer dans le monde des vivants, plus jamais l’occasion de répondre aux détracteurs qui posent sur mon travail un regard condescendant. C’est pour cela que je compense, en m’adressant à vous.
Donc, il était une fois… moi. Et comme vous n’êtes pas là uniquement pour faire de la figuration, je vais vous mettre à contribution. Un mot pour me définir ?
Comme toujours dans ces cas-là, chacun a quelque chose à dire mais ne veut pas être le premier à le dire. Au bout d’une minute pleine sans la moindre quinte de toux, Miss Lili s’est mise à faire les gros yeux ; Walt, lui, ne se déparant pas de son sourire poli.
Une réponse, enfin, arrive dans la bouche d’un garçon asiatique en pull à capuche vert, au fond de la salle :
—Un dessinateur.
—Walt : Oui, merci, Monsieur Courage ! Je suis un dessinateur, oui. Notez tout de même que j’ai peu dessiné moi-même, beaucoup moins que ce que l’on s’imagine communément. J’ai inventé le personnage de Mickey, le premier, celui en noir et blanc. Sous mon crayon est née son espièglerie, mais il a été très « esthétisé », ensuite, par des dessinateurs plus brillants. Et je n’ai créé ni Donald, ni Pluto… Pas même Dingo, malheureusement.
Walt se tait alors et le silence revient. Moins long.
—La déléguée de classe : Un cinéaste.
Walt acquiesce, mais ne dit rien. Un petit silence encore.
—Une fille en pull-over fuchsia : Un conteur.
Nouveau hochement de tête. Et tout de suite :
—Valérie Benguigui : Un scénariste.
—Walt : Là oui, vraiment, merci Valérie, je suis un raconteur d’histoires ! Je vénère le récit et c’est peut-être ce qui a fait la différence. Ce qui a fait mon succès et ce qui fait que vous êtes tous là. La construction est ce qui compte le plus pour raconter une histoire. À mon sens. Du punch, du rythme, savoir quand et pourquoi on marque celui qui écoute et le faire avec une certaine régularité. Le scénario doit être le point de départ. Le dessin, ou tout autre support, qu’importe, ne vient qu’après.
Il regarde le garçon au sweat vert, toujours avec ce sourire.
Et ça repart :
—Un sosie de Bill Gates : Un producteur.
—Une fille avec une énorme rose rouge en tissu coincée derrière l’oreille : Un forain.
—La déléguée : Un bâtisseur.
—La fille à la fleur, encore : Un homme de spectacle.
—Walt : On ne dit pas que du bien de moi… ne soyez pas timides…
—Un gars avec un accent italien et une chemise en molleton, la cinquantaine : C’est plus d’un mot, mais : « Un patron exigeant avec ses employés ».
—Une jeune et jolie brune, assise à côté de l’Italien : Trop.
—Le pull-over fuchsia : Un homme cynique.
—La déléguée : Un homme trop perfectionniste, torturé par la dépression.
—Valérie Benguigui : Un gars qui rêve debout.
—La déléguée : Oui, mais un gars qui a bossé pour rendre ses rêves possibles… pour les créer.
—Le petit nouveau : Un gars qui a transformé les poussiéreux livres de contes en films sur grand écran, puis qui a transformé la fête foraine en…
—Walt : Waltland ?
—Le petit nouveau (des étoiles dans les yeux) : Oui !
—Walt : Oui, je suis tout ça. Le bon et le mauvais. Vous auriez pu ajouter, comme d’autres avant vous n’ont pas hésité à le faire : « un puritain », « un conservateur ». « Un amoureux du progrès » ou « un créateur d’utopie ». Tout cela est vrai.
—Miss Lili: Hum hum.
—Walt: Oui, Miss?
—Miss Lili : C’est l’heure du quart d’heure biographique…
—Walt : Il le faut ?
—Miss Lili : Oui ! Il le faut.
—Walt : Je crains que ce qui va suivre ne soit très hautement narcissique, il va falloir apprendre d’emblée à me le pardonner. Le minimum syndical (Walt pose un regard appuyé mais rieur sur l’Italien), juste de quoi poser quelques balises, je vous le promets.
Représentez-vous le Chicago du tout début du siècle passé… 1901, exactement. Je nais de l’union de Flora et d’Élias. Nous vivons d’abord dans une maison bâtie par mon père lui-même. J’ai trois frères aînés, Herbert, Raymond et Roy (qui a huit ans de plus que moi) ; lorsque j’ai 2 ans, une petite sœur vient compléter la famille : Ruth. Deux ans plus tard, nous déménageons pour une ferme à Marceline, Missouri. Puis, en 1911, la famille pose ses valises à Kansas City et je suis mis au travail. Avec mon frère Roy, nous secondons notre père, qui est devenu distributeur de journaux, chaque matin, dès 4 h 30. Peu de temps pour les devoirs, donc. Mon enfance est quelque peu faussée, beaucoup trop précocement interrompue. Comme ça a été le cas pour beaucoup d’artistes, peut-être.
Nous sommes élevés dans une véritable austérité avec pas mal de sévérité. Il n’y a que deux livres à la maison : la Bible et un recueil de vieux contes européens. Nous n’allons pas au cinéma, pas au spectacle. C’est réprouvé par mon père, à l’instar de l’alcool, du tabac ou du chewing-gum.
J’obtiens mon certificat d’études, six ans plus tard, et effectue quelques petits boulots. J’ai, à cette époque, déjà réalisé quelques croquis humoristiques pour le journal de l’école. Mais ce qui m’intéresse vraiment, c’est la guerre qui se déroule en Europe. Sur mes papiers, je falsifie mon année de naissance pour pouvoir être incorporé. En un coup de correcteur, je n’ai plus 16 ans, mais 17. On est déjà dans l’après-guerre, mais l’Europe a besoin d’ambulanciers. J’arrive au Havre en novembre 1918.
Lorsque je rentre au pays, en septembre 1919, je suis décidé à devenir artiste et je décroche un job dans un studio publicitaire. J’y fais mes débuts dans le cinéma d’animation, passe mon temps libre à la bibliothèque et suis des cours du soir aux Beaux-Arts. Très vite, j’emprunte une caméra pour faire mon premier dessin animé dans un cagibi derrière la maison.
Vite aussi, je recrute quelques autres passionnés pour m’aider. Vite encore, le 23 mai 1922, à seulement 20 ans, je fonde mon entreprise avant de déménager à Hollywood, chez un oncle, pour être réalisateur. Là, personne ne veut de moi, alors je transforme le garage de mon oncle en un studio. Et j’appelle Roy à la rescousse, pour qu’il me seconde ; dès lors, c’est lui qui s’occupera des histoires de sous.
Les choses se mettent en place et grandissent. Je tombe amoureux aussi, d’une jeune femme qui peint les celluloïds pour le Studio, Liliane. On se marie. C’est une époque plutôt prospère, nous réalisons les Alice Cartoon, des courts-métrages mi-prises réelles, mi-dessins, inspirés d’Alice au pays des merveilles. J’aime le dessin, mais c’est la scénarisation et la réalisation qui me passionnent… Déjà. Ensuite, je travaille sur une série avec un personnage récurrent, Oswald le joyeux lapin, qui connaît un petit succès, mais mon distributeur me vole mon personnage ainsi qu’une bonne partie de mon équipe.
Walt marque une pause. Respire, ménage un petit suspense et reprend.
Il me faut une nouvelle créature : Mickey naît en 1928. Je voulais absolument un truc en plus pour me démarquer des autres cartoons. Je vais miser sur le son. Steamboat Willieest le premier dessin animé avec son synchronisé. Je donne ma voix à Mickey, lui m’apportera la célébrité.
Mais je suis bien ingrat : sitôt ma souris adulée, je m’en lasse et rêve de nouveaux défis. Saute de projet en projet… Liliane et moi vivons une vie exaltante et lorsque le désir nous vient d’avoir un enfant, elle fait deux fausses couches. Cet épisode fait apparaître un pan inédit de ma personnalité… en 1931, je sombre dans une dépression qui sera aggravée par une blessure consécutive à une chute de polo.
Après le son, une nouvelle inspiration providentielle me pousse à miser sur le technicolor, que j’exploite pour la première fois sur les courts-métrages des Silly Symphonies. Troisième révolution à mon actif, je vais opter pour le long-métrage. Blanche-Neige. Un pari plus que risqué… mais ça, nous en reparlerons un autre jour...
—Walt : Ai-je tout dit, Miss Lili ?
—Miss Lili : Ce que l’on vous reproche…
—Walt : Oui… Je vous ai cité, plus tôt, « mes détracteurs »… Que me reprochent-ils ?
D’aucuns résument mes films ainsi : un joli et charmant prince tombe amoureux d’une princesse tout aussi jolie et charmante. Il leur arrive des malheurs, mais invariablement, ils finissent par s’en sortir, se marier et faire de jolis enfants princiers. Des histoires avec dedans des feux d’artifice de couleurs, des yeux étoilés, de jolies chansons, des beaux gosses et surtout, diront certains, des happy ends.
Toutes choses qui mettent enfants et parents en joie. C’est affreux, rendez-vous compte !
L’objet de ce séminaire est que mes histoires s’inspirent parfois, souvent, de contes qui ne finissent pas vraiment de la même façon.
Clairement, on me reproche d’ « édulcorer », de « dénaturer », d’ « américaniser », de « mièvriser » voire de « violer » ces contes qui m’inspirent, et leurs auteurs d’origine… et ce, pour les faire correspondre à un idéal populaire. On emploie une expression dont vous ne m’avez pas affublé tout à l’heure, celle de « poète d’usine ».
Ces contes « originaux » sont souvent traumatisants et cruels… je les rends alors moins pénibles et sanglants. Pour autant, mon travail de scénarisation est loin d’être fait à la légère, et c’est ce que je vais tenter de vous montrer.
Oui, lorsque je travaille sur un film, c’est dans l’espoir qu’il plaise… au plus grand nombre. Pas pour que cela rapporte, mais pour que le plus de gens possible puissent en profiter. Pourquoi la beauté des contes ne serait-elle plus là que pour les happy few, que pour quelques intellectuels poussiéreux ?
J’imagine que tout cela se discute, mais j’aimerais tout de même faire admettre que mes films bercent les enfants et font rire les adultes sur plusieurs générations, quasiment à l’échelle planétaire. Mes films sont universels et remuent un univers féerique, empli d’espoir. A priori, personne n’en est tout à fait vierge. Votre diversité face à moi aujourd’hui me pousse, encore une fois, à le croire.
En fait, il m’est avis qu’on m’aurait tout autant critiqué si j’étais resté fidèle aux versions originales. Plus critiqué, sans doute, et je ne serais pas ici pour vous en parler.
Je vais m’attacher à me pencher sur les œuvres dites originales. Ces histoires qui, vous en conviendrez, n’assurent pas aux enfants de doux rêves, mais étaient plutôt faites pour garder ces bambins dans le droit chemin ou pour les avertir de la férocité du monde. Vous le verrez, certaines « versions d’origine » surprennent le contemporain, surtout du fait de ses ingrédients : morts violentes, viols, cannibalisme et autres tortures.
—Miss Lili : Hum hum.
Walt lève un sourcil, amusé.
—Walt : Oui ?
—Miss Lili : Peut-être quelques mots de plus sur ces contes dont s’inspire un nombre important de vos films…
—Walt : Mais certainement. Il s’agit d’un pan de notre culture littéraire. Un pan de notre patrimoine que l’on dit ou croit souvent « destiné aux enfants ». Il s’agit surtout, selon moi, d’un univers passionnant… que l’on soit un enfant ou non. On entend « Il était une fois… » et, tout de suite, on sait qu’on va croiser une princesse qui ne sait pas encore qu’elle l’est, un petit garçon volontairement oublié dans la forêt, et puis un méchant : une sorcière ou un ogre.
Il fut une époque où les contes étaient accessibles à tous, connus de tous. Ils faisaient partie de ce qu’on appelle « la tradition orale ». Les contes étaient transmis de génération à génération, de grand-mères à petits-fils. Chacun connaît plusieurs versions d’un même conte et tout le monde trouve cela très naturel. Chaque conteur modifiant l’histoire à sa guise, l’adaptant ou superposant plusieurs versions entendues. Le tout donne une manne quasi organique, vivante, qui évolue en permanence et partout. Il est quasi impossible, dans la majorité des cas, de donner une origine précise et unique à un conte donné.
La tradition orale a décliné peu à peu. Pour pallier à la disparition des contes, certains choisissent alors de les coucher sur le papier. Ce sera le cas du Français Charles Perrault au XVIIe siècle, l’un des premiers. L’un des premiers aussi à donner une véritable « dimension morale » à ces récits.
Charles Perrault
Naissance : À Paris en 1628.
Carrière : Perrault est l’un des auteurs français les plus importants du XV 1 1e siècle. Il est connu pour prendre part en tant que leader des “Modernes ” à la fameuse Querelle des Anciens et des Modernes.
Les contes : Une part importante de sa carrière consiste en la collecte et la retranscription des contes de la tradition orale française. Il est le premier penseur du conte merveilleux en tant que genre littéraire.
Œuvres : Son écrit le plus célèbre est Les Contes de ma mère l’Oye, aussi appelé Histoires ou contes du temps passé, paru en 1697.
—Miss Lili : Hum hum.
—Walt (le rire à l’œil) :Oui, bien sûr. Miss Lili veut que je vous fasse remarquer que les pages qu’elle fait apparaître sur l’écran derrière elle, grâce à son merveilleux rétroprojecteur, sont toutes reprises dans votre exemplaire du polycopié du cours. Inutile de sortir votre smartphone pour les photographier, donc. Trêve de bureaucratie, allons-y.
Il me faut aussi citer les allemands frères Grimm, les plus connus, les plus repris, et le Danois Andersen au XIXe siècle. Le conte écrit reste alors très populaire et répandu.
Les frères Grimm
Vie : Jacob et Wilhem sont nés à la fin du XV IIIe et morts au milieu du XIXe siècle.
Contes : Dès 1806, ils recueillent et fixent les textes des contes populaires racontés aux enfants. Un trésor selon eux menacé de disparition. Ils débutent leur collecte dans leur région puis envoient des correspondants chercher des histoires en Hasse, Basse-Saxe, Westphalie, Autriche et dans les Sudètes. Ils mixent souvent plusieurs versions et ont tendance à couper les détails trop crus.
Inspiration : Ils font un important travail de collecte mais se réfèrent surtout à Marie Hassenpflug (une célèbre conteuse contemporaine et compatriote, mais d’origine française) pour le domaine allemand. Certains de leurs contes ressemblent beaucoup à ceux de Perrault : Cendrillon et La Belle au bois dormant, par exemple. Ils s’éloignent souvent de lui, par contre, au niveau de leur ton, empreint de poésie étrange et mixant réalisme et fantastique ainsi qu’ironie et cruauté.
Œuvres : Les Contes d’enfants et du Foyer sont publiés en 1812 et 1815, ils sont complétés par un volume supplémentaire en 1822 constitué de notes et de variantes de certains contes.
Portée : Leur œuvre ne se cantonne pas aux contes, ce travail de retranscription s’inscrit dans une réflexion plus large, un travail de recherche sur leur langue et leur culture. Ils entament même l’écriture d’un dictionnaire de langue allemande qui sera achevé après leur mort.
—La déléguée : Pas de diapo pour Andersen ?
—Walt: Deux cours entiers lui seront consacrés, un peu de patience.
Vous l’aurez compris, j’ai un grand amour des contes et je pense avoir apporté ma pierre à l’édifice dans ce travail de transmission. Ils sont un puits sans fond d’histoires à adapter. Je crois avoir su saisir l’essence des contes que j’ai exploités. Beaucoup des choses que j’ai mises en place sont encore copiées aujourd’hui : le dessin animé et les livres pour enfants continuent à exploiter ces histoires actuellement, mais je suis aussi à l’origine de plusieurs évolutions techniques et pratiques. C’est moi qui, par exemple, invente le story-board, une espèce de BD qui permet de visualiser un film plan par plan avant même sa production.
Je ne sais pas vraiment si mon amour de l’Europe a initié mon amour du conte ou si, à l’inverse, l’amour du conte a fait naître l’amour de l’Europe en moi, mais ces deux amours sont liées. La culture populaire européenne me fascine : les contes, mais aussi les fables, légendes et romans… Logiquement, un grand nombre de mes longs-métrages, et ceux réalisés par mon Studio après ma mort, racontent des histoires à l’origine européenne.
—La déléguée : Par exemple ?
—Walt:Ils sont très très nombreux… Allez, quelques exemples :Blanche-Neige, Pinocchio, Cendrillon, La Belle au bois dormant, Peter Pan, Merlin l’Enchanteur. Mais aussi La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Le Bossu de Notre-Dame, Raiponce et La Reine des Neiges.
Après mon retour de France à la fin de la Première Guerre mondiale, je traverserai l’océan à la moindre occasion, toute ma vie, pour me gorger d’Europe.
—La fille au pull-over fuchsia : Pourriez-vous nous parler plus longuement de ce premier voyage, s’il vous plaît ?
—Walt : J’accoste au Havre juste après la signature de l’Armistice, puis, pendant un an, je sillonne le Nord de la France et un petit bout d’Allemagne. Tout y est différent. Tout est patiné, comme là depuis des siècles. J’ai une impression de nouveauté, mais aussi de déjà-vu, car ce sont les lieux qui ont inspiré les contes que ma mère me racontait. Je retrouve des images de mon enfance à chaque clocher, rue sinueuse, muret en pierre, pigeonnier abandonné ou château en ruines que je croise. J’imagine en ces lieux les princesses, les enfants intrépides, les rois barbares et les animaux doués de parole. Ces histoires n’étaient pas nées nulle part, mais ici !
Tout cela se trouvait là-bas et, en rentrant, je me suis donné pour mission de le faire savoir à l’Amérique. À chaque fois que j’y reviendrai par la suite, je rentrerai au pays les bras chargés de livres d’illustrations. Et j’engagerai régulièrement des artistes européens.
Je contredis ceux qui affirment que j’ai appréhendé cette culture de l’Europe à la légère. Je la trouve capitale et captivante. Je l’ai traitée à ma manière, bien sûr, sans doute à travers le prisme de ma culture américaine – comment faire autrement ? – mais mon travail est un hommage, non un pillage.
Un hommage que j’entends rendre par un mode d’expression donné, le cinéma. Septième art qui, depuis sa création, adapte des histoires de tous poils, puisées dans tous les genres littéraires. Notamment les contes.
—Miss Lili : Hum hum.
—Walt(à l’auditoire) : Il semble que Miss Lili veuille intervenir. (Se tournant vers elle, un demi-sourire aux lèvres) : Oui ?
—Miss Lili : Il ne faudrait pas oublier le chapitre « J’ai sauvé le genre du conte en le transposant au cinéma », maintenant. L’heure tourne.
—Walt : Il le faut ?
—Miss Lili : Il le faut.
—Walt : Il s’avère que le cinéma a relancé le genre du conte. En le faisant connaître auprès d’un public large, à nouveau. Et puisque c’est moi qui ai popularisé les contes portés à l’écran, en proposant des adaptations d’animation en long-métrage…
—Miss Lili : C’est un succès qu’il faut porter à votre crédit.
—Walt : Merci…
Depuis le début du XXe siècle et jusqu’à ce que je réalise mon premier long, le genre du conte de fées est menacé de… poussiériture. Il est en danger. J’ai eu cette intuition que le cinéma était la solution, le mode d’expression parfait, pour remédier au problème. Le moyen pour redonner au conte son caractère populaire, lui faire toucher le plus de gens possible.
C’est la modernité du cinéma qui fait que les enfants d’aujourd’hui sont toujours en contact avec le conte, même si les principaux intéressés n’ont pas la notion de cela. Peut-être même qu’il reconduit certains à la lecture.
Je suis l’un des premiers, je pense, à envisager la culture différemment. Avec moins de gravité et de complexes. Avec irrespect, pensent certains, manque de goût. Je répondrais que l’irrévérence est rock and roll tandis que le respect est plus du côté de la constipation ou de la surgélation… selon moi, nos patrimoines valent mieux qu’un flacon de formol.
Walt se retourne alors vers Miss Lili et son bureau. Il prend une bouteille d’eau qui s’y trouve et boit quelques gorgées. Après un sourire à son assistante, il se retourne. Après un sourire à l’assemblée, il reprend.
Évidemment, adapter des contes au cinéma n’a rien de simple et avoir l’idée n’a pas suffi. Les narrativités sont différentes. Le film montre, là où le conte raconte. Le film a un espace-temps plus réduit, il faut condenser, couper, sans perdre la cohérence. Le copier-coller n’est pas permis.
Et puis, surtout, la magie du conte est amenée par le merveilleux et le caractère flou du lieu où se déroule l’action… cela vient buter contre le réalisme cinématographique. Les lieux et les protagonistes sont des archétypes sans appartenance à aucune époque, sans traits réels. Chacun imagine les personnages qu’on lui raconte. La transposition sur écran est nécessairement une trahison et, pour qu’elle soit acceptée, il faut qu’elle soit meilleure que celle que le spectateur s’est imaginée.
Miss Lili s’agite à nouveau, complètement ignorée par Walt. N’y tenant plus, elle se lève et se met à chanter à toute voix :
—Macho macho mannnnnn. I gotta be a macho man.
La salle s’embrase d’un rire, éberluée.
—Walt : Très bien, Miss Lili me rappelle que j’ai oublié d’aborder un autre point, une chose qui m’a été reprochée, elle aussi. Mon machisme.
J’aurais tendance à véhiculer une certaine représentation sociale… machiste – comme vous pouvez le constater, l’édulcoration n’est pas la seule critique que l’on m’adresse.
Un monde où de jolis héros combattent de laids méchants et triomphent de missions qui semblaient impossibles, pour aboutir, invariablement, au bonheur. Un monde où le bien l’emporte toujours. Dans ce monde, le seul but de toute fillette est de se trouver un Prince Charmant.
Alors oui, mesdemoiselles et mesdames, je vous ai fait rêver et croire au Prince Charmant mais n’est-ce pas cela qui vous permet aujourd’hui de vous rebeller et de vouloir autre chose ?
Il faut l’avouer, je reprends une vision de la condition féminine qui date de l’époque où les contes ont été retranscrits pour la première fois. On parle donc du XVIIe ou du XIXe siècles, époques monarchiques. Pour tout dire, cette « condition » ne semble guère avoir évolué au moment où je réalise mes films. Et je reprends les codes sans davantage les modifier. D’ailleurs, ils ne correspondent pas mal à la société moraliste à l’américaine... dont je suis le fruit. J’y vivais et les miens m’ont toujours semblé y être heureux. Une société patriarcale où règnent en rois les paters familias vénérant le travail et le mérite, auprès de femmes dévouées.
Mes « princesses » répondent à l’idéal féminin d’une époque. Un idéal passéiste et conservateur, oui, mea culpa.
Un sourire et il reprend.
Ce séminaire va donc vous emmener dans l’univers pas si merveilleux des contes. Parce que, je le rappelle, les contes, à leur origine, ne sont pas que pour les enfants. De même, je ne fais pas des films qui leur sont uniquement destinés.
Les contes, ceux de Grimm par exemple, n’étaient nullement réservés à un public précis. Jacob et Wilhelm avaient exigé que la phrase « contes pour les enfants et la maison » soit retirée des couvertures de leurs livres. Andersen offre des fins quasi systématiquement tragiques. Même Charles Perrault, pourtant coutumier des happy ends, sert une fin des plus abruptes au Petit Chaperon Rouge, puisque cette dernière finit dans l’estomac du Grand Méchant Loup. Le mélange d’histoires aux fins heureuses ou cruelles permet à l’enfant d’appréhender la vie dans son ensemble et de répondre à ses questions.
De la même façon, vous trouvez dans mes films du noir et du funeste, même s’ils ont tendance à finir tout de rose vêtus. Oui, ma préférence va à la lumière, le monde est naturellement assez moche. Nul besoin d’en rajouter. J’aime les bonnes histoires, celles où l’on rit, où l’on voit le beau, où l’on frissonne aussi, mais où l’on finit sur une note positive.
—La déléguée de classe : Et que pensez-vous des travaux de Bruno Bettelheim ?
—Walt : J’attendais cette question. Je ne vais pas pouvoir me passer de lui dans ce séminaire, bien sûr.
Je le resitue pour tout le monde. Bruno Bettelheim est un psychologue américain. Il enseigne au département de psychologie de notre université depuis une vingtaine d’années – il est décédé en 1990. De son vivant, en 1976, il publie un livre sur les contes de fées. Bettelheim sera accusé de plagiat et décrié pour sa personnalité, ce n’est pas ce qui m’intéresse.
Ce qui m’importe, c’est qu’il inaugure une question captivante, celle d’une seconde lecture possible des contes. Bettelheim détricote les contes et y retrouve les grands schémas qui agitent la psychanalyse : le complexe d’Œdipe, les concurrences fraternelles, la découverte de la sexualité… ces choses que traverse tout enfant sur la route de l’âge adulte.
Selon Bettelheim, les contes sont des mises en scène de ces « épreuves » obligatoires dont les enfants vont devoir s’acquitter. Je pense avoir compris tout cela quarante ans avant ce monsieur, mais lui l’a écrit noir sur blanc. Le manichéisme est là pour construire l’enfant. Manichéisme que je considère comme une ligne de conduite.
Je suis comme Bettelheim, je pense que les contes aident à la construction du psychisme de l’être humain… ils permettent l’accès aux archétypes.
—Le nouveau : Archétype ?
—Walt : Une perception culturelle inconsciente qui correspond à une civilisation donnée, à la civilisation dans laquelle un enfant particulier se trouve. Un archétype est commun à tous les enfants d’une même civilisation.
—Miss Lili : Peut-être que donner quelques exemples d’archétypes aiderait à la compréhension de chacun…
—Walt : Je me tourne à nouveau vers vous. Qui a un exemple d’archétype ?
—Le pull-over fuchsia : Le Prince.
—La fille à côté : La Princesse.
—Valérie Benguigui : La grand-mère, celle qui raconte les histoires…
—La déléguée : le Roi, le vieux sage…
—Un nana avec des tresses tendues à la Fifi Brindacier (la coupant) : Le dragon !
—Walt : Voilà voilà, très bien. Je pense qu’ils comprennent de quoi il s’agit, Miss Lili.
Ce sont ces personnages que l’on retrouve dans les récits et qui se complexifient, prennent de nouvelles caractéristiques, à chaque récit. Des personnages que chacun connaît et qui ont un pouvoir évocateur fort.
À la fin du dossier que Miss Lili vous distribuera à la fin de cette heure, vous trouverez une bibliographie reprenant les écrits de Monsieur Bettelheim et toutes les lectures qu’il serait intéressant de faire pour ce cours. D’autres choses que j’ai oublié d’ajouter, Miss ?
—Miss Lili : Deux à vrai dire. Vous n’avez pas insisté suffisamment, à mon sens, sur votre américanisation des choses. Ni sur le fait que le séminaire va aborder non seulement les contes d’origine, mais aussi certaines adaptations postérieures aux vôtres…
—Walt (rieur) : Eh bien vous avez tout dit… Non, je développe un peu ?
Mes films sont pour beaucoup inspirés de ma passion pour les vieux contes européens, je n’en suis pas moins américain, cela laisse aussi des traces dans mes films : une tendance à l’optimisme et à la pétulance en plus de références populaires issues du Nouveau continent.
—La déléguée : Pétulance…
—Walt : Que dit votre Larousse, Miss Lili ?
Elle sort un gros volume, feuillette les pages un instant, trouve ce qu’elle cherche…
—Miss Lili : « Vivacité impétueuse, difficile à contenir. »
—Walt : C’est sans doute le mélange de ces deux ingrédients particuliers, les contes intemporels européens et la culture américaine, qui font que mon travail n’est pas fait pour un public donné à un moment donné. N’est-ce pas cela, l’art ? Mes films ne continuent-ils pas à émerveiller, à donner du plaisir à des enfants ou à ceux qui les ont vus enfants ?
Mon cours s’arrêtera aussi sur les adaptations postérieures à mes films. Mes films et moi sommes toujours très présents dans l’imaginaire collectif mondial. Et j’ai participé aussi à faire évoluer les contes. Il y a donc des traces de mes films dans les adaptations contemporaines. Dont certaines n’ont nulle peur de la transgression : d’aucuns verraient d’un bon œil que la vilaine belle-mère l’emporte sur Blanche-Neige ou sur Cendrillon !
On observe depuis quelques années un retour en force de ces adaptations de contes, en prise de vue réelle surtout. Réalisés par mon Studio ou par d’autres. Ces réadaptations sont globalement plus sombres, revenant là d’où elles étaient parties. Certaines pour le meilleur, d’autres pour le pire.
Les contes inspirent encore.
Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous dans une semaine !
Deuxième heure
Qui craint le grand méchant loup ?
Dans l’auditoire, une nouvelle fois, Miss Lili est aux prises avec son rétroprojecteur. Le Maître de cérémonie, Walt, regarde les rangées se remplir. Chacun s’installe quand, chut !, ça commence.
—Walt : Bonjour à tous. Ce cours consistera en un petit préambule… avant que Blanche-Neige ne croque la pomme. Aujourd’hui, nous allons nous arrêter sur deux utilisations de contes antérieures à mon premier long métrage : Les Trois Petits Cochons et Le Petit Chaperon rouge.
Ces deux dessins animés sont extraits des