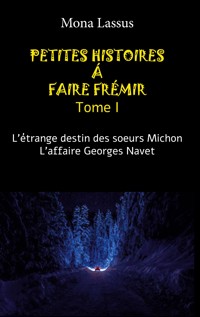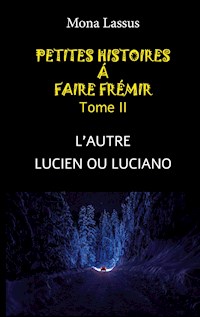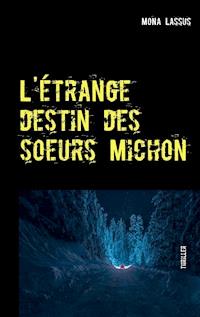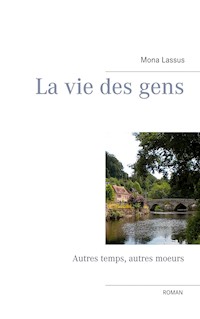
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La vie des gens est une saga familiale. L'histoire se poursuit, de génération en génération, à travers celle d'un petit bourg vendéen depuis le milieu du dix neuvième siècle jusqu'aux années mil neuf cent quatre vingt dix. D'aventures parfois burlesques en drames, il se passait de drôles de choses, dans ce village et on y croisait de bien curieux personnages. Deux guerres, Les tranchées,l'occupation allemande, la résistance, le maquis, firent vivre aux habitants du bourg des aventures haletantes dont le danger n'était pas exclu. Dans les années cinquante, de grands changements vinrent bouleverser la vie des Chevalier. Plus tard, les rêves de Jeanne furent brisés. Ce roman se veut être le témoin de temps et de coutumes révolus, de traditions d'un autre âge à jamais perdues.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PRÉFACE
C’est une saga que nous présente ici Mona Lassus. Nous suivons, dans son récit, la vie de quatre générations au Cœur du marais poitevin tout au long du 20ème siècle. Trois aspects sont à détacher dans ce roman :
L’aspect humain puisque, dans un style simple et détaillé, l’auteure nous fait partager la vie de la famille Chevalier, depuis l’arrière-grand-mère, qui lavait encore au lavoir le linge des familles bourgeoises jusqu’à l’arrière-petit-fils devenu médecin. Avec une chronologie précise, nous vivons les amours, les mariages, les naissances, les deuils de “ces gens” qui ne possèdent ni de titre ni de faire valoir mais auxquels nous pouvons adhérer en tant que miroir de nous-mêmes.
L’aspect historique, puisque l’auteure nous renvoie en fond de tableau l’image de la France dans les campagnes depuis le début du 20ème siècle en suggérant l’impact de la grande guerre ainsi que les conséquences de l’occupation auprès des populations. Nous retrouvons, dans son roman, tant les actes de bravoure que la médiocrité des gens dans une France vaincue.
L’aspect sociologique, puisque toute l’action se déroule dans un petit village du marais poitevin.
“La vie des gens” sert de fil conducteur dans l’observation des changements qui se produisent à l’intérieur de ce village. L’introduction de nouvelles techniques, l’amélioration des conditions de vie après la seconde guerre mondiale, l’accès à la connaissance modifient profondément le paysage et les relations humaines.
Le microcosme de ce village vendéen, si éloigné de la capitale, subit une métamorphose résultant de la fracture des deux guerres, des changements sociétaux et des progrès techniques de la deuxième moitié du 20ème siècle.
C’est en quelque sorte l’histoire de nos parents et de nous-mêmes, enfants de l’après- guerre, que nous retrouvons.
C’est un livre chargé d’humanité, écrit dans le langage des gens, de ceux que nous croisons tous les jours, ceux qui nous ont construits.
Faudrait-il voir, dans la fin de l’histoire, une perte du sens de la vie, une difficulté à être dans un monde qui, à travers ses changements, a peut-être perdu ses repères ?
Liliane CAUMONT Professeur de Français Artiste Sculpteur
Cette histoire est imaginaire.
Toute ressemblance avec des personnes, lieux ou événements existant ou ayant existé, ne serait que pure coïncidence.
Nous tenons de notre famille aussi bien les idées dont nous vivons, que la maladie dont nous mourrons.
Marcel Proust (1871-922)
Généalogie
Famille CHEVALIER
Mme Vve Chevalier
Fille ainée, fille cadette, JULES
Léon GERBAULT
MAURICETTE
JULES et MAURICETTE
Gabrielle, Suzanne, MARCEL
POMPON
JEANNE
MARCEL et JEANNE
PAUL
PAUL et Marie - Hélène
Gilles, Valérie
Famille FALGUERIE
Marie-Paule et Edmond FALGUERIE
MICHELE Jean-Louis Anne-Marie
Les personnages principaux figurent en écriture grasse.
TABLE DES MATIERES
La laverie
La guerre de Jules
Le renouveau
La vie du bourg
L’auberge du pont
Marcel
L’occupation
Jeanne
La rencontre
Le mariage
La naissance et le baptême
L’incendie
Un nouveau départ
L’enfance de Paul
Le chemin de Paul
La descente aux enfers
La délivrance
Epilogue
LA LAVERIE
Ce matin du 25 janvier 1924, Jules fêtait ses quarante ans.
Levé dès l’aube, il avait fait une longue promenade dans les rues du village, musardant dans l’air frais du petit matin. Ce village, qu’il chérissait, riche d’histoire, était planté aux abords du Marais Poitevin. La Vendée le traversait de part en part, tantôt grossie des pluies du printemps, tantôt simple ruisselet courant en gazouillant au centre de son lit, avec ses rives joliment bordées de saules pleureurs ; le paysage appelait à la rêverie ; Jules avait toujours aimé s’y balader. Il prenait un grand plaisir à flâner le long de la berge en sifflotant, le nez au vent, humant les senteurs de terre mouillée, de feu de bois et de châtaigne, les mains enfoncées dans les poches de son pantalon. Il remonta lentement vers la grand ‘rue en zigzagant d’un arbre à l’autre, en cette saison déshabillés de leur feuillage.
Dès le printemps, les dimanches après-midi, les villageois se réunissaient sur la large berge en pente douce où il faisait bon s’abriter du soleil. Pendant que les jeunes s’ébattaient dans l’eau fraiche en s’aspergeant, les anciens goûtaient une sieste réparatrice sous les frondaisons, après les agapes du repas dominical copieusement arrosé.
Cette journée s’annonçait bien. L’eau calme reflétait les premiers rayons du jour au travers d’une brume légère qui s’élevait, doucement soulevée par la brise, s’écartait, comme déchirée, revenait et se soulevait encore, tel un voile vaporeux au-dessus de la rivière enjambée par le pont de pierre, que les Romains avaient posé là, au beau milieu du village dont il réunissait les deux rives.
Dans des temps lointains oubliés de tous, quelques hommes préhistoriques s’étaient arrêtés en cet endroit accueillant. Ils avaient cultivé la terre riche et grasse et avaient créé, au fil des siècles, deux hameaux face à face, séparés par la rivière dont ils devaient se partager, bon gré, mal gré, l’abondance de la pêche. Le franchissement de cette frontière naturelle par l’un ou l’autre des deux voisins avait engendré nombre de conflits plus ou moins meurtriers. Une haine intestine s’était perpétrée bien au-delà de la préhistoire et avait même survécu à l’unification des deux rives par la construction du pont. Longtemps, la méfiance et la concurrence ont été vivaces entre la rive gauche et la rive droite, qui donnait lieu, en période d’élections ou de toute autre compétition, à des scènes toutes aussi cocasses que pathétiques.
En ce début de matinée, le soleil pâle d’hiver éclairait les façades de pierre blanche, réparties de chaque côté du pont, le long d’une large rue qui s’étirait jusqu’au champ de foire. Les anciens chemins de halage cheminaient de part et d’autre des berges. Autrefois, une activité intense animait ces sentiers par lesquels les chevaux de trait tiraient les embarcations à fond plat qui transportaient, au fil de la rivière, les récoltes et autres denrées d’un village à l’autre. Aujourd’hui désaffectés, ils donnaient accès aux jardins potagers des riverains. Malgré la fraicheur de la saison, douceur et sérénité émanaient de cet endroit.
Jules s’arrêta, jeta un regard circulaire sur ce paysage dont il ne se lassait pas ; poussant un gloussement de plaisir, il ne put résister à l’envie de ramasser quelques cailloux pour faire des ricochets dans l’eau, comme au temps de son enfance, lorsqu’il prenait le même chemin pour se rendre à l’école.
C’était un homme heureux. Bon vivant, costaud, un peu râblé même, un beau visage aux traits fins et aux yeux clairs, pas tout à fait gris, pas tout à fait bleu, un sourire ouvert sur une rangée de dents bien alignées, lui conféraient un charme quasi irrésistible. Issu d’une vieille famille Vendéenne, il était né dans ce village, y avait passé toute sa vie et avait hérité de sa mère l’entreprise familiale, unique laverie de la région.
Madame Chevalier mère était lavandière. Elle s’était trouvée veuve à trente ans avec trois jeunes bambins à élever. Son défunt mari, de quinze ans son ainé, était mort prématurément d’une vilaine blessure occasionnée par la chute d’une poutre sur un pied, qui n’avait pas voulu guérir malgré les soins apportés par son épouse et le médecin du village. La plaie s’était infectée, la gangrène avait gagné ; l’amputation, pratiquée trop tard, n’avait rien changé à la chose et le malheureux avait agonisé dans d’horribles souffrances. Orphelin et fils unique, il avait légué à sa femme la propriété familiale. Il y avait, groupés autour d’une grande cour centrale, plusieurs corps de bâtiments. La partie principale, construite au siècle passé sur la base de l’ancienne masure des arrières grands parents, avait été agrandie au fur et à mesure que la famille croissait. (On vivait, alors, à plusieurs générations sous le même toit, ce qui ne facilitait pas toujours les relations familiales). La façade de l’habitation s’étendait le long de la grand’ rue, face à la place de l’église. A l’arrière, deux bâtiments formaient un U avec le corps d’habitation. L’un servait autrefois d’étable. Il avait été transformé en atelier de menuiserie par feu Monsieur Chevalier ; l’autre, auparavant grange à foin, servait de remise. L’ensemble encadrait un vaste terrain composé d’un poulailler, d’une cour pavée et d’un potager arrosé par le débit généreux d’un ru qui courait tout du long, débordant l’hiver mais jamais à sec même par temps de canicule ; il prodiguait une bonne récolte de cresson sauvage au printemps et, pour le plaisir des yeux, un tapis de fleurettes et d’iris jaunes.
Le métier de lavandière était épuisant. Madame Chevalier avait commencé à buer1depuis l’âge de douze ans ; comme ses congénères, elle était de très modeste condition. Elle avait vu ses ainées usées avant l’âge par ce dur labeur.
Les lavandières recueillaient le linge sale des maisons bourgeoises dans des brouettes ou des paniers pour le laver au lavoir. Construit dans les années 1860, ce lavoir représentait un grand progrès pour l’assainissement de la rivière qui recueillait les pollutions laissées par les linges et les savons que le courant emportait au fil de l’eau en de longues trainées mousseuses insalubres. Afin de remédier à cet inconvénient, la municipalité avait fait ériger un bassin fermé alimenté par l’eau de la rivière, bordé de dalles de pierres et couvert d’un toit de tuiles plates. Ce bassin gardait à l’abri des intempéries les lavandières qui s’activaient là en toutes saisons. Qu’il gèle ou qu’il fasse chaud, à genoux sur la bordure du lavoir, elles trempaient le linge dans l’eau en l’agitant pour bien l’humecter, le frottaient avec de la cendre et du savon noir, le battaient avec un battoir en bois, puis le tordaient pour l’essorer et, enfin, l’étendaient l’hiver dans la grange, l’été sur l’herbe des prés.
Il fallait les entendre battre et chanter, battre et se chamailler, battre et rire. Dès potron-minet2, alors que le village s’éveillait à peine, elles arrivaient, les brouettes chargées de guenilles3 sales qu’elles déchargeaient devant l’emplacement qui leur était réservé et se mettaient aussitôt à la tâche en s’interpelant, chacune y allant de son histoire, de son ragot ou de son commentaire.
Elles s’interrompaient à midi, lorsque sonnait l’Angélus, pour avaler sur le pouce une frugale collation composée, dans le meilleur des cas, d’une tranche de pain frotté de lard et d’ail, d’un peu de fromage et parfois d’une pomme ou de quelques noix, le tout arrosé de vin aigre ou d’eau. Elles reprenaient leur travail jusqu’à l’Angélus du soir, en été. L’hiver, lorsque la rivière était gelée et que l’eau glacée transformait leurs mains en crevasses douloureuses, elles se dépêchaient de frotter, battre et rincer pour rentrer le plus vite possible se mettre à l’abri.
Elles animaient la berge de leurs battements, de leurs rires, et, parfois, de leurs chamailleries qui engendraient de mémorables crêpages de chignons. Le dimanche, jour du Seigneur, elles assistaient à la messe mais ne buaient pas. Le village semblait alors s’être assoupi tant le silence que laissait leur absence était profond.
Ce métier était sujet à de multiples rites et superstitions et c’est autour du lavoir que se faisaient et se défaisaient les réputations par les cancans qui s’y colportaient. Par exemple, on disait qu’un nouveau-né ne pourrait survivre si sa première chemise ne flottait pas à la surface de l’eau ; au contraire, si elle ne coulait pas, le bambin promettait d'être un solide gaillard pour ce qui était des garçons et une belle plante pour ce qui était des filles ; on faisait une lessive exceptionnelle après un décès, mais on ne mélangeait pas les draps et les vêtements du défunt à ceux des vivants car ils devaient se purifier du mal qui avait emporté le disparu. Une femme ne devait pas buer pendant ses périodes menstruelles ni lorsqu'elle était enceinte, sous peine de gâter la lessive. L’impie qui osait faire la bugade 4 le jour de la Toussaint ou pendant la Semaine Sainte se condamnait à préparer son linceul, celui de son maître ou d’un de ses proches. Une sorcière, à l'instar des gourgandines5 qui n’avaient point les fesses propres, ne parvenait jamais à obtenir des draps d'une blancheur irréprochable. Une jeune fille devrait épouser un ivrogne si elle mouillait son tablier en lavant son linge. On ne lavait jamais pendant les trois jours de jeûne de chaque saison par crainte de rétrécir le linge. Toute ménagère était maudite si elle faisait sa lessive le Vendredi Saint, car il était dit que Jésus aurait glissé dans de l’eau savonneuse répandue par une lavandière sur le chemin de la croix. Lâcher son battoir dans l’eau, laisser filer6 son savon ou un linge était le signe précurseur de calamités… Ces superstitions débordaient largement des régions, colportées par les marchands ambulants de savons et de cendres qui parcouraient la France. Ces interdits et ces croyances infondés donnaient lieu à des angoisses terribles et à des mises au banc de celles qui ne les respectaient pas.
Madame Chevalier n’était pas femme à s’en laisser conter. Elle se fichait pas mal des superstitions et des ragots.
Outre par les lavandières, le lavoir était occupé par les ménagères qui battaient bon train leur linge en ragotant, leurs marmots s’égayant sur la berge au risque, à tout instant, d’en voir un piquer une tête dans l’eau glacée, ce qui arrivait parfois. Il y avait alors un grand fracas de cris hystériques jusqu’à ce qu’on ait réussi à repêcher l’imprudent sain et sauf, suivi de lamentations mêlées de sanglots lorsque le pauvre bambin s’était noyé, faute de surveillance. L’inconfort, les bavardages de l’endroit et le temps qu’elle perdait à surveiller ses rejetons ne convenaient pas à Madame Chevalier. Pour améliorer ses conditions de travail, Monsieur Chevalier avait construit, en bordure de la grange, un préau abritant une pompe ; par un ingénieux système de goulotte, celle-ci permettait d’alimenter une sorte de cuve à plan incliné à hauteur de bras, propre à laver le linge sans se casser le dos et sans mettre la vie des enfants en danger. Dans la grange débarrassée et nettoyée, il avait installé une cheminée au large foyer surélevé, équipé d’un trépied en fonte sur lequel on plaçait une lessiveuse. Madame Chevalier exerçait son métier dans cet endroit confortable, les petits sagement gardés dans le jardinet clos l’été, dans la grange à bonne distance de la cheminée et des lessiveuses emplies d’eau bouillante, l’hiver.
Maîtresse femme, elle s’était fait une réputation de bonne et sérieuse lavandière et avait recueilli la clientèle des grosses maisons du voisinage. Le travail affluant, elle avait embauché deux compagnes et fait aménager la grange en buanderie avec une deuxième cheminée. Dans les foyers, de grandes lessiveuses, sortes de marmites équipées d’un double-fond perforé, prolongé d’un tube creux et d’un pommeau ressemblant à une pomme d’arrosoir renversée, chauffaient du matin jusqu’au soir. L’eau bouillante, additionnée de copeaux de savon mélangés aux cendres destinées à rendre le linge plus blanc, montait le long du tube et, par le pommeau, arrosait le linge. L'eau redescendait, remontait à nouveau et ainsi de suite. Ce brassage à lui seul suffisait à enlever la plupart des salissures, mais il restait encore bien des taches à nettoyer à l’aide de la brosse chiendent, de savon noir et d’huile de coude.
Il régnait, en ce lieu, une ambiance particulière, avec sa chaleur moite, presqu’insupportable en été, ses odeurs de feu de bois, de savon chaud et de linge humide, sa musique composée du glouglou incessant des lessiveuses, mêlé aux chuintements de l’eau, au fracas des battoirs, aux bavardages et aux rires des deux ouvrières. Deux autres lavoirs avaient été ajoutés dans la buanderie et, dans le prolongement de la bâtisse, un grand hangar servait de séchoir entre les parois duquel on avait tendu des cordes destinées à l’étendage des linges mouillés. Ces enfilades de draps immaculés, légèrement agités par le courant d’air bruissant, l’odeur de linge propre, l’immensité du lieu, faisaient de chaque incursion une aventure extraordinaire pour les enfants qui prenaient plaisir à se faufiler entre les rangées odorantes et humides en prenant garde de ne rien salir. Toute trace suspecte était suivie d’une punition détestable : à l’aide d’une brosse deux fois trop grosse pour leurs petites mains, ils devaient, tous les trois ensembles, car ils étaient collectivement jugés coupables d’avoir joué à cache-cache dans ce lieu interdit, relaver et frotter le linge sali jusqu’à ce que leur mère juge que la blancheur était redevenue absolument parfaite.
Pour compléter son activité, Madame Chevalier avait fait construire une mezzanine audessus de la buanderie. Un atelier de repassage y avait été installé, avec de grandes planches montées sur des tréteaux, des étagères le long des murs et un poêle à tiroir de braises dans lequel brûlaient des copeaux de bois fournis par la scierie voisine. Deux repasseuses œuvraient là à l’aide des fers les plus modernes de l’époque, munis d’un réservoir dans lequel elles plaçaient les braises recueillies dans le tiroir du poêle pour lisser7 certains tissus, ou d’un morceau de métal qu’elles faisaient chauffer à blanc dans le foyer et qu’elles récupéraient à l’aide de longues pinces pour le placer dans le même réservoir. Cette dernière opération était réservée aux effets qu’il était nécessaire de repasser à la patte mouille, c'est-à-dire en appliquant entre le fer et le tissus une étoffe humide, ce qui revient au repassage à la vapeur pratiqué de nos jours. Une boutique avait enfin été ouverte dans la pièce la plus vaste de la maison, ouvrant directement sur la rue principale, face à la place de l’église.
Madame Chevalier avait éduqué ses trois enfants comme elle l’avait été elle-même, dans le respect et la nécessité du travail. Dès l’âge de douze ans, après avoir passé son certificat d’études et fait sa communion, Jules avait été tout naturellement promu homme de la famille. Il avait appris de sa mère, en même temps que ses sœurs, les secrets du métier, pour, peu à peu la remplacer, l’âge ayant eu raison de sa résistance et de sa santé. Ses deux sœurs avaient convolé en justes noces. Jules fut marié à son tour avant son vingtième anniversaire à Mauricette, dix-sept ans, la fille de Léon Gerfaut, le charron.
« Ces deux-là, disait-on, l’avait fallu vit’ fait les unir avant qu’y n’mettent la charrue avant les bœufs, car ça f’sait déjà un bout d’temps que l’Jules tournait autour d’la p’tite, qui, sous ses airs de vierge effarouchée, s’laissait ben conter fleurette en minaudant et n’était pas aussi effarouchée qu’ça, au goût du Léon, son père. Surtout qu’le Jules, c’n’était un s’cret pour personne, l’avait déjà et d’puis longtemps culbuté plus d’un’ fille dans les bott’ de foin. Et c’était miracle qu’il n’ait jamais fait de p’tit bâtard, ou alors, ça n’s’était pas su, car la Mère Pouillet, la r’bouteuse, c’te sorcière qu’on allait quérir tant pour réduire une entorse que pour aider la vache à mett’ bas, était aussi faiseuse d’anges8 et opérait toujours en grand secret ! »
Après leur mariage, les deux sœurs de jules avaient quitté le village pour s’établir dans la famille de leur mari, comme c’était de coutume à cette époque où plusieurs générations vivaient sous le même toit, ce qui n’allait pas sans moult contrariétés. Madame Chevalier avait donné à chacune de ses filles une dot qui consistait en un trousseau de linge de maison complet, un trousseau de linge de corps, trois pièces d’or économisées à grand-peine en prévision de cet événement et un service de vaisselle. L’ensemble était censé représenter la quote-part du partage équitable de l’héritage. En contrepartie, Jules hérita de la maison familiale et de la laverie, ce qui, de toute évidence, était largement supérieur à ce qu’avaient reçu ses sœurs.
Mauricette, jolie brunette aux yeux verts, travailleuse et courageuse, prit la succession de sa belle-mère derrière les lessiveuses pendant que Jules travaillait aux champs, car les seuls revenus du linge sale ne suffisaient pas à faire vivre sa famille. Madame Chevalier Mère était à la charge du couple : de retraite, il n’y en avait pas à cette époque. Elle s’occupait aux tâches de la maison, mais, même si elle faisait de son mieux, il restait encore beaucoup à faire à Mauricette qui aurait préféré qu’elle ne fit rien plutôt que de le faire mal.
La vieille femme était presqu’aveugle et bien des choses lui échappaient. Non pas qu’elle y mettait de la mauvaise volonté, mais de caractère autoritaire, elle ne supportait pas que sa belle-fille lui fasse la moindre remarque ; elle estimait que ce n’était pas la jeunesse qui allait lui apprendre à faire sa soupe ou passer le balai ! Mauricette prenait sur elle pour ne pas donner à sa belle-mère l’occasion de se plaindre à Jules, afin d’éviter les conflits. Il ne pouvait s’opposer à sa mère sans risquer un débordement de mauvaises humeurs, de cris et de pleurs, de reproches d’ingratitude et autres chantages affectifs. Lorsque le couple se chamaillait, ou que Jules faisait une réflexion à Mauricette à cause d’elle, Madame Chevalier mère s’installait dans sa cuisine, au coin de l’âtre, un ouvrage à la main en chantonnant, comme ça, mine de rien.
Dix ans s’écoulèrent ; outre les relations tendues entre la belle-mère et la bru et la naissance de deux fillettes, le couple, à force de travail, avait fait fructifier la laverie. On vivait mieux désormais chez les Chevalier, mais on ne craignait pas sa peine, comme se plaisait à le dire Mauricette. La Grande Guerre mit fin, pour quatre longues années, à ce bonheur.
Jules en était miraculeusement revenu vivant mais estropié et choqué au point de rester des heures allongé dans l’obscurité sans dire un mot, lui qui était autrefois si bavard. Les atrocités qu’il avait vécues au cours de cette horrible guerre revenaient le hanter la nuit. D’affreux cauchemars le laissaient fiévreux et pantelant jusqu’au petit jour où il réussissait enfin à s’endormir d’un sommeil lourd, agité, empli de gémissements et parfois même de cris qui glaçaient le sang de la pauvre Mauricette et lui tiraient des larmes d’impuissance devant la souffrance de son homme. Elle devait faire front, aussi, aux protestations de sa belle-mère qui ne comprenait pas pourquoi son fils mettait tant de temps à se rétablir.
« Car enfin, disait-elle, on est un homme ou une femmelette ? »
Cette bonne Madame Chevalier, dont l’âge avancé n’avait pas réussi à la rendre plus tolérante, commençait à perdre un peu la boule. La situation dépassait son entendement ; rien ne l’avait jamais empêchée de travailler, pas même, comme elle se plaisait à le rappeler, lorsqu’elle avait accouché, seuls instants où elle était restée alitée pour quelques heures, le temps nécessaire, pas plus… Alors que Jules restât si longtemps inactif, pensez donc !
1Lessiver, laver le linge.
2Très tôt le matin.
3 Vieux habits, oripeaux, lambeaux d’étoffe.
4Mot d’origine provençale. Grande lessive.
5 Fille aux mœurs légères, catin, femme de mauvaise vie.
6 Lâcher le savon ou une pièce de tissu au fil de l’eau.
7Repasser le linge.
8Celle qui, par des moyens la plupart du temps archaïques, douteux et dangereux, pratiquait les avortements.
LA GUERRE DE JULES
Le 6 septembre 1918, près de Chauny, petit village Picard, la bataille faisait rage depuis deux jours. Les alliés avançaient et les troupes Françaises, exténuées, avaient trouvé un regain de courage pour repousser l’ennemi vers la ligne Hindenburg. On avait pris, la veille, le village voisin ; le sergent avait encouragé ses gars à donner un dernier coup de collier.
« La victoire est proche sur ces salopards de boches, avait-il affirmé et après ça, mes p’tits gars, on pourra rentrer au bercail ! »
Forts de cette promesse, ils étaient sortis de la tranchée baïonnette au canon et avaient donné l’assaut. En face, les Allemands attaquaient avec la force du désespoir. Les obus pleuvaient, soulevaient des mottes de boue et de fumées nauséabondes, projetaient à la volée leurs éclats meurtriers.
Il avait plu pendant la nuit et la température avait brusquement chuté en ce petit matin. Le sol détrempé collait aux brodequins. Les premières vagues de combattants avaient labouré le terrain ; on s’y enfonçait parfois jusqu’aux chevilles. On ne pouvait s’extirper de ces ornières qu’en tirant fort sur un pied qui se dégageait avec un bruit de succion, un slurp long comme si cette terre gorgée d’eau voulait vous aspirer, pendant que l’autre pied s’enfonçait à son tour. Les brodequins s’alourdissaient de glaise collante jusqu’à en doubler de volume ; l’avancée était de plus en plus pénible avec ce froid qui vous glaçait les os, le manque de sommeil et cette faim qui tenaillait les ventres et les privait de force. Les combattants zigzaguaient à travers les averses de shrapnells, qui, en explosant, criblaient le malheureux poilu de billes d’acier, lui arrachaient les chairs, réduisaient ses os en miettes.
D’un talus à l’autre, d’un abri de fortune, plus illusoire qu’efficace, à un autre, la journée n’avait été faite que de sauts, de rampements, de tractions et de projections brutales au sol pour éviter de se faire trouer la peau. Tout était endolori ; les genoux et les coudes étaient en sang pour avoir trop servi d’amortisseurs aux corps alourdis trainant avec eux le barda, la fatigue et le désespoir. On avait pu grignoter, pendant une courte accalmie, une ration de lard rance et de pain de guerre, ces horribles biscuits moisis par l’humidité. En d’autres temps, ils auraient été qualifiés d’étouffe chrétien mais ils étaient les bienvenus au front, pour calmer la faim, jamais rassasiée par les trop faibles rations et la mauvaise qualité du ravitaillement.
Les compagnons de Jules tombaient comme des mouches dans cette plaine, maintenant totalement à découvert. Plus un talus, plus un buisson ou un simple trou où s’abriter. Le sergent encourageait ses hommes du geste et de la voix en hurlant des ordres que personne n’entendait tant le fracas était assourdissant. Ceux d’en face avaient dû, eux aussi, sortir des frondaisons qui les abritaient et on en était venu, vers la fin de l’aprèsmidi, au corps à corps. La hargne, la volonté, l’instinct de conservation poussaient ceux qui étaient encore debout à se battre pour sauver leur peau. On ne savait plus, d’ailleurs, pourquoi on se battait. Le seul but, en cet instant, était d’atteindre ce bois qu’on apercevait à l’horizon, pour s’y replier et se reposer un peu en attendant la prochaine attaque. Mais pour cela, il fallait éliminer du passage tout ce qui faisait obstacle. L’état-major avait établi son QG dans le parc d’une grosse maison bourgeoise, à la lisière de la forêt. Il fallait dégager l’endroit et repousser l’ennemi au-delà de cette ligne pour, ensuite, prendre d’assaut le village à trois kilomètres de là.
Jules n’était plus qu’à une centaine de mètres du but. Déjà, les premiers camarades s’étaient mis à couvert, épuisés, découragés, blessés et affamés. Le sergent était revenu en arrière pour encourager les retardataires.
« A terre ! Avait-il hurlé ».
Trop tard. Jules avait entendu une énorme explosion qui lui avait arraché les tympans et ressenti un grand choc. Il avait cru s’envoler comme un vulgaire fétu de paille soulevé par le vent. Puis, le trou noir. Plus rien… Alors qu’ils allaient franchir les derniers mètres qui les séparaient du refuge de la forêt, un obus était venu exploser devant eux, tuant la plupart de ses compagnons. Sa hanche et sa jambe gauches avaient été en partie broyées par les billes d’acier meurtrières.
Un souffle léger sur son visage endolori par la poussière, la terre et le sang séché l’avait ramené à la vie. En ouvrant les yeux, il crut avoir une vision. Penchés au-dessus de lui, deux yeux clairs l’observaient. Une voix légère l’appelait :
« Soldat, réveillez-vous. Vous m’entendez ?
— Vous êtes un ange ? Je suis mort ? Vous êtes mon ange gardien. C’est ça !? Demanda-t-il en grimaçant de douleur.
— Non répondit la voix. Je ne suis pas un ange et vous êtes loin du paradis. Ne bougez pas. Vous êtes blessé. Nous allons vous évacuer
A travers son regard brouillé par la douleur, Jules aperçut, au-dessus des deux yeux clairs, une cornette blanche.
—Tiens, s’étonna-t-il avant de sombrer à nouveau, une bonne sœur. »
Jules souffrait. Il errait entre coma et conscience. Il se mit à délirer. La sœur l’installa du mieux qu’elle put, adossé à un talus, en attendant que les brancardiers viennent le chercher. La douleur et la fièvre lui avaient fait perdre la notion du temps et de la réalité. Il était resté couché à même le sol, inconscient et gémissant, sans pouvoir bouger. Il s’en était fallu de peu qu’on le laisse pour mort dans cette plaine de désolation. Les brancardiers, débordés par le nombre de blessés et pressés d’évacuer pour éviter de se trouver sous le feu des obus ennemis, étaient passés à côté de lui sans le voir.
L’hôpital de campagne était installé à côté du couvent. Les sœurs, dévouées à la souffrance, avaient ouvert leurs portes et s’étaient portées volontaires pour seconder la Croix Rouge. Après le passage des brancardiers, et avant celui des nettoyeurs de tranchées9, elles parcouraient le champ de bataille, accompagnées du jardinier et du vieux curé, pour bénir tous ces pauvres bougres morts au combat et, parfois, ramasser un agonisant oublié. Jules dut son salut à cette cérémonie.
L’hôpital de campagne était surpeuplé ; les médecins, débordés et démunis des moyens les plus élémentaires pour sauver tant de vies, n’avaient ni le temps ni la possibilité de s’arrêter à des considérations autres que sanitaires. On craignait les infections et la gangrène. On ne faisait pas dans le détail : on amputait purement et simplement tout membre broyé ou déchiqueté. Pas d’antibiotique à cette époque, ni de morphine, ni d’antiseptique. L’éther et la gnole, quand il y en avait, faisaient office d’anesthésiant et de désinfectant. La plupart mourait en cours d’opération ou connaissait de longues et terribles heures d’agonie. Les survivants étaient lourdement estropiés à vie. Les autres, ceux qui avaient été atteints au torse ou à la face, perdaient la vue, ou devenaient sourds et, dans tous les cas, étaient défigurés, la gueule cassée10.
La mère supérieure du couvent était une maîtresse femme. De forte constitution, avec une voix de stentor, elle menait sa petite troupe de religieuses tambour battant, les manches de sa robe retenues aux coudes par des épingles à nourrice, le pan arrière de sa jupe passé entre les jambes, relevé et attaché à la ceinture comme une culotte de zouave11 pour ne pas être entravée dans sa course au sauvetage. Elle ne s’en laissait pas conter par l’autorité qu’aurait voulu exercer les officiers cantonnés sur ses terres. Son infirmerie était dirigée par une sœur compétente et il n’était pas question de laisser sous les tentes inconfortables de l’armée ses blessés, ceux qu’elle et ses filles avaient trouvés, oubliés par les brancardiers.
La petite infirmerie aux murs blancs, aux lits cachés par des rideaux d’intimité, au crucifix fixé au-dessus de la porte, avait été transformée en salle d’hôpital propre et fonctionnelle. Plus propice, disait la Mère supérieure, au rétablissement de ces soldats pour lesquels ce lieu représentait l’annexe du paradis après les mois terribles qu’ils venaient de connaître, que ces hôpitaux de campagne qui ressemblaient plus à des boucheries qu’à des salles d’opération. Cela sentait le savon de Marseille et le crésyl12 que les sœurs passaient généreusement sur les sols et tous les récipients sanitaires qu’il convenait de désinfecter. Elles avaient installé, dans une salle attenante, une longue table en d’autres temps destinée au repassage du linge ; couverte d’un grand drap blanc, elle tenait lieu de bloc opératoire. Des outils chirurgicaux, posés sur une console, attendaient la prochaine opération ; une armoire contenait des fioles de teinture d’iode, de mercurochrome, et même du laudanum13 en guise d’anesthésiant, du coton hydrophile, des bandes de tissu confectionnées avec des draps que la sœur lingère avait sacrifiés pour en faire de la charpie et des bandages. Des brocs d’eau faisaient la navette entre la pompe et la cuisine, charriés par deux jeunes novices. Après que toute cette eau eut bouilli dans des lessiveuses, elle était amenée dans la salle pour nettoyer les plaies.
Jules avait été transporté par la Mère supérieure et le jardinier, l’une le portant sous les bras et l’autre par les pieds jusqu’au couvent. Son sauvetage était passé inaperçu aux yeux des militaires qui, ne le trouvant pas lors de l’appel et de la revue des blessés, l’avaient porté mort ou disparu. Inconscient, il avait été opéré avec les moyens du bord par la sœur médecin. A force de rafistoler ce genre de blessures, elle avait acquis une expérience lui permettant de mener au mieux l’intervention sans avoir recours à l’irréversible amputation ; dans le cas de Jules, elle aurait nécessité de couper la totalité de la jambe jusqu’à l’aine. Contrairement aux chirurgiens de campagne, la sœur avait tout son temps pour nettoyer, désinfecter, recoudre et panser les chairs tuméfiées. L’opération terminée, elle surveillait le blessé et refaisait ses pansements dans de bonnes conditions jusqu’à parfaite guérison. Ceci n’allait bien entendu pas sans souffrance. Le laudanum ne suffisait pas à anesthésier et il fallait toute la force et la compassion de ces femmes pour empêcher le malheureux de se débattre. On lui plaçait un bâton entre les dents et, dans les cas les plus difficiles, un tampon de chloroforme sur le nez. Grâce à ces soins quasi miraculeux, Jules avait eu la vie sauve. Cette blessure avait mis longtemps à guérir. Il en souffrit jusqu’à son dernier jour. Il en avait gardé la démarche chaloupée d’un marin qui lui avait valu le surnom moqueur mais affectueux que lui ont donné, plus tard, ses ouvrières : « clopinclopant ».
Avant d’être blessé, Jules écrivait tous les jours à Mauricette, entre deux attaques, blotti contre un amas de terre ou à demi couché dans un abri de fortune, sans jamais savoir si ses lettres lui arriveraient. Il lui assurait qu’il allait bien, même si cette guerre était trop longue et difficile, mais il passait sous silence le froid, la faim, la peur, les rats et toutes ces atrocités avec lesquelles il partageait sa vie dans le cloaque des tranchées. Il lui promettait de revenir bientôt, car, c’était sûr, cette saloperie de guerre allait finir pas plus tard que dans quelques semaines. Mais il y eut l’accident. Cet obus le trouva, presqu’à la fin, alors qu’il avait pu, pendant ces quatre années, passer au travers des attaques et des bombardements sans jamais être blessé gravement. Pendant des semaines, il avait été incapable de faire autre chose que souffrir, comater, comater et souffrir encore. Son paquetage, toute sa richesse de soldat, avait été détruit par cet obus de malheur et les braves femmes qui le soignaient n’avaient pas pu prévenir sa famille de son état.
Lorsqu’il était enfin sorti du coma dans lequel il avait erré pendant plus de trois semaines, il apprit que la guerre était terminée et qu’il allait rentrer chez lui dès que les autorités sanitaires pourraient venir le récupérer. Il lui fallut encore attendre six longues semaines. Enfin, un matin, la sœur infirmière déboula toute joyeuse dans l’infirmerie où il jouait aux cartes avec un jeune garçon originaire de Poitiers, à qui il manquait le pied droit, emporté par le même obus que celui qui avait si cruellement blessé Jules :
« Voici une bonne nouvelle, messieurs : après-demain, la Croix rouge viendra vous chercher en convoi sanitaire pour vous ramener dans vos foyers ! »
Ils laissèrent tomber les cartes et, oubliant leurs blessures, ils applaudirent la sœur et la bonne nouvelle. Les deux nuits qui suivirent furent longues et blanches, tant leur joie et leur impatience étaient grandes.
Mauricette ne reçut aucune nouvelle jusqu’à son retour. Il fut rapatrié sur un brancard par un convoi sanitaire de la Croix Rouge qui le déposa, en même temps que trois autres enfants du pays, à la grande joie de tout le village.
Pendant toutes ces années, Mauricette avait continué tant bien que mal à laver le linge des alentours, devenu trop rare. Pour survivre avec ses deux filles et sa belle-mère, elle avait dû louer ses services au travail des champs, car des hommes du bourg, il ne restait que les plus âgés, les adolescents et les bambins. Elle vit revenir son mari avec tant de soulagement, alors qu’elle l’avait cru mort ! Elle le veilla, le soigna, le bichonna, l’entoura de tous ses soins jusqu’à ce qu’enfin, il put réapprendre à marcher. Les blessures physiques furent plus promptes à guérir que le psychique ; il fallut encore attendre quelques mois pour que Jules, bon vivant et d’une nature solide put se remettre au travail. A cette époque, la psychanalyse n’était pas encore appliquée et les blessures psychologiques devaient guérir seules ou ne pas guérir :
« Avec le temps, tout s’en va », disait-on…
De ses camarades partis en même temps que Jules, seuls quelques-uns, la plupart plus abîmés que lui, étaient revenus. Deux d’entre eux étaient malheureusement des gueules cassées, défigurés à jamais par les éclats d’obus qui leur avaient explosé au visage, les voies respiratoires détruites par l’inhalation des gaz que les Allemands balançaient au milieu des lignes Françaises. Ceuxlà ne purent jamais se réintégrer dans la vie civile. Jules les visitait régulièrement, mais jamais il ne parla ni de ce dont ils avaient été témoins, ni de ce qu’ils avaient vécu. Ces sujets étaient tabous.
9Les « nettoyeurs » neutralisaient les ennemis blessés à coups de pistolets, de grenades et même de couteaux ! Quelques-uns brandissaient leur coutelas en exécutant une espèce de danse du scalp… (extrait de : Émile Morin, combattant de la guerre 1914-1918, Besançon, Cêtre, 2002, p. 89, septembre 1915).
10Ceux des survivants de la première guerre mondiale (1914/1918), grièvement blessés par les obus allemands. Ces blessures, souvent au niveau du visage, avaient laissé de terribles cicatrices qui défiguraient les victimes, d’où le terme de gueules cassées.
11 Culotte bouffante resserrée sous le mollet jusqu’à la cheville par une molletière, faisant partie de l’uniforme des zouaves, unité d’élite de l’infanterie africaine sous le second empire jusqu’en 1945, composée à l’origine de soldats kabyles.
12Désinfectant à base de crésol (Mélange des trois isomères) liquide toxique d'odeur forte.
13 Sédatif à base d’opium.
LE RENOUVEAU
Après ces années dramatiques, la vie reprenait difficilement dans le pays. La région avait donné une grande majorité de ses hommes à la défense de la Patrie et ceux qui en avaient réchappé étaient revenus tellement amochés que peu avaient pu reprendre leurs activités d’avant-guerre ; certains, comme ce fut le cas des deux camarades de Jules, durent même être internés tant leurs souffrances les avaient rendus fous.
Le pays était exsangue, il fallait reconstruire. La démographie était tombée au plus bas, il fallait repeupler. Tout était à refaire. La Vendée était loin des soubresauts politiques de Paris. Dans ces campagnes qui avaient échappé aux désastres matériels de la guerre, on s’évertuait à recommencer à vivre du mieux qu’on pouvait, malgré tous ces bouleversements.
Les hommes soldats avaient dû être remplacés aux travaux des champs, aux commerces, et à toutes les activités par leurs épouses, leurs filles, leurs mères (Les femmes, au cours de ces quatre années, durent remplacer les hommes dans tous les travaux ; elles firent preuve d’une détermination et d’un courage exemplaires. (L’histoire nous apprendra, plus tard, que cette période d’émancipation forcée de la gent féminine sera le départ des revendications pour un statut plus indépendant de la femme à laquelle, jusqu’alors, on ne reconnaissait d’autres droits que ceux d’obéissance et de servilité à son mari et à sa famille.) La guerre terminée, les chefs de famille morts au combat, ce furent les fils ainés, devenus adultes, qui prirent peu à peu le relais aux affaires. Les grosses maisons bourgeoises connurent, sinon leur lustre d’entant, du moins un renouveau. Le village reprit vie, le commerce se fit plus florissant. Les mentalités, dans ces provinces, n’évoluaient que très lentement et on retrouva, entre les deux guerres, le même état d’esprit qu’avant. La vie reprit finalement son cours rythmé par les saisons, les travaux des champs, les marchés et les foires. Les commères firent encore des commentaires de tout et de rien, faisant et défaisant d’un coup de langue les bonnes et mauvaises réputations. Les jeunes veuves leur donnaient matière à cancans.
Jules émergea de son apathie. Ses filles grandissaient, Mauricette, épouse aimante et dévouée, ne comptait ni son temps, ni sa peine. L’ordinaire n’était pas florissant, mais la mère et ses deux filles maintenaient une ambiance tendre et gaie qui l’aida à réagir. Il se remit au travail et ensemble, ils œuvrèrent pour donner un nouvel essor à la laverie. Les maisons bourgeoises avaient de nouveau du linge à laver, à nettoyer, à empeser et à repasser. On mariait les jeunes, on recevait, on baptisait les nouveaux nés. Le commerce prospérant, ils employèrent une demi-douzaine de jeunes femmes, le vieux Thomas, homme à tout faire, et Jojo le coursier, dit le benêt parce qu’il était toujours dans la lune. Leurs employés les respectaient, car ils savaient être justes ; Mauricette avait toujours un mot gentil, Jules une boutade, lorsqu’il passait dans les ateliers.