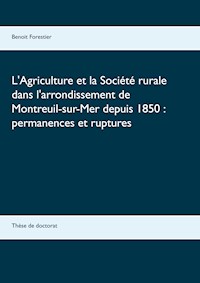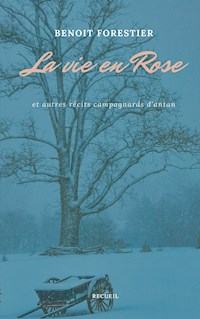
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Tous les récits (ou presque) sont inspirés de faits réels (souvenirs d'enfance des aïeux de l'auteur ou faits divers) et retracent des moments de douleur, de tristesse mais aussi de joie vécus par des hommes et des femmes, appartenant à la classe paysanne, dans la première moitié du XXe siècle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À mon grand-père paternel, Roger.
À Henri Watel, adjudant au 328e Régiment d’infanterie,
tombé au Champ d’Honneur à Sapigneul le 18 mai 1917.
Table des matières
La vie en Rose
Le soldat Bayard
Conte médaillé d’or au concours 2005 organisé par le « Bleuet international »
Une âme un temps égarée
Un Noël chez Gustave
Récit inédit
Se faire du beurre
L’enragée
Le mystère de la ferme
Le renardeau
Nos aïeux
Valeureux poilu
Douce alezane
Le mystérieux puits
Innocente jeunesse
L’humble berger
Un match pas comme les autres
Une étrange ciboulette de printemps
Les haricots
Un long périple
Vive la guerre !
Le prisonnier
Pierre le noyé
L’arbre de la tragédie
L’intrépide René
Ch’maître
Petit Pierre
Les « petits Jésus »
La vie en Rose
L’odeur de la poudre avait peu à peu remplacé la senteur des marguerites et des coquelicots de début de saison. Le ciel bleu s’était rapidement terni. À peine installées, les hirondelles, enfumées par les bombardements et les tirs d’artillerie, avaient précocement migré vers le Sud. La rivière, par endroit, rougissait de honte, celle d’avoir perdu la bataille. Elle pleurait encore les pauvres soldats français tombés si rapidement au combat. Quelques chiens abandonnés dans l’obscurité des fermes éloignées hurlaient à la mort.
Quelques jours plus tôt, à la fin du mois d’avril 1940, allongée sur le dos, Nelly1 attendait son heure. Les douleurs qu’elle ressentait dans le bas du ventre ne cessaient de croître. Elle ne savait que faire pour atténuer sa souffrance. Il était 23h40. La jeune femme n’en pouvait plus. Mais que faire ? Si ce n’était attendre avec patience. Son bourreau n’était autre que le temps qui semblait s’être soudainement figé, n’hésitant guère à la torturer encore et encore.
Par pudeur, Nelly se gardait bien d’extérioriser sa douleur en poussant des cris. Il était maintenant 23h41. À sa droite se tenait un vieil homme au regard sévère, vêtu de noir. Il croisait les bras tout en marmonnant des bribes de mots. Il avait ôté son couvre-chef. C’était monsieur le curé. Dans la pièce, se trouvaient aussi son mari et une vieille dame qui portait avec élégance une longue robe, un de ces vêtements paysans plutôt sombres qui couvraient les femmes de la tête aux pieds. Son époux, Richard, assis à ses côtés, impuissant face à la situation, lui tenait fermement la main gauche pour lui apporter le peu de réconfort qu’il lui était possible d’offrir. Son regard laissait deviner une certaine inquiétude. Il était maintenant 23h52. Le curé se signa et prit congé dans la pièce d’à côté. Le corps de Nelly ne cessait de se crisper au ressenti de chaque douleur. Il lui était de plus en plus difficile de veiller à ne pas hurler. Richard avait positionné une main sur la bouche de sa femme afin d’étouffer le plus possible le bruit atroce des souffrances. Nelly fixait le plafond de la pièce éclairée par une lumière bleue vacillante émise par une ampoule suspendue, habillée à la hâte d’un cache d’azur. Celui-ci permettait d’atténuer la luminosité et ainsi d’éviter au logis d’être la cible potentielle de bombardiers allemands. Elle avait l’impression de s’évader peu à peu, de gravir les montagnes, de traverser les mers et les océans, de parcourir les cieux. Elle rêvait. Elle se sentit soudainement soulagée. Ses maux avaient-ils disparu ? Son corps se relâcha doucement. Nelly soupira une dernière fois.
Ah Nelly ! C’était une brave paysanne. Elle ne rechignait point aux durs labeurs des champs. Elle n’hésitait pas à monter sur les gigantesques meules au doux parfum d’été pour placer les bottes de froment. Elle aimait le travail bien fait. Elle ne se contentait pas de superviser ou de donner des ordres. Elle travaillait durement mais toujours gaiement. Le dimanche, elle se laissait aller à la coquetterie. Elle détestait les femmes aux allures d’hommes rustres qui semblaient avoir perdu une grande part de leur féminité en travaillant la terre aux côtés des hommes. Lors des grandes occasions, comme les noces, la ducasse annuelle, les fêtes religieuses ou encore le bal du 14 juillet, elle portait toujours un petit chemisier délicatement parfumé, parfois avec un peu de dentelle, une longue jupe, souvent noire, et des bottines à talon mi-haut. Elle possédait peu de bijoux hormis une alliance et une jolie montre au bracelet fin et raffiné. Toujours souriante et bien coiffée, elle était élégante et charmante.
Soudain, un petit cri aigu brisa le silence. La vieille dame se redressa, tenant dans ses mains un petit être ensanglanté. Elle présenta le nourrisson à Nelly qui était heureuse d’avoir mis au monde une petite Rose. C’était la septième fleur de son jardin, le fruit d’un amour inépuisable. Richard était une fois de plus le plus heureux des hommes. Fier d’être le père d’une deuxième fille, il s’empressa de faire part à toute la famille de cette merveilleuse nouvelle.
1 Nelly est l’arrière-grand-mère de l’auteur.
Le soldat Bayard
Mon grand-père Roger, éternel nostalgique de son temps, aime me narrer des histoires, au détour d’une conversation, notamment lors d’une promenade dans le chemin vert, au Clivet. Il me raconte souvent ses souvenirs d’enfance, sans lassitude et avec une aisance déconcertante, tout en maniant son bâton de noisetier fraîchement coupé qui lui sert de petite canne d’appui. Il est un infatigable homme du passé, âgé d’à peine 70 ans. Sa joie est si communicative que n’importe quel campagnard tomberait sous le charme d’une époque révolue. À chaque représentation, il ne peut s’empêcher de rire, de faire ressentir ses émotions au spectateur que je suis, bercé par un ton si vivant et mélodieux. Parfois, il sourit au seul souvenir d’une histoire, avant même de me la faire partager.
En 1940, il avait dix ans lorsque que sa famille, originaire du Haut-Boulonnais, migra vers les collines du Haut-pays d’Artois pour s’installer dans la paisible commune de Preures, celle de ses grands-parents paternels. Dans la ferme de ses parents, il apprit le dur métier de cultivateur, à une époque rongée par la guerre et où les machines n’étaient l’apanage que des plus riches d’entre eux. Malgré la mort tragique de son père en avril 1941, il avait gardé semble-t-il de bons souvenirs de son enfance. Néanmoins, il ne pouvait, comme la plupart des jeunes de son âge, oublier les horreurs de la guerre. Il préférait ne songer qu’aux instants de bonheurs partagés.
Eh oui ! Pas un français ne fut épargné par la guerre, pas même ce brave petit Bayard. Il avait résisté corps et âme pour sa patrie, la France, en 1940, contre des hordes venues d’Allemagne. Il était fier de défendre sa terre natale, son doux pays symbole de liberté, qu’il aimait plus que tout. Mutilé, il s’était réfugié dans les collines du Boulonnais, errant dans la campagne et allant de demeure en demeure quérir de quoi assouvir sa faim. Tous les soldats de son bataillon avaient été tués par les Nazis. Laissé pour mort dans un affreux charnier, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale, il était le seul survivant d’une sanguinaire bataille que les Allemands avaient remportée au son des mitrailleuses et des canons d’artillerie. Il n’avait rien pu faire.
À la Libération, le regard de notre pauvre petit Bayard était toujours aussi vide, figé par les atrocités du conflit dont il avait été victime ; comme si son esprit était mort. Le souvenir du combat de 1940 le hantait comme une mélodie que l’on ne cesse d’entendre à force de l’avoir trop écoutée. Parfois, il se retournait brusquement, apeuré, comme s’il venait de croiser des Allemands, assoiffés de sang et de victoire. Des voix, des cris de douleur bourdonnaient sans cesse dans sa tête. Alors, il quittait précipitamment le village dans lequel il avait fait une halte, gravissait un vallon herbagé, traversait une douce rivière, franchissait une terre récemment labourée, et courait jusqu’à l’épuisement, parcourant ainsi des dizaines et des dizaines de kilomètres en espérant laisser derrière lui ce mal qui le rongeait.
Il était brave notre petit Bayard ! Pourtant, il n’était pas de grande race et était loin d’être issu d’une rigoureuse sélection. C’était juste un petit ratier, un bâtard, élevé à la dure par quelques soldats français morts pour la patrie. Orphelin, il errait, au lendemain de la guerre, dans la région de Desvres, dans le Haut-Boulonnais. Les habitants le connaissaient bien. Lorsqu’ils apercevaient notre combattant à trois pattes, ils disaient en ricanant :
« Ah ! Voilà le plus brave de nos soldats. Et en plus, il n’est pas méchant pour un sou ! »
Roger aimait accompagner son grand-père Auguste au marché hebdomadaire de Desvres, qui se trouvait à moins de deux myriamètres2 de la ferme du bassin, à Preures. Il en existait un à environ deux kilomètres, dans le chef-lieu du canton, à Hucqueliers, mais celui-ci, qui se tenait sur la place un autre jour de la semaine, était de moindre importance. Auguste partait toujours très tôt, au lever du soleil, car il détestait perdre son temps. Quant aux grands dormeurs, il les qualifiait, sans vergogne, de grands fainéants. Il était de ceux, des gens de sa génération, qui affirmaient avec certitude que l’avenir n’appartient qu’à ceux qui se lèvent tôt, c’est-à-dire aux braves et aux honnêtes hommes.
Mon grand-père, encore adolescent dans les années 1940, l’aida à harnacher les deux chevaux pour les atteler à la voiture sur ressorts3. Auguste n’était qu’un petit fermier. Il ne roulait pas sur l’or, mais disposait dans son cheptel de deux magnifiques équidés, bien dressés. Il faut dire qu’Auguste ne plaisantait jamais lorsqu’il s’agissait de débourrer un jeune étalon. Il avait déjà été le témoin dans le passé d’accidents terribles. Un coup de patte violent sur le crâne d’un homme s’avérait souvent mortel. Ses bêtes, plaisantes à observer avec leur petit nuage au milieu du museau et leur robe tachetée, étaient loin d’être classées dans les concours agricoles ou dans le prestigieux Stud-Book du Boulonnais. Cependant, elles étaient robustes et fidèles à leur maître. Et ces qualités lui suffisaient.
Ils partirent tous les deux en direction du Botier, pour gagner Séhen, au pas. Mon grand-père tenait fièrement les rennes que son ascendant lui avait confiées ; ce qui ne servait pas à grand-chose, puisque que les chevaux avaient l’habitude d’emprunter le chemin. Mais cela avait peu d’importance. Mon grand-père avait l’impression d’être le meilleur des conducteurs de la région. Les chevaux connaissaient si bien les habitudes de leur maître, qu’un jour, après la messe du dimanche, ils s’arrêtèrent brusquement. Auguste et sa femme, bousculés dans la voiture, cessèrent alors de converser, tout en s’étonnant. Eh, oui ! Les bêtes innocentes s’étaient immobilisées devant les marches du café. Mon aïeul, dont le visage vira subitement au rouge, se trouvait mal à l’aise. Il venait d’être trahi par ses fidèles compagnons de débauche. Le pauvre homme ! Ce jour-là, il était à plaindre parce que sa femme, qui lui interdisait de fréquenter de tels endroits, n’était pas brave.
Après avoir parcouru quelques kilomètres, ils arrivèrent au nord de Séhen, sur le plateau, près du village de Zoteux. Mais, depuis quelques centaines de mètres, mon grand-père sentait que quelque chose intriguait son aïeul. Mais, il n’osait lui demander ce qui le préoccupait. Auguste s’était retourné à plusieurs reprises, en se frottant nerveusement les moustaches et en fronçant sévèrement les sourcils. Il avait l’impression que quelqu’un les suivait, les espionnait. Si cela s’avérait exact, que voulait-il ? Il ne transportait pas de denrées rares et n’avait pas un sou en sa possession. Quand soudain, il se mit à sursauter. Il venait d’apercevoir le brave Bayard qui les suivait en trottinant, probablement depuis leur passage au carrefour de Gournay. Auguste, alors soulagé, soupira doucement. Puis, il éclata de rire en voyant le chien, apeuré, qui se jeta dans un massif d’orties. Mon grand-père ne put s’empêcher de l’imiter lorsqu’il remarqua le bout des oreilles qui dépassait des plantes. L’animal avait appris à se méfier des êtres humains.
À chaque fois que les deux hommes se retournaient pour observer l’arrière de la voiture, le spectacle se renouvelait. Le chien se dissimulait et des éclats de rire retentissaient à travers la campagne avec un écho impressionnant. Auguste avait même attrapé un mal de ventre terrible à force de se tordre.
« C’est vraiment un bon soldat celui-là ! Ah oui, vraiment un bon ! » répétait-il péniblement entre deux moments de bonheur, tout en regardant son petit-fils qui ne pouvait également se contenir d’exprimer sa joie.
Lorsqu’ils arrivèrent aux portes de la petite ville de Desvres, le chien avait disparu. Mon grand-père céda les rennes à son aïeul devant le passage à niveau, car il n’était point rassuré. La conduite était plus difficile en raison du flux de voitures4 et de la foule. Il fallait avoir une certaine expérience afin de pouvoir contrer toute réaction imprévisible des chevaux devant un quelconque danger. Auguste allait sur le marché pour écouler sa production de livres de beurre, mais également pour acheter un produit graisseux, une sorte de margarine. Le cours du beurre étant plus élevé, il préférait, comme beaucoup de petits exploitants, vendre sa production et consommer un produit de substitution de mauvaise qualité et ainsi réaliser une plus-value intéressante. Ils ne restèrent que deux heures sur la place du bourg. Les transactions étaient toujours rapides, car les clients étaient fidèles au rendez-vous. Auguste connaissait bien ses acheteurs.
Mon grand-père et son aïeul repartirent donc vers la capitale du culte de Saint-Adrien5, laissant derrière eux une ville animée par les cris des marchands vantant la qualité et le prix de leurs marchandises, le rire des badauds et le tambourinement des sabots sur le sol, témoin des nombreuses allées et venues au marché. Soudain, alors qu’ils venaient de franchir le passage à niveau situé au sud de Desvres, ils entendirent un hurlement provenant de l’habitation de la garde-barrière, comme si un événement des plus tragiques venait de se dérouler. Surpris par les plaintes de la femme, ils stoppèrent la voiture et se retournèrent pour observer la scène et tenter de comprendre ce qu’il se passait. L’employée de la compagnie de chemin de fer, chargée d’avertir l’arrivée des trains pour éviter toute collision, se faisait peut-être agresser ou était victime d’un accident. C’est du moins ce que pensait Auguste, l’air grave, étant donné l’intensité des cris. Mais, alors qu’il s’apprêtait à descendre de voiture pour porter secours, une femme, vêtue d’un vieux tablier et de sabots usés, sortit subitement de sa demeure en brandissant un morceau de bois et en lançant toutes sortes de jurons. La quinquagénaire semblait poursuivre un animal. D’après ses plaintes, celui-ci venait de lui voler une livre de beurre posée sur la table de la cuisine, en pénétrant par l’une des fenêtres. Comme le soleil les éblouissait, mon grand-père et son aïeul portèrent leur main droite sur le front. Ils s’aperçurent que l’auteur du larcin était un petit chien.
« Mais ! C’est Bayard ! Oui, c’est bien lui le voleur ! affirma Auguste, hésitant, en regardant son petit-fils, comme s’il était en train de lui révéler un grand secret.
- Ah ! C’est un sacré celui-là ! ajouta-t-il, en ricanant tout doucement dans sa fine moustache.
- Et en plus, même avec ses trois pattes, il court aussi vite qu’un lièvre ! Hein ? rétorqua à son tour mon grand-père en regardant le chien qui s’éloignait avec son précieux butin.
- Eh oui ! Ce voyou n’a pas perdu ses habitudes de soldat ! Il est toujours aussi rusé ! » répondit Auguste, en montant dans la voiture.
Le retour à la ferme fut marqué par d’innombrables fous rires lorsqu’ils racontèrent à toute la famille cette surprenante et authentique histoire.
2 Un myriamètre équivaut à 10 kilomètres.
3 Il s’agit d’une voiture suspendue, à quatre roues, attelée de deux chevaux.
4 Il ne s’agit pas d’automobiles, mais de voitures mues par des chevaux. Les véhicules à moteur sont rares en 1946 dans cette région.
5 Il s’agit de la commune de Preures.
Une âme un temps égarée
Un jour de juin 1915, une jeune femme élégamment vêtue se promenait seule sur la plage d’Étaples. Cheminant, la tête baissée, elle ne cessait de remettre en place ses mèches brunes malmenées par le vent. La mer était particulièrement agitée. Tout à coup, elle s’arrêta, se tourna vers les flots et observa l’horizon. Elle écoutait le bruit de l’eau s’abattant sur les rochers et le cri strident des goélands qui fuyaient les lieux. Des larmes s’échappèrent et coulèrent sur ses joues meurtries par le frottement incessant des grains de sable qui tourbillonnaient. Elle éclata en sanglots.
Puis, l’inconnue, à l’âme visiblement torturée, se redressa, regarda de nouveau l’étendue d’eau, puis se remit en marche. Au fur et à mesure qu’elle se rapprochait de la mer, elle accélérait le pas. Les premières vagues, glaciales, lui caressèrent les chevilles, puis les mollets et les genoux. La jeune femme se laissa ensuite emporter par les flots, sans bouger, paralysée par le froid et la tristesse. Son corps s’en était allé. Elle ne songeait plus qu’aux instants de gaieté mémorables passés jadis en compagnie de son fiancé.
Le 14 juillet, Julie se rendait comme chaque année, depuis sa tendre enfance, chez ses grands-parents maternels qui résidaient dans un petit village situé à la périphérie du bourg d’Étaples. Ses ascendants, des cabaretiers, qui tenaient un établissement près de l’église, avaient besoin de son aide les jours de forte affluence. Depuis le début de l’après-midi, la petite place était animée. Des villageois installaient des rangées de tables et de bancs. D’autres transportaient le matériel imposant dont avaient besoin les musiciens pour le traditionnel bal. Le garde champêtre plaçait soigneusement le majestueux drapeau aux couleurs de la République sur la façade de la mairie. Julie, quant à elle, vêtue d’un joli tablier bleu, dépoussiérait les plateaux et les innombrables tasses qui n’étaient utilisés que les jours de la ducasse et de la fête nationale. Puis, la foule se mit à grossir et le brouhaha s’intensifia. Les habitants venant des hameaux les plus reculés profitaient de cette occasion pour échanger, pour saluer leurs vieux camarades de classe. La plupart adorait ressasser de vieilles anecdotes en bonne compagnie. C’était l’occasion d’oublier un instant les tracas routiniers de la vie et de se laissait aller à la bonne humeur et aux éclats de rire, parfois exagérés. Julie ne savait plus où donner de la tête. Tous voulaient leur « bistouille »6.
Alors que la jeune femme était en service, elle remarqua qu’un homme, d’une vingtaine d’années, plutôt cossu, ne cessait de la regarder. Intriguée et surtout flattée, elle le fixa à son tour et laissa échapper un léger sourire. Il détourna aussitôt le regard et fit semblant de converser avec d’autres villageois, tout en remettant en place, d’une main légèrement tremblante, sa fine moustache. Mais, il ne put empêcher ses joues de le trahir. Il se mit à rougir. Il semblait particulièrement attiré par la jeune femme. Celle-ci se remit à l’ouvrage, feignant d’ignorer ce signe du destin. Mais au fond d’elle-même, elle bouillait d’impatience de faire la connaissance du bel inconnu.
Soudain, le jeune homme s’approcha d’elle et lui demanda :
« Puis-je en avoir une, belle demoiselle ?
- Certainement », lui répondit-elle d’une voix douce, tout en lui offrant son plus beau sourire. Julie s’empara d’une tasse de café aromatisé à l’eau-de-vie de cidre et la lui tendit. Il la remercia, puis se tut. Il but le précieux liquide tout en la regardant. Ses joues étaient rouge écarlate. Il avait envie d’apprendre à la connaître, mais sa timidité l’empêchait de converser. Il avait peur de bafouiller. Alors Julie décida de forcer le destin. Elle lui vint en aide en rompant le silence. Sa grand-mère qui, un peu plus loin, assistait à la scène la regarda en souriant et lui fit signe de prendre congé. La jeune femme retira alors son tablier et emmena le bel inconnu à l’écart, loin du vacarme ambiant. Ils discutèrent de tout et n’importe quoi, riant parfois sans retenue. Puis vint l’heure du traditionnel bal. Il l’invita à valser. Bien sûr, elle accepta. Au bout d’une heure, épuisés, ils s’assirent sur un banc. Ils n’osaient plus parler. Puis, soudain, d’un air un peu gêné, le jeune homme se rapprocha d’elle et balbutia :
« Vous, … Vous permettez que … ? »
Julie ne lui laissa pas le temps d’achever sa demande. Elle s’empressa de joindre ses lèvres aux siennes. À peine eut-elle profité de ce doux moment qu’elle entendit un écho, une voix de plus en plus audible.
« Mademoiselle ! Mademoiselle ! » s’écria un militaire en la secouant légèrement. À une centaine de mètres de là, un soldat français qui se dirigeait vers la gare assista à la scène. Sans réfléchir, il se mit à courir, puis se jeta à son tour dans la mer particulièrement agitée. Au bout de quelques minutes interminables, le militaire réussit enfin à ramener sur le sable l’inconnue. Son courage et sa persévérance avaient eu raison de la mort. Le jeune homme n’avait pas eu le temps d’ôter ses vêtements avant d’entrer dans les flots. L’eau continuait ainsi à ruisseler de toute part. Le soldat s’assura que la jeune femme était saine et sauve, avant de s’effondrer d’épuisement. Il s’allongea sur le dos et se mit à haleter. La miraculée se rendit soudainement compte qu’elle était encore de ce monde. Un sentiment étrange commença alors peu à peu à l’envahir : la honte. Elle n’osait pas regarder l’homme à qui elle devait la vie.
6 Une bistouille est une boisson traditionnelle faite d’un subtil mélange de café et d’eau-de-vie de cidre.
Un Noël chez Gustave
Pendant un court instant, je me mis à observer, à travers la vitre légèrement embuée de la fenêtre de la chambre, ces confettis blancs qui planaient avec légèreté comme des petites plumes, avant de se poser avec délicatesse sur le sol. Dans le jardin, même les ardoises de la petite maison en bois étaient recouvertes d’un manteau neigeux. Ce refuge pour les oiseaux, perché sur le haut d’un poteau d’acacia, à plus de deux mètres du sol, renfermait de généreuses boules de graisse et une grande variété de graines rigoureusement sélectionnées. Un silencieux va et vient était mené, toute la matinée, par de fins cascadeurs, qui se jetaient dont on ne sait où et atterrissaient sur un minuscule perchoir extérieur situé à la porte de la caverne aux milles plaisirs gustatifs. Les ailes de ces aviateurs chevronnés étaient à rémiges noires. Leur tête se composait d’une calotte ténébreuse mais subtilement bleutée, de joues blanches, d’un menton et d’une gorge sombres se prolongeant en une épaisse raie noire sur le dessous, telle une longue cravate. Quel étonnant spectacle m’offraient ces douces mésanges aux couleurs éclatantes !
Je ne pus m’empêcher de descendre dans le jardin afin d’observer d’un peu plus près les minuscules volatiles. Mais, il ne s’agissait en réalité que d’un prétexte. Mon plaisir était de marcher sur le sol enneigé et d’entendre le bruit de la neige qui se compactait sous mes pas, laissant derrière moi les empreintes du temps. Cette vaste étendue blanche me procurait un réel bien être, une impression folle et grandissante de liberté, source d’espoir pour tout être humain.