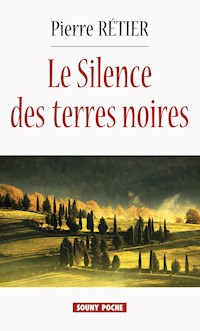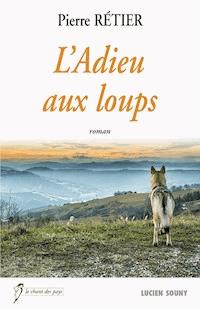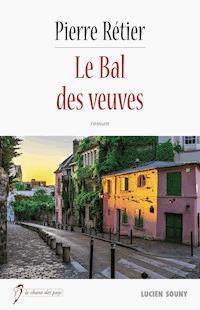
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Lucien Souny
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Quand il décide de participer au « bal des veuves », une vieille tradition alsacienne, Étienne Lambert embarque sans le savoir dans une drôle d'aventure...
Joseph Weiss est à l'origine de cette idée pour le moins incongrue mais ô combien ambitieuse : organiser au coeur de Paris, le soir du Mardi gras de cette année 1971, un « bal des veuves », une tradition ancestrale en Haute-Alsace, uniquement, et qui y perdure encore. Il compte sur la participation de ses plus fidèles amis, qu'ils soient Alsaciens ou Auvergnats, comme Étienne Lambert, dont la famille, depuis deux générations, tient un bar-tabac sur la rue Lepic. Ce jeune célibataire butine au gré des rencontres et n'a nulle envie de se faire passer la bague au doigt. Une seule femme a réussi à le charmer et elle vit dans les lointaines montagnes du Cantal. Étienne se laisse convaincre et se rend à l'événement. La magie du bal va opérer et le voilà embarqué dans une aventure qui le dépassera vite ! D'ailleurs il devra faire appel à Joseph, l'ancien du 36, quai des Orfèvres, pour déminer cette sulfureuse affaire ! Quelles femmes se cachent derrière ces petits loups ? Si elles prennent le pouvoir le temps du bal, les rôles finiront-ils par s'inverser ? De Paris, à Munster en passant par l'Auvergne, rencontres, séductions, surprises, déceptions... tout est possible, sous la plume pittoresque et bienveillante de Pierre Rétier.
Un thriller rocambolesque qui vous mènera de Paris jusqu'en Auvergne !
EXTRAIT
Un vent de liberté soufflait sur la France. Aux prémices de cet été, on profitait d’un grand et beau soleil pour goûter au plaisir qu’offraient les plages de l’Atlantique ou de la Méditerranée. Pour d’autres, leur choix s’était porté sur un petit coin de campagne où beaucoup retrouvaient leur famille et un terroir dans lequel plongeaient leurs racines. Déjà, Paris s’était vidé de nombre de ses habitants qui étaient partis respirer un autre air que celui de la Capitale. Peu à peu, les touristes étrangers étaient arrivés des quatre coins de l’Europe et souvent même d’outre-Atlantique. Dorénavant, ils envahissaient les quartiers historiques avides de découvrir cette ville où tant d’événements s’étaient déroulés, où quantité de monuments rappelaient une histoire qui, en règle générale, avait eu des répercussions sur toute la planète.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Auteur de plus de vingt romans,
Pierre Rétier n’a pas son pareil pour dépeindre des fresques réalistes et sans concessions de nos campagnes minées par les secrets, les non-dits, la jalousie, et pour offrir des portraits magnifiques de personnages attachants sur fond de rébellion, de passions et d’amitiés profondes. Des romans efficaces et captivants. De remarquables mélanges d’intrigues et de sentiments.
Il a été récompensé par le prix Panazô pour
Le Maître de l’eau, et par le prix Lucien Gachon pour
La Nuit des louves.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Un vent de liberté soufflait sur la France. Aux prémices de cet été, on profitait d’un grand et beau soleil pour goûter au plaisir qu’offraient les plages de l’Atlantique ou de la Méditerranée. Pour d’autres, leur choix s’était porté sur un petit coin de campagne où beaucoup retrouvaient leur famille et un terroir dans lequel plongeaient leurs racines.
Déjà, Paris s’était vidé de nombre de ses habitants qui étaient partis respirer un autre air que celui de la Capitale. Peu à peu, les touristes étrangers étaient arrivés des quatre coins de l’Europe et souvent même d’outre-Atlantique. Dorénavant, ils envahissaient les quartiers historiques avides de découvrir cette ville où tant d’événements s’étaient déroulés, où quantité de monuments rappelaient une histoire qui, en règle générale, avait eu des répercussions sur toute la planète.
Outre les incontournables tour Eiffel et Arc de triomphe, ils ne pouvaient imaginer quitter la Ville lumière sans se faire déposer au pied de la butte Montmartre, avant d’aller par les petites rues vers des lieux où se côtoyaient souvent le profane et le sacré.
Et comme chaque année à la même époque, c’étaient de longs cortèges d’hommes et de femmes qui ne perdaient rien de ce que leur expliquait un guide tout en les conduisant vers les hauteurs de la Butte. Chaleur aidant, l’ascension était loin d’être une sinécure avec ces rues majoritairement pavées qui ne cessaient de monter en pente raide. Mais le jeu en valait la chandelle, tant le spectacle était au rendez-vous avec la place du Tertre et cette basilique du Sacré-Cœur qui dominait Paris.
À quelques pas de là, en haut de la rue Lepic, à deux pas du Moulin de la Galette, se tenait un petit bar-tabac, Le vieux Bougnat, qui ne payait pas de mine.
L’établissement avait été créé dans les années trente par Léon Lambert, un homme courageux qui avait quitté Lagarde, un petit village du Cantal où la vie était dure dans la minuscule ferme familiale – dont les maigres revenus permettaient tout juste d’avoir le boire et le manger.
Intelligent, doté d’un sens aigu des affaires, et après avoir travaillé comme un forcené, tout en économisant sou après sou, il acheta pour une bouchée de pain ce qui n’était alors qu’une vieille bâtisse dans laquelle avait été installé un vulgaire bar à vin aux allures de tripot.
Une fois qu’il eut effectué quelques travaux qui s’avéraient indispensables, il ouvrit un café de bougnat. Ce dernier s’inscrivait dans une vieille tradition de ces Auvergnats qui montaient à Paris et qui s’établissaient dans un commerce où l’on proposait diverses boissons, mais également du bois et du charbon. Mais Léon Lambert était un touche-à-tout. Aussi se fit-il rapidement connaître comme un excellent aiguiseur de couteaux et de ciseaux, sans parler de la réparation des parapluies dont il fit en peu de temps sa spécialité.
Au fil des ans, le petit commerce avait trouvé sa vitesse de croisière. En compagnie de son épouse Pauline, Léon avait aménagé un lieu où les habitants du quartier aimaient se retrouver. Au premier étage, un appartement avait été rénové et habillé par quelques meubles de qualité que le couple avait dénichés chez un brocanteur de la Butte.
Au début des années cinquante, le décès de Léon sema la consternation dans tout le quartier. Anéantie, Pauline trouva alors un réel soutien auprès d’un fils qui avait toujours marché dans les pas de son père.
À l’image de ce dernier, Paul était un grand gaillard au caractère bien trempé. La période de deuil passée, il prit en main un commerce qui vivotait et qui se dirigeait tout droit vers le déclin. Ambitieux, il fit appel à quelques amis de son père, bien placés, et obtint l’autorisation de transformer son petit bar en un bar-tabac qui vit, brusquement, affluer une nouvelle clientèle.
Mais il n’en resta pas là. Dans un premier temps, il fit l’acquisition d’un nouveau comptoir, plus moderne, de huit tables en bois de manguier et acier, de chaises confortables et de tabourets de bar qu’il se procura lors d’une vente aux enchères.
Du jour au lendemain, beaucoup de personnes qui habitaient en haut de la rue Lepic s’arrêtaient chez Le Vieux Bougnat, histoire d’acheter un paquet de cigarettes ou de tabac, voire pour s’offrir un café ou un petit ballon de rosé d’Anjou.
Cette nouvelle clientèle était diverse. D’abord, il y avait les habitués, les gens du quartier qui trouvaient là l’occasion de se retrouver et de bavarder ensemble. Puis, à la belle saison, arrivaient les touristes qui montaient en transpirant en direction de la basilique. Aussi, certains étaient heureux de faire une courte pause tout en s’offrant un petit rafraîchissement, soit à l’intérieur du bar, soit sur le trottoir où Paul avait installé quelques tables supplémentaires.
Enfin restaient quelques célébrités qui étaient venues, souvent par hasard, et dont les portraits dédicacés habillaient les murs du bar-tabac. C’était un petit plus dont Paul et sa mère n’étaient pas peu fiers. Il y avait là les portraits de Jean Marais, de Jacques Prévert, de Boris Vian, de Patachou, d’Édith Piaf et de Gisèle Casadesus. Au-dessus du bar avait été accrochée la photo de Louison Bobet, et aussi celle de Louis Bergaud, un jeune coureur cycliste originaire du Cantal qui allait un jour briller dans le Tour de France.
Si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, restait tout de même à Paul à trouver une jeune femme susceptible de devenir une bonne épouse. Cela sous-entendait une personne sérieuse, au physique agréable avec le sens du commerce, qualité indispensable en un lieu où il fallait toujours avoir le sourire aux lèvres, quelles que soient les circonstances.
Soudain survint un événement qui jeta le trouble tant chez Paul que chez sa mère. En effet, à l’issue du Conseil de révision, les médecins militaires décidèrent de réformer Paul Lambert, pour insuffisance cardiaque. Durant plusieurs jours, les Lambert ne savaient que penser d’une décision pour le moins inattendue.
Il est vrai que jusqu’à ce jour, Paul n’avait jamais ressenti la moindre gêne quant à son rythme cardiaque. Solide, bon vivant, rares étaient les fois où ses parents avaient dû faire appel à un médecin. Dans ces cas-là, c’était, la plupart du temps, pour de bénignes maladies infantiles, des rhumes, voire une bonne grippe qui touchait, l’un après l’autre, tous les membres de la famille.
Pauline décida de prendre rendez-vous chez le docteur Galopin. Celui-ci était le médecin de la famille et avait ausculté Paul, bien des fois, sans rien déceler de particulier. Il habitait Montmartre, rue Caulaincourt, en face du cimetière Saint-Vincent.
C’était un personnage petit, nerveux, qui avait un débit de paroles impressionnant. Parisien de vieille souche, il maîtrisait l’histoire de la Capitale sur le bout des doigts. On ne lui connaissait qu’un défaut : c’était un coureur de jupons invétéré. On disait qu’il portait bien son nom.
Le cabinet du docteur Galopin ne respirait pas la modernité. Depuis plus de trente années qu’il exerçait, il n’avait pas fait les moindres travaux. Les murs étaient habillés d’un vieux papier jauni qui n’avait plus d’âge, et le sol était recouvert d’un abominable tapis qui montrait de réels signes de faiblesse.
À peine Paul et sa mère s’étaient-ils installés dans deux fauteuils brinquebalants, que Galopin se tourna vers cette dernière.
— Eh bien ! vous en faites une tête ? Bon, que se passe-t-il de si grave ?
Paul grilla la politesse à sa mère.
— Docteur, je viens d’être réformé pour insuffisance cardiaque. Je ne suis pas malade et je mène une activité normale. Aussi, j’aimerais connaître votre diagnostic.
Galopin se leva et l’invita à prendre place sur une vieille chaise en partie déglinguée.
— Paul, je vais prendre ta tension et écouter ton pouls.
Les opérations terminées, il ausculta sa gorge, le blanc de ses yeux, avant de reprendre place derrière son bureau. Puis, il se tourna vers Paul Lambert.
— Mon petit Paul, tu as douze-sept de tension et ton pouls bat à quatre-vingts pulsations minute. Ah ! Ces médecins militaires ! C’est à croire qu’ils ont trop d’hommes qui se présentent dans le cadre de la conscription. Bref ! Sois rassuré, tu n’as rien de grave. Et puis, soit dit en passant, tu seras plus utile rue Lepic que dans le djebel. Car ça va péter ! Je vous l’annonce !
Chez les Lambert, tout en écoutant les informations, on accueillait toujours avec le sourire les clients dont beaucoup étaient curieux de découvrir ce bar-tabac que fréquentaient tant de célébrités. En dehors de ses heures passées à servir une clientèle parfois très exigeante, Paul s’offrait quelques virées nocturnes qui le conduisaient de temps à autre à Saint-Germain-des-Prés où se produisaient des orchestres de jazz de très grande qualité, ou alors il passait ses soirées – la plupart du temps – dans un bal auvergnat qui avait pignon sur rue à quelques pas de la place Blanche.
Dans une immense salle du premier étage, un orchestre jouait des airs à la mode. C’était de la bonne musique, du musette qui plaisait à toute une foule de danseurs et de danseuses dont la grande majorité venait des quartiers populaires de la Capitale.
Ce n’était pas en ce lieu que Paul pouvait espérer trouver l’âme sœur. La plupart des filles étaient venues pour danser, pour s’amuser, voire pour flirter, mais certainement pas pour dénicher celui qui leur mettrait la bague au doigt.
Dès lors, Paul se contentait d’inviter quelques belles créatures peu farouches, retrouvait un groupe de camarades et s’offrait un verre de bière, avant de quitter l’établissement et de remonter jusqu’en haut de la rue Lepic où traînaient encore quelques noctambules en goguette.
Paul traversait une période difficile durant laquelle il ne cessait de s’interroger au sujet de son avenir. Lui, d’ordinaire d’une humeur égale, aimant plaisanter et ne manquant pas d’humour, montrait depuis quelque temps, des signes de lassitude qui ne pouvaient tromper sa mère.
Elle décida de crever l’abcès. Un soir, après avoir fermé le bar-tabac, comme ils en avaient pris l’habitude, ils s’étaient retrouvés dans la salle à manger où un petit coin salon avait été installé.
Après une journée bien remplie, ils faisaient une pause. Ce moment de détente s’inscrivait dans une sorte de tradition qu’avait instaurée Léon Lambert. Et pour rien au monde, ils n’auraient dérogé à la règle. Tout en surveillant ses cuisses de lapin qui mijotaient dans une sauteuse, Pauline préparait les apéritifs. À savoir : un porto pour elle et un pastis pour son fils. Après avoir déposé les verres sur la petite table, elle prit place à côté de ce dernier.
— Paul, je te sens inquiet, mal dans ta peau. Tu sais que tu peux te confier à ta mère. Lorsque tu as eu quelques problèmes à résoudre, j’ai toujours été de bon conseil.
Il hésita un court instant. Pour la première fois, elle le devinait plus fragile qu’il ne paraissait. Il se tourna vers elle.
— Ce n’est pas à Paris que je vais trouver la femme de ma vie. Ici, les filles sont superficielles. Moi, ce qu’il me faudrait, c’est une belle jeune femme, solide dans sa tête, travailleuse.
Il s’interrompit.
— Mais aussi amoureuse, ajouta-t-il.
Pauline esquissa un petit sourire.
— Ton père s’est retrouvé dans la même situation que celle que tu connais. Il avait hâte de se marier et désespérait de trouver une femme à Paris. Alors, il a pris la route en direction du Cantal et a trouvé une payse à son goût. Et c’était moi.
— À Lagarde, les belles filles se font rares, fit observer Paul.
Sa mère se pencha vers lui.
— Certainement. Mais personnellement, j’en connais une qui pourrait très bien te plaire.
— De qui veux-tu parler ?
— De la petite Marie Boichu, la fille de l’épicier de Lagarde. Je trouve qu’elle a beaucoup de charme avec ses longs cheveux noirs et ses beaux yeux verts. Et puis, elle sait ce qu’est le commerce. Pendant que son père et son frère font les tournées à travers la campagne, c’est elle qui tient la boutique. Ah ! C’est un beau parti ! s’exclama Pauline.
Elle goûta au porto avant d’enchaîner.
— Cette semaine, j’ai reçu une longue lettre de la tante Jeanne, la sœur de ton père. Bien entendu, elle m’a donné des nouvelles du pays, mais m’a aussi informée que la petite Marie Boichu ne cessait de demander de tes nouvelles. Mon grand, je te le dis comme je le pense, c’est véritablement un beau parti.
Paul attendit la fin de la saison estivale. Arrivé les premiers jours de septembre, il quitta Paris au volant de sa Renault 4CV, sous le regard de sa mère qui, pourtant, peu portée sur la religion, se signa et demanda au bon Dieu d’intervenir afin que son fils convole bientôt en justes noces.
Lagarde était un village d’environ six cents âmes. Situé à une altitude moyenne de mille mètres, il donnait vue sur la longue chaîne des volcans d’Auvergne qui s’étendait du puy de Sancy jusqu’au puy Mary et le Plomb du Cantal.
Les commerces y étaient peu nombreux. Restaient tout de même une boulangerie-pâtisserie, une boucherie, un magasin qui proposait des appareils électroménagers et une belle épicerie tenue par la famille Boichu.
À chaque occasion qui lui était donnée de se rendre à Lagarde, il se partageait entre la maison d’habitation qu’avait su conserver son père, et la ferme proprement dite dont avait hérité sa tante Jeanne. Cette dernière s’était mariée avec Antoine Bonnemaison, un grand échalas, fort comme un bœuf, qui lui avait fait un fils, Guillaume, qui travaillait dorénavant la petite propriété.
Comme de coutume, Paul fut accueilli à bras ouverts. Chaque fois qu’il se rendait à Lagarde, il était assailli de questions, tant par sa tante que par son oncle. Ils désiraient tout savoir sur ce qui se passait à Paris. Mais Paul se pliait de bonne grâce à la curiosité de ces paysans qui n’avaient quitté le Cantal qu’en de très rares occasions.
Son séjour dura une bonne semaine. Il passa une majorité de son temps entre une visite de la propriété qui, autrefois, avait appartenu à ses grands-parents, quelques balades dans les environs et le tour du village où il avait lié quelques amitiés.
Quand il pénétra dans l’épicerie de la famille Boichu et qu’il la vit souriante, belle, avec un visage ou tout maquillage était absent et deux grands yeux verts dans lesquels il devina tout l’amour qu’elle était en mesure de lui offrir, il sut que c’était elle. Et personne d’autre.
Plusieurs soirs, ils sortirent ensemble. Ils se réfugiaient souvent sur les hauteurs de Lagarde d’où ils pouvaient admirer le beau pays d’Auvergne avec cette montagne qui barrait l’horizon, ces vallées profondes, ces petits hameaux isolés et plus près d’eux, ces belles vaches Salers qui allaient et venaient en faisant résonner les cloches accrochées à leur cou.
Quand il lui demanda : « Veux-tu devenir ma femme ? » Pour toute réponse, elle se jeta à son cou et fondit en larmes, tant elle était emplie de bonheur. Lorsqu’elle annonça la nouvelle à sa famille, tout le monde éclata en sanglots, y compris Jules Boichu, le père, qui pleura comme un veau qu’on conduit à l’abattoir.
À la demande des Boichu, la noce fut célébrée à Lagarde, au mois de mai 1956. Tout se déroula sans le moindre accroc. La cérémonie religieuse fut parfaite et le repas de noces, qui accueillait près d’une centaine de convives, fut servi dans une des granges de la famille Bonnemaison. On sentait bon la paille et le foin, avec un menu typiquement auvergnat où étaient proposées toutes les spécialités que pouvait offrir le Cantal.
Quand la belle Marie se retrouva rue Lepic, dans le joli bar-tabac, bizarrement, elle s’adapta tout de suite à cette nouvelle vie, à cet environnement qui lui était pourtant totalement étranger. L’entente avec sa belle-mère était tout simplement exemplaire. Il est vrai que les deux femmes étaient issues du même milieu. Parfois, histoire d’agacer Paul, elles dialoguaient en langue occitane et riaient de bon cœur lorsque ce dernier faisait les gros yeux.
En avril 1957, Marie donna naissance à un magnifique petit garçon qu’ils prénommèrent Étienne. Un immense bonheur était entré dans la maison. Toute la famille était en admiration devant ce bébé qui semblait avoir hérité du visage de son père et des grands yeux verts de sa mère.
Durant de longues années, la vie s’écoula sans que rien ne vienne perturber la belle harmonie qui unissait Marie et Paul. Étienne s’épanouissait sous le regard de sa grand-mère qui lui passait, la plupart du temps, tous ses petits caprices. Quant aux parents, ils avaient pris la décision d’agrandir le bar-tabac et faisaient parfois appel à un accordéoniste qui venait, certains soirs, jouer quelques airs de musette.
Le drame survint à l’automne 76 avec le décès brutal de la grand-mère, Pauline. Ce fut un choc pour tout le monde et en particulier pour Étienne qui avait toujours été très attaché à sa grand-mère.
Les obsèques furent célébrées en l’église Sainte-Marie des Batignolles et Pauline fut enterrée dans le caveau familial, auprès de son mari, au cimetière Montmartre.
Aujourd’hui, beaucoup d’eau avait coulé sous les ponts de la Seine et la vie, plus forte que tout, avait repris ses droits. Étienne était entré dans sa vingt-cinquième année. C’était un homme élancé, large d’épaules, doté d’une chevelure noire, légèrement bouclée et d’un visage où deux intenses yeux verts ajoutaient encore au charme qui se dégageait de sa personne.
La disparition de sa grand-mère l’avait fortement perturbé. Aussi, après avoir passé avec succès un bac littéraire, décida-t-il soudainement d’arrêter là ses études, au grand désespoir de ses parents. De ce fait, depuis plusieurs années, il s’était totalement investi dans la bonne marche du bar-tabac.
Et il ne manquait pas d’idées. Ainsi, il organisait, de temps à autre, des soirées littéraires. Les gens de la Butte y venaient en nombre, car chacun avait tout loisir de pouvoir s’exprimer, qu’on soit ouvrier, fonctionnaire ou danseuse au Moulin Rouge.
Au quotidien, Le Vieux Bougnat accueillait un groupe d’habitués qui fréquentaient les lieux le matin, le midi, et souvent même le soir. Cette petite bande était, en grande partie, représentative d’une population qui faisait la spécificité de ce quartier de Paris, pas tout à fait comme les autres.
Ce soir-là, l’équipe se trouvait presque au complet. Il y avait là Émile Racine, un ancien fort des halles qui était capable d’ouvrir une boîte de sardines avec les dents, Louis Martinaud, le facteur de la rue Lepic, Solange Mougette, la veuve d’un gardien de la paix qui se saoulait au blanc-casse, sans oublier Lucienne Moulard, une ancienne prostituée qui un jour était tombée en extase, rue Saint-Vincent, et qui depuis jouait les dames patronnesses. Enfin, toujours fidèle au poste, Marie Labourier se tenait près du comptoir. On la surnommait la Crevette, car pareille au petit crustacé, elle avait un corps splendide et une tête moche comme il n’est pas possible.
Comme toujours, c’étaient des discussions à n’en plus finir sur les événements qui faisaient l’actualité. Et chacun avait son mot à dire sur cette gauche qui était enfin arrivée au pouvoir et dont certains attendaient le meilleur, alors que d’autres redoutaient le pire.
Alors que Marie avait rejoint son appartement du premier étage afin de préparer le repas du soir, Paul et Étienne assistaient à un spectacle où les propos échangés tenaient du café du commerce et du grand guignol.
Déjà, Solange Mougette avait le regard vitreux et la Crevette montrait des signes évidents d’intense fatigue. Soudain, Paul Lambert sortit de derrière son comptoir et se dirigea vers eux.
— Mes enfants, on ferme ! Allez, vous reprendrez votre discussion demain.
Le bar-tabac avait fermé ses portes. La nuit commençait à tomber sur Paris. En cette belle soirée d’été, le temps était lourd, orageux, et le ciel se chargeait déjà de quelques cumulo-nimbus.
La petite bande remontait maintenant la rue Lepic, bras dessus, bras dessous, en chantant à tue-tête Le Temps des cerises.
* * *
Août était arrivé avec des orages monstrueux qui avaient rapidement vidé les rues de la Capitale. Quelques intrépides se dirigeaient tout de même vers la place du Tertre et la basilique du Sacré-Cœur. Face à la pluie qui ne cessait de tomber, beaucoup s’arrêtaient chez Le Vieux Bougnat, histoire de s’offrir un café ou un bon chocolat chaud.
Une fois qu’il eut effectué son service militaire sur la base de Villacoublay, Étienne choisit de mener une vie de célibataire, peu disposé qu’il était à envisager une liaison sérieuse dans laquelle il ne voyait que des inconvénients. En compagnie de quelques camarades du quartier, ils quittaient souvent la Butte pour le Quartier latin ou le boulevard Montparnasse. Ils avaient déniché quelques night-clubs plutôt sympathiques et des restaurants qui ne l’étaient pas moins.
Ces dernières décennies, Paris avait beaucoup changé. Le Pigalle d’autrefois n’était plus que l’ombre de lui-même. Le boulevard de Clichy était devenu un piège pour touristes. La longue artère n’était plus qu’un alignement de restaurants de seconde zone, de sex shops, et de quelques boîtes qui faisaient de moins en moins recette.
La poésie qui émanait jadis de ce quartier avec les bars louches, les tripots, le spectacle chez la Mère Arthur et le minuscule jet d’eau de la place Pigalle, s’était peu à peu évanouie, laissant bien seul le Moulin Rouge dont les ailes tournaient toujours devant les badauds ébahis.
Cela faisait belle lurette que le petit bal auvergnat avait fermé ses portes. Les prostituées étaient toujours là avec quelques établissements réservés aux lesbiennes et aux gays. Dans les rues sombres et peu accueillantes qui jouxtaient le boulevard, quelques bars faisaient encore bonne figure avec des hôtesses à la plastique irréprochable et parfois envoûtante. Petits lieux de perdition où ces adorables créatures avaient pour mission de faire consommer le client… jusqu’à plus soif.
Cela faisait bien longtemps qu’Étienne ne fréquentait plus ce quartier qui avait vendu son âme. Seul, ou en compagnie de quelques compères, il préférait se retrouver au cœur de Saint-Germain-des-Prés où il avait ses habitudes. Bien entendu, là aussi, la grande époque de l’après-guerre, avec ses caves emblématiques, ses orchestres de jazz, ses personnalités telles que Juliette Gréco, Boris Vian, Sydney Bechet ou le couple légendaire formé par Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, était à ranger au rayon des souvenirs.
Malgré tout, demeurait comme une atmosphère singulière du côté du Café de Flore ou des Deux Magots. Et puis, le charme était toujours présent dans ces petites rues où se côtoyaient restaurants, épiceries fines, libraires et de nombreux magasins d’antiquités.
Étienne prenait un réel plaisir à jouer le lèche-vitrines dans un quartier où il aimait partir à la découverte de ces petites boutiques qui ne payaient pas de mine, mais dans lesquelles on pouvait parfois trouver de véritables trésors. C’était un client fidèle de ces petites librairies où il savait dénicher le livre rare. En effet, s’il avait pris la décision d’arrêter ses études après le décès de sa grand-mère, il restait un amoureux des belles-lettres. Longtemps, il avait caressé l’espoir de devenir journaliste. Au lycée, il avait même été le rédacteur en chef d’un petit journal mensuel qui avait obtenu un certain succès. Il avait aussi fait quelques piges dans un quotidien régional. Aujourd’hui, si son rêve s’était envolé, il ne pouvait se passer d’une lecture quasi quotidienne de romans, mais surtout de biographies et de livres traitant d’événements historiques.
Qui aurait pu penser que ce grand garçon qui passait de table en table pour servir des verres de bière, des apéritifs ou des cafés était habité par une boulimie de la lecture, au point que sa petite chambre regorgeait d’œuvres littéraires en tous genres qui s’amoncelaient dans un désordre tel, que sa mère avait abandonné tout espoir d’un quelconque rangement.
Il avait ses auteurs classiques. S’il détestait Sartre et Robbe-Grillet, il adorait Simone de Beauvoir et Henri Troyat. Il n’était pas insensible au style de Malraux, mais ne se lassait pas de lire et de relire Paroles de Prévert et les merveilleux poèmes de Louis Aragon. Enfin restaient les livres d’histoire et en particulier ceux écrits par François Furet qu’il considérait comme un des plus grands historiens de son temps.
Ses longues balades dans le Quartier latin se terminaient souvent rue Princesse. Là, face à chez Castel, se trouvait un petit bar dans lequel travaillait Marguerite Boucheron dont il avait fait connaissance au cours d’une soirée bien arrosée.
Tout de suite, des liens s’étaient tissés, vu qu’elle était native du Cantal, et plus précisément du village de Condat, situé à quelques kilomètres de Lagarde. C’était une femme qui approchait de la quarantaine. Divorcée, elle était devenue lesbienne comme d’autres deviennent bouddhistes, probablement pour être dans l’air du temps.
Parfois, elle le conduisait à quelques pas de la rue Princesse où une cave discrète avait été aménagée en un bar, exclusivement réservé à ces dames. Et elle riait de bon cœur de voir la mine dépitée de ce pauvre Étienne au milieu de ces ravissantes jeunes femmes qui semblaient l’ignorer superbement.
Montparnasse était un autre quartier de la Capitale dans lequel il effectuait, de temps à autre, quelques virées nocturnes, histoire de faire des rencontres et de passer un bon moment avec une agréable et belle créature, mais en certaines occasions également avec des dames d’un certain âge.
C’était le lieu idéal où il pouvait satisfaire sa libido. Il fallait bien que jeunesse se passe. Aussi se rendait-il souvent à La Coupole, une brasserie presque légendaire.
L’établissement avait ses lettres de noblesse. D’abord, le cadre était extraordinaire avec son bar américain, son salon privé et sa terrasse. La grande salle était un chef-d’œuvre de l’Art déco. Enfin restait le dancing, lieu que fréquentait Étienne et dans lequel il avait connu moult aventures sentimentales.
L’endroit était renommé pour accueillir des femmes mariées, issues des milieux bourgeois, venues pour s’encanailler avec quelques bellâtres. Étienne avait déjà noué de courtes relations avec quelques-unes de ces dames. La plupart du temps, c’étaient des rencontres qui se soldaient par une partie de jambes en l’air. Sans plus. Néanmoins restaient des exceptions avec des liens qui perduraient avec le risque d’un scandale si jamais le mari trompé découvrait le pot aux roses.
Sur la butte Montmartre, et ce depuis sa plus tendre enfance, Étienne fréquentait la famille Weis. C’étaient de braves gens qui habitaient à une centaine de mètres du bar-tabac. Lui était un ancien inspecteur de police qui avait fait une grande partie de sa carrière au 36, quai des Orfèvres, au sein de la brigade criminelle.
Joseph était né dans la partie sud de l’Alsace, dans la région du Sundgau. Il avait conservé, en partie, l’accent de son terroir. Son épouse, Cécile, était née à Belleville dans une famille dont les origines parisiennes se perdaient dans la nuit des temps.
C’était un couple fusionnel. Ils se regardaient toujours avec des yeux emplis d’amour. Sans enfant, ils connaissaient la famille Lambert depuis des décennies. Probablement pour compenser leur manque, ils avaient toujours eu une tendresse particulière pour Étienne.
Ce dernier leur rendait visite, habituellement, plusieurs fois par semaine. Aujourd’hui à la retraite, Joseph avait des histoires plein sa besace. Durant les longues années passées à la brigade criminelle, il avait vécu quelques affaires sordides qui avaient fait la une des quotidiens nationaux. Et Étienne adorait l’écouter raconter toutes ces enquêtes, ces filatures et ces arrestations souvent musclées qui se terminaient parfois dans le sang.
Il ne se lassait pas de l’entendre narrer l’histoire du gang des Tractions Avant, avec Pierre Loutrel, dit Pierrot le fou. En 1952, il avait fait partie de l’équipe qui avait enquêté sur un braquage qui s’était soldé par le meurtre de Jean-Baptiste Vergne, un gardien de la paix. Et puis, en 1976, était survenu l’assassinat commandité du député Jean de Broglie qui avait fait grand bruit dans le landerneau politique.
Enfin restaient toutes ces affaires jamais élucidées. Et elles étaient nombreuses avec des règlements de compte entre truands ou des disparitions étranges dont beaucoup demeuraient un grand mystère.
Chaque année, tout au début du mois de septembre, alors que la horde de touristes avait quitté la Capitale, Marie et Paul Lambert avaient instauré une tradition qui perdurait depuis une dizaine d’années.
Avant de fermer boutique, et à la veille de rejoindre le village de Lagarde, ils conviaient les habitués du bar-tabac que Paul surnommait « la bande à Bonnot », ainsi que Cécile et Joseph Weis, à un repas simple et convivial qui s’inscrivait dans l’amitié qui unissait une grande majorité de Montmartroises et de Montmartrois.
Au cours de l’après-midi, Marie Labourier et Solange Mougette étaient venues prêter main-forte à Marie Lambert. Elles avaient dressé les tables au beau milieu du bar, avaient installé les nappes et les couverts, et avaient aussi préparé les plats de charcuterie, laissant à Marie le soin de confectionner la blanquette de veau dont elle avait fait sa spécialité.
Et ils avaient, toutes et tous, répondu à l’invitation des Lambert. Mais ils n’arrivaient pas les mains vides. Tandis que l’un apportait une bouteille de bourgogne, un autre était venu avec un champagne brut de la région d’Épernay. De son côté, Cécile Weis avait offert un magnifique bouquet de roses rouge et jaune, alors que Robert Cartier n’avait pas oublié de se présenter avec son accordéon suspendu à son épaule.
Cette petite assemblée était plutôt sympathique avec un ancien fort des halles, un facteur en activité, une veuve et une ancienne prostituée qui disait avoir vu la Sainte Vierge. Et puis, il y avait Joseph Weis qui en imposait par sa stature, ce qui ne l’empêchait nullement de rire de bon cœur quand la Crevette narrait de sa voix gouailleuse la dernière histoire de coucherie qui traînait dans le quartier.
Mais ce qui unissait tous ces hommes et ces femmes qui venaient de milieux très différents, c’était l’esprit de Montmartre. Au cours de ces soirées, on ressentait combien la Butte restait un grand village où perdurait une belle humanité. Et on trinquait, buvait, riait dans une ambiance bon enfant, alors que Marie Lambert avait déjà déposé sur la longue table deux gargantuesques plats de charcuterie.
Des discussions informelles s’ensuivaient, chacun donnant son avis sur l’entretien de la rue Lepic, le ramassage des ordures, l’éclairage défectueux et la prochaine vendange du vignoble de Montmartre, dont on reconnaissait que la récolte n’était pas prête à rivaliser avec les grands crus bordelais ou bourguignons.
De temps à autre, histoire de faire patienter entre deux plats, Robert Cartier offrait alors quelques airs de musette qui étaient repris en chœur. C’étaient des chansons populaires comme La Complainte de la Butte, La Java bleue ou À la Villette.
Alors que la Crevette et Marie Lambert se présentaient les bras chargés de deux grands plats emplis, l’un de la blanquette de veau, et l’autre de riz, on était passé du coq à l’âne.
Régnait un brouhaha indescriptible où tout le monde avait son mot à dire sur la générosité du gouvernement qui distribuait à tout va des milliards de francs aux fonctionnaires, aux retraités, aux agriculteurs, sans oublier la revalorisation des allocations familiales.
— Mais où vont-ils prendre tout cet argent ? s’enquit Émile Racine.
Paul Lambert se tourna vers lui.
— Mais mon cher Émile, dans nos petites économies. Tu verras, dès l’année prochaine, Mitterrand va nous demander de nous serrer la ceinture.
À l’odeur alléchante de la blanquette de veau, ils avaient fait une pause. Un grand silence s’était installé dans la salle alors que tout ce petit monde appréciait un plat préparé avec amour et talent par Marie Lambert. Soudain, la Crevette se redressa et s’essuya les lèvres.
— J’ai appris que Brassens n’était pas au mieux. Il paraît que c’est grave. Ah ! Il ne faudrait pas que notre Georges nous quitte. On a encore besoin de lui, déclara-t-elle d’une petite voix dans laquelle perçait une véritable émotion.
— Ce sont toujours les meilleurs qui partent, fit remarquer Lucienne Moulard. Demain, je monterai à la basilique et je demanderai au bon Dieu d’intervenir afin qu’il le sorte de ce mauvais pas.
L’heure était déjà bien avancée. Après avoir fait honneur au plat de fromages où trônaient, cela va de soi, un saint-nectaire, un bleu d’Auvergne et un vieux cantal, on se régalait de deux belles tartes aux reines-claudes et du champagne qu’avait amené Émile Racine.
Joseph Weis se tourna vers Paul Lambert.
— Quand partez-vous pour Lagarde ? demanda-t-il.
— Après demain, dans la matinée. Les deux semaines passées dans nos chères montagnes vont nous faire le plus grand bien, répondit Paul.
— On dit que dans le Cantal les filles sont belles. Avec un peu de chance, Étienne trouvera la femme de sa vie, intervint Louis Martinaud.
— À Lagarde, il y a des belles et des moches. Comme partout. Cela dit, j’en connais quelques-unes qui sont en capacité de faire tourner les têtes, répliqua Paul.
Tout le monde riait, y compris Étienne, habitué qu’il était à son célibat. Quand les cloches de l’église Saint-Jean de Montmartre résonnèrent pour annoncer minuit, peu à peu l’assemblée quitta les lieux. Toutes et tous s’attardèrent afin de remercier Marie et Paul pour leur accueil, avant que la petite troupe ne se dispersât à travers les rues de la Butte dont le silence n’était troublé que par quelques matous à la recherche de nourriture.
La voiture des Lambert était une R 12 TS, de marque Renault, bleu foncé. Elle était une grande partie de l’année garée dans un minuscule garage situé rue d’Orchampt. En fait, Étienne était bien le seul à lui faire prendre l’air, de temps à autre. À la belle saison, il lui arrivait de partir, avec quelques camarades, sur les bords de la Marne ou de descendre vers le beau pays de la Sologne.
Le trajet entre Paris et Lagarde était long avec des portions qui recommandaient la plus grande prudence. Comme toujours pour un voyage qui prenait une bonne journée, Étienne était au volant et conduisait à vitesse raisonnable. Déjà, l’arrivée de l’arrière-saison se faisait sentir. L’air était plus frais et quelques feuillus avaient déjà pris des teintes automnales.