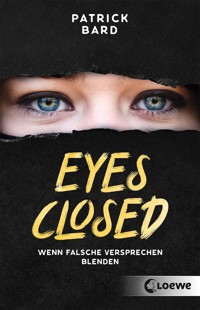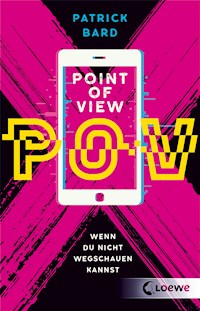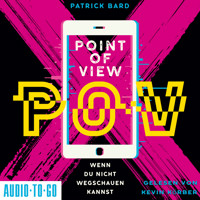Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
À la découverte du Berry ancestral.
Patrick Bard, auteur de polars glaçants qui emmènent leurs lecteurs (nombreux) au bout du monde, livre ici une ode très émouvante à son pays de cœur, à cette terre de potiers du Berry dont ses fibres les plus intimes sont issues. À lire ce photographe de talent qu’il est aussi, on voit spontanément les images qu’il écrit sur la cuisine, sur la géographie, sur George Sand, sur ce terroir de vins et de sorciers qui a vu naître Jacques Cœur et Le Grand Meaulnes.
L'auteur nous invite avec tendresse à découvrir le Berry, pays plein de charme de son enfance.
EXTRAIT
D’où suis-je vraiment ? Quelle est ma culture ? Celle de l’enfance ? Celle qui marche avec une langue, un accent, une cuisine, l’éducation des sens ? Qui suis-je ? Si je devais répondre à cette question, je dirais : « Berrichon. » De parents, de grands-parents, d’arrière, arrière-arrière, aussi loin qu’il vous serait possible de remonter la lignée incertaine de miséreux que je nomme ancêtres, glèbe collée aux sabots. Berrichon je suis, donc. Berrichon de toutes les vacances de mon enfance, Toussaint, Noël, Chandeleur et Pâques incluses, et croyez-moi, ça fait un paquet de temps…
À PROPOS DE L'AUTEUR
Patrick Bard, né le 13 avril 1958 à Montreuil-sous-Bois, est un photojournaliste et écrivain français.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 84
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À mes grands-parents, Hélène et Alexandre…
« J’adhérerai à SOS-racisme quand ils mettront un S à racisme. Il y a des racistes noirs, arabes, juifs, chinois et même des ocre-crème et des anthracite-argenté. Mais à SOS-Machin, ils ne fustigent que le Berrichon de base ou le Parisien-baguette. C’est sectaire. (…) Mais attention, il ne faut pas me prendre pour un suppôt de Le Pen sous prétexte que je suis contre tous les racismes. »
Pierre Desproges,Fonds de tiroir, Éditions du Seuil
« Changement d’herbage réjouit les veaux »,proverbe berrichon
ÊTRE ET NAÎTRE
On naît quelque part comme on est de quelque part. Quoique, s’il faut en croire Brassens, seuls les imbéciles heureux naissent quelque part et en tirent fierté. Je suis venu au monde à Montreuil-sous-bois. J’y ai passé vingt-quatre heures. La naissance est un hasard. L’être, lui, relève de l’enfance, de l’imprégnation, de la culture. En ce sens, je suis un banlieusard élevé en Seine-Saint-Denis. J’ai vécu vingt-sept ans sur les bords de Marne. Mais je suis aussi un Hispanique, par ma belle-famille, depuis trente-sept ans. Plutôt, non, espagnol-mexicain, d’ailleurs, pour avoir passé plusieurs années au pays de la tortilla. Et puis, tant qu’on y est, je suis Percheron, puisque je vis depuis sept ans dans le Perche, que ma fille y vit aussi, et que l’une de mes deux grand-mères y est enterrée bien qu’elle soit une pure Normande née à la Rivière Saint-Sauveur et habitante de Deauville. C’est beaucoup, je vous l’accorde bien volontiers. Mais qu’est-ce que ça fait de moi, au juste, cette somme d’être ? D’où suis-je vraiment ? Quelle est ma culture ? Celle de l’enfance ? Celle qui marche avec une langue, un accent, une cuisine, l’éducation des sens ? Qui suis-je ? Si je devais répondre à cette question, je dirais : « Berrichon. » De parents, de grands-parents, d’arrière, arrière-arrière, aussi loin qu’il vous serait possible de remonter la lignée incertaine de miséreux que je nomme ancêtres, glèbe collée aux sabots. Berrichon je suis, donc. Berrichon de toutes les vacances de mon enfance, Toussaint, Noël, Chandeleur et Pâques incluses, et croyez-moi, ça fait un paquet de temps. Berrichon, parce que mes grands-parents, sans doute, me consacrèrent plus de temps que mes parents ne le firent, trop occupés qu’ils étaient à leurs intestines querelles. Berrichon par la cuisine, au beurre, forcément au beurre. Par le vin, pinot noir ou cabernet-sauvignon. Par le pain, béni. Par la littérature – en Berry, on n’échappe pas à Sand –, par la terre, celle des potiers, par les eaux de l’Indre et du Cher, par le feu et le fer du forgeron du village, par le peintre-poète-écrivain-globe-trotter – du village aussi – qui indiquait sa profession sur un panneau cloué à sa porte et qui me fit rêver de lointains. Par l’odorat, par l’ouïe, le goût, le toucher, le regard, je le confesse, je suis berrichon, habitant de la planète Terre.
Si l’on en croit le regretté Desproges, on est toujours le Berrichon d’un autre…
Terre
Bandez-moi les yeux, emmenez-moi en Berry, je vous dirai sans hésiter où je suis rien qu’à l’odeur de la terre. On prétend que l’odorat est le sens de la mémoire. Depuis ma naissance, j’ai senti, respiré le Berry, en toutes saisons. Ses fragrances sont inscrites dans mes cellules. Je l’ai dit, je descends d’une longue lignée de paysans, la plupart du temps sans terre. Des domestiques, des journaliers, des gardes-vignes. De Sainte-Lizaigne, en champagne berrichonne, jusqu’à Sassierges Saint-Germain, les miens ont parcouru un peu plus d’une trentaine de kilomètres en trois cent quarante ans. Cette terre-là est dans mes gênes. Elle n’est pas noire, ni grise argile. Elle est brun-clair, sensuelle, grumeleuse sous la pulpe des doigts, parsemée de calcaire et de silex. Avec un petit effort d’imagination, elle sentirait presque le pain. Cette terre-là, mes grands-parents l’ont retournée avant de la fuir pour échapper à la misère, avant d’y revenir, avant, enfin, d’y pourrir. Ma grand-mère, placée à huit ans comme bonne, mon grand-père confié à sept ans comme arpette dans une ferme. Ils se sont rencontrés dans un bal. Il y avait-là des sonneurs, des cornemuseux, des vieilleux. Hélène et Alexandre étaient pauvres, mais portaient des noms de héros antiques. Il se sont aimés sur un air de bourrée, de branle, et se le sont avoué en berriau, en langue berrichonne. Ils louèrent une maison, enfin, une maison, c’est beaucoup dire. Une bouinotte, plutôt, un genre de pièce unique au sol de terre battue, sans eau ni électricité, à Châtre, un hameau où mon grand-oncle et sa famille s’étaient installés comme fermiers. Enfant, je l’ai connu cette ferme-là, avec ses chèvres pour le lait, le fromage, quelques vaches, des poules, des lapins, des canards, un potager, un cheval percheron, des champs de blé et d’orge. Des bouchures. Des mares. Des garennes. Je me souviens de l’échelle en bois appuyée à la lucarne, de la porte fermière à double-battant, de la salle basse aux poutres noircies par la fumée, des mouches se débattant sur le papier collant, de ma grand-tante maniant les aiguilles dans la cheminée, de la longue table et des bancs. Des verres épais où mon grand-oncle, Eugène Mouchebœuf, dit Tontaine, versait un vin noir, sanguin, qui tachait la toile cirée, tandis que ma grand-tante exhumait d’un bahut une boîte de fer blanc remplie de biscuits. En ce temps de mon enfance, les cadeaux venaient aux étrennes plus qu’à Noël, qui n’était pas encore très installé sous sa forme étasunienne en Berry, en dépit de la présence des forces de l’Otan à Châteauroux.
Mes grands-parents, donc, étaient arrivés à Paris au début des années 1930, fuyant une indigence crasse. Ils y étaient restés à peine plus de vingt ans, le temps pour Alexandre de se faire une retraite de conducteur de rame de métro, puis ils avaient réalisé leur rêve. Ils avaient acheté un bout de terre à quelques kilomètres de Châteauroux, sur la route de La Châtre, et s’y étaient construit un bout de paradis. Une maison, une vraie maison, à eux, avec une basse-cour, une vigne – les bonnes années, le rouge tutoyait les six degrés ! Un vin de soif plus apte à désinfecter l’eau du puit qu’à ennivrer, un vin qu’Hélène et Alexandre ont toujours coupé d’eau et qui laissait un goût aigrelet sur la langue, un goût que je n’ai jamais retrouvé, ni oublié. Le vin, c’était la boisson des grands, mais aussi celle des petits, avec plus d’eau que de vin, cependant. Le potager était immense, vu de mon enfance, évidemment. Chaque samedi, mes grands-parents se rendaient à Châteauroux, au marché de la place Voltaire, pour s’installer dans l’ombre de l’église Saint-André, la nef où j’ai été baptisé. Ils y vendaient leurs légumes, leurs œufs, leurs fleurs et leurs volailles sur un petit étal. Mon grand-père n’avait pas le permis de conduire. Ils y allaient à vélo, au début, tirant chacun une petite remorque. Dès qu’il l’obtint, il fit l’acquisition d’une 2 CV, cuvée 1955, dont la bâche descendait jusqu’au pare-choc arrière et dont il fallait actionner l’unique essuie-glace à la main.
Il n’y avait alors rien d’autre autour de Châteauroux que des champs. Le lieu-dit où les grands-parents avaient bâti leur chaumière avait pour nom La Brauderie. On y accédait par un mauvais chemin de terre, pas toujours praticable en voiture. Le Berry de mon enfance, c’était ce Berry-là. Celui d’avant le remembrement. Un Berry de parcelles, de bouchures – les haies – peuplées d’oiseaux, par centaines, de têteaux – trognes émondées, figures grimaçantes collées au ciel, membres crochus, tordus –, arbres à sorciers, fossés plein d’eau et de têtards, noyers immenses dont nous récoltions les cerneaux pour les porter au moulin à huile. Le goût de cette huile, son parfum, jamais je n’ai pu les oublier, ni les retrouver, pas plus que le vin du grand-père.
Il fallait alors aller jusque vers Vatan pour buter sur un paysage de champs infinis, monotones, aux allures de Beauce. Mais la Brauderie était encore enserrée dans un réseau de bouchures. Alexandre m’entraînait sur le chemin de terre qui menait à la Forge de l’Isle. Enfant, il l’avait emprunté en diligence. Il était né en 1902, un temps où les voitures étaient inconnues en Berry. Nous regardions passer au loin la micheline blanche et rouge qui cornait joyeusement au passage à niveau, avant de disparaître du côté de La Châtre. Du fond de sa vigne, mon grand-père scrutait les premiers reliefs qui annonçaient le pays creusois. Invariablement, le vent qui en venait nous apportait la pluie. Je l’entends encore annoncer l’orage sur la Creuse, oracle assis sous sa tonnelle, un verre de sancerre blanc en main : « Ça va faire eud l’iau ! »
Ces souvenirs d’enfance, je pourrais les énumérer sans me lasser jamais, tant chaque mot fait resurgir une image.
Les pommes de terre dans l’ombre du cellier, les semis de radis sous les chassis, les salades sous les cloches de verre, la cabane en planche des WC à côté des lapins, le chocolat chaud sur la cuisinière à bois, la soupe en guise de petit déjeuner, la tartine de fromage de chèvre que je mangeais en regardant ma grand-mère saigner les poules ou bien étouffer les pigeons sous ses aisselles, les promenades en forêt du Poinçonnet avec mon grand-père et son chien Riquet, mon premier potager d’un mètre carré. Hélène prenant la main d’Alexandre sur le sentier, une histoire d’amour de soixante-dix ans. Je les adorais. Je passais-là toutes mes vacances et je trouvais tout beau.
Mais c’était sans compter avec les seventies