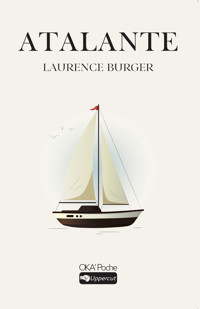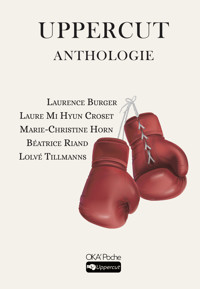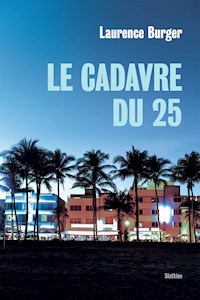
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Slatkine Editions
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Suivez un inspecteur de police monégasque dans une enquête palpitante !
François Gaudard, inspecteur de police à Monaco, ne s’attendait pas à découvrir un sac mortuaire alors qu’il procédait au séquestre d’un coffre-fort d’une importante banque italienne du Rocher. Sac mortuaire qui plus est occupé par un cadavre ! Alors qu’elle ne fait que commencer, l’enquête va se trouver rapidement prise dans les méandres financiers de sociétés licencieuses. Entre affaire de dopage, escort-girl, lutte contre le blanchiment, trafics divers entre Genève et Miami, et exploits sportifs, les héros, deux policiers dont les existences ne cessent de se croiser, se confrontent à des malfaiteurs d’origine aussi diverses que des membres de cartels sud-américains et des banquiers douteux, qui n’hésiteront pas à faire couler le sang pour défendre leurs méfaits.
Un corps retrouvé ne présentant aucune blessure mortelle… Mais pourquoi cacher quelqu'un mort naturellement? Le mystère du meurtre s'épaissit au fur et à mesure que les affaires se croisent et s'entremêlent. L'inspecteur pourra-t-il éclaircir ce nuage de doutes?
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
"En 351 pages, on voyage et on croise toutes sortes d’archétypes clairement assumés. Ceux du banquier privé et de l’avocat genevois, du narcotrafiquant latino-américain, du sportif dopé, de la fille de l’Est et j’en passe. Descriptions et portraits sont aussi brefs que l’action est rapide. Un livre à ne pas lâcher avant le dénouement, sinon tout est à recommencer." - LaTribuneDeGenève
À PROPOS DE L'AUTEUR
Avocate de formation, spécialiste en arbitrage international, Laurence Burger a décidé il y a quelques années d’étendre sa passion pour le verbe à l’écriture de romans policiers qui allient mystère, voyages et, bien sûr, crimes. Le cadavre du 25 est son premier roman publié aux Éditions Slatkine.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Dramatis personae
Nino Bartolini
Avocat à Banca della Santía
Ricardo Calderón
Détenu à la prison centrale de Bogota
Adrienne de Catville
Épouse d’Arnaud de Catville
Arnaud de Catville
Associé de la banque genevoise Luce Rennstein & Randaud
Roberto Cuomo di Niperlia
Financier, cousin d’Alberto di Ruggio
Marushka Dabrowski
Maîtresse d’Arnaud de Catville
Dan Davis
Médecin à l’Hôpital universitaire de Miami
Yves Farge
Journaliste genevois
Alphonse Favre
Directeur d’Alpine Peaks
Jean-Christophe Fellay
Détective vaudois à la retraite
François Gaudard
Inspecteur au sein de la Sûreté publique de Monaco
Olivier Gaudard
Frère jumeau de François, informaticien travaillant pour la Direction départementale des Finances publiques des Alpes-Maritimes en France
Guido Giolli
Procureur de la Principauté de Monaco
Alain Giroud
Inspecteur de la Police cantonale de Genève
Benito Gomez
Membre d’un cartel colombien
Horace Grané
Médecin-légiste de la Sûreté publique de Monaco
Miguel Jimenez
Étudiant au Miami Dade College
Luc Leguennec
Coach sportif
Gérard Lion
Bras droit de François Gaudard à la Sureté publique de Monaco
Ron McDougall
Commissaire divisionnaire de Miami
Rose McGawn / Ana Miganof
Inspectrice à Scotland Yard
Gabriela Ortega
Infirmière à l’Hôpital universitaire de Miami
Federico Pietro
Hacker
Andres Podro
Membre d’un cartel colombien
Guillermo Podro
Membre d’un cartel colombien
Eduardo Ramón
Homme d’affaires à Miami
Dominic Rubovz
Responsable de la société Alpine Peaks
Alberto di Ruggio
Directeur de la Banca della Santía
Melissa Sanchez
Agent de la police de Miami
Rick Simmons
Inspecteur au Federal Bureau of Investigation (FBI) de Miami
Gianfranco Tadei
Hacker
Benoît Verret
Juge d’instruction à Genève, cousin d’Arnaud de Catville
Marianne Verret
Épouse de Benoît Verret
Alexandre de Weinster
Avocat de Dominic Rubovz
James Wright
Petit ami de Rose McGawn
Max Zibel
Vice-champion de ski alpinisme
Prologue
Avant de partir au travail, il consulta sa messagerie électronique. Toujours aucune réponse. Devait-il comprendre qu’on désapprouvait sa démarche ? Il était surpris, mais quand il y réfléchissait, ce n’était pas si étonnant. Après tout, son ami n’était pas un modèle de courage.
Chassant ses sombres pensées, il enfourcha son vélo et rejoignit rapidement la grande route qui serpentait entre les vignes. En cette fin d’été, les ceps regorgeaient de grappes déjà bien formées et les feuilles commençaient à se parer de tons chatoyants, dessinant une mer de couleurs chaudes. Dans une heure, les vignerons seraient au travail, mais pour le moment, il avait l’impression que la nature tout entière lui appartenait.
Subjugué par ce qui l’entourait, il ne vit pas la fourgonnette qui attendait à l’intersection d’une route secondaire, dissimulée par la verdure. Alors qu’il s’apprêtait à passer devant elle, elle démarra et lui coupa la route. Il planta les freins, perdit l’équilibre et tomba sur l’asphalte. N’arrivant pas à détacher ses pieds des pédales, le cycliste peinait à se relever. Le conducteur s’approcha et plaqua un chiffon imbibé de chloroforme sur son visage. L’anesthésiant agit immédiatement. L’assaillant ouvrit le hayon, y jeta le vélo, puis déposa le corps inerte avant de démarrer en trombe. Ni vu, ni connu, l’enlèvement avait duré moins de trois minutes.
Chapitre 129 septembre
Monaco
Coincé derrière un bus orange, l’inspecteur François Gaudard pestait. De la compagnie « Les Rapides d’Azur », ce bus n’avait de rapide que le nom. Il attendait longuement à chaque arrêt et François ne pouvait s’empêcher d’avoir l’impression que le chauffeur savourait la vision de la longue file de voitures qui s’agglutinait derrière lui. François hésitait à enclencher son gyrophare, mais les tensions créées par sa dernière enquête lui donnaient plutôt envie de se faire un peu oublier.
De plus, il avait une nouvelle voiture de fonction. Moins bien que la précédente, certes, car il n’avait pas pu la donner à son copain Dédé le garagiste pour qu’il y ajoute quelques chevaux, ses initiatives personnelles tendant à augmenter la puissance de ses montures étant désormais malvenues. On lui avait aussi fait comprendre qu’on préférerait qu’il ne la rende pas sous la forme d’une sculpture de César comme la dernière fois.
Donc, pas de dépassement intempestif sur la route étroite que devient la Basse Corniche en entrant dans la localité de Cap-d’Ail. Il allait arriver en retard à la Banca della Santía, où l’attendaient deux de ses hommes pour procéder à un séquestre.
Chose rare, les tribunaux monégasques avaient procédé à l’exécution d’une requête pénale émanant de la High Court de Londres. Dans une affaire de blanchiment, la High Court avait demandé que soient saisis les coffres forts détenus par la société Alpine Peaks, Inc., domiciliée à Jersey. François devait assister à l’ouverture des coffres et procéder à la confiscation de leur contenu.
Avec une bonne demi-heure de retard, la Peugeot se gara devant le bâtiment de la Banca della Santía. Les deux policiers mandatés par François s’y trouvaient déjà, fumant une cigarette sur le trottoir.
– Salut les gars, les héla François, désolé pour le retard. Tout est prêt ?
– Oui, répondit l’un des policiers.
– Alors allons-y.
Les trois hommes entrèrent dans la banque, où ils furent immédiatement reçus par Alberto di Ruggio, son directeur, un petit homme obséquieux qui les invita à le suivre rapidement. De toute évidence, la banque n’avait pas envie que la présence de policiers entre ses murs soit trop remarquée.
Ils prirent un ascenseur de fonction, petit et vétuste – rien à avoir avec celui, Belle Époque et tapissé de bois noble, réservé aux clients que François avait emprunté lorsqu’il était venu voir di Ruggio pour discuter des modalités du séquestre – et descendirent au 3e sous-sol. Ils arrivèrent devant un long couloir de béton sur lequel donnaient des portes en métal. Le directeur passa en premier. Ils parcoururent toute la longueur du corridor pour arriver devant une porte blindée frappée du chiffre 25. Di Ruggio scanna son badge et la porte s’ouvrit automatiquement sur une petite pièce dotée d’un autre accès quelques mètres plus loin. Les murs du sas, qui ne devait pas mesurer plus qu’un mètre sur un mètre, étaient habillés d’un revêtement en plastique rigide qui se terminait au plafond à la façon d’un toit d’igloo.
– Entrez tous avec moi, dit-il une fois la porte refermée, cet appareil opérera une reconnaissance corporelle de chacun de nous. Si l’un de nous ne correspond pas à sa description dans le fichier, nous resterons enfermés ici jusqu’à que vos collègues viennent nous chercher, continua-t-il avec un pâle sourire.
François, les deux policiers et di Ruggio s’entassèrent dans la petite pièce. Une fois la porte refermée, des faisceaux de lumière se mirent à descendre le long des murs, scannant les corps de la tête aux pieds, puis ils s’éteignirent et la machine émis trois petites sonneries.
– C’est bon, dit le directeur en poussant l’autre porte qui s’était déverrouillée.
Ils arrivèrent dans une imposante salle carrée, au fond de laquelle se trouvait l’accès à un coffre-fort. Di Ruggio s’en approcha, introduisit une clef USB dans un orifice prévu à cet effet, puis mit la paume de sa main sur un écran. Une fois l’identification digitale terminée, il approcha son œil droit d’un autre scanner. François entendit le cliquetis des serrures qui s’ouvraient. Le directeur saisit la grosse roue sur l’avant du coffre, la tourna d’un quart dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, et tira dessus.
La porte tourna sur ses gonds, laissant apparaître une pièce d’environ deux mètres de largeur sur six de longueur, dans laquelle un homme pouvait aisément se tenir debout. Di Ruggio s’écarta pour laisser passer François en premier.
À peine entré dans le coffre, François mit sa manche sur son nez.
– Ça pue là-dedans, des rats y sont morts ou quoi ?
Il s’avança un peu. Des boîtes en plastique dur étaient empilées de chaque côté sur un mètre de haut. Les piles commençaient environ à la moitié de la pièce et semblaient s’arrêter au fond.
François se dirigea vers les premières. Il mit les gants en latex qu’il avait toujours sur lui, ouvrit un couvercle et poussa un petit sifflement d’admiration. La boîte était remplie de lingots d’or « Good Delivery », soit d’environ douze kilos. Il en compta dix. Il se mit à avancer entre les boîtes pour les compter. Il y en avait dix. Il fit un rapide calcul. À près de 40 000 euros le kilo d’or, il y en avait pour environ dix millions.
Arrivé près du mur du fond, François remarqua une forme noire allongée sur le sol. L’odeur putride était encore plus forte à cet endroit. François sortit son portable pour éclairer l’objet que les néons faiblards du coffre peinaient à rendre visible. Il aperçut une fermeture éclair. Sa crainte se trouva confirmée. Il s’agissait bien d’un sac à dépouille.
Il se baissa et attrapa la fermeture d’une main, appuyant toujours fermement sa manche sur son nez pour atténuer l’odeur. Il tira. Le zip s’ouvrit sur une vingtaine de centimètres avant de se gripper.
– Merde ! s’exclama-t-il.
Par l’ouverture, il venait d’apercevoir un doigt putréfié.
François referma rapidement l’orifice, se releva et revint à grandes enjambées vers l’entrée où se tenaient le directeur et les policiers, immobiles.
– Il y a combien de temps que ce coffre a été ouvert pour la dernière fois ? demanda-t-il à di Ruggio.
– Je crois que personne n’y a pénétré depuis que le locataire y a déposé les boîtes, donc environ huit ans.
– Et vous ne vous êtes jamais rendu compte qu’il y avait un mec qui pourrissait ici depuis tout ce temps ?
– Mon Dieu, c’est cela cette odeur ? s’écria le directeur.
– Oui, c’est ce qu’il y a dans le sac là-bas, au fond, répondit François.
– Oh Mon Dieu ! Oh Mon Dieu ! continua di Ruggio, qui semblait complètement paniqué.
François se tourna vers ses collègues.
– Apposez les scellés, j’en ai assez vu.
Puis au directeur :
– Sortons d’ici.
Une fois di Ruggio et François sortis, les agents attachèrent de la rubalise rouge et blanche en travers de la porte du coffre, puis la petite troupe ressortit en passant à nouveau par le sas, laissant la même bande bicolore sur chaque porte qu’ils traversaient. Ils remontèrent en silence au rez-de-chaussée.
– Il vaut mieux que vous veniez dans mon bureau pour discuter, dit le directeur qui tremblait de nervosité.
Laissant les policiers dans le hall de la banque, François monta avec di Ruggio, empruntant cette fois-ci le bel ascenseur réservé les clients. L’heure était grave et la prétention n’était plus de mise. François sortit son portable et appela Horace Grané. Horace était le nouveau médecin-légiste de Monaco qui avait remplacé Géraldine Franc après qu’elle avait été arrêtée pour collusion et dissimulation de preuves. C’était l’ancien assistant de Géraldine, dont François s’était personnellement assuré qu’il la remplacerait pour éviter tout jeu d’influence de la part des autorités monégasques.
– Salut, François, répondit Horace. Ce que François appréciait le plus chez Horace, c’était sa disponibilité à toute heure du jour et de la nuit.
– Salut, Horace. J’aurais besoin de toi à la Banca della Santía. Il y a un cadavre en train de finir de pourrir dans un des coffres-forts. Il va falloir que tu l’emportes pour l’identifier.
Horace soupira. Il n’osait pas imaginer l’état du cadavre.
– OK, j’arrive ! dit-il avant de raccrocher.
François regarda di Ruggio qui ne semblait toujours pas calmé. Il s’épongeait sans cesse le front, mais se remettait immédiatement à suer. François lui demanda les relevés de visite du coffre. Le directeur composa un numéro, devant s’y reprendre à plusieurs fois tant il était nerveux. Finalement il réussit et une voix de femme répondit. Il lui donna des ordres en italien. Au bout de deux minutes, la secrétaire entra avec une page imprimée. Di Ruggio la prit et y jeta un rapide coup d’œil avant de la présenter à François. Il semblait rassuré que le document confirme que la seule ouverture du coffre avait eu lieu quand les transporteurs de fonds étaient venus apporter les boîtes, huit ans auparavant.
Quelques instants plus tard, on frappa à la porte et la tête d’adolescent attardé d’Horace apparut dans l’interstice. François fit les présentations.
– M. di Ruggio vient de me montrer les relevés de visites du coffre où se trouvait le corps, et ils confirment ses dires. Il a été ouvert une seule fois il y a huit ans quand les biens ont été entreposés. Va voir le macchabée et dis-moi si tes analyses corroborent cela !
– Les collègues de M. Gaudard ont tout laissé ouvert, les entrées ne sont barrées qu’avec cette sorte de ruban, précisa di Ruggio sur un ton de reproche. Mon collaborateur va vous accompagner, puis je vous demanderai d’avoir l’amabilité de tout refermer derrière vous, continua-t-il.
Alors qu’Horace partait en compagnie d’un employé de banque, François tendit au directeur une liasse de pièces administratives à signer afin d’exécuter le séquestre.
Une dizaine de minutes plus tard, Horace réapparaissait sur le seuil du bureau. Il avait un air horrifié.
– Ça a beau être mon métier, les cadavres en voie de putréfaction, j’ai toujours de la peine.
François lui sourit d’un air compréhensif.
– Et alors, pour toi, ça fait combien de temps qu’il pourrit là-dedans ?
– C’est tout à fait possible qu’il y soit depuis huit ans. Depuis une vingtaine d’années, les cadavres se décomposent moins rapidement. On pense que c’est l’effet de tous les conservateurs qu’on ingurgite au cours de notre vie. Et puis il était dans un environnement presque sans air, à température constamment fraîche. Bon, évidemment, il va falloir que je te confirme tout cela après l’autopsie. Je l’ai pris avec moi, j’ai demandé à ce qu’il soit déposé dans ma fourgonnette. Je vais y aller, je t’appelle dès que j’ai les résultats.
– Ça marche, à plus.
François regarda le directeur.
– Bon, monsieur di Ruggio, on dirait qu’il va nous falloir les vidéos de vos caméras de surveillance du jour où les valeurs ont été apportées dans vos sous-sols.
Chapitre 230 septembre
Monaco
Alberto di Ruggio regardait Nino Bartolini, l’avocat de la banque, en triturant ses doigts. Le directeur de la Banca della Santía avait tout de l’Italien de bonne famille, cinquantenaire issu d’une longue lignée de nobles qui remontait à la Venise du XVe siècle. Tout en lui respirait l’élégance née d’une vie facile et fortunée. Vêtements de belle coupe et de matière noble, montres de prix, loisirs qui le conduisaient régulièrement dans des pays exotiques et belles voitures, rien ne manquait à l’image d’aisance de di Ruggio. Toutefois, son visage reflétait souvent l’angoisse. En effet, Alberto se trouvait plus souvent qu’il ne l’aurait souhaité dans des situations où il sentait qu’il perdait le contrôle. C’était tellement plus simple avant, quand il n’y avait pas les règles sur la transparence, le blanchiment, l’évasion fiscale. On prenait l’argent de ceux qui en avaient, on le plaçait ou on le gardait en sécurité pour eux, on se payait de belles commissions, et le tour était joué. Désormais, plus moyen d’ouvrir un compte ou de recevoir des fonds sans vérifier leur provenance, et gare à la sanction si les valeurs transitaient par un pays que les instances internationales considéraient comme véreux ou si leur bénéficiaire était un peu trop près des arcanes du pouvoir.
Di Ruggio pensait à tout cela et transpirait à grosses gouttes. Il demanda à l’avocat s’il pensait que la situation était grave.
L’avocat le regarda intensément.
– Grave et de plus très gênant. Car comme vous pouvez l’imaginer, maintenant, l’inspecteur Gaudard va retourner la terre entière pour savoir d’où vient le cadavre. Tant qu’il ne s’agissait que de la requête de la High Court, j’ai pu m’arranger pour limiter son pouvoir de nuisance, mais là, je ne sais pas si je le pourrai encore. Il y a potentiellement meurtre, il va s’arroger tous les pouvoirs d’investigation. J’ai peur que la banque doive maintenant compter sur ses visites quotidiennes.
Devant cette réponse, di Ruggio parut extrêmement stressé.
– Comment cela, tous les jours ? Je vais l’avoir tous les jours dans les pattes ?
Bartolini continua sans flancher.
– Probablement, oui. Mais dites-moi, vous saviez qu’il y avait un cadavre dans ce coffre ?
– Non, non ! Ce que j’ai dit à Gaudard est vrai. Je n’en avais aucune idée. Il n’a jamais été ouvert après que les transporteurs y sont venus. Ils avaient demandé la plus grande discrétion lors de leur arrivée. Personnellement, je pensais qu’ils amenaient des œuvres d’art ou archéologiques. Vous savez, avec les guerres, on en trouve toujours beaucoup sur le marché. À l’époque de la location du coffre, c’était déjà le cas. Mais leur commerce était moins prohibé que maintenant, dit le directeur poussant un soupir, semblant regretter cette époque bénie.
Bartolini botta en touche, ne voulant pas s’aventurer dans ce genre de discussion. Il lui importait d’être sûr que le seul locataire du coffre était bien Alpine Peaks, et qu’aucune autre entité n’en avait jamais eu l’accès. Di Ruggio, qui continuait à suer à grosses gouttes, lui assura qu’Alpine Peaks avait toujours été la seule société ayant bénéficié de cet usage. Mais s’il était rassuré, l’avocat n’y laissa rien paraître. C’était un stratagème bien éprouvé qui lui permettait de renforcer la nécessité de ses services aux yeux du directeur. Il l’informa que l’affaire était vraiment épineuse mais qu’il essayerait de tout faire pour que les intérêts de la banque n’en pâtissent pas.
– Avec votre permission, je vais appeler le responsable d’Alpine Peaks. Si je ne me trompe pas, il s’agit d’un certain Dominic Rubovz. C’est bien cela ? demanda Bartolini.
– Oui, c’est son nom, mais je pense qu’il vaut mieux que ce soit moi qui l’appelle. M. Rubovz a un caractère plutôt, comment dirais-je, difficile. Je préfère lui annoncer la nouvelle. Bartolini ne répondit pas tout de suite, puis acquiesça. Avec ses contacts, il saurait toujours comment rattraper l’affaire par la suite.
Gaudard avait trouvé un cadavre dans un coffre-fort de la Banca della Santía qui appartenait à la société Alpine Peaks. Un cadavre ! Guido Giolli, le procureur de la Principauté de Monaco, peinait à contenir sa rage. Seule la présence de son assistante de l’autre côté de la porte le retenait d’envoyer son téléphone voler à travers la pièce. Comment cet idiot de di Ruggio avait-il pu laisser faire cela ? Ne se rendait-il pas compte que le système monégasque était fondé sur la discrétion, et cet événement allait attirer toute la presse à sensation ! Il frissonna. Les journalistes allaient en faire leurs choux gras, comme à chaque fois qu’un scandale éclatait sur le Rocher. Des chairs putréfiées mêlées à des lingots d’or ! Giolli imaginait déjà les gros titres. Forcément, La Mecque des riches et célèbres éclaboussée par une sordide affaire, toute la plèbe se ruerait sur les journaux pour lire les spéculations colportées par des gratte-papier gauchisants.
Le téléphone de Giolli sonna, le sortant de ses haineuses pensées. Sa secrétaire l’avertissait de l’arrivée de di Ruggio et de l’avocat de la banque, Nino Bartolini, qu’il ne connaissait pas encore, car il était récemment entré en fonctions.
Dès qu’ils eurent pénétré dans la pièce, il les fit asseoir sur les fauteuils Louis XV qui trônaient de part et d’autre de son bureau. Il aimait le côté « audience à la cour du roi » que cet aménagement conférait. Sans s’attarder en politesses, il entra dans le vif du sujet, s’adressant à Alberto di Ruggio en l’observant de ses yeux perçants cachés derrière des lunettes aux verres en dégradé de bleus.
– Je vous ai convoqués de façon informelle, avant que l’enquête menée par l’inspecteur François Gaudard ne batte son plein, car j’aimerais savoir quelle est votre position, monsieur di Ruggio. L’enquête sur le cadavre retrouvé dans votre banque peut être très dommageable pour Monaco, surtout si la presse s’en mêle. Je veux que les coupables soient traduits en justice, mais sans que la réputation du Rocher ne soit entachée. Inutile de vous préciser que je compte sur votre totale collaboration à cet égard.
Le banquier le regarda, interloqué. Il ne s’attendait pas à être ainsi mis sur la sellette. Il était venu en pensant trouver un allié en ce magistrat qui se montrait habituellement si accommodant avec les hommes d’affaires et les grands noms de la Principauté. Mais, face à l’adversité, les choses avaient visiblement changé et di Ruggio constata que l’homme de loi conciliant avait laissé place à un opportuniste qui ne voulait surtout pas voir sa réputation ternie.
– Je n’en sais rien, bredouilla-t-il.
– Vous n’en savez rien, je vois, dit le procureur en le toisant. Il se tourna d’un air méprisant vers Bartolini.
– Et vous Maître, vous avez peut-être une meilleure idée de la position à adopter ?
Pondérant la réponse la plus adéquate, l’avocat regarda silencieusement Giolli. Après une longue minute pendant laquelle ses yeux noirs et brillants, qui illuminaient son visage sec d’une lueur étrange, semblèrent sonder le procureur, il prit la parole.
– M. di Ruggio ne savait rien, c’est la vérité. Mais cette position n’est évidemment pas celle que nous souhaitons défendre, car nous ne voudrions pas que le public pense que le directeur d’une banque ne sait pas ce qui se passe dans son établissement, dit-il en jetant un regard appuyé au directeur. Je pense donc que la meilleure stratégie, la seule possible à vrai dire, est de garder le silence. Nous dirons que nous ne pouvons pas faire de commentaires tant que l’enquête n’est pas terminée.
Le procureur laissa un instant son regard courir sur l’avocat, puis fit un signe de tête approbatif. Il était visiblement beaucoup plus satisfait des capacités de raisonnement de ce dernier que de celles de son patron.
– Je vois que nous sommes sur la même longueur d’onde. Il faut à tout prix éviter que la presse ne s’empare de cette affaire avant que nous n’ayons pu faire notre travail. La réputation de la place de Monaco est en jeu. Et nous en dépendons tous, dit-il en fixant longuement di Ruggio.
Genève
Les pieds sur sa table basse, Dominic Rubovz se gratta les testicules à travers son pantalon de training, comme il le faisait à chaque fois qu’il était contrarié. Il venait de recevoir un appel d’Alberto di Ruggio, le directeur de la banque dans laquelle sa société, Alpine Peaks, possédait un compte et un coffre. Ce dernier l’avait informé qu’un cadavre y avait été découvert.
Il était très ennuyé, énervé même, de n’avoir pas été tenu au courant du séquestre dont le coffre avait été frappé. Il avait soulevé ce point avec di Ruggio et s’était vu répondre que le directeur n’avait rien pu faire, car les tribunaux londoniens qui avaient ordonné la mesure avaient précisé que le détenteur du coffre ne devrait pas être informé au préalable. Il n’en restait pas moins, se disait Dominic, que c’était un comble que son avocat, Me de Weinster, ne se soit pas opposé à la mesure ou tout au moins ne l’ait pas averti. Souvent il flirtait avec l’idée de virer cet homme affable qu’il considérait comme trop effacé et pas assez pugnace. Mais Me de Weinster, issu d’une famille patricienne, possédait à Genève de nombreuses connexions utiles. Rubovz, dont les origines et l’attitude nuisaient à ses ambitions, avait besoin de lui pour ouvrir certaines portes. Et surtout, il était un des seuls avocats qui, de par son manque de caractère, acceptait toutes ses injures sans résilier le mandat qui les liait.
Rubovz bailla, s’étira et frotta son ventre gras et mou qui tombait sur le haut de son jogging. Il jeta un coup d’œil par la fenêtre. Le ciel était uniformément gris, comme souvent à Genève. Il avait faim. Il se leva pour aller voir ce qu’il avait dans le frigo. En passant près du mur de la cuisine, il tapa dedans avec son poing pour se défouler.
Londres
Une pluie fine et glacée tombait sur la chaussée. Les lumières des échoppes se reflétaient sur le bitume comme des taches de couleur dans un tableau de Pollock.
Rose McGawn but une gorgée de thé brûlant et tenta de trouver une position plus confortable. Elle avait beau adorer sa Mini Cooper vintage, il fallait avouer que ces vieux modèles portaient vraiment bien leur nom. Pour une grande fille comme elle, c’était assez exigu.
Elle essaya de ne plus penser à la crampe qu’elle sentait naître dans le bas de son dos et de se concentrer sur les alentours. Ce quartier de l’Est de Londres, non loin de Canary Wharf, abritait une population en majeure partie musulmane, venant du Pakistan, d’Inde et du Bangladesh. Les femmes qui passaient à côté de sa voiture étaient pour la plupart voilées et les hommes portaient encore le kamis, signe qu’ils appartenaient probablement à la première génération d’immigrants. Les magasins reflétaient aussi l’origine des habitants du quartier. Les devantures riches en couleurs offraient des services de traduction et des produits exotiques, et de bons arômes de curry s’échappaient de petits restaurants dont Rose distinguait les tables bariolées à travers les fenêtres.
Soudain, la porte de l’immeuble qu’elle surveillait s’entrouvrit et une silhouette fine apparut. L’homme regarda rapidement à gauche et à droite, puis se glissa dans la rue. Rose le laissa prendre quelques mètres d’avance avant de sortir de sa voiture et de lui emboîter le pas. Le suspect marchait vite, la tête baissée. La pluie s’intensifiait et il devenait difficile à Rose de ne pas le perdre de vue parmi les parapluies qui s’ouvraient. Elle le vit tourner au coin de la rue pour rejoindre une artère plus animée. Elle tentait de se frayer un chemin entre les passants quand, soudain, le tonnerre gronda et l’averse redoubla de force. Elle se retrouva happée par un flot de piétons qui se ruaient en direction d’une bouche de métro pour s’abriter. Le temps de s’en extirper, et l’homme avait disparu.
Rose laissa échapper un juron et retourna vers sa Mini. Son portable sonna. C’était le jeune policier à qui elle avait confié une partie de l’enquête qu’elle menait sur les réseaux islamistes à Londres. Il paraissait surexcité.
– Rose, il faut que tu viennes immédiatement.
– Tu es où ?
– Je suis aux docks de Tilbury.
Rose consulta sa montre. Tilbury était du côté de la Tamise où elle se trouvait, mais à l’extérieur de la ville. Avec la circulation, elle y serait dans une heure.
Elle engagea rapidement la Mini dans le trafic et rejoignit le flux des véhicules qui se dirigeaient vers l’Est sur l’A13. Laissant derrière elle les gratte-ciels de Canary Wharf, elle suivit une autoroute dont le tracé coupait au milieu d’une zone industrielle jusqu’à Tilbury.
La pluie n’avait pas cessé et la nuit était en train de tomber. Le grand port avait un air lugubre, avec les énormes porte-conteneurs qui disparaissaient derrière les brumes de la Tamise. Elle entendait au loin le chant sourd d’une balise phonique qui sonnait au gré des vagues. Robbie l’attendait dans sa voiture et lui fit signe de le suivre lorsqu’elle approcha. Ils conduisirent encore quelques minutes entre d’immenses hangars, puis ils se garèrent côte-à-côte. À voix basse, il la salua quand elle sortit de la voiture.
– Boss, il faut que vous voyiez ça.
Il pénétra par une porte entrebâillée dont la serrure avait été forcée et alluma sa lampe de poche. Le bâtiment était rempli de conteneurs. Robbie se faufila entre les murs de tôle jusqu’à l’un d’eux, invitant d’un geste Rose à y entrer. Elle fit courir le faisceau de sa lampe à l’intérieur, éclairant des boîtes en bois de forme rectangulaire. Elle se dirigea vers l’une d’elle dont le couvercle avait été ouvert et laissa échapper un sifflement.
Dans la lumière blanche luisait le métal noir de deux fusils semi-automatiques.
Monaco
Dans son bureau, François repassait pour la troisième fois la vidéo que lui avait remise di Ruggio. Mais on ne voyait rien. La caméra gardant l’entrée de la banque avait filmé les transporteurs qui arrivaient, sortaient les boîtes sur des chariots motorisés sous haute protection armée, et entraient avec elles dans la banque. Pas de trace de sac de dépouille. Ensuite, les appareils qui filmaient le hall d’entrée prenaient le relais, mais là, rien non plus. Enfin, ceux des couloirs qui conduisaient au coffre avaient enregistré la même chose, des transporteurs avec des caisses. Toujours pas de sac. François avait vérifié auprès du directeur qu’il s’agissait bien de la seule entrée de la banque.
De guerre lasse, il fit comme toujours lorsqu’il se trouvait perplexe devant un indice issu de la technologie, il l’envoya à Olivier. Olivier était son frère jumeau. C’était aussi un petit génie de l’informatique qui mettait ses talents de hacker au service de l’administration fiscale. Si une information avait transité par internet, Olivier la retrouverait pour le plus grand bonheur de son employeur. Son dévouement au travail lui avait coûté son mariage, sa femme étant partie avec le boucher qui prêtait plus d’attention à ses charmes que son mari. Depuis lors, Olivier passait encore plus de temps au bureau à fumer cigarette sur cigarette derrière son écran, traquant sans répit le fraudeur fiscal et aidant à l’occasion son frère à résoudre les mystères informatiques rencontrés dans ses enquêtes. Même si les preuves obtenues n’étaient pas très légales, François parvenait toujours à s’en servir d’une façon ou d’une autre, sans qu’elles finissent formellement dans un dossier.
En pensant à la femme d’Olivier, François se mit à songer aux femmes en général. Elles partaient tôt ou tard, qu’on passe du temps avec elles ou non. C’était le cas de toutes celles qu’il avait connues. Il se souvint de Virginie, son ex-épouse qui lui avait préféré un promoteur immobilier et puis, naturellement, à Rose.
Rose qu’il avait laissée s’envoler après lui avoir dit que sa rupture avec Virginie était trop récente. Rose qui pourtant était prête à rester avec lui à Monaco et à renoncer par la même occasion à sa nomination au poste supérieur d’inspectrice de Scotland Yard, une promotion rarement attribuée à une femme.
Il avait bien merdé. Après quelques mois merveilleux, il avait commencé à faire le difficile, en écoutant les imbéciles qui lui disaient qu’il était bête de se remettre si vite en couple, qu’il devrait profiter de sa vie de célibataire. Rose, au vu du sacrifice auquel elle consentait, n’avait pas tardé à lui demander ce qu’il comptait faire, et face à sa réponse tiède, avait pris ses affaires, enfourché sa moto, et était repartie à Londres. Depuis lors, ils avaient quelques contacts sporadiques, et elle lui avait envoyé son numéro de portable anglais, mais c’était tout. Quel gâchis ! Lui, de son côté, avait bien rencontré quelques filles, mais pas une qui arrivait à la cheville de Rose, sa vie rêvée de célibataire se résumant ainsi à travailler puis à rentrer chez lui regarder la télévision, devant laquelle il ne manquait jamais de s’endormir.
Chapitre 31er octobre
Miami
L’imposante Range Rover se gara au pied du bâtiment en construction. Un chauffeur bodybuildé en sortit pour ouvrir la portière à un petit homme de type sud-américain, qui posa d’un air dégoûté ses pieds chaussés de mocassins blancs parmi les flaques d’eau sale. Le conducteur lui tendit un attaché-case. L’homme refusa d’un geste brusque le casque qui lui était proposé et se dirigea vers l’entrée du chantier. Avant d’y pénétrer, il contempla avec fierté la bâtisse haute d’une cinquantaine d’étages. Elle était presque terminée. Il ne restait plus aux vitriers qu’à placer au niveau de l’attique les immenses baies vitrées qui tapissaient les quatre façades de la construction. Avec l’indigo de l’océan qui s’y reflétait, l’effet était spectaculaire.
Eduardo Ramón avait fait construire l’immeuble sur le sable, faisant fi de toutes les normes cycloniques et sismiques que connaissait la Floride. Ainsi bénéficiait-il d’un emplacement de rêve, directement sur la plage, séparé de la grève par une dizaine de mètres seulement. Bien sûr, obtenir la permission de bâtir à cet endroit n’avait pas été chose facile. Cela avait requis de faire valoir des arguments très persuasifs auprès du fonctionnaire fédéral en charge des autorisations. Heureusement, il avait une cargaison de ce genre de rhétorique, sous forme de billets verts tout droit sortis de la vente de cocaïne colombienne à Miami. D’ailleurs, le but de sa visite était de régler à l’intermédiaire la deuxième partie de ce paiement.
Les portes d’acier brossé du bâtiment étaient encore couvertes d’un plastique de protection. Eduardo Ramón emprunta le monte-charge des ouvriers jusqu’au 48e étage, où les vitres n’avaient pas encore été posées. De grandes bâches en plastique soulevées par les courants d’air flottaient au-dessus du vide.
Ramón s’avança sur la dalle en béton suivi de son chauffeur. Un homme très rond, coiffé d’une casquette et portant l’uniforme typique de l’Américain en weekend, pantalon beige et polo, confortable et informe, sortit de derrière l’un des piliers de métal qui soutenaient la structure. Il s’approcha, la main tendue vers Ramón, et après un peu de small talk obséquieux, lui demanda s’il avait l’argent.
Sans lui répondre, Ramón lui tendit la mallette. L’homme la saisit et s’accroupit pour l’ouvrir. Il compta rapidement les billets, puis se releva.
– Le compte est bon, dit l’homme en se dirigeant vers l’ascenseur.
– Pas si vite ! Où est l’autorisation finale ? répliqua Ramón.
L’homme posa la mallette et se racla la gorge avant de parler.
– À ce sujet, dit-il.
– Quoi ? répondit Ramón d’un ton énervé.
– Obtenir la version finale de l’autorisation s’avère plus difficile que prévu, répondit l’homme. Il va falloir une petite rallonge.
– Une petite rallonge ? s’exclama Ramón.
– Oui, vous savez. 100 000 de plus.
La mâchoire crispée, Ramón dévisagea l’homme comme s’il allait le frapper. Puis il se ravisa et laissa passer son chauffeur, qui empoigna le malheureux par le col de son polo et l’entraîna vers le vide. Les parasols sur la plage dessinaient des petits points de couleur à des dizaines de mètres plus bas. L’homme se débattait en criant, mais ses hurlements étaient étouffés par le claquement des bâches. Le chauffeur jeta l’infortuné par terre, l’attrapa par sa cheville, puis le balança vers l’extérieur. L’homme gesticulait dans le vide, tête en bas, retenu seulement par la puissante main du colosse.
– Je vais vous obtenir l’original, sans frais supplémentaires ! hurla-t-il.
– Quand ? demanda Ramón.
– Demain ! cria l’homme.
Ramón regarda son chauffeur, puis l’homme qui pendait au-dessus de l’abîme.
– OK, dit-il. Demain matin à l’aube, au même endroit. Si tu n’y es pas, ou si tu n’as pas l’autorisation, tu iras soit nourrir les alligators, soit ton cadavre disloqué attendra la première équipe d’ouvriers du matin.
Sur ces paroles, le chauffeur jeta l’homme tremblant sur le sol et rejoignit Ramón qui se dirigeait déjà vers l’ascenseur en époussetant des particules de plâtre de ses épaules.
Monaco
– Si tous les avocats étaient comme vous, la vie serait beaucoup plus simple.
Guido Giolli déjeunait à La Salière, son restaurant préféré, avec Nino Bartolini. À la suite de la réunion avec ce dernier et di Ruggio, il avait pris les devants pour s’assurer les bonnes grâces du représentant légal de la banque, qui l’avait impressionné lors de l’entretien. Bien qu’il méprisât en règle générale les avocats, il tolérait ceux qui comme Bartolini laissaient leur ambition personnelle l’emporter sur leurs devoirs éthiques. Il lui semblait évident que Bartolini ne comptait pas rester juriste bancaire très longtemps et convoitait un poste plus élevé, peut-être même celui de di Ruggio. S’il parvenait à le soutenir dans cette ambition, le procureur s’allierait la direction d’une des plus anciennes banques de la place et y assoirait ainsi encore plus son influence. Son intuition lui suggérait que Bartolini était assez ambitieux pour qu’il suffise de l’encourager subtilement à révéler la mauvaise gestion du directeur. L’avocat saurait ensuite amener le problème devant le conseil de direction de la banque pour l’inciter à voter la démission de ce dernier et ensuite briguer sa succession.
Le procureur poursuivit.
– Je salue votre ouverture d’esprit, Me Bartolini. Je n’étais pas sûr que vous accepteriez de venir déjeuner dans ces circonstances. Mais vous êtes à l’évidence l’un des rares avocats qui comprennent l’importance d’une collaboration étroite avec le Ministère public.
– Je vous en prie, c’est tout naturel, répondit Bartolini, flatté.
– Malgré mes efforts, je n’ai malheureusement pas pu retirer l’enquête à l’inspecteur François Gaudard. Personnellement, je déplore que l’enquête lui ait été confiée, car je n’approuve pas ses méthodes. Mais il a refusé de s’en dessaisir. Il sera donc particulièrement important que vous me teniez informé des développements de celle-ci. M. Gaudard, voyez-vous, a tendance à faire cavalier seul et à prendre certaines libertés que je ne saurais tolérer.
– Je comprends, dit l’avocat.
– C’est dans l’intérêt de la banque.
Bartolini, qui était au courant de la mésentente entre Gaudard et le procureur, hocha la tête. Ce dernier sentit que c’était maintenant le moment d’invoquer les ambitions du juriste, et de l’assurer de son soutien.
– Me Bartolini, si je puis me permettre, comme nous sommes entre gens de bonne composition, j’ai une question, assez personnelle, disons. C’est une réflexion que je me fais souvent lorsque je rencontre la direction de la banque. Est-elle vraiment compétente ?
L’avocat se racla la gorge et regarda autour de lui.
– Vous n’avez pas entendu cela de moi, mais, en effet, je ne le pense pas.
– Ah ! c’est bien cela. Cette direction qui passe de père en fils, cela n’assure pas que ce soit la personne la plus apte à le faire qui dirige la banque.
– C’est exactement mon avis.
– Ce serait donc presque un mal pour un bien si ces événements permettaient de faire un peu de nettoyage là-dedans, non ?
À ces paroles, les yeux de Bartolini s’allumèrent d’un éclat avide.
– Je le pense aussi.
– Parfait. Nous nous comprenons. Je compte donc sur vous pour me tenir au courant de l’évolution de la situation, et je m’assurerai pour ma part que tout se déroule au mieux. Giolli décocha au juriste un clin d’œil. Au mieux pour les intérêts de la banque, bien évidemment.
Le téléphone de François sonna. Voyant que c’était Horace, François décrocha.
– Dis-moi que tu as de bonnes nouvelles. Il est mort de quoi ?
– Je ne sais pas si ce sont de bonnes nouvelles. Il est mort d’une crise cardiaque.
– OK. Et qu’est-ce qui a provoqué cette crise cardiaque ?
– Rien.
– Comment ça, rien ?
– Comme tu as pu le constater, les tissus sont très abîmés. Donc je ne suis pas sûr à 100 %. Mais ceux que j’ai pu tester n’ont rien révélé d’anormal.
– Cela semble bizarre que l’on cache le corps de quelqu’un qui est mort naturellement, mais soit. Et c’est qui, le bonhomme ? Tu as pu l’identifier ?
– Ben, là aussi, chou blanc. Les empreintes digitales se sont décomposées. Mais j’ai fait un moule de sa dentition et je l’ai envoyé au centre d’odontologie médico-légale. On va voir s’ils peuvent l’identifier.
– OK, et ça va prendre combien de temps ?
– Quelques semaines.
François grogna.
– Et leur demander de passer la deuxième vitesse, tu crois que ce serait possible ?
– J’en doute. En général plus tu les pousses plus ils prennent leur temps.
– OK, merci Horace. Tiens-moi au courant.
François raccrocha, de mauvaise humeur. Il ouvrit le dossier du séquestre et se mit à relire la décision de la High Court de Londres. Mais son anglais était mauvais, il comprenait un mot sur deux. Il connaissait bien quelqu’un qui pouvait l’aider, évidemment. Mais s’il appelait Rose pour lui demander de traduire l’arrêt londonien, ne sentirait-elle pas tout de suite le subterfuge ? De plus, elle verrait immédiatement qu’il était en train d’outrepasser sa juridiction car il n’avait pas le droit de partager une décision confidentielle avec une personne qui n’était pas dans l’affaire. Même si son besoin d’un traducteur était réel, elle aurait sans doute l’impression qu’il faisait cela dans le seul but de reprendre contact avec elle. Quelle serait alors sa réaction ? Elle avait été extrêmement distante avec lui chaque fois qu’il avait fait mine de la recontacter.
Il prit son téléphone, appuya sur l’écran pour l’allumer et tapa sur l’icône des contacts. Il n’eût pas besoin de chercher plus loin, le smartphone, qui pour une fois méritait bien son nom, avait classé Rose McGawn dans ses favoris. Il regarda le nom, l’index levé, hésitant à appuyer dessus. Puis il se décida.
Genève
Alexandre de Weinster était assis en face de Dominic Rubovz dans le bar préféré de ce dernier, Le Dôme. Weinster détestait cet endroit qui attirait tout ce que Genève avait de snobs, c’est-à-dire pas mal de monde. Il les partageait en trois groupes : les vieux beaux qui vivaient de leurs rentes et venaient là pour la compagnie des escorts toujours présentes, les courtiers immobiliers qui flambaient leurs commissions en champagne dès qu’ils avaient signé une affaire et essayaient de se faire payer des verres quand le business n’était plus aussi florissant, et les banquiers et avocats qui tournaient de toute façon toujours autour des deux premiers groupes.
En regardant son client qui, avachi sur un canapé de cuir noir, consultait son téléphone portable sans lui prêter attention, il se sentit soudain très seul. Rubovz était, comme à son habitude, vêtu d’habits de marque dont il exhibait autant que possible les logos. Weinster était toujours étonné que ces grandes marques, avec leurs magnifiques collections, s’autorisent à faire des vêtements aussi vulgaires pour séduire une couche de la population qui avait de l’argent mais pas de goût. Assurément, il y avait un marché pour les nouveaux riches dont le seul intérêt était d’afficher leur pouvoir d’achat au travers d’étiquettes de luxe.
Rubovz posa son téléphone et regarda Weinster de ses petits yeux méchants perdus au milieu de son visage porcin. Le carnage pouvait commencer.
– Pourquoi vous ne m’avez pas averti du séquestre ?
– Je n’en étais moi-même pas informé, répondit Weinster sur un ton d’excuse.
– Et je vous paye pour quoi, moi ?
– Ceux qui ont demandé le séquestre l’ont fait exparte, ce qui veut dire que nous ne devions pas en être avertis.
– Ne me sortez pas vos termes latins ! Vous êtes un imbécile. Vous auriez dû être au courant.
Weinster vit qu’il ne servait à rien d’argumenter. Rubovz voulait lui faire porter le blâme pour la découverte du corps et rien ne l’en dissuaderait. Il savait comment cela allait se passer. Lorsqu’il aurait fini de lui poser des questions de plus en plus rhétoriques, auxquelles il pourrait de moins en moins répondre, Rubovz exploserait en faisant une scène et en quittant bruyamment les lieux, le laissant régler la note.
Monaco
Après l’avoir lu avec attention, Bartolini ferma le fichier électronique d’Alpine Peaks. Ce client avait été envoyé à la Banca della Santìa par Arnaud de Catville, associé-gérant d’une des plus vieilles banques privées de Genève. Il connaissait personnellement Arnaud, qui avait déjà été invité plusieurs fois par la Banca della Santìa pour assister au Grand Prix automobile de Monaco. C’était un homme en apparence bien sous tous rapports, qui n’aimait pas le scandale. Il n’était donc pas étonnant qu’il ait voulu se débarrasser du compte d’Alpine Peaks, dont le directeur était doté d’une réputation louche et sulfureuse. Mais ce que Bartolini avait besoin de comprendre, était comment et pourquoi la Banca della Santía avait accepté de prendre ce client.
Bartolini saisit son second téléphone portable, celui dont la ligne ne pouvait pas être remontée jusqu’à lui. Il composa un numéro de téléphone international. Une voix de femme répondit.
– Bureau de M. de Catville ?
– Bonjour, Madeleine, dit Bartolini avec une voix suave, est-ce qu’Arnaud est là ?
– Oui bien sûr, monsieur Bartolini, je vous le passe tout de suite.
Sacrée Madeleine ! Elle le reconnaissait toujours. Même si elle n’était qu’une assistante de direction, cela le flattait à chaque fois.
– Salut, Nino, comment ça va ? Le ton de voix se voulait élégant, mais Arnaud n’arrivait jamais tout à fait à dissimuler les lenteurs de son accent genevois.
– Salut, Arnaud, tout va bien dans les banques suisses ?
– On fait aller, tu sais, les temps sont durs, les politiciens nous font des misères.
Bartolini rit. Cet Arnaud, avec sa superbe propriété de vingt millions de francs suisses au bord du lac Léman, parvenait toujours à se plaindre. Un trait bien genevois. Choisissant de ne pas relever, Bartolini lui demanda s’il était disponible le lendemain. Ils convinrent d’un rendez-vous à 14h et Arnaud confirma qu’il demanderait à Madeleine de lui faire une réservation à l’Hôtel de la Cigogne.