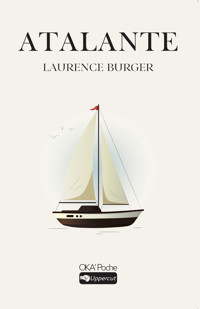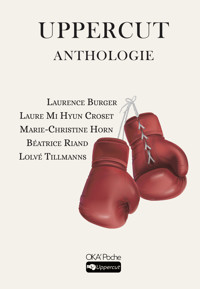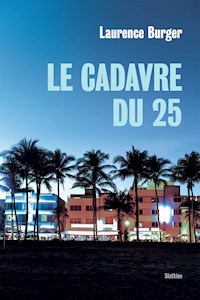Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Slatkine Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
New York, 4h du matin. L’inspectrice Rose McGawn est réveillée, en pleine forme, prérogative du décalage horaire. Sous ses yeux s’étend la masse sombre de Central Park, mer d’arbres à peine éclairée par de rares réverbères. Son regard est attiré par trois silhouettes qui se dirigent vers le parc. L’une d’elles semble soutenue par les deux autres. Mais déjà, elles disparaissent sous le couvert touffu des feuillus.
Occupée à la préparation d’un procès dans lequel elle et son acolyte, l’inspecteur François Gaudard, doivent témoigner, Rose oublie cette vision nocturne jusqu’au jour où ces évènements lui reviennent en mémoire après la lecture d’un article du New York Times relatant la découverte d’un cadavre dans Central Park. Y a-t-il un lien avec ce qu’elle a observé ?
Il ne lui en faut pas plus pour se lancer dans une enquête haletante qui l’entraînera des beaux quartiers de l’Upper West Side à Harlem, de Chinatown aux Hamptons, en passant par Washington et Miami, sur fond d’intrigue politique.
À PROPOS DE L'AUTRICE
Avocate de formation, spécialiste en arbitrage international,
Laurence Burger a décidé il y a quelques années d’étendre sa passion pour le verbe à l’écriture de romans policiers qui allient mystère, voyages et, bien sûr, crimes. Après
Le cadavre du 25,
Les Inconnus de Central Park est son deuxième roman paru aux Éditions Slatkine.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Remerciements
À Laure Mi Hyun Croset, pour son enthousiasme qui m’a mis le pied à l’étrier ;
à Philippe Lafitte, pour ses conseils éclairés ;
à Céline Bezençon, pour sa relecture minutieuse ;
et à tous les autres, parents et amis, pour leur soutien inconditionnel et leur enthousiasme indéfectible.
Dramatis personae
Rashid Al-Bashir
Ambassadeur d’Arabie saoudite aux États-Unis
David Bernstein
Inspecteur-chef du poste de police de l’Upper West Side
Céline Bracco
Compagne de Daniel Jones
Grace Brown
Infirmière au Veterans Hospital de Manhattan
Rebecca Cohen
Secrétaire du poste de police de l’Upper West Side
Marco Debiosi
Mafieux
Jason Duncan
Rédacteur en chef du New York Times
Umberto Diaz
Gardien de prison à Miami
Douglas Freeman
Membre du département de l’Économie du gouvernement américain
François Gaudard
Inspecteur de la Sûreté publique de la principauté de Monaco
Olivier Gaudard
Frère jumeau de François, informaticien travaillant pour la Direction départementale des Finances publiques des Alpes-Maritimes en France
Guido Giolli
Ex-procureur de la principauté de Monaco
Mohammed Husseini
Directeur de la Fondation Al-Amal
Daniel Jones
Magnat de la télévision
James Jones
Demi-frère de Leyla, travaille à la National Rifle Association
Leyla Jones
Étudiante en journalisme à l’université Columbia
Luke Jones
Demi-frère de Leyla, travaille à la chaîne de télévision Tox News
Adam Liebstovski
Ténor du barreau new-yorkais
John Maculoso
Directeur du cabinet du Président
Karen Maghee
Inspectrice du poste de police de l’Upper West Side
Zacharia Mitsakis
Ancien sergent de l’armée américaine
Rose McGawn
Inspectrice de Scotland Yard
Park Nam-Ji
Tueuse nord-coréenne
Patrick O’Brien
Procureur du Southern District de Manhattan, New York
Eduardo Ramon
Membre d’un cartel de la drogue à Miami
Mélissa Sanchez
Inspectrice de la police de Miami
Rick Simmons
Ex-inspecteur du FBI
Don Tang
Inspecteur du FBI
Zhang Ting
Employée du consulat de Chine
Imam Tursun
Chef religieux ouïghour
Liang Wú
Professeur à l’université Columbia
Prologue
Manhattan, N.Y.
Quelle poisse, cette insomnie ! Il était 4 h du matin, et elle se sentait fraîche comme un gardon.
Rose McGawn sortit sur le petit balcon attenant à la chambre de l’appartement qu’on lui prêtait. De là, elle avait une vue sur tout Central Park qui, à cette heure très matinale, n’était encore qu’une grande masse sombre où l’on distinguait à peine le halo des réverbères éclairant les allées du parc. Au loin s’élevait le Willis Avenue Bridge, dont les câbles illuminés se découpaient en surpiqûres blanches sur les ombres noires des immeubles du Bronx.
Elle était arrivée la veille pour rencontrer les représentants du ministère public du Southern District de New York en prévision de son audition dans l’affaire du cartel colombien. Le procès commençait la semaine suivante et le procureur adjoint désirait passer en revue avec elle son témoignage. Il était certain que les avocats de la défense allaient l’interroger sans relâche. Le ministère public voulait la préparer à la cross-examination, cette forme d’interrogatoire propre à la procédure américaine. Bref, il fallait qu’elle soit reposée ; sinon les heures qu’elle allait passer dans les bureaux de l’administration judiciaire new-yorkaise tourneraient au cauchemar.
Rose regarda, juste au-dessous d’elle, l’intersection où la 96e Rue coupait Central Park West puis disparaissait sous la voûte des arbres. De jour, de nombreux piétons traversaient l’avenue qui courait le long du parc pour aller y promener leur chien ou faire du jogging, mais à cette heure-ci le carrefour était désert.
Soudain, du côté de la bouche de métro située à l’opposé du bâtiment où elle se trouvait, un mouvement attira son attention. Sa vision était en partie obstruée par les travaux de ravalement de façade sur l’immeuble en face, pourtant elle était sûre d’avoir vu quelque chose bouger. Un sans-abri, sans doute, délogé par quelque agent de sécurité de la Metropolitan Transportation Authority. L’ombre semblait monter les escaliers avec peine. Elle atteignit le trottoir et Rose crut alors distinguer deux silhouettes accrochées l’une à l’autre. Déjà, elles disparaissaient derrière un abribus. Ce n’est que lorsqu’elles se mirent à traverser l’avenue que Rose put les compter.
Il n’y avait pas deux invidivus, mais trois. Deux vêtus de pardessus et de bonnets sombres soutenaient un troisième qui portait un long manteau. Celui au centre avait de la peine à marcher et semblait s’appuyer sur les deux autres, ses pieds traînant sur les bandes blanches du passage piétons. Parvenu sur le trottoir d’en face, le trio s’arrêta. Rose eut l’impression qu’une dispute avait éclaté, la personne du milieu gesticulant comme pour se défaire de l’emprise des deux autres, qui le maintenaient malgré tout fermement. Au bout de quelques instants, ils reprirent leur progression en direction de Central Park. Juste avant qu’ils ne disparaissent sous le feuillage dense des premiers arbres, Rose crut le voir se débattre à nouveau.
Elle hésita. Fallait-il prévenir la police ? Mais pour leur dire quoi ? Que trois pochards étaient entrés bras dessus, bras dessous dans le parc vers 3 h du matin ? Bien sûr, son accès était officiellement interdit pendant la nuit, cependant sa fermeture n’était que théorique et de nombreuses personnes en quête de sensations fortes s’y promenaient après minuit pour y côtoyer les habitants du parc, dealers, vagabonds et marginaux en tout genre.
Convaincue qu’on lui rirait au nez, Rose retourna dans sa chambre, se glissa sous les draps frais, et se rendormit immédiatement.
* * *
L’enfer vert. La jungle. Les bruits effrayants, dont on ne savait pas d’où ils venaient. Le sol, sous lui, humide et froid. L’odeur de la sueur, de la peur… du sang.
Se cacher sous les feuillages. Fallait pas que les Niaques le voient ! Comment l’avaient-ils retrouvé ? Il y en avait deux, là, pas loin ; il les avait aperçus entre les arbres. Ils avaient dû mettre la main sur l’un des siens, car il entendait des coups. Ils le tabassaient, les salopards ! Il devait réagir. Lève-toi, soldat, et va leur régler leur compte ! Impossible… son corps lui faisait trop mal. Tout son être n’était que douleur. Ses jambes ne répondaient plus. Se battre ne servirait à rien. L’autre rejoindrait les rangs des dizaines de morts inutiles dont il avait été témoin.
Il but une gorgée et retomba rapidement dans un sommeil comateux.
Chapitre 125 avril
Washington, D.C.
Rashid Al-Bashir, l’ambassadeur d’Arabie saoudite aux États-Unis, s’assit à son bureau d’onyx aux pieds dorés. Il avait forcé sur le kabsa, la spécialité culinaire saoudienne au riz et poulet épicé, lors d’une réception donnée dans les opulents locaux de l’ambassade le soir précédent, et sa nuit en avait été quelque peu chamboulée. Il se mit à consulter les mémorandums que ses assistants avaient laissés sur son bureau. Visites protocolaires à venir et organisation de la fête nationale, rien de très excitant. Soudain, une note attira son attention. Il s’agissait d’un rapport sur l’imam Tursun, ce Chinois sunnite et turcophone, l’un des chefs religieux de la communauté musulmane chinoise, les Ouïghours. Les Turcs avaient obtenu un visa de sortie de Chine afin de lui permettre de demander l’asile aux États-Unis. Il séjournait dans une résidence fournie par la délégation turque, mais les Turcs ne voulaient désormais plus assurer sa protection sur le sol américain et réclamaient aux Saoudiens de prendre la relève.
L’ambassadeur s’apprêtait à laisser tomber le mémo dans sa corbeille à papier, dans un geste de classement vertical qui lui était cher, quand le téléphone sonna. Son assistant l’informait de la visite d’un membre du gouvernement américain. À peine eut-il reposé le combiné qu’un homme en costume foncé, aux épaules carrées, poussa la porte de son bureau.
« Je ne vous dérange pas, j’espère », dit-il en guise de bonjour.
Al-Bashir pouvait pressentir des myriades de raisons pour lesquelles cette visite le perturbait ; toutefois, il jugea qu’il était plus prudent de ne pas les énumérer.
– Non, bien sûr. Asseyez-vous. Un loukoum ?
Devant le refus de l’Américain, Al-Bashir n’osa pas se servir, ce qui augmenta son exaspération.
– Vous avez vu la note sur l’imam Tursun ? continua l’Américain.
– Je viens de la lire.
– Les Turcs ne veulent plus s’occuper de la protection de Tursun, invoquant son coût ; à notre avis, ils recherchent plutôt un positionnement favorable dans le cadre de l’achat d’hélicoptères de combat chinois.
– Et en quoi cela concerne l’Arabie saoudite ? demanda Al-Bashir.
Son interlocuteur se racla la gorge.
– Je ne pensais pas avoir à vous rappeler pourquoi nous avons accepté, à la demande de la Turquie, que Tursun entre sur notre territoire. Accueillir ce dissident chinois sur le sol américain n’était pas particulièrement adéquat dans le contexte de nos propres négociations commerciales avec la Chine. Néanmoins, comme vous aviez une dette envers la Turquie, nous avons décidé de l’honorer à votre place. Entre alliés, on se doit bien un petit coup de main de temps en temps. Nous trouvons cependant maintenant que vous pouvez faire un effort pour assurer la protection de l’imam.
Al-Bashir détestait qu’on lui parle sur un ton paternaliste. Il choisit toutefois de se montrer conciliant.
– Bien. Que souhaitez-vous que nous fassions ?
– Commencez par lui offrir une sécurité. Rapprochée, mais discrète.
– Comment cela ?
L’homme soupira, irrité par le manque de bonne volonté criant d’Al-Bashir.
– Des gardes du corps qui le veillent. Les Turcs sont disposés à le laisser résider dans la maison qu’ils ont mise à sa disposition. Par contre, ils ne veulent plus assurer sa protection physique. Et il vaudrait mieux que les personnes affectées à sa surveillance n’appartiennent pas à votre ambassade. Vous travaillez avec des fondations, non ?
– Oui.
– Alors, voyez si l’une d’elles peut engager des agents de sécurité pour le protéger.
– D’accord.
– Je compte sur votre célérité, souligna l’homme en s’apprêtant à sortir.
Al-Bashir posa la question qui lui brûlait les lèvres.
– Excusez-moi monsieur, mais je ne crois pas vous connaître. Vous êtes ?
– John Maculoso, fit l’homme en sortant sans se retourner.
Al-Bashir soupira. À peine était-il de retour que les contrariétés recommençaient. Il attrapa de ses doigts potelés un loukoum qu’il avala gloutonnement. Il avait besoin de sucre pour se donner du cœur à l’ouvrage.
Il entreprit d’appeler la fondation Al-Amal et leur demanda que l’on fasse le nécessaire pour assurer la garde rapprochée de Tursun. Puis il se décida à rechercher le nom de l’homme qui lui avait rendu visite. Google lui fournit immédiatement la réponse : John Maculoso était l’âme damnée du Président nouvellement élu et, dans cette Maison-Blanche déjà en proie à un jeu constant de chaises musicales, il en était l’indé-boulonnable directeur de cabinet. Comment avait-il pu l’oublier ? Tout le petit corps rond d’Al-Bashir fut secoué par un frémissement. Les instructions venaient de haut. Il valait mieux qu’il ne foire pas cette mission.
Manhattan, N.Y.
« Bien dormi ? » demanda François en se penchant vers Rose, une tasse de café fumant à la main.
Comme il redoublait d’attention ! À l’évidence, il souhaitait continuer à se voiler la face et prétendre qu’il ne s’était rien passé. Après ses grandes déclarations, lors de leur précédente enquête à Miami, sur les sentiments qu’il lui portait, suivies d’une cour effrénée de plusieurs mois, elle avait cédé et décidé de lui redonner une chance. Elle avait pris ses dispositions pour aller le voir à Monaco, pensant qu’une visite surprise serait drapée du romantisme nécessaire pour remettre leur relation sur une bonne voie. Qu’elle avait été naïve ! Pour être interloqués, ils l’avaient été lorsque, utilisant la clef qu’elle avait conservée, elle était rentrée dans son appartement en jetant un « c’est moi ! » sonore et enthousiaste. Lequel avait été suivi par un bruit de chute et de pas paniqués dans la chambre ; elle avait trouvé François dans un lit défait et Mélissa, la jolie inspectrice qu’il avait rencontrée à Miami, en tenue d’Ève dans la salle de bains attenante.
Rose n’avait pas jugé nécessaire d’expliquer à François, qui lui répétait depuis plusieurs mois qu’elle était la femme de sa vie, pourquoi elle avait prestement tourné les talons et était revenue à Londres. Depuis, drapée dans son orgueil bafoué, elle avait ignoré ses appels et ses messages. Toutefois, quand tous deux avaient été convoqués à New York pour témoigner dans le procès du cartel, il lui avait demandé où elle prévoyait de loger. Elle avait répondu que, vu la longue durée du séjour, on lui prêtait un appartement. Il l’avait alors suppliée de le laisser le partager avec elle, « pour sceller leur amitié », comme il disait. Chacun aurait sa chambre et serait libre de ses faits et gestes. Tu parles ! Depuis Paris, où il l’avait rejointe pour prendre le vol pour New York, il la couvrait d’attentions qui n’avaient d’autre effet que de profondément l’exaspérer.
Dieu, qu’il était lourd ! S’il continuait ainsi, elle allait finir par ramener un inconnu à la maison un soir. Lorsqu’il se retrouverait au petit déjeuner avec un autre type, il se résoudrait peut-être finalement à l’évidence : leur histoire était du passé. Toutefois, elle devait, pour le moment, se coltiner un François ridiculement empressé et prêt à tout pour se faire pardonner.
Il posa le café sur la table de nuit. Rose se frotta les yeux et regarda l’heure sur son téléphone portable. 9 h 30. Zut ! Elle allait être en retard.
– Bof, répondit-elle en sautant du lit. Avec ce fichu jet-lag, j’étais debout à l’aube.
– Ma pauvre ! compatit François.
– Toi, ça ne te fait rien, bien sûr, poursuivit-elle en cherchant ses affaires de jogging qu’elle n’avait pas encore sorties de sa valise.
– Non, c’est l’avantage d’être un vieux schnock, soupira François en se poussant pour la laisser passer. Les fuseaux horaires n’ont plus d’effet sur moi.
– Il faut bien un privilège à être âgé, dit Rose en enfilant son collant. Se soustrayant à son regard, elle enfila une brassière de sport et mit ses chaussures de course à pied. Elle jeta un coup d’œil à sa montre. Elle serait de retour à temps pour être prête pour le tribunal à 11 h.
Rose prit l’ascenseur jusqu’au rez-de-chaussée. D’habitude, elle utilisait les escaliers lorsqu’elle partait faire du jogging, mais descendre puis monter les quatorze étages lui aurait coûté trop de temps.
Elle salua le portier et se retrouva dans la rue. Elle fut immédiatement happée par la frénésie ambiante. Un taxi passa devant elle à grande vitesse, un éclair jaune cahotant sur des nids-de-poule. New York dégageait une onde d’énergie qu’elle ressentait dès qu’elle voyait se dessiner la haie de gratte-ciels, la Manhattan skyline, en arrivant depuis JFK. À quoi était-ce dû, à l’air, aux bruits, aux gens ? Au côté de bric et de broc de la mégapole, buildings luxueux, enceintes multicolores, chaussées déformées et bouches d’aération à la vapeur blanchâtre, jungle urbaine qui s’arrêtait net aux confins de Central Park, comme repoussée par ce poumon vert ? Ou alors à ses habitants, de toutes ethnies et de toutes origines, sans-le-sou ou multimillionnaires, pourtant tous grouillants, bavards et opiniâtres, ces New-Yorkais au caractère si opposé au flegme et à la retenue des Londoniens et parmi lesquels elle se trouvait toutefois tellement à l’aise ?
Rose se mit à courir en direction de l’entrée de Central Park. Elle traversa l’avenue et continua dans les allées du côté du Reservoir, ce lac artificiel niché au milieu des arbres. Ayant dépassé le Loop, la route carrossable entourant le parc, elle rejoignit la piste équestre. Au lieu de chevaux, qui se faisaient rares depuis que les écuries de la Claremont Academy avaient définitivement fermé leurs portes, ce chemin de terre accueillait maintenant le petit trot des coureurs, les robes baies et alezanes ayant cédé la place aux leggings multicolores des adeptes du jogging.
Rose arriva sur le sentier recouvert de gravier noir qui bordait le Reservoir. Les rayons du soleil levant embrasaient les immeubles, lui rappelant ces films de science-fiction où New York était le théâtre d’attaques extraterrestres.
Elle commença une boucle à un rythme tranquille. Sous ses pas, les gravillons crissaient. Rose se concentrait sur sa respiration tout en contemplant la surface miroitante de l’eau. Après avoir achevé le premier tour, elle augmenta sa cadence. Elle sentit sur elle le regard d’un homme qu’elle venait de dépasser, et qui se mit à lui emboîter le pas. C’était une nouvelle tendance, en réaction au mouvement MeToo, certains frustrés suivaient maintenant les joggeuses tout en prétendant se focaliser sur leur propre entraînement. Elle hâta son allure pour se débarrasser de son poursuivant, sa foulée s’allongeant, son rythme cardiaque accélérant. En un rien de temps, elle avait distancé l’importun.
* * *
Leyla Jones passa la grille monumentale qui délimitait l’entrée de l’université Columbia, et suivit la route bordée d’arbres qui traversait le campus. À cette époque de l’année, les ginkgos bilobas affichaient un vert tendre, et Leyla s’engagea avec bonheur sous leur voûte fraîche et apaisante. Après une centaine de mètres, elle atteignit un immense terrain rectangulaire encadré de hauts bâtiments de brique rouge aux toits verts. Sur la gauche se dressait la statue de l’Alma Mater, la patronne de l’université. Des étudiants quadrillaient la place, certains pressés de se rendre à leurs cours et d’autres rejoignant des amis assis sur les pelouses du square. Elle grimpa rapidement quelques marches, passa devant la chapelle Saint-Paul puis par-dessus le pont qui enjambait l’Amsterdam Avenue, et entra dans la faculté de droit.
Arrivée au troisième étage, elle trouva avec surprise le bureau du professeur Liang Wú vide. Pourtant, ils avaient rendez-vous à 10 h 30 et elle avait déjà cinq minutes de retard. D’habitude, le professeur n’était jamais en retard. Leyla regarda autour d’elle et vit, un peu plus loin, une porte entrouverte. Elle frappa doucement, puis y passa la tête.
« Bonjour, j’ai rendez-vous avec le professeur Wú, vous ne l’auriez pas aperçu ? »
L’occupante du bureau leva la tête de sa lecture et dévisagea la jeune femme.
– Et vous êtes qui ? fit-elle.
– Leyla Jones, je suis doctorante à la faculté de journalisme, souffla Leyla.
Son interlocutrice sembla perdre tout intérêt. Leyla avait souvent remarqué que les juristes déconsidéraient toute personne qui n’appartenait pas à leur caste.
– Donc, vous l’avez vu ? osa Leyla malgré sa timidité.
– Non, pas depuis que je suis arrivée, il y a environ une heure, compléta la femme avant de se replonger dans sa lecture. Considérant qu’elle ne pourrait rien en tirer de plus, Leyla repartit, perplexe. Depuis qu’elle travaillait sur sa thèse avec Wú, il avait toujours été d’une parfaite ponctualité.
* * *
Le métro emportait Rose et François à toute vitesse vers le sud de Manhattan. D’abord debout dans un wagon bondé, ils avaient trouvé des places assises lorsqu’ils avaient changé de ligne à Columbus Circle. Rose observait autour d’elle. À chaque fois qu’elle venait à New York, elle était impressionnée par le melting pot de la mégapole. Asiatiques, Africains, Sud-Américains, Européens, tous se mêlaient ici, attirés par une vie meilleure qui se révélait souvent une chimère. Pour combien d’entre eux le rêve américain se réaliserait-il ? Une infime partie, probablement. Pourtant, ils étaient tous là, dans la rame de métro qui les menait à leur travail, habillés de façon similaire – chemises et pantalons pour les hommes, chemisiers et jupes pour les femmes – penchés sur leur smartphone, isolés par leurs écouteurs, savourant les derniers moments de tranquillité avant d’aller affronter les salles de marchés et des piles de paperasse, dans l’espoir d’acquérir un jour un appartement, une voiture et, pour les plus chanceux, une maison en banlieue à proximité d’une bonne école. Rose avait remarqué que le profil des usagers du métro variait en fonction de l’heure. Le matin, c’était la population active, les jeunes qui, n’ayant pas encore fondé de famille, avaient encore les moyens d’habiter à Manhattan. Pendant le reste de la journée, on y trouvait des jeunes femmes en tenue de sport qui se rendaient à leurs cours de yoga, des étudiants, des couples à la retraite et des touristes. Le soir, c’était l’exode en sens inverse : les gens sortant de leur travail, défraîchis, fatigués, certains un peu éméchés après la première bière prise avec leurs collègues dans un bar à côté du bureau.
« C’est notre arrêt », indiqua Rose en arrivant à City Hall, la station qui desservait le quartier de la mairie de Manhattan. Rose connaissait bien cette halte. Elle avait fait un stage avec des enquêteurs new-yorkais au début de sa carrière. Toute cette morne partie de New York – bâtiments administratifs, tribunaux, postes de police – n’avait plus de secret pour elle. François la suivit dans les escaliers qui conduisaient à l’extérieur, prenant garde à bien rester derrière elle pour ne pas déranger le flux de passagers qui descendaient. Il avait remarqué que, dans cette ville, celui qui, mal placé, perturbait les allées et venues des habitants toujours pressés, se faisait vite houspiller. Ils sortirent sur Broadway et traversèrent le parc qui se trouvait devant la mairie, le New York City Hall, contournèrent un gigantesque édifice, la Tweed Courthouse, l’ancien palais de justice du comté de New York, qui mêlait les styles grec antique et Renaissance, pour finalement arriver sur une place pavée.
« C’est par là », continua Rose. Se faufilant entre les barrières en béton destinées à protéger les bâtiments des voitures-béliers, ils s’approchèrent d’un immeuble moderne. Une fois à l’intérieur, ils durent passer sous un portique de sécurité avant d’être escortés jusqu’au cinquième étage, où se trouvait le bureau de l’assistant district attorney, le procureur adjoint.
– Bienvenue !
Un homme aux cheveux noirs, imposant et mince, s’avança vers eux, la main tendue. Rose remarqua immédiatement ses yeux très bleus.
– Je suis Patrick O’Brien, dit-il avec un grand sourire jovial.
– Rose McGawn, se présenta Rose en le lui rendant.
– Ah, nous venons de la même région, je vois, continua O’Brien en serrant chaleureusement sa main, tout en plantant ses iris céruléens dans ceux de Rose.
– Je suis d’origine écossaise, rétorqua Rose.
– Avec une belle chevelure rousse et des yeux verts comme les vôtres, vous pourriez être de chez moi, poursuivit le procureur adjoint avec un petit clin d’œil. D’ailleurs, je peux t’appeler par ton prénom ? termina-t-il d’une voix que Rose trouva presque suave. Elle lui rendit son sourire en assentiment.
À ce moment, François toussota. O’Brien se tourna vers lui.
– Et vous devez être François Gôdarde ?
– C’est Gaudard, articula François. À chaque fois, les anglophones estropiaient son nom, ce qui avait le don de l’agacer suprêmement. À votre service, grinça-t-il d’un ton sarcastique, en faisant une petite courbette. O’Brien le dévisagea un instant d’un air étonné, puis regarda vers Rose.
– Je peux vous offrir un café ? proposa-t-il en indiquant une cafetière.
– Pas pour moi, merci, répondit Rose.
– Cette espèce de jus de chaussette américain, sans-façon ! siffla François entre ses dents. Rose lui décocha un coup d’œil réprobateur.
– Je ne vais pas trop vous ennuyer aujourd’hui, assura O’Brien en les invitant d’un geste à s’asseoir. Le calendrier de procédure a maintenant été arrêté, le procès commence lundi prochain, néanmoins, vous ne serez pas appelés à témoigner avant une dizaine de jours.
– Chouette, on va pouvoir jouer les touristes, railla François.
O’Brien ne releva pas.
– Je vais vous remettre les mémoires des parties, il va falloir que vous les lisiez ces deux prochains jours, conseilla-t-il. Ensuite, nous allons nous voir pour vous préparer à répondre à nos questions et à celles de la défense, qui promettent d’être corsées.
En disant cela, il attrapa derrière lui six gros classeurs. Il en posa trois devant Rose et trois devant François.
– Voici donc vos devoirs. Je vous propose que nous nous retrouvions jeudi, même endroit, même heure, est-ce que cela vous va ?
– Mais je croyais que nous avions le temps ! protesta François.
– Vous avez le temps, assura O’Brien en lui lançant un regard vide. Juste assez pour apprendre le contenu de ces dossiers.
Rose et François s’emparèrent des documents et prirent congé d’O’Brien. Une fois dehors, Rose invectiva François :
– Non, mais tu es sérieux ? Qu’est-ce qu’il t’a pris ?
– Quoi ?
– Tu étais super désagréable avec Patrick !
– Tu as vu un peu son ton paternaliste ? On n’est pas des écoliers !
– Ça va te prendre du temps de lire tout ça en anglais, déclara Rose, conciliante.
– C’est ça, défends-le, s’énerva François en s’éloignant en direction de la bouche de métro.
– Attends, coupa Rose. Avec tous ces documents, il vaut mieux qu’on prenne une voiture.
Calant ses lourds dossiers sous un bras, elle leva l’autre main pour héler un taxi. À peine eut-elle accompli ce geste qu’un véhicule jaune s’arrêta en faisant crisser ses pneus. Rose ouvrit la portière arrière. Elle fut assaillie par une odeur de curry. Elle regarda le conducteur. Il était d’origine indienne. François se glissa après elle en grimaçant.
– Ça pue !
– Tu as avalé de la vache enragée aujourd’hui ou quoi ? Bienvenue à New York ! Ces gars bossent douze heures quotidiennement et ne veulent pas perdre une minute, alors ils mangent leurs repas dans leur voiture. Tu vas t’habituer, tu verras.
Le chauffeur avait démarré en trombe. Il ne paraissait maîtriser que deux modes de conduite, l’accélération et le freinage. Son véhicule, qui avait connu des heures meilleures, rebondissait sur le patchwork de bitume caractéristique des rues de New York. Lorsqu’il heurta un trou particulièrement profond, la tête de François tapa contre le plafond du taxi.
« Aïe, maugréa-t-il. Je sens que je vais apprécier ce séjour ! »
Chapitre 226 avril
Manhattan, N.Y.
Rose se leva sur un coude et regarda l’heure. 4 h 15.
Elle avait presque gagné une heure de sommeil sur la nuit passée. Quel succès !
Elle sortit de sa chambre, et alla prendre une brique de lait dans le frigo. Zéro pour cent de matière grasse, dix vitamines, sans lactose pour une meilleure digestion. Les aliments américains, avec leurs multiples réductions, ajouts et innombrables améliorations, la fascinaient toujours. Et malgré cela, plus de la moitié de la population était obèse ou en surpoids.
À travers les lamelles des stores, elle observa le parc. Dans la nuit noire, la crête des arbres créait un océan déchaîné, aux vagues inégales. Elle porta son regard sur les immeubles en face. À part le cube éclairé du Mount Sinaï Hospital, aucune lumière. Était-elle vraiment la seule à souffrir ainsi d’insomnie sur tout l’Upper East Side ? La « ville qui ne dormait jamais », chantée par Sinatra, restait semble-t-il un mythe dans ces quartiers bourgeois.
La vision de la nuit précédente lui revint soudain à l’esprit. Occupée pendant la journée par la visite à O’Brien et la lecture qui s’était ensuivie, elle n’y avait pas pensé. S’était-il passé quelque chose de grave, ou avait-elle seulement été spectatrice de la vie nocturne du parc ? Elle regarda en bas, en direction de l’entrée du métro. Pourtant, ce matin, personne ne montait ou ne descendait les escaliers. Quand elle reviendrait de sa séance de course à pied, elle consulterait le journal.
Elle passa dans le salon. Elle était encore trop troublée pour pouvoir immédiatement retrouver le sommeil. Elle mit en marche la télévision, en prenant garde à laisser le volume très bas pour ne pas réveiller François. Les chaînes câblées ne connaissaient pas de repos, et diffusaient des nouvelles toute la nuit. Guerre en Syrie, conflits au Venezuela, bataille des tarifs entre la Chine et les États-Unis. C’était certain, le besoin de l’être humain d’en découdre avec ses congénères avait de beaux jours devant lui. Dégoûtée par l’état du monde, elle retourna se coucher.
* * *
Leyla Jones regardait l’écran de son ordinateur. Elle se levait tous les jours à 5 h du matin pour finir la rédaction de sa thèse car elle avait du retard dans son programme. De plus, c’était à l’aube qu’elle écrivait le mieux. Elle pouvait ouvrir la fenêtre de son appartement, qui donnait sur Riverside Park, sans être trop dérangée par le bruit des voitures alors que, pendant la journée, la circulation intense rendait la concentration difficile. À travers les arbres, elle entrevoyait l’Hudson River, dont les eaux grises dissimulaient toujours un redoutable courant. Souvent, elle observait avec amusement les bateaux filer avec le flux, ou quand ils le remontaient, batailler de la toute-puissance de leurs moteurs.
Son logement n’était pas grand, mais elle l’avait joliment décoré et s’y trouvait bien pour écrire. Elle aurait pu louer un espace beaucoup plus vaste et plus luxueux, si elle n’avait pas refusé de vivre différemment des autres étudiants. Elle aimait ce quartier du nord-ouest de Manhattan, avec ses bâtiments de brique rouge aux toits verts, qui vivait au rythme de l’université Columbia, et, pour rien au monde, elle ne serait allée habiter ailleurs.
Ce matin, sa rédaction peinait. Les mots ne lui venaient pas, construire ses phrases lui demandait un gros effort. Elle était très soucieuse de la disparition du professeur Wú. Après sa visite, elle avait essayé de l’appeler plusieurs fois et était même retournée à la Law School, en vain. En désespoir de cause, elle s’était rendue dans l’immeuble où il résidait. Le portier lui avait répondu qu’il l’avait vu sortir le soir précédent, sans l’avoir vu rentrer. Elle craignait que sa disparition ne soit liée à leur projet.
Leyla avait contacté le professeur Wú six mois auparavant, alors qu’elle commençait la thèse qui devait couronner la fin de ses études de journalisme. Elle avait choisi comme sujet la répression des minorités musulmanes en Chine. Comme le professeur, un ressortissant chinois, enseignait les droits de l’homme, elle l’avait rencontré pour obtenir des informations, et l’aide de l’intellectuel avait été précieuse. Il lui avait transmis de nombreux documents attestant les disparitions et les internements de Chinois de confession musulmane, qui lui avaient ainsi fourni une trame pour la rédaction de son travail universitaire. Wú avait récemment approché l’un de ses compatriotes, un imam, qui était demandeur d’asile aux États-Unis et habitait du côté de Washington, D.C. Elle savait que Wú était allé rendre visite à cet homme, et c’était pour discuter de cet entretien qu’elle avait pris rendez-vous avec lui. Et maintenant, il avait disparu sans laisser de trace.
Pensive, Leyla caressa son chat, qui avait grimpé sur son bureau pour venir se coucher sur son cahier de notes. Elle se demandait toujours si l’animal recherchait sa présence ou exerçait seulement un contrôle rapproché sur l’être qui avait l’accès au garde-manger. Quoi qu’il en soit, il restait son plus fidèle compagnon, elle que sa timidité maladive coupait souvent du reste du monde.
Elle regarda sa montre. 6 h. Le livreur du New York Times devait déjà être passé. Elle descendit au rez-de-chaussée et récupéra un des exemplaires empilés dans l’entrée de l’immeuble, à même le sol. Visiblement, ce journal restait la lecture de choix des étudiants de Columbia University.
Leyla rentra chez elle, se versa un verre de jus d’orange, et consulta le journal. Son regard fut immédiatement attiré par un titre en première page : « Cadavre retrouvé dans Central Park ».
* * *
Insensible aux cahots du wagon, Rose était plongée dans sa lecture. Elle avait acheté un quotidien en entrant dans le métro et était tombée sur un article relatant la découverte d’un corps dans Central Park le jour précédent. Le journaliste expliquait que la police présumait qu’il s’agissait d’une rencontre à caractère sexuel qui avait mal tourné. En raison de l’état du cadavre, il n’avait pas encore pu être identifié. La dépouille d’un Asiatique de sexe masculin avait été retrouvée dans la partie nord du parc, non loin de la traversée de la 97e Rue. L’article se terminait par un appel à témoins avec le numéro de téléphone de l’inspecteur en charge. Rose le nota sur son portable.
– Qu’est-ce que tu lis ? lui demanda François.
Pour toute réponse, Rose lui tendit le journal. François y jeta un coup d’œil.
– Et alors, c’est fréquent, non ?
– Quoi ? Les meurtres à Central Park ?
– Oui. Il y a eu cette femme, il y a quelques années.
– La joggeuse de Central Park ? C’était il y a trente ans. Et elle n’est pas morte.
– Oui, mais je me souviens qu’elle avait été laissée pour morte et avait souffert de graves séquelles.
– C’est vrai. Cela avait beaucoup choqué l’opinion publique. En plus, l’enquête avait pris une tournure raciste, cinq jeunes afro-américains avaient été incarcérés à tort. Une honte ! Seulement, New York était différent à l’époque. Depuis, deux maires successifs ont nettoyé la ville. Donc non, les homicides à Central Park, même s’ils existent, ne sont pas une chose fréquente. En revanche, dit Rose en pointant son index sur l’article, je pense avoir été témoin des derniers instants de cet homme.
– Comment cela ? demanda François, interloqué. Tu étais à Central Park il y a deux nuits ?
Rose se mit à rire.
– Oui, tu ne savais pas que j’étais noctambule, et que mon activité préférée était de me promener dans les parcs sombres ? plaisanta-t-elle en lui donnant un coup de coude.
Elle lui raconta ce qu’elle avait vu. Elle venait d’achever son histoire quand le métro arriva à leur arrêt. Ils se rendirent rapidement au bureau de Patrick.
– Alors, cette lecture ? questionna ce dernier en guise de bonjour.
– Très intéressante, répondit Rose.
– N’exagérons rien ! ronchonna François.
Patrick jeta à François un mauvais coup d’œil mais continua sans relever.
– Comme prévu, poursuivit Patrick, François témoignera contre Guido Giolli, le procureur de la principauté de Monaco, et toi, Rose, contre Rick Simmons, l’agent du FBI corrompu avec lequel tu as travaillé.
– Et qu’est-il advenu d’Eduardo Ramon ?
– Il a conclu un plea bargain1. En tant qu’ancien gardien de la prison de Bogotá devenu investisseur de l’argent du cartel dans l’immobilier à Miami, il a adopté l’attitude commune aux membres de ces organisations, c’est-à-dire transiger en disant une partie de ce qu’ils savent.
– Ah, s’étonna Rose, pourquoi font-ils cela ? Ils ne se mettent pas à mal avec leurs anciens acolytes ?
– Non, cela leur permet d’obtenir une immunité qui les déleste de leur obligation de témoigner au procès. Leurs aveux sont préparés par leurs avocats en collaboration avec les cartels, ce qui permet à ces derniers de s’adapter.
– Étonnant, déclara Rose, les mafias européennes ne fonctionnent pas comme ça. Puis, reprenant le cours de la conversation : Giolli plaide qu’il ne connaissait pas l’étendue des activités criminelles du réseau. Selon lui, il n’était qu’un pion servant à blanchir l’argent à Monaco, est-ce que vous pensez qu’il arrivera à défendre cette thèse ?
– Avec votre aide, nous allons tout faire pour qu’il n’y parvienne pas, assura Patrick en lui adressant un sourire enjoué.
– Bon, on s’y met ? abrégea François.
– Allons-y ! rétorqua Patrick en lui lançant un regard amusé.
Il commença à exposer ce à quoi François devait s’attendre quand il prendrait la place du témoin devant la Cour fédérale du district sud de New York. Contrairement à ce dont François avait l’habitude en France et à Monaco, ce n’était pas à un juge, mais à un jury que reviendrait la décision de condamner, ou non, l’accusé. Le juge serait présent uniquement pour régler les problèmes de procédure. Le jury, composé de douze personnes du grand public, entendrait l’ensemble des plaidoiries et des témoignages avant de délibérer sur la culpabilité des inculpés.
– Vous serez témoins à charge et vous serez par conséquent interrogés avec précision par les avocats qui défendent Giolli et Simmons, poursuivit Patrick en s’adressant à Rose et à François. Vous voyez ce que je veux dire ?
– Comme dans Law and Order2 ? s’enquit François.
– Oui, exactement.
– Bon, ça devrait aller, fanfarona François, j’ai regardé tous les épisodes de cette série.
Patrick lui lança un regard condescendant.
– C’est un bon début, c’est sûr. Mais nous allons quand même vous soumettre à un interrogatoire fictif, car ces avocats sont des spécialistes. Ils vont chercher les moindres contradictions dans votre témoignage pour vous décontenancer et vous déstabiliser.
– Tout se déroulera en anglais ? demanda encore François en pâlissant un peu. Son anglais progressait depuis qu’il connaissait Rose, mais il se voyait mal tenir tête à un avocat dans la langue de Shakespeare.
– Nous avons demandé qu’un interprète soit présent. Même si vous comprenez les questions en anglais, vous pourrez réfléchir à ce que vous voulez répondre pendant qu’il traduira et ce sera toujours ça de gagné.
– Dans ce cas, ça va aller, hâbla François, ce qui lui valut un coup d’œil soucieux de Rose. Si François ne prenait pas plus au sérieux cet exercice, cela pourrait tourner au désastre pour l’issue du procès. De plus, elle n’osait pas imaginer ce qu’elle entendrait sur « les Ricains » et « leurs méthodes » si jamais il perdait la face pendant un interrogatoire. La litanie de critiques serait sans fin. Elle laissa échapper un soupir, alors que Patrick commençait la préparation de François.
* * *
Capuche sur la tête, une fine silhouette enveloppée dans un long manteau noir en cachemire, à la coupe parfaite, marchait à grands pas dans la 42e Rue. Laissant derrière elle les lumières de Times Square, l’Asiatique se dirigeait vers l’Hudson River. À grandes enjambées, indifférente à la foule, elle passait devant les brasseries pour touristes. Un clochard lui tendit sa sébile ; elle frappa dedans, pour le plaisir de voir le pauvre homme essayer de récupérer ses pièces, à quatre pattes.
Teint très pâle, presque blanc, hautes pommettes. Avec ses cheveux de jais, coupés très court, seul un œil entraîné pouvait distinguer qu’il s’agissait d’une femme.