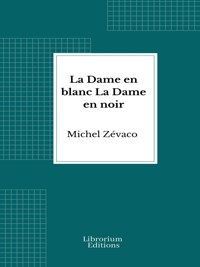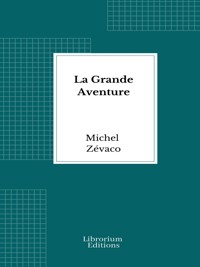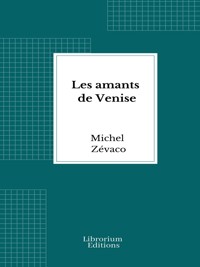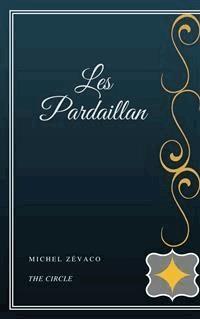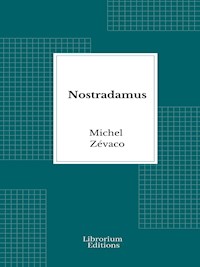3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Au début du 17e siècle, en France. Un cavalier s'élance et tombe comme la foudre au milieu des brigands épouvantés. Les rapières se croisent, les chevaux se cabrent, des hommes s'écroulent, d'autres s'enfuient. Alors, se découvrant d'un geste, le cavalier s'incline en souriant devant la frêle jeune fille qu'il vient d'arracher aux griffes des malfaiteurs. Capestang, jeune noble de province, vient de connaître sa première escarmouche et de rencontrer la délicieuse Gisèle d'Angoulême. Bientôt célèbre sous le nom Capitan, il devra déjouer de nombreuses intrigues, les complots de l'odieux Concini et sauver le jeune roi Louis XIII.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Le Capitan tome 2
Pages de titreXXXIVXXXVXXXVIXXXVIIXXXVIIIXXXIXXLXLIXLIIXLIIIXLIVXLVXLVIXLVIIXLVIIIXLIXLLILIILIIILIVLVLVILVIILVIIILIXLXLXILXIILXIIITablePage de copyrightMichel Zévaco
Le Capitan
Michel Zévaco
Le Capitan
roman
Tome deuxième
Le Capitan
II
XXXIV
La fortune de Capestang
Ce fut ainsi que Condé fut arrêté dans ce Louvre où, quelques heures auparavant, il se croyait sûr de pouvoir entrer en maître. Vitry le remit aux mains du marquis de Thémines qui, avec une vingtaine de gentilshommes, attendait dans l’antichambre la fin de cette scène. Thémines emmena le prince sous escorte et le fit monter dans un carrosse fermé : une demi-heure plus tard, Henri II de Bourbon, prince de Condé, n’était plus que le numéro 14 de la tour du Trésor, à la Bastille.
Vitry était sorti en jetant un étrange regard à Capestang. Sur un signe de Louis XIII, Luynes sortit à son tour, et il eut le même coup d’œil oblique vers le chevalier. Dans ce double regard, Capestang put lire toute l’envie qu’il inspirait. Le vieux maréchal d’Ornano, qui, le dernier quitta le cabinet royal, lui murmura à l’oreille :
– Jeune homme, si vous ne sortez pas d’ici grand favori, je vous conseille de fuir Paris à franc étrier et de mettre une bonne centaine de lieues entre votre poitrine et les poignards qui vont s’aiguiser. Et, se tournant vers le roi : Sire, ajouta-t-il avec une sorte de rudesse, ce n’est pas M. de Condé qu’il fallait arrêter.
– Ah ! ah ! Et qui donc ? Voyons, parle, mon vieil ami. Qui fallait-il arrêter ? Guise ? hein !
– Non, sire : Concino Concini ! dit froidement le maréchal qui s’inclina et puis s’éloigna lentement, comme s’il eût attendu, espéré un cri, un ordre.
Mais le roi demeura muet. Le maréchal sortit en haussant les épaules. Pour la deuxième fois, Louis XIII et Capestang se trouvèrent seuls en présence. Mais cette fois, c’était l’aventurier qui était soucieux et le roi qui était radieux. Louis XIII entendait encore résonner ces mots qu’il avait criés d’une voix qui l’avait étonné lui-même :
– Capitaine, arrêtez le prince !
Son premier acte de roi ! Le premier geste de sa puissance !
Ainsi donc, il avait commandé. Et on lui avait obéi ! Il avait suffi d’un éclat de sa voix pour qu’un prince du sang fût saisi et jeté dans un cachot ! Il avait suffi de ce geste royal pour que Paris en émeute, Paris en ébullition, pareil à une mer démontée, s’apaisât.
Ces pensées agitaient cet adolescent de quinze ans et le remplissait d’orgueil. Il était pareil à ces enfants à qui on vient de remettre un jouet compliqué et qui s’étonnent de le voir fonctionner lorsqu’ils poussent un ressort, et s’émerveillent du résultat sans comprendre le mécanisme. Louis XIII contemplait Capestang avec la même reconnaissance admirative de l’enfant pour celui qui lui a apporté le jouet.
– Tout d’abord, fit le roi, parlez-moi de cette compagnie de cinquante gardes que mon cousin de Condé avait réussi à armer, d’après ce que M. de Luçon est venu nous dire dans la soirée.
– Tenez, sire, dit Capestang, j’aime mieux vous raconter les choses telles qu’elles se sont passées depuis le moment où, rue de Vaugirard, j’ai rencontré Cogolin.
– Cogolin ? Qu’est-ce que Cogolin ?
– Mon écuyer, sire.
Eh bien, donc, voici l’histoire depuis son début. Cela se passe, sire, dans une pauvre auberge de la rue de Vaugirard, qui...
– Attendez, chevalier ! interrompit tout à coup Louis XIII qui frappa du marteau sur un timbre, à trois reprises. Peut-être serons-nous mieux, pour raconter et écouter, dans la salle à manger.
Louis XIII, depuis un instant, cherchait quelle preuve d’amitié il pourrait bien donner au chevalier qu’il avait humilié du nom de Capitan et qu’il voyait tout embarrassé comme s’il lui eût gardé quelque rancune. Le signal que venait de donner le roi correspondait sans doute à un ordre habituel et déjà connu, mais ce soir-là, l’ordre fut interprété avec une magnificence spéciale. En effet, au bout de quelques minutes, la porte s’ouvrit à double battant, et Capestang effaré vit entrer un officier en grande tenue, l’épée au poing, qui cria :
– Les viandes de Sa Majesté !
Derrière l’officier, quatre hallebardiers. Derrière les hallebardiers, quatre officiers de la bouche portant une table. Derrière la table, quatre autres hallebardiers. Les officiers de la bouche déposèrent la table au milieu du cabinet. Les hallebardiers se rangèrent le long des murs où ils s’immobilisèrent, pareils à des cariatides. La table supportait, par-dessus sa nappe éblouissante, les couverts étincelants, les gobelets d’or, deux candélabres à six flambeaux de cire, des flacons de cristal où rutilaient les rubis des vieux vins de Bourgogne et toute une variété de plats recouverts de leurs cloches d’argent.
Capestang demeura stupéfait de cette fastueuse mise en scène, et, involontairement, le souvenir s’évoqua en lui de cette caisse renversée sur laquelle, au fond du grenier, Cogolin lui avait servi un de ces succulents jambons qui doublent l’appétit et triplent la soif. Pourtant, comme il avait grand-faim, il jeta un regard d’envie sur la splendide table, renifla les parfums qui s’en dégageaient, soupira et songea :
– C’est tout de même une glorieuse chose que la royauté. Si j’étais roi, Je pourrais m’asseoir à cette table et tâter un peu de ces mets qui doivent être royaux, puisqu’on les habille d’argent. Mais je ne suis que le chevalier de Capestang... Bah ! je regarderai le roi manger, il paraît que c’est un grand honneur, et puis cela me donnera de l’appétit.
Si Capestang fut étonné, il y eut quelqu’un de plus étonné que lui : et ce quelqu’un c’était le roi ! Jusque-là, quand il demandait son dîner ou son souper, on le conduisait dans une salle à manger où il s’asseyait devant une table assez mal servie. Un instant, Louis XIII demeura tout pensif devant ces honneurs auxquels il n’était pas accoutumé.
– Pourquoi m’apporte-t-on mon souper ici ? demanda-t-il. Et pourquoi avec ce cérémonial ?
– Sire, répondit une voix soyeuse et caressante, en ma qualité de surintendant du palais, c’est moi qui ai donné l’ordre d’apporter ici la table de Sa Majesté. Et quant au cérémonial, c’est celui dont on usa toujours à l’égard des grands rois !
Et Louis XIII vit s’incliner devant lui celui qu’Ornano lui conseillait d’arrêter : Concino Concini ! Capestang avait tressailli. Un frisson de colère le secoua. Presque malgré lui, il porta la main à la garde de sa rapière. Mais déjà Concini, sans paraître l’avoir vu, sortait à reculons, tout courbé, marche et attitude ne formant qu’une longue révérence jusqu’à ce qu’il eût disparût. Louis XIII, d’un geste, ordonna aux hallebardiers et officiers de bouche, de sortir également.
– Mais, sire, observa respectueusement le lieutenant de garde, qui servira Votre Majesté !
– Bah, monsieur ! je ferai comme mon père le soir de la bataille d’Arques : je me servirai moi-même ! Mettez-vous là, devant moi, monsieur le chevalier, et soupons, car vous devez mourir de faim, et moi j’enrage.
Le bruit se répandit aussitôt dans le Louvre que le roi faisait familièrement manger à sa table le jeune chevalier de Capestang et, dès lors, plus d’un gentilhomme se mit à guetter la sortie du nouveau favori pour lui faire sa cour. Concini avait rapidement franchi deux ou trois salles. Il était livide. Comme dans ses crises de fureur, ses lèvres moussaient.
– Va, gronda-t-il, va, misérable fier-à-bras, intrigant ! sacripant ! Capitan ! Soupe à la table du roi ! cette nuit, tu souperas à la table du diable, ton patron !
Au palier du grand escalier, il trouva Rinaldo qui l’attendait.
– Tout est-il prêt ? demanda Concini.
– Jugez-en, monseigneur : Montreval et Bazorges dans l’antichambre. Louvignac dans le bas de l’escalier. Pontraille dans la cour. Et moi ici pour surveiller à la fois l’escalier et l’antichambre. À la porte du Louvre, Chalabre avec vingt gaillards dont le moindre en est à son trois ou quatrième coup de poignard. Cette fois nous tenons le drôle, il ne nous échappera pas !
Concini, d’un signe de tête, approuva ce dispositif d’une embuscade qui semblait dressée contre quelque fabuleux géant. Cependant, celui qui était menacé par ces formidables préparatifs, celui contre qui Concini avait jugé que trente assassins ne seraient pas de trop, s’inclinait à ce moment, pâle d’orgueil, devant Louis XIII.
– Quoi, sire ! M’asseoir à la même table que Votre Majesté !
C’était un honneur que Louis XIII n’avait encore fait à personne et qu’il devait peu prodiguer. Le pauvre chevalier à qui M. de Trémazenc son père avait raconté qu’il avait été un jour admis à l’honneur de regarder manger le roi croyait faire un beau rêve de fortune et de gloire. Il finit par prendre place sur le siège que Louis lui désignait, et alors, il se redressa comme s’il eut conquis le monde, et jugeant que la meilleure manière de remercier son hôte était de se montrer bon convive, il se mit à dévorer.
Louis se taisait, écoutait, et grignotait à peine, ayant l’esprit malade malgré Hérouard ou peut-être à cause d’Hérouard. Quant à Capestang, il attaqua à belles dents une tranche de chevreuil, et, en même temps, à grand renfort de verbes sonores, un récit tout flamboyant que le roi entendit en frémissant d’enthousiasme. Le chevalier parla donc pour deux, mangea comme trois, et but comme quatre. Lorsque le souper fut achevé, lorsque se termina ce récit, le roi, longuement, contempla l’aventurier qui, d’un dernier geste, illustrait sa narration.
– C’est magnifique ! s’écria-t-il enfin. Cette traversée de Paris avec Condé à votre bras ! Ce nom de Condé jeté aux bourgeois du Pont-Neuf ! Et ce double duel, là-bas, dans l’auberge ! Et vous dites que vous n’avez reconnu aucun des gentilshommes qui devaient endosser les costumes ?
– Non, sire : aucun ! dit Capestang.
– Quel dommage ! Mais ce qu’il y a encore de plus beau dans tout cela, c’est l’histoire des costumes cachés dans la cave. Cela vaut l’histoire des fameux camions de peinture !
– N’est-ce pas, sire, que c’était bien imaginé ? fit naïvement le chevalier.
– Ah ! j’en rirai longtemps, rien qu’en me figurant la mine désappointée des cinquante !
– Et moi, sire, j’en ris déjà ! fit Capestang qui en effet éclata. Et puis, ajouta-t-il, j’ai pensé que Votre Majesté aurait là cinquante costumes tout trouvés pour ses gardes. C’est une économie, cela !
– Je vous les achète ! fit vivement le jeune roi. Sans doute ! ajouta-t-il en voyant l’étonnement du chevalier, ces costumes sont à vous ; c’est une prise de guerre. Eh bien ! je vous les achète.
Capestang réfléchit une minute, puis répondit :
– Soit, sire. Je vous vends mes costumes. Ou plutôt, je vous les échange.
– Contre quoi ? fit Louis XIII en souriant.
– Contre un costume ! dit gravement le chevalier.
– Ah ! Ah ! s’écria le roi. (Il va me demander un grade, songea-t-il. Ma foi, il l’aura !) Et quel costume voulez-vous que je vous donne contre les cinquante que vous me vendez ?
– Celui du prince de Condé, répondit Capestang. (Le roi fronça le sourcil.) Seulement, sire, comme je vous offre cinquante pour un, il sera juste, il sera légitime, qu’avec le costume vous me donniez le prince par-dessus le marché. (Louis XIII se leva d’un brusque mouvement, Capestang en fit autant.) Je vois, sire, que vous hésitez, que vous méditez. Ce que vous demandez, est pourtant peu de chose.
– Un prince ! peste...
– Un homme, sire ! fit Capestang qui se grandit, un homme comme moi.
– Et qu’en voulez-vous faire ! s’écria Louis irrité, effaré, stupéfait devant l’étrange marché.
– Lui rendre la liberté, sire !
– Jamais ! gronda Louis XIII dont le visage pâle s’empourpra. Vous avez acquis ce soir des droits à ma reconnaissance. Mais vous en abusez et votre demande me fait concevoir d’étranges soupçons.
Soupçon ! Louis XIII venait de prononcer le grand mot qui domina sa pensée. Toute sa vie ne fut qu’une chaîne de soupçons. Il fut un soupçon vivant.
– Sire, fit Capestang, avec une simplicité qui faisait un violent contraste avec son habituelle abondance de gestes, il y a pour moi quelque chose de pire que d’être suspect à moi-même. Vous m’avez nommé Chevalier du roi. Et moi, misérable, je suis descendu au rôle de chevalier du guet. Si lorsque j’ai arrêté le prince et que je lui ai ordonné de venir au Louvre vous faire sa soumission, il m’a suivi de bonne grâce, parce que je lui ai dit : « Ne craignez rien, je réponds de vous ! » Le prince est à la Bastille, et j’ai donc manqué à ma parole. Sire, rendez-moi mon prisonnier, ou je vous jure que je démolirai la Bastille pour l’en faire sortir !
Louis XIII haussa les épaules, éclata d’un rire aigre, et... pour la deuxième fois, murmura :
– Capitan !
Et cette fois encore, Capestang vacilla sous le coup ! Son exaltation tomba, les ailes brisées ! Il se vit ridicule, il vit qu’il prêtait à rire, lui qui avait rêvé de faire trembler ! Pauvre chevalier ! Il était tout bonnement sublime de naïveté. Le voyant si abattu, le petit monarque résolut de compléter sa victoire, et, d’une voix mauvaise :
– La Bastille ! Prenez garde d’y être enfermé vous-même ! grinça-t-il.
Mais ce fut le coup de fouet qui, dans la cage, accule le lion, la gueule ouverte, la griffe dehors, la patte dressée pour déchirer, fracasser... En deux pas rapides, il rejoignit le roi, qui se dirigeait vers la porte comme pour jeter un ordre ; il se pencha, se baissa sur lui comme pour lui faire comprendre combien il était petit et gronda :
– Moi à la Bastille ! Osez donc oser cela, sire ! Tenez ! si vous voulez, j’ouvre cette porte ! j’appelle ! Et je crie ! « Messeigneurs, qui de vous veut conduire à la Bastille celui qui ce soir a sauvé la monarchie et le roi Louis ! »
Le roi recula... Il tremblait de fureur, il bégayait. Capestang acheva :
– J’ouvre la porte, sire ! Je traverse vos antichambres sans hâte. Je m’en vais. Je ne ferai pas un pas plus vite que l’autre. Vous êtes le roi. Vous êtes le maître... faites-moi arrêter !
En même temps, il ouvrit la porte, et, la tête très haute, l’œil fulgurant, la lèvre frémissante, le poing sur la hanche, d’un pas lent et rude et insolent, il traversa la foule des courtisans qui s’écartaient devant lui, souriaient, saluant très bas le nouveau favori, saluant la fortune de Capestang !
...................................................................
La porte du cabinet royal était restée grande ouverte. Louis XIII avait fait un pas en avant pour crier l’ordre... la voix s’étrangla dans sa gorge... il porta les deux mains à sa collerette de dentelle comme si ce faible poids l’eût étouffé, il recula, livide, les yeux exorbités, et alla tomber sur un fauteuil. À ce moment, dans l’encadrement de cette porte, apparut une tête pâle et convulsée... Et Concini, qui venait de voir passer Capestang, Concini qui flairait quelque grave événement, Concini qui avait entendu des éclats de voix, jeta sur Louis XIII un long regard.
– Dieu me damne ! cria-t-il. Le roi s’affaiblit !
Et il se précipita, en même temps que dans les antichambres éclatait un tumulte. En deux bonds, Concini fut près du roi qui, à ce moment, ouvrait les yeux.
– Hérouard ! hurla le maréchal. Qu’on appelle Hérouard ! Sire ! Sire ! Qu’avez-vous ? Que s’est-il passé ?
– Cet homme ! murmura le roi.
– Capestang ! gronda Concini d’une voix de joie terrible.
– Il m’a insulté. Qu’on l’arrête !
– Insulté ! Il a insulté le roi ! Eh bien sire, vous allez voir de quoi est capable le maréchal d’Ancre quand on insulte son roi !
– Arrêtez-le, amenez-le-moi, murmura Louis XIII, mais... ne lui faites pas de mal !
Mais déjà Concini s’était élancé. Et tandis que bruissait le murmure des courtisans empressés à montrer leur douleur, tandis qu’Hérouard préparait sa lancette pour saigner le roi, celui-ci songeait :
– Est-ce que la reine aurait raison ? Est-ce que Concini serait le plus dévoué de mes serviteurs ?
Vingt gentilshommes, à ce mot : « Qu’on l’arrête ! » avaient mis l’épée à la main et s’étaient jetés à la suite de Concini. Dans l’antichambre, il les arrêta d’un geste furieux.
– Ces imbéciles, gronda-t-il en lui-même, le ramèneraient au petit roi, qui ne demande qu’à pardonner... Messieurs, l’épée au fourreau, s’il vous plaît. Et que personne ne bouge ! Cette affaire me regarde, moi, moi seul ! Nul que moi ne peut mettre sa main au collet de l’insulteur de la majesté royale.
Il se rua, laissant les courtisans stupéfaits de son audace et de son dévouement. Dans la cour, Rinaldo attendait en grommelant :
– Eh bien ? haleta Concini.
– Il passe le pont-levis. Nos hommes sont sur lui et ne le perdent pas de vue. Faut-il sonner l’hallali, monseigneur ?
– Pas encore. Laisse-moi faire. En route !
Et se penchant sur Rinaldo, il ajouta avec un calme sinistre :
– Coûte que coûte, il me le faut vivant !
XXXV
La bataille du grand Henri
Le chevalier de Capestang sortit du Louvre au moment où dix heures sonnaient. Il se mit à marcher d’un pas rapide, dans la nuit profonde, tantôt trébuchant comme un homme ivre, tantôt s’arrêtant pour se frapper le front. Où allait-il ? C’est à peine s’il le savait. Hérissé, haletant, la sueur au front, il était terrible. À un moment, dans une ruelle, il se heurta à quelqu’un qui lui dit :
– La bourse ou la vie !...
Capestang tira furieusement sa bourse qui était pleine d’or et, à toute volée, en assomma à moitié le tire-laine qui tomba, étourdi sous le coup.
– La voilà, la bourse ! vociféra Capestang. Tiens ! prends ! Gorge-toi ! Soûle-toi ! Et quant à ma chienne de vie, je te bénis si tu la prends aussi.
– Merci, monseigneur ! grogna le truand qui, pendant des années devait demeurer étonné de cette aventure, de cette royale aumône dont cet inconnu l’avait assommé – moralement et physiquement.
Un peu soulagé d’esprit et tout à fait soulagé d’argent, le chevalier reprit son chemin en grondant :
– Qu’ai-je à faire de pistoles, maintenant ? Ah ! triple brute ! Ah ! faquin ! Ah ! bélître !
C’est à lui-même qu’il adressait ses épithètes, et non au roi ni au truand comme on pourrait le supposer. Il était furieux, exaspéré, mais contre sa propre attitude.
– Je n’avais qu’à me laisser faire ! continua-t-il. Je tenais la fortune. Comment ! J’ai la chance inouïe d’amener au Louvre le prétendant que tout Paris acclamait ! Le hasard fait de moi le sauveur d’une monarchie ! Je n’avais qu’à me taire ! Et demain, tu étais le premier du royaume ! Demain tu pouvais te présenter devant le père de Giselle et lui dire en toute assurance : « Votre fille m’aime, et je l’aime. Maintenant que je suis quelqu’un, arrachez-la à Cinq-Mars, qui n’est qu’un pauvre petit marquis de rien et donnez-la-moi ! »
Comme il disait ces mots, il s’arrêta en frissonnant : il venait de s’apercevoir qu’il était rue des Barrés ! devant la maison de Marie Touchet ! devant la maison de Giselle ! Il était venu là, d’instinct, sans s’apercevoir qu’il y venait.
– Que suis-je venu faire ici ? songea-t-il. N’est-elle pas l’épouse de Cinq-Mars ? Ce mariage n’a-t-il pas dû s’accomplir, à minuit ? Il est vrai qu’elle m’a dit qu’elle m’aime. Il est vrai qu’elle ne donnera à Cinq-Mars que son nom ! Et sans doute, elle attend que j’accomplisse ma promesse de la conquérir de haute lutte ! Mais où en suis-je ? Que puis-je espérer, puisque je ne sais pas profiter des chances que m’offre la fortune !
Non, il n’avait plus rien à espérer. Le roi lui-même était maintenant son ennemi !
Il se leva, se recula et, avec un inexprimable découragement, considéra la maison. Elle était à peine visible dans les ténèbres. Elle était silencieuse, avec une face obscure. Puis il se remit en route. Il erra ainsi de longues heures, tournant à droite ou à gauche, virant, revenant sur ses pas, au hasard, véritable épave ballottée – très malheureux. Si malheureux que la pensée lui vint, ou plutôt se précisa en lui, de se tuer.
– Aussi bien, réfléchit-il, je ne ferai que devancer de quelques jours le moment d’aller voir ce qui se passe ad patres.
Il ne croyait pas si bien dire. Car Montreval et Louvignac l’avaient suivi dans toutes ses évolutions et étaient décidés à le suivre jusqu’à ce qu’il s’arrêtât quelque part : moment auquel Montreval monterait la faction devant son logis quel qu’il fût, tandis que Louvignac irait prévenir les forces concentrées à l’hôtel d’Ancre.
Toute la question, pour Capestang, se réduisait donc à choisir un genre de mort qui lui parût convenable. Il les passa en revue, rapidement, puis soudain :
– Ah ! j’ai trouvé, cette fois !
Il s’arrêta, haletant, flamboyant d’audace.
– Ce que j’ai dit au roi, je le ferai ! C’est moi qui ai fait mettre un gentilhomme à la Bastille. C’est moi qui l’en ferai sortir ! Et comme dans ce duel gigantesque entre la Bastille et moi, c’est la Bastille qui m’écrasera, je trouverai ce que je cherche, c’est-à-dire une mort glorieuse, et je retrouverai ce que j’ai perdu en remplissant le rôle de sbire, c’est-à-dire l’honneur ! Cette fois-ci, voilà la bonne idée, c’est la chance !
Et ces deux mots qu’il venait de prononcer : la guigne, la chance, appelant une naturelle association d’idées, il se remit en route d’un pas plus ferme en murmurant :
– Où est Cogolin ? Où est ce cuistre ! Il n’est jamais là quand j’ai besoin de lui ! Il a dû retourner m’attendre au grenier du Grand Henri, courons-y.
Cinq heures du matin sonnaient au couvent des Carmes, lorsque, après cette nuit terrible, le chevalier pénétra dans l’auberge abandonnée, harassé, mais plein de courage pour l’exécution de son idée.
– Cogolin ! s’écria-t-il impétueusement. Va chercher les chevaux à la Bonne Encontre ! Et puis il doit te rester de l’argent, remets-le-moi, Cogolin ! Où es-tu, faquin ! Me laisseras-tu m’égosiller ! Cogolin !
Cogolin n’était pas dans l’auberge. Lorsque Capestang eut acquis cette conviction, il s’assit ou plutôt se laissa tomber sur le tas de foin qui, depuis quelques jours, lui servait de couche. Il était las. Il sentit le sommeil le gagner... Un rayon de soleil se glissant dans le grenier s’en vint se poser sur ses yeux. Il grogna un juron et entrouvrit les paupières. Le mince regard qui filtra de ses paupières appesanties s’alla poser sur la lucarne, et Capestang tressaillit.
À cette lucarne, à ce moment même, une tête se montrait. Dans la même seconde, Capestang la reconnut :
– Rinaldo ! rugit-il en lui-même.
* * *
D’un bond Capestang fut debout et marcha à la lucarne : la tête avait disparu. On se rappelle qu’il y avait deux lucarnes à ce grenier : l’une donnant sur la cour, et à laquelle aboutissait l’escalier de bois qui desservait extérieurement les étages, l’autre donnant sur la route. C’est à cette dernière lucarne que s’était montré Rinaldo.
Capestang, s’étant penché, le vit qui descendait d’une échelle qu’on avait appliquée là ; il jeta un regard sur la route et vit que l’auberge était cernée par une vingtaine d’hommes ; à gauche et à droite, de loin, des passants arrêtés regardaient curieusement ce qui allait advenir ; la porte charretière de l’auberge était ouverte, et six hommes y étaient postés. Il courut à l’autre lucarne, jeta un coup d’œil dans la cour, et il y vit une dizaine d’hommes. Ceux-là, il les reconnut pour la plupart : c’étaient les spadassins, les ordinaires du maréchal d’Ancre, et, parmi eux, Concini lui-même !
Capestang, de ce regard de terrible clairvoyance que les hommes très braves ont au moment du suprême danger, embrassa tout le grenier, cherchant un trou, une chatière, une rupture dans les tuiles ou sur le plancher, un passage quelconque, si étroit qu’il fût : rien ! il ne vit rien ! Alors, les forces décuplées, l’esprit bouleversé par une sorte de joie formidable, insensée, qui s’emparait de lui lorsque du fond de son être il entendait sonner la charge des batailles furieuses, en quelques minutes il édifia une barricade devant la lucarne. Derrière la table, une caisse ; derrière la caisse, trois ou quatre escabeaux : derrière les escabeaux de chêne, deux poutres qui se croisèrent et maintinrent solidement l’échafaudage.
Alors, dans sa main gauche, il assura son poignard ; d’un grand geste flamboyant il tira sa longue rapière, la tint un instant élevée au-dessus de sa tête et, les talons joints, comme à la parade, la tête haute, le buste droit, tout raide, l’âme emplie de tumulte, effrayant à voir, d’une voix rauque, il cria :
– Capestang à la rescousse !
Et il franchit la lucarne de la cour, se montra au haut de l’escalier. Une clameur accueillit cette apparition fantastique du chevalier qui, de ses yeux emplis d’éclairs, défiait la meute massée au bas de l’escalier. Concini leva la tête et éclata d’un rire sinistre qui retroussa ses lèvres écumantes.
– Le voici ! le voici ! vociférèrent les spadassins.
– Bonjour messieurs les assassins à gages ! hurla Capestang.
Concini fit un geste. Le silence tomba sur la meute.
– Au nom du roi ! cria Concini d’une voix qu’il s’efforçait de rendre imposante. Au nom du roi, descendez !
– Au nom de moi ! tonna Capestang, au nom de moi, je reste !
– Ton épée ! gronda Concini.
– Dans ton ventre ! rugit Capestang.
– Messieurs, vous êtes témoins qu’il y a rébellion ouverte, les armes à la main !
– À mort ! À mort ! vociférèrent les spadassins.
– La peste ! La fièvre quarte ! La mort pour vous ! répondit Capestang.
– Traître et rebelle ! grinça Concini.
– Couard et félon ! rugit le chevalier.
Ils se défiaient, s’insultaient du geste, du regard, de l’attitude, de la voix. Concini écumait. Les spadassins trépignaient d’impatience. Capestang était une insulte vivante. Au haut de son escalier, les mains crispées à la rampe de bois, penché jusqu’à en tomber, dans cette sorte de gloire dont l’enveloppaient les rayons du soleil levant, il apparaissait farouche, indomptable, et, débridé, livré à lui-même, jugeant inutile toute retenue de gestes puisqu’il fallait mourir, il exagérait encore sa frénétique attitude de matamore qui défie une armée.
– Allez ! dit Concini dans un grognement bref et rauque.
Et il eut le geste du piqueur qui lâche les chiens pour la curée. Les spadassins se ruèrent, non sans ordre, établissant une méthode instinctive de l’assaut, Rinaldo et Pontraille, en tête. Derrière, Bazorges et Louvignac, Chalabre et Montreval venaient ensuite. Puis une dizaine des sacripants qui avaient été embauchés.
– Vivant ! Prenez-le-moi vivant ! tonna Concini.
– Tête-gris ! – Corbleu ! – Mort-Diable ! – Ventre du pape ! – Tripes du diable ! hurlaient les assaillants qui montaient en s’excitant.
Ils montaient, l’œil sanglant, la bouche grande ouverte ; ils montèrent en masse, le long de l’escalier, pareils à une monstrueuse bête hérissée de pointes d’acier. Ramassé sur lui-même, la pointe en avant, rugissant, le chevalier les attendait. Brusquement éclata là-haut une rumeur de grognements, de grondements, de cris entrechoqués, de jurons, d’insultes, les assaillants arrivés aux dernières marches se ruaient ! D’en bas, Concini vit le choc et trépignant, oubliant sa recommandation de le prendre vivant hurlait :
– Tue ! Tue ! bravo, Pontraille ! Taïaut, Rinaldo ! Sus, sus ! Louvignac, Bazorges ! Montrez vos crocs, mes braves ! Mille écus d’or à qui m’apporte sa carcasse ! Oh ! ah ! lâches ! lâches !
Que se passait-il ? Il se passait que, parvenus à l’endroit le plus resserré de l’escalier, les assaillants avaient voulu foncer tous à la fois ! Il se passait que Capestang, avec son immense et fulgurante rapière, coup sur coup avait fourragé dans ce tas de chair humaine ! Que le sang giclait, en même temps que des hurlements plus féroces ! Que trois des premiers étaient blessés et voulaient se retirer de la bagarre, et que, dans leur descente éperdue, ils entraînaient tout le reste jusqu’au palier de l’étage !
– Lâches ! Couards ! rugissait Concini. En avant ! Sus ! Sus !
Rinaldo, entraîné par les autres, avait dégringolé lui aussi jusqu’au palier. Mais c’était un brave que Rinaldo. Il n’avait pas peur d’une bonne saignée, dût la mort s’ensuivre. Et puis il était vraiment dévoué à son maître. Et puis, il haïssait Capestang de toutes ses forces. Il se pencha une seconde et cria d’une voix presque paisible :
– Patience, monseigneur, je vous l’apporte !
En même temps, il leva les yeux, et ce qu’il vit le fit frémir d’une joie formidable. Capestang n’avait plus d’épée !
* * *
Capestang, à la seconde où les assaillants montaient à l’assaut les dernières marches, en avait descendu deux ; son bras se détendit ; la rapière troua une poitrine ; cinq ou six fois, du même geste furieux et calme, si ces deux expressions peuvent traduire ce qu’il y avait à la fois de méthodique et de frénétique dans sa défense, il plongea ainsi son épée... et tout à coup, à ce moment même où se produisait la reculade éperdue, il s’aperçut qu’il n’avait plus rien dans la main qu’un misérable tronçon : Rinaldo, d’un coup terrible, venait de lui briser sa rapière.
Une seconde, Capestang se vit perdu. Il eut un soupir de rage et de désespoir. Dans cet instant, il entendit la clameur des assaillants :
– Il est désarmé ! En avant ! Sus ! Sus ! Tue ! Tue !
Dans ce même instant, il les vit monter comme une bande de loups. C’était la fin !
Capestang se retourna vers le grenier avec ce mouvement du condamné qui, à la minute fatale, regarde autour de lui comme pour demander secours aux puissances surnaturelles. Et il tressaillit. Et un rire formidable éclata sur ses lèvres violentes... D’un geste prompt comme la foudre, il baissa et ramassa quelque chose qu’il venait de voir, là, à l’entrée du grenier, contre la lucarne ! Les assaillants se ruaient. On entendit ce cri furieux :
– Rinaldo à la rescousse !
Et à ce cri, répondit un rugissement de Capestang :
– Henri IV à la rescousse !
Et alors, Concini dans la cour, les passants accourus, les cinq cents Parisiens qui s’étaient entassés aux abords de l’auberge pour assister à la capture du truand, tout ce monde put voir une chose prodigieuse, et fabuleuse comme un épisode ressuscité des antiques prouesses des demi-dieux :
En haut de son escalier, Capestang, sans épée, sans poignard (il l’avait jeté), Capestang, à toute volée, assommait, frappait à coups retentissants comme des coups de gong, il frappait, il assommait les assaillants avec quelque chose d’énorme, une sorte de grande plaque en fer ! et c’était l’enseigne de l’auberge, déposée là par Lureau quand il l’avait décrochée ! et c’était l’image du Grand Henri, c’était Henri IV qui écrasait des crânes, défonçait des poitrines, se levait, retombait, bousculait en tempête, et finalement repoussait les assaillants éperdus, fous, qui se laissaient dégringoler en grappe jusqu’au bas de l’escalier !
Alors Capestang, à bras tendus, souleva l’enseigne, la montra à tout ce peuple qui croyait assister à la lutte d’un titan et, d’une voix tonnante, cria :
– Vive Henri quatrième ! Vive le grand Henri !
La foule, trépignante, délirante d’enthousiasme, se découvrit, jeta en l’air chapeaux, bonnets et toques, et vociféra dans une immense clameur :
– Vive le grand Henri !
Concini s’arrachait les cheveux. Rinaldo bandait sa tête. Pentraille, Chalabre, dix autres pansaient leurs blessures et, là-haut, Capestang, dans son attitude exaspérée, le matamore, le capitan hurlait à tue-tête :
– Henri IV et Capestang à la rescousse ! Vive le grand Henri !
À ce moment où Concini, affolé, blêmissait non plus seulement de fureur, mais d’épouvante, la multitude massée dans la rue de Vaugirard se mit à fuir, éperdue, avec des cris de miséricorde, s’émietta, se fondit, se dispersa comme ces monstrueuses vagues qui se brisent sur le rivage.
– Sus ! sus ! À la rescousse ! rugirent les gens de Concini en se précipitant au-dehors.
De la rue de Tournon, trente ou quarante reîtres à cheval sortis de l’hôtel d’Ancre, débouchaient au galop, frappant, renversant, culbutant tout sur leur passage, balayant la rue emplie de tumulte ; pendant une minute, ce fut une clameur terrible, une fuite furieuse, par les ruelles, par les champs et les jardins, puis brusquement, reîtres et spadassins se retrouvèrent autour de l’auberge.
– À l’assaut ! En avant ! vociféra Concini en montrant l’escalier.
Capestang, voyant ce renfort qui arrivait, ces reîtres qui se joignaient aux ordinaires, voyant, dis-je, qu’il tenait tête à cent hommes armés en batailles, eut un frémissement d’orgueil, et, se rejetant à l’intérieur du grenier, commença à barricader la lucarne ! Il voulait un siège fabuleux. Il voulait une mort dont il serait parlé dans les fastes héroïques, et, souple, furieux, frénétique, il entassait au hasard tout ce qui lui tombait sous la main. Et quand ce fut fini, il essuya son front ruisselant de sueur, se croisa les bras, et cria :
– Allons, venez-y, mes agneaux ! À la rescousse ! Mais prenez garde, vous n’êtes que cent !
Comme il parlait ainsi, il fut frappé de l’étrange silence qui régnait au-dehors. Non seulement l’ordre de Concini n’était pas exécuté, non seulement personne ne montait à l’assaut, mais on eût dit que reîtres et spadassins, tous étaient partis ! Alors, l’angoisse le saisit. Ce silence qui trouait tout à coup le tumulte enragé lui apparut comme un abîme.
– Ils se concertent, rêva-t-il, ils méditent, mais quoi ? Oh ! ajouta-t-il soudain, les yeux arrondis par l’effroi.
D’un coin obscur du grenier, il venait de voir un peu de fumée ! Capestang demeura immobile, une minute, doutant, voulant douter encore, la petite fumée blanche qui rampait en volutes au ras du plancher monta soudain, ses spirales passèrent du blanc au noir, une seconde encore, et la fumée acre, violente, se mit à tourbillonner, puis il y eut des craquements, des sifflements, des crépitements, puis, de ce coin où cela avait commencé, fusa un jet de flammes, l’auberge était en feu ! Ils n’étaient pas partis ! ils avaient entassé des fagots, des fascines, Ils l’enfumaient comme un renard et, vaincus, ils appelaient l’incendie à leur secours !
– Lâches ! Lâches ! hurla Capestang qui tout autour de lui, jetait des regards égarés, cherchant une arme, un morceau de fer, n’importe quoi.
Et il ne trouvait rien ! Il n’avait que son tronçon de rapière. Les flammes sifflaient, hurlaient, se tordaient autour de lui. Au-dehors, les vociférations, les insultes, les clameurs de joie furieuse, les intraduisibles invectives se croisaient, éclataient, se mêlaient aux sifflements de l’incendie, et cela formait une rumeur étrange. Dans la cour, dans la rue, spadassins, reîtres, le nez en l’air, les poings tendus, les faces convulsées, défiaient Capestang. Tout à coup, il apparut au haut de l’escalier, qu’il se mit à descendre en se secouant, son tronçon de rapière d’une main, son poignard de l’autre, pareil à un fauve qui sort de son antre en montrant ses griffes puissantes.
Il y eut dans la bande un recul instinctif, car l’homme résolu à mourir dégage on ne sait quel magnétisme de force et d’audace ; puis, brusquement, une clameur forcenée, puis, dans la seconde qui suivit, un silence effroyable de gens rués, les dents serrées. Et, en mettant le pied sur le sol de la cour, Capestang, l’âme hors des gonds, la pensée emportée par la tempête, vit ces faces décomposées, ces regards rouges, ces bouches convulsées, ces bras levés, ces épées qui luisaient ; il frappa, à coups redoublés, à coups frénétiques, au hasard ; il frappa ; du sang, autour de lui, sur lui, jaillit, gicla ; il frappait, il ne sentait plus rien, sa chair labourée de coups ne souffrait pas, il était en lambeaux, il était plein de sang.
Tout à coup, il tomba.
Ils étaient une dizaine sur lui qui le liaient, le garrottaient. Il fut jeté tout pantelant au travers d’un cheval...
– Emportez-le à l’hôtel ! grogna Concini d’un grognement bref, rauque, à peine compréhensible.
Et, tandis qu’on l’emportait ainsi, solidement lié, entouré d’une trentaine de reîtres, Concini et ceux de sa bande, se voyant tous couverts de sang, voyant les morts, les blessés, l’incendie qui hurlait, se regardèrent, livides, haletants, hagards, comme s’ils eussent emporté une ville d’assaut et combattu une armée !
XXXVI
Catachrèsis !
Cogolin, la veille, avait suivi son maître dans cette fabuleuse marche à travers Paris soulevé ; il avait assisté à cette chose inouïe : Capestang traînant jusqu’au Louvre le chef de l’émeute, le prince de Condé qui eût dû être le maître et qui se trouvait prisonnier.
– Le moins qui puisse arriver à M. le chevalier, ruminait-il, c’est d’être jeté à l’eau, ou peut-être pendu à quelque enseigne. Et si l’on pend ou si l’on noie mon maître, que me fera-t-on à moi ? On m’écorchera, peut-être ! Ah ! pauvre Cogolin.
Nous devons ajouter à l’honneur de Cogolin que, bien qu’il se crût perdu, il emboîtait le pas et surveillait les moindres gestes du prince prisonnier. La traversée du Pont-Neuf, les bourgeois en armes, les clameurs, ces vastes bouillonnements de foules à travers lesquelles il se sentait emporté comme une paille, l’arrivée au Louvre, l’entrée de Capestang et du prince de Condé, toutes ces visions se succédèrent comme autant de rêves fantastiques. Et lorsque Cogolin vit que non seulement le chevalier avait passé sain et sauf, mais encore qu’il avait entraîné le prince dans le Louvre, il demeura ébahi, les yeux écarquillés, et murmura : « Corbacque ! »
Lorsque Cogolin se permettait le même juron que le chevalier, c’est qu’il était hors de ses esprits. Combien de temps demeura-t-il là, partagé entre la stupeur de se voir encore vivant et l’admiration que lui inspirait son maître, il ne s’en rendit pas compte. Lorsqu’il regarda autour de lui, il vit que la situation avait étrangement changé.
Le mot trahison courait de bouche en bouche. Le tumulte s’apaisait. Une inquiétude pesait sur les groupes nombreux qui voulaient espérer encore. Cette inquiétude se changea en terreur lorsqu’on vit sortir une compagnie de mousquetaires et une autre d’arquebusiers qui tenaient allumées les mèches de leurs arquebuses. Et lorsque le vieux maréchal d’Ornano apparut criant que le prince s’était soumis au roi et que les compagnies allaient faire feu sur les rebelles, les bourgeois s’enfuirent jetant leurs pertuisanes pour courir plus vite. Cogolin avait détalé comme les autres. Lorsqu’il s’arrêta tout essoufflé, il se campa comme il avait vu faire son maître, et dit :
– Corbacque, nous avons remporté la victoire !
S’étant essuyé le front, il réfléchit que sans aucun doute le chevalier passerait la nuit au Louvre. Un instant, il songea à aller se présenter au guichet de la grande porte. Il dirait simplement :
– C’est moi, Cogolin, l’écuyer du chevalier de Capestang.
Mais au bout de quelques pas qu’il avait commencés dans la direction du Louvre, un doute lui vint sur l’accueil qui lui serait fait et la célébrité de son nom. Alors il résolut de glorifier à lui tout seul la grande victoire. S’étant fouillé, il se rappela que, pour le moment, le chevalier était détenteur de la bourse, mais il vit qu’il se trouvait tout de même en possession de six écus. Cogolin résolut de manger et de boire les six écus jusqu’au demi, persuadé que le lendemain matin il nagerait dans l’opulence, le roi ne pouvant manquer de couvrir d’or celui qui venait de le sauver.
Il jeta un coup d’œil autour de lui, et s’aperçut que sa fuite précipitée l’avait conduit jusqu’aux abords du Temple, dont la tour silencieuse dressait sa sombre masse dans le ciel noir, alors il se dirigea vers le centre de Paris.
En arrivant à l’angle de la rue du Chaume et de la rue des Quatre-Fils, il s’arrêta étonné du spectacle qui le frappait : des gens arrivaient du fond de Paris, par groupes de trois ou quatre, les uns à cheval, les autres à pied, balançant d’une main la petite lanterne en papier qui éclairait leur route. Tous ces nocturnes promeneurs s’engouffraient sous la grande porte d’un vaste hôtel que Cogolin, en homme qui connaissait à fond son Paris, nomma sur-le-champ :
– L’hôtel de Guise ! fit-il entre ses dents. Or çà, est-ce qu’il y a ballet chez M. le duc, et tous ces gens viennent-ils donc y danser en l’honneur du triomphe de Sa Majesté ? Hum ! Voici des danseurs bien étranges, avec leurs mines mystérieuses, et ces crosses de pistolets que j’ai entrevues. Que diable se passe-t-il ce soir dans l’hôtel de Guise ?
– Au large ! gronda près de lui une voix.
Cogolin vit s’agiter une ombre, entendit le cliquetis d’une arme et, recourant une fois de plus à ses longues jambes s’empressa de mettre une respectable distance entre lui et ceux qui faisaient si bonne garde autour de l’hôtel. Il parvint ainsi jusqu’à une certaine ruelle mal famée, appelée rue des Singes, nous ignorons pourquoi. Cette rue des Singes était un vrai cloaque, tant au moral qu’au physique. À droite et à gauche, une douzaine de maisons, de masures. Chaque rez-de-chaussée était un cabaret, chaque cabaret portait son enseigne, et toutes les enseignes s’enchevêtraient, se heurtaient et grinçaient au moindre souffle de vent.
Cogolin était affamé. Cogolin était assoiffé. Mais Cogolin était chaste... et même pudibond à ses heures. Il s’assit donc à une table où il se fit servir deux bouteilles de vin d’Anjou, du lard grillé, du jambon avec des œufs et autres choses épicées, mais il repoussa modestement la ribaude fanée, dépoitraillée, échevelée, qui émit la prétention de s’asseoir sur ses genoux.
Cogolin se mit donc à manger et à vider force gobelets en l’honneur de la victoire et de la fortune de Capestang ; tant et si bien qu’à la troisième bouteille il ne fut nullement surpris de voir installée sur ses genoux la ribaude tenace qu’il avait écartée d’un geste plein de dignité. Bref, Cogolin se vautra dans l’orgie ; il roula dans l’ivresse et l’abjection ; il fut un ivrogne fieffé : il fut un paillard sans retenue. Cette débauche qui avait pour but de célébrer la gloire du chevalier son maître, dura une partie de la nuit.
Cogolin se vautra donc dans sa turpitude jusqu’au moment où il s’aperçut que la ribaude venait de s’éclipser tout à la douce et sans prendre congé de lui ; en même temps l’hôtesse appuyait ses deux poings sur la table et le regardait fixement du haut en bas.
– À boire ! dit Cogolin.
– Payez d’abord ce que vous avez bu et mangé jusqu’ici, car, Dieu merci ! vous ne vous privez de rien. Cela fait cinq écus tout juste.
Cogolin sourit. Il se rappelait parfaitement qu’il avait six écus. Il lui restait donc un écu à transformer en victuailles et en boissons.
– À boire ! répéta-t-il d’un ton suffisant. On a de quoi, je pense ! Avec six écus, on peut en payer cinq, j’espère ! Du vin, et du chenu, un peu !
– Payez d’abord, dit l’hôtesse.
L’hôtesse était parfaitement payée. En effet, Cogolin avait mangé et bu pour trois écus environ. Et elle venait d’en recevoir quatre de la ribaude qui, ayant subtilisé ses six écus à l’infortuné Cogolin, se contentait de deux pour sa part. Cette coquine donc n’avait eu d’autre but que de s’assurer si son client n’avait pas quelque autre magot.
Mais Cogolin eut beau se fouiller, il ne trouva ni nouveau magot, ni les six écus. Il demeura atterré et leva vers la matrone, qui déjà posait ses deux poings sur ses hanches, geste préliminaire d’une bordée d’invectives, un visage navré, un regard voilé par les larmes du désespoir et du vin.
– Je n’ai plus rien, bégaya-t-il ; je ne sais comment la chose se fit, mais...
Cogolin n’eut pas le temps d’achever...
– Fripon ! Bélître ! rugit l’hôtesse. Tireur de laine ! Pendard ! Ah ! tu bois et tu ne payes pas ! Ah ! peste qui t’étouffe ! Fièvre qui te mange ! Ah ! ribaud, sacripant, mauvais garçon, ladre-vert, paillard fourbe, parpaillot !
Sous cette grêle d’injures, Cogolin eût gardé le calme qui convient à la vertu calomniée si elle n’eût été accompagnée d’une autre grêle beaucoup plus frappante : coups de poing, coups de pied, coups de bâton, de l’hôtesse, de son mari, du garçon, accourus aux cris ; vociférations, tumulte, gémissements, et finalement Cogolin arraché de son banc, poussé, repoussé, houspillé, fut jeté dehors d’une dernière bourrade, et alla rouler dans le ruisseau, tout meurtri, tout confus, tout saignant et poussant des plaintes lamentables.
Ayant gémi tout son soûl, et sans que personne s’avisât de venir le secourir, Cogolin, voyant qu’il ne gagnait rien à crier « Au feu ! » et « Au meurtre ! » se releva, se tâta, constata qu’il n’avait rien de cassé ; puis, tout étourdi du vin qu’il avait bu, de la rossée qu’il avait reçue, et de l’étonnement que lui causait l’inconcevable disparition de ses six écus, clopin-clopant, il se mit en route.
Il se dirigeait vers l’auberge de la rue de Vaugirard, non dans l’espoir d’y retrouver le chevalier, mais dans la pensée de se reposer dans le grenier et d’y cuver à son aise vin, rossée et le reste.
Le jour commençait à poindre lorsqu’un coup violent sur le nez étendit le malheureux Cogolin tout de son long sur la chaussée de Vaugirard, où il était parvenu tout en monologuant. Il entendit des vociférations furieuses. Il sentit sur son dos le pied d’une foule de gens qui, en courant, lui marchaient dessus. Affolé, ahuri, contus, moulu, éperdu, Cogolin parvint à se traîner dans un coin, et, redressant sa tête en gémissant, il demeura tout à coup stupide d’effarement devant ce qu’il voyait. Il se trouvait devant l’auberge du Grand Henri, son auberge ! Des gens armés la cernaient ! La cour était pleine de gentilshommes, l’épée à la main.
– Quoi ! grogna Cogolin, c’est moi qui ai loué ce logis ! Oh ! que veut cette face de carême que je reconnais ?
Cogolin se dégrisait. La face de carême, c’était quelqu’un qui venait de s’approcher de Concini et lui disait quelques mots, c’était Laffemas. Comme en rêve, Cogolin vit Laffemas s’élancer vers un hangar, et en sortir avec des fascines auxquelles il mettait le feu.
– Bravo, monsieur Laffemas ! hurla Concini.
– Laffemas ! gronda Cogolin. Laffemas ! mon sacripant de l’hôtel d’Angoulême ! Et pourquoi met-il le feu à mon auberge ? Je me plaindrai à M. le chevalier ! Oh ! le chevalier ! là ! il descend l’escalier ! miséricorde !
Cogolin fit un effort pour se lever et parvint à se mettre sur ses genoux. Et, pétrifié, horrifié, les yeux agrandis par l’épouvante il assista au dernier et rapide épisode de la prise de Capestang, il le vit succomber, il vit qu’on le jetait sur un cheval et, tout sanglotant, se mettant à suivre de loin la bande triomphante, il vit que tous ces gens qui entouraient son maître s’engouffraient dans l’hôtel Concini !
– Mon pauvre maître est perdu ! Mon pauvre chevalier est mort !
* * *
Un mois environ s’était écoulé depuis l’incendie du Grand Henri, depuis cette matinée où le chevalier de Capestang fut emporté dans l’hôtel Concini comme dans un antre formidable d’où il avait toutes les chances possibles de ne pas sortir vivant – si toutefois il vivait encore au moment où il franchit le portail, attaché en travers d’un cheval.
Au jour où nous nous reportons maintenant, il pleuvait une de ces petites pluies entêtées qui semblent n’avoir aucun motif de s’arrêter jamais.
Un homme s’en allait le long de la rue de la Juiverie, serrant les épaules, se glissant sous les auvents des boutiques pour éviter l’eau qui s’égouttait des toits. Cet homme devait être remarquable, puisqu’on le remarquait et que les passants se retournaient pour le suivre un moment du regard. Sa jambe droite était ornée d’une botte encore munie de son éperon de fer. Le pied gauche n’était chaussé que d’une simple sandale de moine. Sur une sorte de justaucorps, dont la primitive couleur écarlate s’était transformée en lie-de-vin, il portait un manteau troué, reprisé, effrangé, rapiécé de jaune sur vert. Enfin, le chef de cet homme était accommodé d’une perruque filasse, ou du moins de quelque chose qui avait la prétention de figurer une perruque et qui n’était qu’un amas de chanvre informe. C’était Cogolin !
Mais en quel triste état ! Comme il était maigre, efflanqué, minable et misérable ! Ayant perdu sa perruque dans la bagarre de la ruelle aux Singes, Cogolin s’en était fait une lui-même avec des morceaux de cordes qu’il avait démêlées et peignées tant bien que mal. Son nez pointu s’allongeait et ses yeux louchaient terriblement lorsqu’il passait devant quelque rôtisserie.
Comme il s’avançait, lugubre, le nez sur la poitrine, crotté, trempé, ruisselant, ne songeant même plus à se garantir sous les auvents, tout à coup il donna de la tête dans le dos d’un bourgeois arrêté.
– La peste étouffe le maraud ! grommela le bourgeois.
– Excusez-moi, monsieur, je ne voyais pas, balbutia Cogolin.
– Vous ne voyez pas qu’on ne peut pas passer ! Il y a pourtant assez de monde dans la rue ! Où diable mettez-vous vos yeux ? Dans votre poche, peut-être ?
Mais déjà Cogolin n’écoutait plus. Et ces yeux qu’on lui reprochait de mettre dans sa poche, il les ouvrait tout grands, tout arrondis de surprise, et les fixait avec stupeur sur quelque chose qui devait lui sembler extraordinaire.
– Ah ! ah ! murmura Cogolin. Qu’est-ce que cela veut dire ?
Il y avait encombrement dans la rue. Plusieurs carrosses stationnaient sur le côté gauche, tandis que le reste de la chaussée était occupé par une foule de badauds, le nez en l’air. Or, sur le côté droit de la rue, devant une boutique spacieuse, des tréteaux avaient été élevés. Sur ces tréteaux, il y avait deux hommes qui se démenaient, gesticulaient et parlaient à la foule qui, à chaque instant, éclatait de rire. Sur cette estrade se dressaient trois tableaux : l’un, au centre, immense ; les deux autres, de plus modeste proportion, le flanquaient à droite et à gauche.
Le tableau de gauche représentait une dame en vêtements de cour ; cette dame était entièrement chauve ; au-dessous, une pancarte portait ce simple mot : avant ! Le tableau de droite figurait la même dame, avec le même costume, mais pourvue d’une chevelure qui lui tombait aux talons ; la pancarte, dans sa simple éloquence, disait : après !
Cogolin porta son regard d’Avant à Après, du tableau de gauche au tableau de droite, de la dame chauve à la dame chevelue. Puis, ces yeux écarquillés par l’effarement, il les ramena sur le grand tableau central, et tressaillit jusqu’aux fibres les plus insensibles de sa longue personne. En effet, cette peinture violemment enluminée représentait une sorte de déesse ou de magicienne. Et au-dessus de cette fée, ou de cette nymphe qui souriait en présentant du bout de ses doigts un pot à onguent, s’étalaient en lettres énormes ces mots qui firent béer Cogolin de stupeur et le firent frissonner d’un vague espoir :
À l’illustre Catachrèsis
– Catachrèsis !... rugit en lui-même Cogolin. Par la sambleu ! Par la corbleu !... Catachrèsis ! Je ne rêve pas ! J’y vois clair ! Cornes de Satan ! C’est bien Catachrèsis ! Je me pincerais bien pour voir si je suis éveillé, mais je ne peux pas, je n’ai plus que des os et un peu de peau dessus.
Son regard émerveillé, alors, descendit précipitamment de l’illustre et souriante Catachrèsis aux deux hommes qui paradaient sur les tréteaux. Et il faillit s’affaiblir de joie, il eut un grondement de stupéfaction, sa bouche se fendit jusqu’aux oreilles en un rire de bonheur, ses yeux pleurèrent !
– Lureau ! fit-il d’une voix étranglée. Maître Lureau !
L’un de ces deux hommes, en effet, n’était autre que Lureau, l’ex-patron de l’ancienne auberge du Grand Henri. Lureau vendait à l’enseigne de la Catachrèsis l’onguent que Cogolin, pour lui arracher quelques pistoles et quelques poulets accompagnés de jambons et de pâtés, lui avait affirmé être souverain pour la repousse des cheveux ! Lureau berné faisait fortune en bernant à son tour le peuple de Paris ! Lureau possédait la boutique la plus achalandée de la rue Saint-Martin ! Lureau, le crâne orné d’une magnifique perruque qu’il jurait naturelle, débitait sans trêve ni relâche de petits pots emplis de graisse de bœuf mélangée de suie ! Gentilshommes, bourgeois, artisans se pressaient devant la boutique !
Cogolin trépignait d’enthousiasme. À ce moment, quelqu’un le toucha à l’épaule. Il se retourna et se vit près d’un carrosse de bonne mine au fond duquel était assise une jeune femme d’une éclatante beauté qui semblait examiner maître Lureau avec un étrange intérêt.
– Tiens ! pensa Cogolin, la jolie dame qui, aux Trois Monarques, m’a donné neuf pistoles et qui vint faire visite à mon pauvre chevalier, à l’auberge du Grand Henri.
C’était en effet Marion Delorme. Que voulait-elle donc ? Marion Delorme avait-elle reconnu sous les oripeaux du charlatan l’aubergiste du Grand Henri ? Voulait-elle essayer de savoir, en interrogeant cet homme, ce qu’était devenu le chevalier de Capestang ? Peut-être. En tout cas, ce n’était pas elle qui avait touché Cogolin à l’épaule ; c’était un laquais galonné, chamarré, majestueux, qui, juché derrière le carrosse, s’était penché, et lui disait :
– Je ne me trompe pas ; c’est bien monsieur Cogolin que je vois ici ?
Cogolin reconnut aussitôt la face rubiconde et vermeille ainsi que le ventre monumental du valet de Cinq-Mars.
– Monsieur de Lanterne ! s’écria-t-il en s’inclinant humblement. (C’est le ciel qui me l’envoie !)
Lanterne rougit un peu, mais il sourit. Cogolin vit ce sourire et en inféra habilement que si Lanterne n’avait pas oublié tout à fait la leçon du renard au corbeau, sa vanité recherchait encore les délices de l’encens dont elle s’était enivrée avant cette leçon. Mais Lanterne voulait aussi une vengeance.
– Eh quoi ! fit-il, la figure bouffie de dédain, vous êtes à pied, monsieur Cogolin ?
– Hélas, oui, monsieur de Lanterne, je suis forcé d’aller pedetentin, comme disait mon patron le pédagogue, tandis que vous, peste, il vous faut un carrosse !
– Eh quoi ! reprit Lanterne avec une cruelle insistance, est-ce vous que je vois en si triste équipage, vêtu de guenilles comme un mendiant de la foire Saint-Laurent, et si maigre, si maigre...
– Qu’on vous verrait au travers de mon corps tant vous reluisez !
– Oui ! Et avec un pied chaussé d’une botte et l’autre d’une sandale !
– C’est que j’hésite si je dois entrer en religion ou si je dois me faire soldat !
– Et avec un manteau plein de trous...
– Au travers desquels passent le vent, la misère et la pluie, tandis que vous portez une livrée de bon drap toute couturée de galons, si bien qu’on me prendrait pour une pauvre lune à demi rongée et vous pour le soleil.
– Oui ! Et d’où vient une si affreuse misère, monsieur Cogolin ?
– Je vais vous le dire, monsieur de Lanterne. J’ai dans mon logis sept équipements complets, tout neufs, et, Dieu merci, bien pourvus de galons, j’ai sept chapeaux, j’ai sept paires de bottes...
– Ah ! Ah ! fit Lanterne en écarquillant les yeux. Et pourquoi sept ?
– Un pour chaque jour de la semaine, vous comprenez ? Mais j’ai fait vœu de me promener tel que vous me voyez pendant septante jours, en signe de deuil.
– Oh ! oh ! Et de qui portez-vous le deuil, monsieur Cogolin ? De votre mère, peut-être ?
– Hélas ! fit Cogolin, qui ne put retenir une grimace de douleur sincère, j’ai perdu celui qui me servait de père, de frère, de cousin, d’ami, celui qui était tout pour moi et sans qui je ne puis plus rien, j’ai perdu mon pauvre maître !
– Quoi ! M. le chevalier de Capestang ?
– M. de Capestang est mort voici tantôt un mois, fit Cogolin d’une voix lugubre.
Lanterne allait se récrier. Mais à ce moment, une main fine et gantée de soie saisit Cogolin par le bras, et Marion Delorme apparut à la portière du carrosse. Son beau visage était bouleversé. Elle était affreusement pâle et tremblait convulsivement.
– Que dites-vous ! bégaya-t-elle. Qu’avez-vous dit ! Que le chevalier de Capestang est mort !
– C’est-à-dire, madame... je n’en suis pas sûr ! dit Cogolin, le cœur tout remué par cette douleur de cette si jolie femme. Je disais seulement que j’ai perdu mon pauvre maître...
– Il est mort ! balbutia Marion d’un accent de désespoir. Je le vois bien ! Tu pleures ! Mort ! Mort !
Et Marion se rejetant dans le carrosse éclata en sanglots.
– Madame, affirma énergiquement Cogolin, je vous jure que je n’en suis pas sûr !
– Alors, pourquoi pleures-tu ? Mais parle donc ! Qu’est-il arrivé. Tiens, prends cette bourse, et ne me cache rien !
Cogolin, qui n’avait pas mangé depuis la veille, dont les dents claquaient de misère, dont le maigre corps grelottait sous la pluie, Cogolin eut un geste sublime. Il prit la bourse, et la laissa retomber sur les coussins de la voiture :
– Il ne sera pas dit, madame, que j’aurai exploité ma douleur et la vôtre, et que j’aurai fait argent du malheur survenu à mon maître M. Trémazenc de Capestang.
– Ah ! murmura Marion saisie, on voit bien de qui vous avez reçu les leçons, mais parlez, je vous en supplie, et n’omettez aucun détail, il faut que je sache tout.
Cogolin fit un récit rapide, mais fidèle, de tout ce qu’il avait vu : l’auberge cernée par les gens de Concini, l’incendie allumé par Laffemas, la lutte suprême, le corps tout meurtri du malheureux jeune homme jeté en travers d’un cheval et porté à l’hôtel Concini. Marion Delorme avait écouté avec une attention passionnée, les yeux agrandis par l’épouvante. À peine Cogolin eut-il terminé qu’elle se pencha et cria au cocher :
– Vite ! Touche à l’hôtel !
Le carrosse fit demi-tour, s’élança et s’arrêta devant l’hôtel du marquis de Cinq-Mars. Marion Delorme courut à sa chambre. Ce qu’elle ferait, ce qu’elle voulait, elle ne le savait pas. Ce qu’elle faisait en ce moment, elle le savait à peine. Elle vivait une de ces minutes terribles qui laissent leur empreinte sur toute une existence. Elle pleurait à grosses larmes, sans se soucier de les essuyer ou de les cacher à la soubrette qui tournait autour d’elle. Elle s’assit, et, fiévreusement traça ces quelques mots :
Je vous ai loyalement prévenu que peut-être, parfois, mon caprice m’entraînerait à prendre quelques heures de liberté. Je vous quitte, cher ami, pour un jour, peut-être, ou peut-être pour bien longtemps. Quoi qu’il arrive, soyez en repos ; je vous jure que, quant à la fidélité, vous n’aurez aucun reproche à me faire. Ne cherchez pas à savoir où je suis ni ce que j’entreprends, et tenez seulement pour assuré que, près ou loin de vous, Marion est assez fière pour respecter ses engagements. Adieu, mon très cher, à bientôt sans doute, ou peut-être à jamais.
Elle cacheta, appela Lanterne, et lui tendit la lettre :
– Pour M. de Cinq-Mars quand il rentrera. Maintenant, souviens-toi bien de ceci, maître Lanterne : si tu touches un mot de la rencontre que nous avons faite rue Saint-Martin, je te fais chasser. Si tu dis que tu m’as vue pleurer, je te fais bâtonner. Si tu essaies de me suivre, de m’espionner, je te fais poignarder. Va, maintenant !
Lanterne, la face décomposée par la terreur, saisit la lettre en allongeant le bras, de loin, et, malgré son ventre, disparut avec la rapidité d’un daim poursuivi. Pendant ce temps, Marion entassait de l’or et des bijoux dans une sacoche qu’elle remit à sa femme de chambre :
– Suis-moi, Annette ! fit-elle en s’élançant.
– Où allons-nous, madame ? demanda la soubrette.
– Pour quelques jours, répondit Marion Delorme, je reprends mon appartement à l’hôtellerie des Trois Monarques... en face de l’hôtel Concini !
* * *
Cependant, Cogolin, après avoir un instant suivi des yeux en hochant la tête, le carrosse qui fuyait, avait poussé un soupir de douleur ou peut-être, nous ne savons pas au juste, de regret pour la bourse qu’il avait refusée, qu’il eût encore refusée, mais qu’il était trop malheureux pour ne pas regretter tout de même un peu. Puis il se tourna vers les tréteaux au moment où Lureau, d’un air grave, saluait :
– Nobles dames et gentilshommes qui m’écoutez. (Frappant de sa baguette le tableau de gauche.) Ceci vous représente la haute et puissante duchesse de Mirliflor, dame espagnole qui accompagnait Sa Majesté la reine lorsqu’elle épousa notre sire Louis treizième que Dieu garde. Comme chacun peut s’en convaincre, cette noble princesse est chauve, ayant perdu ses cheveux à la suite d’une forte émotion. Ceci, donc, vous la représente avant l’emploi de l’onguent merveilleux inventé par l’illustre magicienne Catachrèsis ici présente. Y a-t-il quelqu’un qui puisse contester que cette malheureuse dame est entièrement chauve ? (Signes de dénégation dans la foule.)
« Maintenant, continua Lureau en frappant de sa baguette le tableau de droite, voici la même duchesse de Mirliflor après qu’on lui eut frotté la tête avec l’onguent de la sublime Catachrèsis ! Chacun peut voir et même toucher. Voici la portraiture de la noble dame, et ses cheveux sont si longs, si touffus qu’elle peut s’en envelopper tout entière comme d’un manteau ! (Marques d’admiration nombreuses et formelles.) Mais, direz-vous, toi qui parles, peux-tu nous indiquer le lieu où se trouve cet onguent admirable ? Je réponds : Oui, messieurs ! Ce n’est ni en Chine, ni en Barbarie, ni à Pontoise, ni à Babylone, c’est à Paris ! c’est dans la rue Saint-Martin ! C’est dans cette boutique même que j’ai placée par gratitude et déférence sous l’invocation de l’illustre Catachrèsis ! (Satisfaction unanime de la foule.) Mais, me direz-vous encore, toi qui parles, comment se fait-il que tu aies retrouvé le secret de la fabrication de ce sublime onguent ? Tu es donc bien savant ?
« Messieurs, je suis savant, c’est vrai ! Mais je suis modeste, aussi ! quoi qu’il m’en puisse coûter, je l’avoue, je le proclame : ce n’est pas moi qui ai retrouvé ce secret ! (Attendrissement général devant cette preuve de modestie et de sincérité.) Celui qui a retrouvé ce secret, messieurs, ce dont je bénis chaque jour le nom que je vais révéler (Cogolin dresse ses oreilles), celui enfin à qui l’humanité souffrante est redevable de cette miraculeuse découverte, c’est un illustre savant, un noble vieillard qui fait trois fois le tour du monde, c’est le grand, le saint, le glorieux M. Cogolin ! (Lureau se découvre, long murmure dans la foule ; Cogolin demeure pétrifié, bouche béante, écrasé de stupeur.) Ce secret, continua Lureau en arrêtant d’un geste la musique enragée, ce secret, je l’ai donc acheté deniers comptants à l’illustre Cogolin ; j’y ai engagé toute ma fortune ; s’il était là, il pourrait vous le dire. (Heu, murmure Cogolin, toute sa fortune !) Je l’ai payé cinquante mille écus ! (Rumeur d’admiration.) Mais, me direz-vous encore, toi qui parles, puisque tu as payé cinquante mille écus le secret de Cogolin et de la Catachrèsis, tu sais bien que nous ne sommes pas assez riches pour acheter de cet onguent, qui doit être terriblement cher !
« Oui, messieurs, il est terriblement cher, l’onguent ! Mais rassurez-vous. En conséquence d’un vœu que je fis le jour où les cheveux me repoussèrent sur la tête, je ne vends pas l’onguent de Catachrèsis, je le donne ! (Applaudissements et bravos enthousiastes.) Je le donne ! Chacun peut en prendre autant qu’il en veut ! L’onguent ne coûte rien ! Pas un denier ! Pas un ducaton ! Pas une maille ! Pour ne pas me ruiner complètement, je fais seulement payer le pot qui le contient ! Une livre, une simple livre ! Qui n’a pas une livre pour acheter un pot enveloppé de la prière qu’il faut réciter, portant inscrits en lettres d’or les trois mots magiques, les trois talismans : Parallaxis ! Asclépios ! Catachrèsis ! Entrez ! Entrez dans la boutique de l’illustre Catachrèsis ! C’est pour rien ! Pour rien ! Entrez ! Musique ! »
Flûtes, violes et tambourin attaquèrent aussitôt une marche guerrière, tandis que dix, vingt, cinquante badauds se précipitaient dans la boutique où Mme Lureau débitait les fameux pots d’onguent. Cogolin, abasourdi de ce qu’il venait d’entendre, émerveillé de ce qu’il voyait, Cogolin ahuri, pas bien sûr de ne pas être un illustre savant, Cogolin, l’esprit ballotté par la stupeur, l’admiration, l’espoir de trouver tout au moins un bon dîner, Cogolin fendant la foule s’avança, radieux, la bouche en cœur, vers Lureau.
Lureau l’aperçut soudain ! Et Lureau pâlit ! Lureau fut saisi de terreur et de fureur ! Lureau gronda entre les dents !
– Ah ! tu viens me dénoncer, toi ! Ah ! tu veux m’empêcher de faire fortune, toi ! Attends ! Je vais te montrer de quel bois je me chauffe !