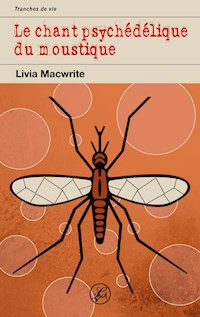
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un cheminement intérieur qui serpente au rythme de l'humeur, examinant un passé et un présent qui s'affrontent, s'observent, se fondent mais se livrent toujours avec sincérité. Une confession intime tapie à la lisière des mots qui vous embarque sans crier gare. Extrait : Quelqu'un m'a dit un jour qu'après trente ans de mariage les mots passion, amour, tendresse, étaient usés. Ne reste plus alors que la résignation. Ce mot-là je n'en veux pas. Je ferai en sorte que les trois autres ne s'usent jamais et qu'ainsi tu ne me vois pas, un jour, résignée.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 77
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Des mots en guise de baume
pour apaiser le sang
et faire fleurir le bois.
Table des matières
Aïe
En(quête)
Dommage
Les mots difficiles
Colère
Peur d’enfant
Le dessin
S’il ne devait en rester qu’un
La réunion
Sagesse ennemie
Bel oiseau
C’est terminé
Il faut épurer
La course
La bonne place
Je ne vous dis pas merci
Le petit-déjeuner
Parents - enfants
Quelle chaleur !
L’écriture
Stop
Tout feu, tout flamme
Trou noir
Le hasard ?
Bientôt Noël
Un monde meilleur
La chasse
Surprise !
Pas envie de crier
Ne parlons plus musique
Poivre et sel
Le bon numéro
Secrets de famille
De l’air
Un peu de lassitude
Bonne soirée !
Ma sœur
Quel vacarme !
Point d’interrogation
Le collier
Méfiance
Touché !
Abri
Intox
Évidence
Plaisir d’été
Soupe à la grimace
Un choix difficile
Ailleurs
Un autre jour
Casse-tête
Reviens
Bas les masques
Le discours bricolé
Drôles de vacances
La chambre
Illusions
Mamie
Instants précieux
Rêve de gloire
Que d’histoires
Et demain ?
Fille de glace
Aïe
La vie est un cadeau. J’ai souvent entendu cette phrase sentencieuse, forcément exprimée avec certitude. Pourtant je ne suis pas sûre de m’en accommoder. Je suis comme un enfant devant un hérisson. Excité et curieux par une si belle trouvaille mais ne sachant pas par quel bout la saisir.
En(quête)
Je me surprends parfois à penser que j’aimerais être un homme...
Un homme fier, franc et sincère. Un homme qui impose le respect et sait se faire comprendre sans avoir à parler. Un regard droit et profond, légèrement teinté de mélancolie. Il saurait s’émouvoir et sourire. Je l’imagine effleuré par le charme des ans, pas vraiment beau mais élégant.
J’aimerais parfois être cet homme-là, mais j’en suis loin. Je suis bien autre chose, que je ne sais pas toujours définir, qui me surprend parfois et me déçoit souvent. Je suis moi, simplement, que j’apprends à connaître tous les jours un peu mieux et qui, insidieusement, a pris sa place et s’est fait accepter. A force de s’observer du coin de l’œil, de se bouder, de se toucher et de se perdre, on a fini, moi et moi, par ne faire qu’un. Un être tout entier qui se débat tant bien que mal pour avancer dans ce monde qui lui est étranger. Mais peu importe ; aujourd’hui, même s’il me manque des réponses, même si j’ai cherché longtemps ce que je pouvais être sans véritablement le découvrir, j’ai au moins une certitude, celle d’avoir quelque chose en moi.
Dommage
Jamais ils ne m’ont dit qu’ils étaient fiers de moi. Chez nous ça ne se disait pas. Les gestes de tendresse, les baisers, les caresses - ces prétendus signes de faiblesse - c’était bon pour le chien. Lui on l’aimait bien, il ne dérangeait pas. Tout ça c’était normal. On ne pense pas faire du mal. La famille idéale. Enfants bien élevés, maison bien rangée, frigo bien rempli. On fait partie de la ronde, c’est comme ça chez tout le monde.
Moi je ne crois pas à tout cela, ou plutôt je n’y crois plus. Je suis sûre que ce n’est pas foutu, on peut faire autrement. Et ce n’est pas qu’une question de génération. On dit avec juste raison qu’il ne faut pas monter sur scène si l’on n’a pas de talent, ne pas chanter l’opéra si l’on a pas de voix. Alors pourquoi faire des enfants si l’on n’a pas le temps de leur remplir le cœur avant qu’ils ne soient grands.
Les mots difficiles
J’avais peur. Peur de paraître faible. Mais on ne peut indéfiniment garder ses sentiments pour soi. Lorsqu’on réalise enfin que l’on peut tout dire à ceux que l’on aime, il est souvent trop tard. Les paroles que l’on aurait souhaité partager avec eux, ils ne sont plus là pour les entendre. Ne reste alors que le regret de ne pas s’être exprimé à temps.
Aussi, maintenant, fini les faux-fuyants.
Je vous dédie ces mots, à vous qui tous les jours écrivez mon histoire, forcez mon respect ; vous qui avez croisé ma route, soi-disant par hasard et l’avez marquée à jamais. Je me décide enfin à vous offrir ces mots si difficiles à dire : je vous aime.
Colère
Je ne connais pas la colère, la vraie colère, celle qui éclate bruyamment, libère le cœur et le corps. Je ne connais que la rage sourde et malfaisante, tapie au fond de moi, et qui me consume lentement et prenant bien soin d’infester ce qui était encore préservé. Sa manière à elle de proclamer qu’elle est là et ne me lâchera pas de sitôt.
Du fait de sa puissance et de la force brutale qui s’en dégage, il me semble que la colère est masculine. Tout au moins celle qu’il me plairait d’éprouver. La colère féminine c’est autre chose, dangereuse, certes, du moins je le crois, mais plus sournoise, cynique et froide. Cette dernière est torrent glacé qui ravine, submerge, ravage tout sur son passage ; l’autre est volcan, explosion brûlante, dévorante, consumant la terre elle-même pour la faire sienne.
Je crois utile, parfois, de libérer cette force-là comme on crève un abcès trop longtemps enduré. Jouir ensuite de l’apaisement de l’âme.
Aurai-je la force de cracher ma colère ? Ce jour viendra peut-être. Plus tard. Reste la rage.
Peur d’enfant
Je dois avoir une dizaine d’années. Je suis dans ma chambre, allongée à plat ventre sur plancher, l’oreille collée contre. J’écoute. À l’étage au-dessous, mes parents se disputent, comme trop souvent. La tension s’accroît. Je la sens envahir l’espace, le rendre plus étroit. Mon corps est douloureux à force de se tendre, ma tête bourdonne, menace d’éclater. Je ne sais plus si je respire. Mes sens sont focalisés sur le drame qui se déroule en bas. Je voudrais ne plus entendre, fermer les yeux, mais c’est plus fort que moi, je dois savoir. J’écoute encore. Les insultent fusent, on s’époumone à trop gueuler, un objet éclate contre un mur. Et puis, soudain, le silence absolu. Plus terrible encore que les cris. J’écrase ma tête contre le plancher, mais je n’entends rien d’autre que les battements affolés de mon cœur qui martèlent mes tempes. Une peur panique m’envahit, dépose un boulet au creux de mon estomac, paralyse mes muscles et fait germer en moi ce doute horrible : sont-ils encore vivants ? L’idée m’est insupportable, je la repousse, sans réussir à la chasser vraiment. Et toujours ce silence, lourd comme un corps sans vie, pesant sur les minutes qui me paraissent des heures. Que faire ? Descendre ? Pour trouver quoi ! Ne pas bouger ? Attendre là, ravagée par l’angoisse ? Le son étouffé d’une porte que l’on ouvre et referme derrière soi m’arrive enfin. Une délivrance. Quelqu’un vient de sortir de la maison. Je me surprends à penser qu’au moins l’un des deux est vivant.
Mon esprit d’enfant s’en trouve presque soulagé. J’entends aussi de l’eau couler dans la salle de bain. Je fais le point, rassemble les morceaux, recoupe les indices, au bout du compte, tout a l’air d’aller bien.
Je me lève et vais m’asseoir sur mon lit. Je respire lentement, m’oblige à me calmer. Tout à l’heure, ma mère viendra me voir. Elle me dira qu’il n’y a rien de grave, je ne dois pas m’en faire, ce n’était qu’une querelle sans conséquences. Pour eux, sans doute. Je lui dirais que je vais bien, je suis grande maintenant, je peux comprendre, et ferai semblant d’avoir tout oublié. Ce soir, il me faudra dormir. Demain il y a école.
Le dessin
Tu commences d’un trait fin, incertain. Un crayonné léger. Ta main hésite. Puis les choses se précisent sans trop se dévoiler, mais, déjà, tu sais ce que tu vas faire. Le sujet est sans grande importance, prétexte à laisser dériver ton imagination. C’est à ce moment-là que tu te sens le mieux. Là, au creux de ton monde, univers protégé que je ne peux atteindre, où tout est si différent de ce que je connais. Nous sommes assises au centre du wagon, mais le voyage c’est dans ta tête qu’il se fait. Tant de choses sont à explorer que tu t’y perds, parfois.
Ensuite, tu passes à la couleur. Le pinceau glisse sur le papier du carnet de voyage. Le trait s’étire, paresseux, comme le temps qui défile, dans ce train qui nous berce.





























