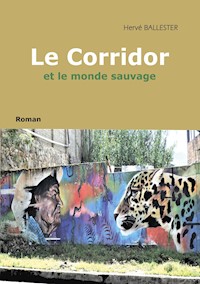
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Henri, narre une anecdote lors d'une journée lointaine passée en compagnie de sa soeur, Sophie. Elle avait raconté son projet de réaliser un long-métrage avec son histoire des hommes et des femmes qui la rongeait, mettant en scène les personnages de Germain, aventurier dans l'âme, puis Amtziri, sociologue et défenseuse des ethnies naturelles. Les deux personnages évoluent vers une situation civilisationnelle inextricable, et, finalement, Sophie fait basculer son histoire dans le plus beau "tableau" coloré et varié de, peut-être, tout l'Univers. Mais qu'adviendra-t-il de Sophie et d'Henri ? Cérémonie hallucinante, jungle fantastique, chaos civilisationnel, oasis perdue sont les toiles de fond entre "corridor" et vie sauvage.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À ma mère
pour toutes mes années passées trop loin.
Au monde sauvage
Aux indigènes encore sauvages
« Je n’écris pas pour dévoiler la vérité.
Simplement, j’ai besoin de dessiner une ouverture
afin qu’une vérité ne soit pas enterrée vivante.
S’il existe un cimetière des mots arrachés aux êtres
qui comprennent, je veux pouvoir m’y promener. »
Élise TURCOTTE (l’apparition du chevreuil, Le mot et le reste 2020)
Table des matières
Pas pessimiste… ni optimiste…
UNE LIGNÉE PARALLÈLE
Germain
Séance avec le Yagé
Germain (2)
Fin de séance du Yagé
Le monde de Konoto
Sa réflexion
L’intelligence
Le monde de Mimi-Kutu
Expérience essentielle
La résolution
Le « corridor »
L’or noir
Une coordination interethnique
UNE PLANÈTE À COMPRENDRE
Le couple d’amis
Les « pourparlers »
L’analyse
L’île paradisiaque
Le forum
LE COUPLE AMOUREUX
La théorie du chaos
L’oasis
Retour à la terre
Tout au bout de l’anthropocène
L’auteur à Deltebre
Réaliste celui qui voit la réalité, sans fard, sans fioritures.
Pas pessimiste… ni optimiste…
Sophie, ma sœur, est réaliste !
Après plus de dix-mille années d’une guerre unilatérale sans fin, la nature contre-attaque son despote, cette fois-ci avec force, et lui impose un repli, un cessez-les-hostilités. C’est à ce moment, où nous étions jeunes adultes dans un monde au bord de l’asphyxie, que Sophie était venue s’isoler avec moi afin de nous tenir compagnie quelques jours. Pour la deuxième fois en trente années, tous les citoyens de la planète avaient reçu l’obligation de s’enfermer entre leurs murs exigus le temps de quelques semaines, question de vie ou de mort ! C’est ainsi que Sophie avait profité de cet étrange coma de toute l’humanité recluse pour exulter, à mes ouïes, de son histoire des hommes et des femmes qui la rongeait.
{— Henri !, tu sais que j’ai écrit quelques courts-métrages. À présent j’aimerais bien poursuivre sur quelque chose de plus consistant : un film ! Et bien, j’ai toute une histoire qui trotte dans ma tête et je veux te la conter ! Assieds-toi donc, et enclenche l’enregistreur… ça pourrait servir ! m’avait-elle sommé.}
UNE LIGNÉE PARALLÈLE
Germain
— Jeune-homme, souhaitez-vous un apéritif avant le déjeuner ?
À la verticale, au-dessus de Germain dans son siège exigu, le visage de l’hôtesse de l’air le sortit de ses songes. Chignon bien arrangé, maquillée de crèmes et de poudres, elle lui servait un sourire séduisant, rouge pourpre.
Germain n’avait jamais pu s’endormir dans les avions. De retour vers l’Europe, à peine passé le décollage, il s’était plongé dans un réseau de pensées et de souvenirs enchevêtrés lui permettant d’interpréter les derniers temps qu’il avait eu plaisir à profiter en pleine nature. Neuf trop courtes années s’étaient déjà écoulées depuis le jour où il avait quitté sa famille, abandonné ses amis et sa terre natale catalane, pour aller s’imprégner du « Nouveau Monde », de la jungle et ses habitants.
{— Sophie, l’avais-je interrompue, qui est donc ce jeune homme aventurier ?}
— Je te décris le personnage. En apparence, Germain est un jeune homme tout à fait banal, taille moyenne, corpulence moyenne, tête ronde, les cheveux raides, le nez aplati et un menton proéminent, avec un caractère sans aucune extravagance et une vision peu enthousiaste de sa vie. Pourtant, dès l’enfance, tout au fond de lui un quelque chose d’insaisissable essayait de l’éveiller à l’inattendu, aux rêves improbables.
L’école ne l’avait jamais enthousiasmé. Il l’avait fréquentée par obligation, contraint à se combattre lui-même chaque matin de chacune des journées scolaires, contraint d’aller chauffer, contre son gré, le banc le plus éloigné du tableau vert. Germain s’était malgré tout montré assidu dans ses études. Un tant soit peu appliqué, il avait sauvé son parcours scolaire par quelques petits diplômes satisfaisants. Cependant, il avait préféré se nourrir d’aventures rocambolesques comme celles de Jules Verne lorsqu’elles le transportaient vers des univers inhabituels ou mystérieux. Ce tout jeune gout pour la vie hors du carcan institutionnel l’avait aussi mené à s’orienter vers d’autres lectures plus réalistes. André Cognat, Jacques Lizot et Géromine Pasteur lui avaient ainsi fait toucher du bout de l’esprit le mode de vie de quelques peuples premiers, naturels. Ces populations à l’écart du monde évolué avaient éveillé sa curiosité. Il les percevait vraies, authentiques. Les nombreuses peuplades en marge du style de vie artificiel attiraient tout particulièrement son attention émotionnelle. Il avait aussi su intégrer la clairvoyance de Claude Levi Strauss à propos de l’état du monde qui, dans « Tristes Tropiques », corroborait justement la vision que Germain se faisait des civilisations, de leurs écoles classiques et des façons de conditionner les populations.
Ce bout de vie à passer les années bêtement assis, en vue de se faire inculquer un enseignement mal orienté, opposé à la logique de ce qu’est une planète vivante et entière, lui avait paru pénible. L’instruction établie ne lui avait pas convenu du tout. Plutôt que de l’enrichir de notions universelles, elle lui avait fait éprouver la désagréable sensation de le diriger droit vers une marionnettisation des individus et vers un vide sidéral intérieur. « Dans les démocraties les individus sont libres » ; Germain ne croyait pas en cette attribution dont il percevait l’envers caché de la belle médaille.
À seize ans, il avait donc préféré des études courtes et techniques qui le mèneraient, avait-il pensé, plus rapidement à son indépendance. Puis, dès sa majorité, il avait enfin pris pied dans une vie active déjà forcenée, dans laquelle un enjeu sécuritaire préconisait d’économiser un pécule pour en arriver à la propriété privée ; avec pour cadeau l’endettement, l’imposition, une complète dépendance au système et à son cercle vicieux, duquel ensuite on ne peut plus échapper. Une année plus tard, ses convictions pacifistes lui avaient fait découvrir, et ressentir, les murs d’une geôle civile. Il y séjourna six douloureux mois parmi la délinquance commune. Son crime : un refus d’obéissance ; il n’avait pas accepté un autre invraisemblable enseignement obligatoire à ce moment-là, celui du service militaire étatique, tout aussi asservisseur.
Les idéaux pacifistes que Germain portait en lui faisaient écho à l’éducation que lui avaient déployée son père et son oncle. Durant ses quelques jeunes années militantes, ils lui avaient prodigué les enseignements familiaux. Ni maître ni dieu, et Liberté, Égalité, Émancipation, avaient été les maîtres-mots.
Les deux frères, alors enfants et déjà en voie de devenir réfugiés de la dictature militaire espagnole, entrainés par leurs parents, avaient fui la violence fasciste ibérique, osant traverser les Pyrénées à pied, de nuit et à l’insu des autorités bilatérales. Une dictature idéologique et religieuse les avait ainsi conduits à passer dans la partie française de la Catalogne. Germain discerna plus tard que cette territorialité culturelle, entière, au moment où elle avait été conquise quelques siècles auparavant, avait été divisée en deux, dans le dos des citoyens concernés, par une frontière convenue entre deux nations impérialistes suite à plusieurs guerres, pour l’intérêt habituel d’élargir leurs pouvoirs et renforcer les profits.
Son grand-père avait participé à la résistance en Espagne. Il avait été un guérillero contre le franquisme. Il avait aussi combattu l’Église parce qu’il était convaincu que la liberté élevait les peuples, et qu’à ce moment-là les dignitaires d’un bien drôle de dieu, soutenant le pouvoir tyrannique illégitime en place, en avait profité pour affirmer eux aussi leur autorité, avec leur religion obligatoire et leurs châtiments.
Le difficile et immérité séjour d’incarcération, résulté de son refus d’accomplir le service militaire, s’était déroulé sous les hostilités du directeur de prison jubilant de son zèle. Face à l’injuste affaire, des médias internationaux pacifistes avaient suscité un élan de soutien sur la planète. Quantité de lettres étaient arrivées sans discontinuer des cinq continents. Les protestations de Germain l’avaient agacé. De nombreuses correspondances internationales soutenant sa rébellion avaient exacerbé l’humeur irritée du directeur.
Par chance, cette captivité n’avait pas été que négative. Une parenthèse positive, inattendue dans ce milieu carcéral, s’était ouverte à Germain. Par un improbable hasard, la prison qui enferme les corps avait malgré tout pu faire évader son esprit en déposant entre ses mains un récit de Thor Heyerdahl. Sur une île au nom rêveur de Fatu Iva, l’auteur aventurier et son épouse avaient voulu expérimenter une vie quelque peu robinsonnienne. L’épopée déclencha alors chez Germain la volonté de prendre un tournant dans sa vie. La narration lui avait fait prendre conscience de ce que devrait être une existence. Non pas un abrutissant train-train quotidien régi par le boulot-métro-dodo et entrecoupé de quelques sottes vacances réparatrices, mais plutôt un voyage personnel au pays de la connaissance : cette école de la vie où l’on peut nourrir et enrichir son intellect par plaisir, de manière autodidacte, pour une meilleure évolution personnelle et une réelle prospérité intérieure.
Des médias dissidents des cinq continents avaient ébruité cette affaire incommodante d’incarcération. À la consternation du directeur, Germain fut extrait des quatre murs avant la fin de sa peine, avec malgré tout l’absurde mention « P4 », soit fou à lier !
Au pied de l’enceinte, ses parents s’étaient étonnés de ne pas le récupérer heureux de sa liberté retrouvée. Luimême s’était questionné à ce propos ; il n’avait pas ressenti le légitime bonheur qui aurait dû le faire sauter de joie, ou du moins ouvrir grand ses bras vers l’immensité de l’air bleu – ce vaste espace où seuls les oiseaux vivent libres, dépourvus de carcans institutionnels et d’artifices contre nature.
Pour autant, de retour dans la vie active, il ne s’était pas senti plus libre. Germain n’arrivait plus à retrouver une sereine joie de vivre. Entre les quatre murs de béton armé, son esprit s’était ouvert et lui avait fait entrevoir la possibilité d’accéder à un monde différent de la quotidienneté établie.
Lors d’un marché dominical de la ville, au milieu d’un amas de bibelots « empucés », il avait un jour trouvé un étonnant petit écriteau de plastique rigide. Depuis, chaque jour, il avait pu s’imprégner de l’inscription « Qu’est-ce que je fais ici ? ». Tous les matins de chacun des jours, posée bien en évidence sur sa table de bureau, cette plaque de couleurs vives lui avait sauté aux yeux. Les grosses lettres rouges imprimées sur un fond jaune vif l’avaient harcelé. Germain, mal dans sa peau, s’était posé cette même question existentielle inéluctable : « Mais qu’est-ce que je fais donc ici ? ».
En quelques mois, l’éloquente inscription lui avait fait prendre conscience de l’évidence. Pour retrouver la joie, il lui faudrait quitter une vie bien trop rangée, trop carrée, trop fermée. Il devrait alors sortir de ce cocon sociétal qui l’engluait pour pouvoir transformer sa vie. Peut-être, aussi, se transformer lui-même comme une repoussante chenille en un merveilleux papillon.
C’est ainsi qu’à l’âge de vingt-trois ans, la quête du bienêtre personnel propulsa Germain dans une autre région du monde. Mais aussi dans un style de vie éloigné de ce qu’il connaissait et de ce qu’on lui avait inculqué.
Peut-être, cet indispensable besoin intérieur était-il provenu d’un héritage familial, inconscient, ancré au plus profond de lui-même ? Il n’avait retenu aucun souvenir de son grand-père, celui du côté maternel. Il était mort – avec la grand-mère – bien trop tôt, pendant un accident domestique, loin de ses trois enfants et de ses petits-enfants, au moment où Germain étrennait à peine sa dixième année de vie. Avide et éternel voyageur, ce grand-père fougueux, tout juste sorti de l’adolescence, avait fui la vie bourgeoise qui l’avait bercé, mais aussi la sale guerre hitlérienne. Il avait par la suite fondé sa famille, et l’avait guidée dans des aventures bohèmes faites de lieux de vie insolites : un ancien bunker ou encore un vétuste autobus, réaménagés pour un petit bout de vie. Il avait parcouru quelques pays d’Europe, d’Afrique du Nord, et coïncidence étrange, une partie de l’Amazonie. C’est en Catalogne du Nord qu’une de ces filles avait alors croisé le chemin du futur père de Germain.
{— Déjà, une jeunesse assez particulière pour Germain, n’est-ce pas Henri ? Voyons ce qu’il se remé-more depuis le départ d’Amérique du sud, durant son vol de retour vers ses racines.}
Séance avec le Yagé
J’amorce une nuit tiède et mystérieuse, très désirée de ma part ! Épris d’une envie de connaître et de comprendre, ma curiosité m’a conduit ici pour tenter une bien étrange expérience. Je me trouve enfin là, attentif et assis proche de Taitá Jënÿá. Un sacré petit homme, gringalet, le visage allongé, une attitude toujours posée. Ce soir, je le sens serein, un tantinet mystérieux, et dans l’air flotte un je ne sais quoi qui me laisse présager la soirée pour le moins déconcertante. Cela me ravit d’être ici, mais je suis soucieux. Cet évènement peu commun relève d’un monde auquel je ne m’identifie pas. À cet instant j’appréhende les prochaines heures ; à peine quelques minutes auparavant, j’ai laissé fluer dans mon gosier quelques millilitres d’une substance sombre très amère. À présent je ne peux plus faire marche arrière. Je m’interroge sur ce qu’il adviendra de mon esprit. ‘Où ira-t-il gambader ? Où donc me guidera Taitá Jënÿá ? Et mon corps, comment réagira-t-il ?’
Pendant que le circuit sanguin véhicule les substances psychotropes dans tout mon être, je questionne mon hôte à propos de l’étrange univers qu’il manie avec sa communauté ; à mon sens, un monde aussi peu consistant qu’une boule d’air entre deux mains creusées. Nous attendons ainsi que les effets bousculent nos esprits, peut-être même nous mènent vers d’autres mondes par-delà mes réalités. Lui, le guide, sait où. Moi, jeune curieux, à peine sorti de l’adolescence et empli de rêves d’aventures singulières, sans la connaissance suffisante, je le suivrai au travers des méandres de ma matière grise.
Les yeux clos, je tente de trouver une concentration révélatrice alors que, pour l’instant, rien n’illumine un éventuel imaginaire.
Ça chahute : les enfants de mes hôtes sont agités. Ils rentrent et sortent sans cesse comme tout jeune enfant qui à peine l’énergie ingurgitée nécessite de la dépenser sans compter. L’endroit est ainsi bruyant. Puis, deux bougies, collées sur la vieille table par un conglomérat de cire verte durcie, apportent trop de lumière. Aussi, quelques éléments particuliers détournent mon attention curieuse ; ils révèlent les mœurs des occupants de cette habitation simple mais peu ordinaire. Tous ces éléments me perturbent ; ils ne sont pas propices à une concentration aisée. À cet endroit précis, je voudrais entrevoir le tréfonds de mon esprit. Je m’impatiente, je voudrais rentrer dans le vif du sujet.
À l’extérieur, la nuit règne, sombre et exceptionnelle. Les étoiles étincelantes semblent à portée de main, et toute la Voie lactée parait plus dense, plus fournie qu’ailleurs. C’est proche de l’équateur que le beau hasard m’a fait suspendre, pour un instant, le cheminement bohème de ma nouvelle vie.
Je m’accoude sur la longue table de planches devenues grises avec le temps. Le seul gros ameublement fait mauvaise mine. Il est comme une verrue, il semble ne pas être à sa place dans ce monde-là qui n’en a jamais eu la nécessité. Sur ses plus longs côtés, deux bancs tout aussi vétustes l’accompagnent. Je suis assis sur l’un d’eux. Là, pour le temps des quelques prochaines heures, mon être aimerait s’envoler sans encombre et côtoyer le monde onirique de l’ethnie Kamëntšá.
C’est autour de ce mobilier quelque peu formel que Taitá Jënÿá reçoit les étrangers à sa communauté. La famille et les amis préfèrent se retrouver dans le recoin au fond à gauche de la grande pièce, là où par tradition brûle le feu sacré. Ils prennent souvent leur place au ras du sol en terre battue, proche du foyer de cuisson, parfois accroupis, le plat creux entre les genoux, ou alors assis sur de très bas tabourets sculptés d’un seul bloc dans un morceau de bois tendre. C’est le domaine de Tsjuanoca. Elle a le pas ferme, les gestes précis. Une tenue traditionnelle colorée embellit sa fierté amérindienne. Lorsque son heure arrive, elle organise le foyer de cuisson avec du bois. Elle positionne toujours trois troncs de petit diamètre en étoile. Leurs extrémités – intercalées entre trois gros cailloux qui représentent les fondations de la famille (père, mère, enfant) – forment alors le brasier. Lorsqu’il nourrit une belle flamme, ces pierres supportent l’auge de terre cuite noircie par une accumulation mémorielle des nombreuses préparations culinaires.
En ce début de nuit, quelques restes de braises élèvent encore une fine fumée. Elle se déploie lentement sous la toiture brunie et colporte ses molécules jusqu’à mes narines. Je perçois ainsi l’odeur des aliments disposés en hauteur sur le fumoir. Installé sur le banc, mon dos appuie la cloison de torchis. La maisonnette est robuste. Taitá Jënÿá et Tsjuanoca l’avaient bâtie eux-mêmes, de façon traditionnelle, aidés de quelques « mingas » : un système d’entraide solidaire – issues de traditions séculaires – indispensable dans une vie en communauté dépourvue de capitaux. Les murs, faits de glaise mêlée à de la paille et de quelques cailloux, protègent de la chaleur le jour, de la fraicheur aussi, lorsque certaines nuits des déluges débordent de nuages turbulents. Dans cette contrée subtropicale, ils s’abattent par instants, créent des cascades au bout de la retombée des toits et creusent des rigoles argileuses sur le pourtour. Des feuillages recouvrent la toiture de tôles ondulées et défendent ainsi d’un rayonnement parfois chaud et peu supportable. Ces tôles sont pourtant impropres à leur habituel mode de vie respectueux envers la nature. Les indigènes de cette ethnie les utilisent depuis que les missionnaires, par leur sainte intolérance, ont contraint leur proie à se sédentariser. La terre du sol est rouge, battue et compacte comme dans beaucoup des habitations indigènes en Amazonie. Au fur et à mesure des passages des plantes de pieds, la matière est devenue soyeuse, agréable sous la corne des pieds nus. Ici, le courant électrique est une songerie sans fondement, et l’eau coule librement. Elle court le long d’un large ruisseau qui sinue avec une limpide symphonie cristalline entre des rochers de grès noir, bas et arrondis.
L’endroit se situe sur un haut plateau préamazonien, exempt ici de moustiques butineurs de chairs blanches. Des effluves tropicaux embaument les alentours. Le lieu, élémentaire, beau, isolé dans une nature abondante, m’apparait chaleureux, riche de belles valeurs, plein d’une vie simple qui prend aux tripes et au cœur. Je m’y sens comme à l’intérieur d’une belle parenthèse naturelle à l’écart de mon monde moderne et artificiel.
*
Face à moi, de l’autre côté de la pièce, assis dans la pénombre sur une chaise usagée et branlante, Taitá Jënÿá, les yeux bridés, la peau cuivrée, chantonne à voix basse. Entre ses lèvres à peine entrouvertes, il laisse échapper une douce mélopée incompréhensible. Elle m’intrigue. Elle est issue du langage des esprits de son monde. Taitá Jënÿá les invite ainsi à parfaire la cérémonie. Il agite avec bruit le bouquet de longues feuilles sèches, un instrument indispensable. Il les avait cueillies soigneusement, avec le plus grand des respects, de façon chamanique après avoir invoqué les esprits des plantes et de la forêt. Par son usage, Taitá Jënÿá sait appeler ou chasser toutes sortes de bons ou de mauvais esprits. C’est un outil tout aussi essentiel que la désagréable potion qu’il m’a fait ingurgiter quelques instants plus tôt.
Dans un angle de la pièce, des termites affamés rongent un petit meuble vieillot et rudimentaire. Posé dessus, le portrait encadré du propriétaire trône comme un glorieux diplôme. Taitá Jënÿá pose avec une fierté imposante et, malgré les couleurs maintenant délavées, il m’intimide. Il apparait en tant que guérisseur dans toute sa splendeur traditionnelle, l’air assuré de sa compétence. Un habit coutumier de couleur sombre l’enveloppe, tissé main, et une couronne de plumes multicolores sur le tour de sa tête fait rayonner le personnage. Son cou supporte une bonne épaisseur de divers colliers chaque fois plus allongés jusqu’au bas de sa poitrine. Ils sont les attributs talismaniques significatifs de son ethnie et de son rang, composés de petits ossements et de dentitions animales, de graines et de plumes. Des ornements de provenances magiques aux dires du guérisseur.
Taitá Jënÿá s’enquiert de mon état. « Rien n’émoustille encore mon ciboulot ! » lui dis-je. Malgré tout, je me sens anxieux. Je n’imagine pas ce qui bientôt adviendra dans mon amas de neurones rationnels.
Une brève expérience précédente, chez une autre ethnie, n’avait pas assouvi mes espérances. Mes hôtes m’avaient sans doute trouvé trop blanc de peau – donc d’esprit – trop intrusif dans leurs rites, et avaient apparemment contenu les effets hallucinogènes, me barrant ainsi l’accès à tout le côté sacré pour ne me faire bénéficier que la part purgative du breuvage.
Taitá Jënÿá, les cheveux épais et lisses, noirs comme une nuit sans lune, coupés au bol selon la coutume des moines qui un temps avaient été leurs maîtres, m’apparait comme impénétrable, en dehors du réel dans cette situation singulière. Pour cette séance, nous ne sommes que lui et moi, en tête à tête. À vrai dire, je ne sais pas à quoi m’attendre, mais je pressens la soirée prometteuse. Mon intuition ne tire pas son origine de l’allure qui le désavantage ; il ne lui a pas semblé nécessaire de m’impressionner par un apparat cérémoniel. Il est vêtu dans une simplicité occidentale mais pas à la mode. Sans doute, avait-il dégoté ses vêtements de bas prix, trop grands et trop larges, dans l’authentique et coloré marché dominical de la vallée.
Pour imprégner ses trois jeunes enfants des pratiques traditionnelles, il leur avait permis de nous accompagner un instant. J’avais bien vu leur excitation à prendre part une nouvelle fois à un acte « magique ». En cherchant à se concentrer eux aussi, ils se sont endormis à même le sol. Taitá Jënÿá leur avait servi le breuvage en une faible dose dans un but dépuratoire ; mais peut-être les fait-il déjà voyager dans leur sommeil, parmi toute une batterie d’esprits, ceux des plantes, des arbres, des animaux, des eaux et des monts. Taitá Jënÿá les réveille tendrement. Il les somme d’aller retrouver leur literie aérienne ; des hamacs encore immobiles les attendent.
Le moment attendu va semble-t-il s’installer. Entre ses larges doigts calleux de cultivateur, Taitá Jënÿá étouffe la flamme de l’une des bougies. Un dernier spasme s’évapore alors dans une fine volute blanche. Elle envahit le lieu, et une grossière odeur de cire brûlée se diffuse puis se mêle à celle de fumée refroidie. Il déplace la seconde à l’écart, sur le cul d’une jarre d’argile renversée. Elle n’apporte ainsi plus qu’une simple lueur dans la pièce où il me guidera vers je ne sais quelle autre dimension. De légers déplacements d’air font osciller la flamme qui met alors en scène des ombres mouvantes, amples et fantomatiques, imprimant une atmosphère intrigante.
Le silence prend enfin possession de l’endroit. Il me permet de me concentrer, de me focaliser sur la surface intérieure de mes yeux clos et sur les « entrailles » de mon cerveau. Il voudrait bien maintenant s’ouvrir et dévoiler la possibilité de ses folies intérieures.
Je perçois enfin les prémices d’une ivresse. Elle voyage à dos de globules. À l’intérieur de mes veines, elle prend de la consistance. Rapide, pétillante, sa vigueur s’accentue à chaque instant puis, me faisant frémir le haut du crâne, pénètre enfin l’esprit comme un éclair. Lors de minces tentatives antérieures, l’ivresse causée par le Yagé n’était jamais montée en moi à un degré si haut en un aussi bref instant. Ce soir, l’ivresse bouillonne. Des milliers de « bulles » minuscules éclatent et pétillent. Au milieu de mes molécules abasourdies, elles libèrent une substance envahissante qu’aucun de mes sens ne peut contrecarrer. Ces alcaloïdes font naitre en moi l’appréhension que les choses puissent aller trop loin vers des dimensions labyrinthiques. Je l’avais déjà entendu raconter de la bouche de quelques initiés croisés sur mes chemins investigateurs. Certains m’avaient assuré avoir perdu le sens de la réalité lors d’une transe trop profonde, et n’avaient alors pu retrouver la sortie que par le savoir-faire du guérisseur ; d’autres avaient pleuré toute une nuit, choqués par ce qu’ils voyaient et vivaient dans les bas-fonds de leur esprit peut-être tourmenté à ce moment-là.
J’essaie de calmer l’emballement de mes sens. Je voudrais ralentir le pouls de mon flux sanguin et adoucir cette spirale enivrante, trop forte, inquiétante à mon gout de néophyte. À intervalles réguliers, je me contrains à ouvrir les paupières. M’extraire de la concentration devrait atténuer l’intensité de cette oppression éthylique. Lors d’une rencontre avec des initiés, j’avais eu écho de quelques astuces de ce genre. Une anxiété m’envahit. Il est temps que je vérifie l’efficacité de ma ruse.
Elle n’agit en rien. Lorsque j’entrouvre les paupières, je perçois l’alentour peu prévisible, comme si rien n’était tout à fait réel. Tout le solide brille, étincèle presque, et l’atmosphère gazeuse semble une mousse scintillante sous de puissants rayons d’une lune absente.
Taitá Jënÿá, paisible, m’interroge à nouveau au sujet de mon état.
— Je me sens ivre, lui dis-je.
L’esprit vaporeux, je reste malgré tout bien conscient de ce qui se déroule, bien accroché à l’endroit où je me trouve.
Il n’a pas une très grande expérience de guérisseur, cependant il en a une ample connaissance. L’utilisation du Yagé et des plantes médicinales n’ont aucun secret pour lui. Taitá Jënÿá ne pratique en réalité l’art de la transe qu’à l’intérieur de l’enceinte familiale, lors d’occasions peu fréquentes. Il s’aide du breuvage afin de rééquilibrer un égarement psychologique, ou pour aussi récupérer une information pratique auprès de quelques esprits. Durant toutes ses jeunes années initiatiques, son père, avec une patience méticuleuse, s’était employé à lui transmettre ce savoir millénaire. Au moment de prendre son « envol » en dehors de la cahutte qui l’avait vu naitre, Taitá Jënÿá n’avait pas suivi les conseils avisés de son entourage et avait préféré ne pas exercer cet art en tant que profession. Ainsi, m’avait-il expliqué, il n’était pas amené à exercer la magie noire. « Acte que je ne pratique jamais », m’avait-il confirmé.
De nature réservée mais habituellement souriant, ce soir il arbore un air solennel. Ses gestes sont sûrs, ses rituels précis. Le cercle de plumes colorées autour de sa tête semble faire envoler son esprit. Ses incantations sont d’un monde où les paroles n’ont de sens que pour les initiés et les êtres surnaturels. Tout cela m’inspire un profond respect et m’installe dans un cocon tissé de traditions élaborées.
C’est Tsjuanoca, son épouse, qui lui avait soufflé de préparer cette séance de Yagé à mon intention.
J’évoluais, depuis quelques semaines déjà, au sein de leur ethnie située au milieu d’une large vallée verdoyante. À l’Est, la crête des collines bascule dans le vaste et humide bassin amazonien. À l’Ouest, la piste dégradée grimpe tortueusement vers les Andes centrales froides. Le lieu déconcerte par sa beauté et son authenticité : tant au niveau du paysage – où se mêlent une nature arborée sans une seule rangée rectiligne, des clairières sans formes géométriques établies, et des espaces semés de végétaux comestibles, eux aussi désordonnés et divers –, qu’au niveau de l’humain, qui permet à tout insecte, tout animal sauvage de conserver sa place, et fait en sorte que la terre ne soit une propriété, ni même à l’image de « l’homme » formaté pour qui tout doit être tiré au cordeau, regroupé par espèce et rentré dans une case.
Tsjuanoca, à peine plus jeune que son compagnon pour la vie, porte en elle la fierté d’appartenir à une ethnie séculaire. Elle vêt toujours, avec allure, les habits traditionnels. Un rectangle de toile noire plaqué autour de sa taille couvre le haut de ses jambes, et un haut, clair, coloré, égaie sa physionomie. L’étoffe épaisse de coton blanc, fait main d’un tissage élaboré, est ouvragée de nombreuses ornementations symboliques liées à sa culture. Elle est une femme convaincue de l’intérêt vital des traditions, notamment dans son ethnie : les Kamëntšá. Plutôt que de chausser ses pieds, elle préfère les avoir toujours nus pour ressentir et utiliser l’énergie de la Terre. Ils sont larges, puissants, ils se modèlent de manière étonnante sur tous types de sols. Une vie quotidienne à l’air libre marque déjà son visage typé. Nombre de sillons, de plis ordonnés, dessinent ses joues et son front avec tendresse. Tsjuanoca irradie ainsi une splendeur intérieure peu commune, et, à sa seule vue, c’est une émotion bien chaleureuse qui me submerge.
La passion d’une discussion nous émouvait parfois, et leur vie coutumière constitue son sujet de prédilection. C’est ainsi qu’elle m’avait commenté les dégâts occasionnés durant l’époque récente des missionnaires, tout comme l’emprise de ces colonisateurs sur son ethnie. Le temps de leur dictat, usant de malhonnêtetés, ils s’étaient notamment approprié de nombreuses terres alentour, « pour le bien de leurs ‘‘brebis’’ » avaient-ils insinué dans les esprits naïfs. Ils avaient pour cela mis en œuvre quelques perfidies de leur acabit, au nom d’un bien drôle d’oiseau que leur Dieu. Mais ils avaient aussi profané et interdit l’emploi de l’indispensable Yagé. Pour autant, ces religieux, pur produit des civilisations, ne purent jamais anéantir l’esprit rebelle Kamëntšá qui palpitait encore au plus profond d’un recoin où résistait leur orgueil. En cachette, avec habileté, ils avaient perpétué l’utilisation du Yagé. Ces cérémonies clandestines leur permirent alors de conserver un minimum de leur culture et de leurs savoirs, indispensables dans leur mode de vie. Il s’agissait d’atouts, m’avait expliqué Tsjuanoca, nécessaires à une identification ethnique ancestrale, elle-même fondamentale à leur survie en tant que peuple millénaire.
— La communauté Kamëntšá, considérons la sécurité d’un savoir ancestral, efficient, crucial pour notre sérénité intérieure ! m’avait-elle affirmé.
L’ambition qui avait mené les religieux ici leur avait été commandée par une volonté obstinée à faire entrer ces Amérindiens dans leurs rangs. Ils avaient ainsi usé de leur hypocrite argument de salvation pour extraire les autochtones d’une vie millénaire bien ajustée à l’équilibre des choses. Ces nouvelles « brebis » devaient abandonner leur manière de vivre, saine et logique, respectueuse des maillons de la chaine des vivants. Les religieux, par leurs belles paroles pourtant intolérantes, s’étaient sentis fiers de s’être immiscés là. Au nom de la civilisation ecclésiastique, ils s’étaient autorisés à anéantir une culture et des croyances qui avaient accompagné la sérénité des Kamëntšá au long de milliers d’années.
J’avais profité de ses remarques au sujet du Yagé pour lui faire part du profond souhait qui m’obsédait : tenter l’expérience mythique de cette fameuse et puissante plante sauvage, et partager une cérémonie étonnante parmi les siens.
Elle m’avait rapidement présenté Taitá Jënÿá. Au premier abord, il m’avait paru plutôt fragile pour un indigène des basses montagnes, mais ensuite, à son attitude comme maligne, maître de lui, exhibant un visage impassible, il m’avait intimidé. Ses yeux noirs, puissants, m’avaient fixé d’une étrange expression. Sa poignée de main, molle, m’avait fait sous-entendre le peu de confiance qu’il pouvait accorder à un blanc, qui plus est issu d’une civilisation. Me trouvait-il trop artificiel, trop intrusif à son goût ? Il faut dire que beaucoup d’Amérindiens considèrent l’homme blanc comme un barbare, un voyou dépourvu d’un quelconque autre respect que pour celui de l’argent, de la convoitise et de la gloire.
C’est après quelques semaines passées aux côtés de Taitá Jënÿá, profitables à ma curiosité et mon entendement, que j’obtins la confiance nécessaire de sa part. Il avait apprécié mon aide, pourtant malhabile, dans son travail aux champs. Il avait aussi su reconnaitre mon intérêt honnête, et philosophique, à comprendre sa culture. Notre relation était devenue honorable et l’avait alors prédisposé à enfin organiser cette séance. J’avais voulu l’imaginer intéressante et instructive malgré l’appréhension de l’inconnu. Il m’avait donné rendez-vous dans sa maisonnette quelques jours plus tard. Entre-temps, il s’était rendu dans la forêt pour s’imprégner des esprits des plantes et s’entretenir avec elles. Il devait, après leur avoir soumis ses intentions, collecter les ingrédients nécessaires à la préparation de la potion hallucinogène : un type de liane particulière de l’Amazonie, ainsi que quelques feuilles d’un arbuste appelé ici « Chagruna ». L’une amène l’ivresse, l’autre « la pinta » : le style de visions. Les deux ne peuvent être dissociés et contribuent à l’élaboration du Yagé.
De retour de sa cueillette, il m’avait invité à éclater ces végétaux dans un recoin spécifique de son champ afin de libérer leurs fibres. Je m’y étais attelé à grands coups acharnés d’une lourde bâte de bois, sur une large pierre à peu près plate, légèrement creusée par les années d’utilisations. Nous avions ensuite mis tout ce matériau trituré à l’intérieur d’un chaudron au-dessus d’un feu alimenté par d’épaisses branches. J’aurais pu présumer ce récipient magique tant la situation rappelait les contes de sorcières. Les braises crépitaient de vivacité. La décoction mijota durant de longues heures sous la protection de quelques incantations que Taitá Jënÿá prononçait régulièrement selon l’avancée du processus. Le résultat consista en un concentré sombre, épais et presque inodore, pas très affriolant à la vue : le Yagé que nous avalerions le lendemain.
*
Je révèle à Taitá Jënÿá mon état d’ivresse maintenant accru.
— Par contre je n’aperçois toujours rien, le noir absolu dans mes yeux clos.
Il m’approche alors, puis susurre à mes oreilles une délicate mélopée. La mélodie est émouvante. Elle se dévoile sur une intonation indigène typique, curieusement assez similaire dans toute l’Amérique amérindienne. Dans le même temps, une vibration vive de son avant-bras agite le bouquet de feuilles sèches et sonores sur tout le pourtour de mon corps. Il désire peut-être ouvrir mes pores à l’acceptation de ce qui se produira. Il accompagne ce rituel de quelques incantations mystérieuses, et termine par un « il fait froid n’est-ce pas, tu n’as pas froid ? ».
— Absolument pas, lui dis-je.





























