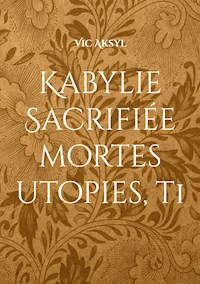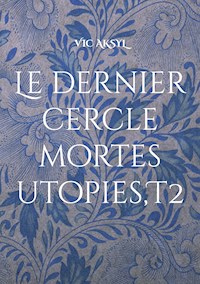
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mortes Utopies
- Sprache: Französisch
La France des années 1860 était en proie à l'inflation, à l'affairisme et aux coteries occultes. Le régime de Napoléon III chancelait; tandis que de l'autre côté du Rhin le roi Guillaume 1er de Prusse et son ministre-président, Otto Von Bismarck, s'étaient lancé dans une politique agressive d'unification des états allemands au profit de la Prusse. L'Empire français constituait, à leurs yeux, un obstacle à leur projet. Mohand, sous une identité d'emprunt traquait, alors, à travers la France entière, les meurtriers des parents de Justine; une riche héritière qui détenait des informations qui lui permettraient de retrouver, enfin, sa famille. Dans sa quête, il se heurte à un criminel redoutable, aussi intelligent que pervers, expert dans l'art de la manipulation et du déguisement. A la tête d'une clique malfaisante de ploutocrates et de brigands, il oeuvre à la perte de l'Empire français.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« Ne pas rire, ni se lamenter, ni haïr, mais comprendre ! »Baruch Spinoza
« A force de tout voir,
On finit par tout supporter.
A force de tout supporter,
On finit par tout tolérer.
A force de tout tolérer,
On finit par tout accepter.
A force de tout accepter,
On finit par tout approuver. »
Saint Augustin
Sommaire
Prologue
Les monstres (Paris, 1863)
Remords (Bougie, 1914)
Quand le destin vacille (Alger-Paris, 1867)
Rencontre
La promotion
Un art millénaire
Une première piste
Début de la traque
Vils penchants
Les intouchables
De Saint-Denis au Périgord
Jolie môme
Le piège (Royaume-Uni, novembre 1869)
Vent nouveau, vent mauvais (Paris, juillet 1870)
Félonies
Lorsque tout chancelle (août 1870)
L’aigreur du sang
Bibliographie
Romans, ouvrages et revue d’histoire
Site web
Documents pdf
Prologue
Le dernier cercle est le lieu le plus effroyable de l’enfer, décrit par Dante, on y rencontre les damnés voués à des châtiments perpétuels pour trahison.
En cette année 1867, la Kabylie n’avait plus rien de commun avec celle qu’avait connue Mohand dans sa plus tendre enfance. La France l’avait transformée de fond en comble, l’affublant de mœurs « arabes » qui lui seyaient mal et qui la défiguraient. Progressivement, toutes les régions que les colons appelaient « Kabylies » cessaient d’être kabyles1 ! Dans un même temps, la France, la patrie du conquérant, subit un sort semblable. Depuis 1789, bien des années s’étaient écoulées ! La République cédait le pas à des régimes autoritaires qui l’entraînèrent dans des aventures militaires, auxquelles elle n’avait rien à gagner, qui ensanglantèrent l’Europe et les colonies. L’esprit des lumières était mort lui aussi. En 1851, la bourgeoisie, échaudée par les événements de 1848, appela de tous ses vœux un nouveau tyran. Napoléon III, ce despote éclairé, ne put empêcher la France de sombrer sous les serres d’affairistes et de corrupteurs. Alors que la majorité des Français était en proie à une exploitation forcenée, les prédateurs, grands et petits, assoiffés de profits se pressaient dans les allées du pouvoir. La quasi-totalité de la France laborieuse, payée à la semaine, voire à la journée, croupissait dans la précarité, la pauvreté et l’exclusion. Ceux que l'on appelait « les bas-fond » humiliés, contraint souvent de vivoter dans des conditions d’hygiène et de soins misérables, étaient fréquemment obligés de s’endetter à des taux prohibitifs pour seulement manger, sont systématiquement exclus des réformes coûteuses lancées par Napoléon III. Alors fleurissaient les utopies et les sectes. Le petit peuple de France, idéalisé par les révolutionnaires et les poètes, était en vérité tenu à la lisière par tous les politiciens qui dirigeaient la France, mais qui n’hésitaient pas à se servir de lui au besoin.
Les Françaises, bridées par le code Napoléon et le machisme ambiant, n’avaient désormais rien à envier à leurs sœurs des Kabylies, étouffées sous le poids des nouvelles mœurs importées d’orient par les conquérants et les religieux islamistes.
L’empereur, au crépuscule de son règne, malgré les réformes qu’il imposa, dut faire face à une contestation croissante de toutes les classes sociales.
1 A l’origine les conquérants, de ce que l’on n’appelait pas encore l’Algérie, appelaient Kabylies toutes les régions qui échappaient à l’autorité turque ou à celle des alaouites et qui avaient gardées leurs mœurs démocratiques et égalitaires. Voir « Kabylie sacrifiée, mortes utopies T1, par K. Aksel » Editions BOD.
Les monstres (Paris, 1863)
« C’est par moi que l’on va dans
La cité des pleurs,
C’est par moi que l’on va dans
Le champ des douleurs,
C’est par moi que l’on va chez
La race damnée ...
Là tout était couvert d’impénétrables voiles, et des cris raisonnaient sous un ciel sans étoiles… »
Dante (Divine comédie – L’enfer)
A quelques pas des luxueux hôtels particuliers du faubourg Saint-Germain, à proximité du palais de justice, un quartier lugubre s’étirait sur plusieurs rues. Entre ses façades lépreuses, dans son enchevêtrement de venelles tortueuses et fétides s’écoulaient des ruisseaux d’eaux fangeuses. La lueur des flammes vacillantes des rares réverbères révélait cet îlot de misères qui, parmi d’autres, s’encastrait entre faste et déliquescence. Malgré le temps exécrable, quelques femmes, des gamines pour la plupart, parcouraient inlassablement ces fossés abjects. Pour se protéger de l’averse, elles s’abritaient sous de sombres porches d’où s’exhalaient de répugnantes odeurs. Elles aguichaient les passants occasionnels, qui échouaient là par hasard, ou parfois intentionnellement, pour leur proposer leurs charmes contre quelques pièces. Un fiacre, ruisselant d’eau de pluie, stoppa à l’angle de la rue de la calandre et de la rue de la vieille draperie. Un homme tout de noir vêtu en descendit, il donna quelques brèves instructions au cocher puis rabattit le col de sa cape sur sa nuque. Son chapeau tromblon2 reflétait une étrange lueur verdâtre. Il ne s’attarda pas et se dirigea d’un pas rapide vers un tapis-franc3. Il ne prêta guère d’attention aux jeunes prostituées, tenaillées par la faim, qui le hélaient d’une voix éraillée par le froid. Elles accompagnaient souvent leurs appels d’un geste las. Il pénétra dans le cabaret, regorgeant de monde à cette heure. La vaste salle enfumée était plongée dans la pénombre ; l’éclairage, de mauvaise qualité, ne parvenait pas à apporter une lumière suffisante. Il pesta intérieurement, l’endroit était plutôt bruyant. Il s’apprêta à rebrousser chemin lorsqu’une ogresse4 l’apostropha en lui faisant une large grimace, qui se voulait un sourire.
« — Mais donnez-vous la peine d’entrer, monseigneur ! Et surtout, n’ayez aucune crainte. Cette auberge est une des plus respectables. Ici, nous n’acceptons pas les malfaisants ni les scélérats ! »
Ce faisant, elle grimaça un nouveau sourire, qui révéla sa bouche édentée, se croyant ainsi plus engageante. « Cette femme, pensa-t-il, doit être issue d’un milieu plus raffiné que ses clients… Triste époque ! » Les consommateurs, assis à d’antiques tables, fixées aux murs, les bancs, eux, étaient scellés au sol, interrompirent leurs discussions pour dévisager l’intrus. L’un d’eux se leva et le convia à entrer, ils se dirigèrent un peu à l’écart des autres habitués. Il lui fit signe de se taire et il s’adressa à l’ogresse : « — une cholette de tortu5 et un arlequin6, la birbasse7 ! A moins que mon compagnon ne soit tenté par le menu ? » Il interrogea ce dernier qui, d’un hochement de tête, déclina l’invitation. Lorsque la vieille femme se fut éloignée, l’homme en habit lança un regard noir à son ami.
« — Ne vous ai-je point recommandé, monsieur « le fossoyeur », de me donner rendez-vous en un lieu discret ? »
Celui à qui il s’adressait fit un mouvement d’impatience, avant de lui répondre :
« — holà, camarade, tout doux, ne t’offusque point ! Tu ne trouveras nul endroit plus sûr ! »
D’un coup d’œil, il inspecta la salle, avant de poursuivre :
« — Tous les clients de ce tapis-franc ont eu des démêlés avec la justice ! En ce lieu, tu as la plus belle brochette de grinches, de chourineurs et d’entailleurs8, aucun d’eux n’ira faire des indiscrétions !
— Précisément ! lui répliqua l’homme au chapeau tromblon. Ils ne m’inspirent guère confiance. »
Entre-temps, la tenancière revint avec les commandes. Les deux compères se turent. Le fossoyeur se délecta du plat fumant et ruisselant, sous l’œil dégoûté de son comparse. Entre deux mastications, il lui demanda :
« — à qui devons-nous faire un sort ?
— A un bourgeois qui réside dans un hôtel particulier qui fait l’angle du boulevard d’Enfer9 et de la rue du Regard.
— Je m’en serais chargé seul, si ce n’est qu’ça !
— Vous devez tous les tuer ! »
Le fossoyeur lui jeta un regard interloqué.
« — Les escarper10 tous ? Même les momacques11 ?
— Tous ! » Lui répéta-t-il, « les hommes, les femmes et les enfants, les domestiques compris ; sauf celui qui vous introduira sur les lieux, bien entendu !
— Tu connais son blaze ? »
L’avocat éluda cette question.
« — Je vous offre deux mille francs chacun, pour cette tâche ! Lui déclara-t-il en affichant un grand sourire. Les hommes, que je représente, sont très généreux ! »
« — Deux mille francs ! » S’exclama le fossoyeur. « C’te affaire risque de nous coûter cher, si on est pris !
C’est le bagne ou la coloquinte12 au béquillard13. »
En même temps, il fit un geste évoquant la décapitation de la main gauche. Il posa sa cuiller et approcha son visage de celui de l’avocat. Son haleine fétide incommodait visiblement ce dernier.
« — Pour ce travail, c’est cinq mille francs ou rien ! Penses-tu ! Pour entailler une famille de daims huppés,14 deux mille c’est pas assez. Les gendarmes courront sans cesse à travers la France et la Navarre, avant qu’ils nous aient cravatés !
— Soit ! Lui rétorqua l’homme en haut-de-forme, cinq milles pour vous et deux milles pour chacun de vos comparses, ne m’en demandez pas plus ! Mais j’exige un travail soigné. »
Cette réponse semblait plaire au fossoyeur. Il leva le bras et brailla à l’attention de la tenancière :
« — holà la mère, arrose-nous d’eau d’aff15, l’zig16 m’a mis d’bonne humeur ! »
Sans se donner la peine d’ajouter un seul mot, son compagnon laissa son siège et quitta les lieux discrètement.
Le soleil pointait à peine, que ses dards se perdaient déjà dans ses boucles blondes. Elle s’humecta les lèvres, puis prit une inspiration avant de déclamer, d’une voix chantante :
« — Sublime aurore,
De tes rayons d’or,
Tu illumines de tes couleurs,
Mon jardin parsemé de fleurs.
Paris, l’éblouissante cité,
Éclatante de joliesse,
S’éveille sous tes caresses,
S’imprégnant de ta volupté.
Jouissance évanouie quand le jour avance,
Tu t’enfuis comme une mauvaise engeance.
Mais n’est-ce point faire preuve d’inélégance ?
Que m’abandonner dans la désespérance ?
Après que tu m’eus séduite par ton exubérance,
Que tu m’eus étourdie de tes enivrantes fragrances,
Et que tu m’eus conquise par ta discrète romance ! » Elle adressa un sourire à Maxime, un enfant de cinq ou six ans. Ce dernier parut subjugué. Il avait le regard ébloui, buvant chacun de ses vers. Elle referma soigneusement son cahier, relié de cuir rose, et alla s’asseoir sur le banc à côté de son frère. Un homme s’approcha d’elle, il était pansu et entre deux âges, il avait le visage enserré entre deux gros favoris et les cheveux rares et grisonnants. Il lui caressa la joue, dissimulant à peine sa fierté. Une émotion profonde s’empara d’elle, ses grands yeux rayonnèrent de joie. La jeune fille se leva et déposa un baiser sur son front.
« — Quelle radieuse aurore, s’exclama-t-elle ! »
Son père l’enveloppa dans son bras puissant.
« — Elle nous promet une journée tout aussi étincelante, ma tendre enfant ! »
L’astre diurne s’était hissé au-dessus du mur d’enceinte, qui enserrait la cour et le jardin de sa masse grise, et le ciel s’était teinté d’un bleu lumineux. Les rosiers diffusaient leur parfum enivrant et sensuel. Plus personne n’ajouta le moindre mot, même les oiseaux stoppèrent leurs piaulements, comme s’ils étaient tous subjugués par ce matin féérique. Le silence n’était brisé que par le gargouillement de l’eau, qui s’écoulait de la fontaine rococo, au centre du patio.
« — Venez, votre mère et votre sœur s’impatientent, le petit-déjeuner est prêt, dit l’homme à contrecœur. »
Justine sourit, puis suivit son père qui marchait avec difficulté ; sa vieille blessure ranimait régulièrement une douleur intense.
La place de la Grève17 était déserte, ce qui peut sembler normal, car l’aube tardait à se lever, pourtant cela était inhabituel ; en effet, chaque jour, une foule hâve et décharnée l’envahissait. Des journaliers qui, avant l’aurore, venaient là, le corps transi et le ventre vide, pour proposer leurs services aux patrons avides de main-d’œuvre bon marché. Ils faisaient peine à voir, trépignant des pieds pour se réchauffer, vêtus de pantalons rapiécés, de mauvaises blouses et de manteaux usés, sales et couverts de taches. Ce matin-là, une bande de scélérats18 les avaient devancés sur les lieux. Ils se regroupèrent, un instant, autour de leur chef avant de fondre sur la place du Chatelet. Ils longèrent les ondes noires du fleuve, silencieusement, pendant quelques minutes et, soudain, ils le traversèrent furtivement. Puis ils se glissèrent tout aussi subrepticement entre les façades grises du quartier latin. Semblant suivre une piste, telles des hyènes affamées, la meute traversa rapidement et discrètement une rue étroite et malodorante. Ensuite, le fossoyeur et ses acolytes rejoignirent le domestique qui les attendait impatiemment devant la spacieuse demeure de ses maîtres, plongée dans un profond sommeil. Il ouvrit anxieusement le portail et les introduisit dans les lieux. Justine était assise sur un banc de marbre, dans le jardin, cherchant l’inspiration entre pénombre et clair de lune. Quand elle remarqua les créatures terrifiantes, faites d’ombre et d’effluves, qui se dirigeaient vers la maison, elle eut peur et tomba à la renverse. Elle s’évanouit et disparut derrière un fourré. Ce qui la soustrayait à leurs œuvres maléfiques. La dernière chose qu’elle vit, ce furent leurs yeux luisants de bestialité. Personne ne peut ressentir une telle frayeur sans en perdre la raison, ou en mourir.
L’infect laquais guida ceux-ci en tous lieux du foyer, jusqu’ici paisible. Partout, ces fourbes, ces bêtes immondes y répandirent le sang, l’horreur et l’abjection. Les murs et les sols se couvrirent de pourpre. Leur instinct meurtrier s’exprima avec une extrême sauvagerie. Rien ni personne ne put enrayer leur ardeur assassine, ni les pleurs, ni les cris, ni même les suppliques. La vieille dame à la faux devait se réjouir de tant de diligence, l’entrain avec lequel ils semaient la mort dut lui arracher des gloussements de joie. Avec de tels serviteurs, le travail ne manquera pas, avant qu’elle ne s’occupe d’eux, à leur tour. De lourds nuages sombres envahirent le ciel étoilé en obscurcissant la Lune. Ils peignirent toute la maison de ténèbres, sans parvenir à cacher les flaques noires aux reflets écarlates qui maculaient les murs et les meubles. Autant les cris et les gémissements horrifiaient, autant le silence, qui s’abattit soudainement sur la riche demeure, devint affreux. D’hôtel particulier, elle s’était changée en cimetière.
Leur tâche accomplie, les assassins quittèrent les lieux aussi discrètement qu’ils étaient venus. Ils se fondirent dans la foule des miséreux qui emplissaient les rues et qui se dirigeaient lentement vers la place de la Grève. Ces derniers se mouvaient par grappe, sans mot dire, pour économiser leurs forces.
Une frayeur effroyable assaillit l’homme qui découvrit les malheureux, baignant dans leur sang et leurs viscères. A cet instant, il crut sombrer dans une folie extrême, celle qui vous perd à jamais.
Ce proche voisin, ne les fréquentait pas, les connaissait à peine, ne leur parlait pas sinon un bonjour ou un bonsoir lorsqu’il croisait le maître ou la maîtresse de maison, au hasard de ses flâneries. Au petit matin, au cours de sa promenade quotidienne, il remarqua leur portail ouvert sur leur jardin désert et leur résidence étrangement calme, il dépêcha l’un de ses domestiques pour qu’il prévienne la police, avant de s’aventurer seul sur les lieux.
Mal lui en prit ! C’est là qu’il rencontra l’horreur et la barbarie extrême. Tout ce carnage le révulsa. Alors il recula et trébucha sur l’un des corps éventrés, glissa sur une flaque pourpre qui souillaient le parquet et s’étendit près des restes d’un enfant. Une vive émotion lui secoua les entrailles avant qu’il ne sombre dans les limbes.
2 Chapeau haut de forme à fond évasé.
3 Terme argotique : Estaminet, cabaret, gargote.
4 Terme argotique : L’ogresse est une tenancière de gargote, mais ce terme désigne également celle qui loue des vêtements aux prostituées.
5 Termes argotiques : Bouteille de vin.
6 Restes provenant de la desserte de la table des domestiques des grandes maisons.
7 Termes argotiques : La vieille.
9 Baptisé Boulevard Raspail depuis 1887.
10 Terme argotique : assassiner.
11 Terme argotique : enfants.
12 Terme argotique : ou Sorbonne, tête.
13 Terme argotique : bourreau.
14 Termes argotiques : bourgeois.
15 Termes argotiques : eau de vie.
16 Terme argotique : compagnon.
17 Dernier vestige du Marché aux esclaves de l’antiquité, elle fut rebaptisée « place de l’Hôtel de Ville » sous Napoléon III.
18 Voyou des grandes villes, malfaiteur prêt à tout (terme vieilli).
Remords (Bougie, 1914)
« Je vis, à sa façon d’enchaîner sa pensée, qu’il voulait corriger par les mots de la fin l’effet bien différent des premières paroles.
Mais malgré tout cela, son discours m’effrayait… »
Dante (Divine comédie – L’enfer)
« — J’ai passé mon existence à me tromper ! »
C’est par ces propos que Mohand poursuivit la seconde partie de son histoire. A cet instant, son visage poupin s’empourpra, les ridules autour de ses yeux étaient presque gommées par le délicat flot de lumière filtré par une fenêtre minuscule.
« — Ah ! si je pouvais remonter le temps pour changer notre destinée, l’arracher au sort. Aucun des actes, que j’ai semés au cours de ma longue vie, ne s’est épanoui pour m’apporter une quelconque fierté. »
Ali tenta de le tirer de sa mélancolie avec quelques paroles chaleureuses et affectueuses, en vain.
Peu après la prière de l’aube, lorsque les derniers lambeaux de nuit se dissipèrent, Mohand reprit, au bout du compte, sa narration d’un ton teinté d’amertume.
« — Te souviens-tu dans quelles circonstances nous aboutîmes, Baya et moi, dans cette ferme modèle qu’Aristide, mon ex-prisonnier, avait bâti19 ? Elle et moi avions trouvé là un refuge, un foyer ! Nous participions à la prospérité du domaine et nous y écoulions des jours paisibles et heureux. Lorsque vint la fin des moissons, elle et moi fêtâmes enfin nos noces.
A notre mariage, nous invitâmes tous les employés de l’exploitation ; je savais que certains d’entre eux me jalousaient, que quelques-uns avaient tenté de me discréditer aux yeux de mon associé, toutefois j’évitai de montrer quelque rancune ce jour-là, qui était pour nous exceptionnel et merveilleux. Je ne doutais point que, hormis Baya, seul Aristide me gardait une amitié indéfectible. Et ce fut réciproque, je l’aimais pour sa franchise, son honnêteté et son humanisme. A part lui, je ne connaissais pas d’autre colon qui sacrifierait son temps, et ses deniers, pour aider mes semblables. Aussi, quand je le vis surgir de nulle part, et venir vers nous, je ne pus cacher mon allégresse. Je me précipitai à sa rencontre et lui tendis les bras pour l’enlacer et l’inviter à prendre place à nos côtés ; mais son regard resta austère, ses traits fermés et il refusa de s’asseoir. Lui qui était d’habitude si jovial. Son attitude réservée me fit craindre le pire. Mille conjectures me vinrent, alors, à l’esprit : voulait-il me faire part d’une quelconque calamité, d’un nouveau drame ? A cet instant, j’étais loin de me douter que l’objet de ses soucis bouleversera ma vie à jamais.
Après quelques minutes, qui me parurent une éternité, il nous entraîna, Baya et moi, à l’écart de mes autres invités.
Il me dévisagea d’un air grave, puis il se décida enfin à parler. J’appréhendai le moment où il l’évoquera ! Il arriva, hélas, plus tôt que je le redoutais. Il teinta mon bonheur de grisaille.
« — Te souviens-tu de ta promesse ? Me demanda-t-il. » Je hochai la tête tout en éprouvant une horrible inquiétude, une émotion poignante ; je pensais au sacrifice qu’il s’apprêtait à me réclamer. Malheureusement, mes craintes étaient fondées. Il voulait que je l’accompagne en France, pour prêter assistance à une femme dont il était amoureux.
« — Je te suivrai n’importe où, car je te dois tout, lui répondis-je, cependant, je ne puis laisser Baya. Je ne peux l’abandonner. »
Il me répliqua qu’elle ne pouvait se joindre à nous, car l’armée n’acceptait pas de femmes20. Mes objections et mes arguments ne le convainquirent aucunement.
« — Qui nous oblige à nous rengager21 ? Après tout, rien ne s’oppose à ce que de simples civiles se rendent en France.
— Il est important qu’aux yeux de certains, nous passions pour deux officiers qui reprennent du service. De plus, cela nous facilitera considérablement l’accès aux informations judiciaires. »
Je me désolais de devoir abandonner Baya, la seule famille qui me reste, lorsqu’il m’assena une nouvelle ahurissante.
« — Tu retrouveras Baya à ton retour. Cependant, tu as une autre famille qui t’attend en France !
— Que veux-tu dire ? Lui demandai-je d’une voix qui trahissait mon abasourdissement.
— La personne, qui sollicite notre soutien, détient des informations importantes sur ta mère et tes sœurs. »
Je t’avoue, Ali, mon fils, que je garde toujours au cœur des chagrins cuisants ; je me sens si malheureux, de n’avoir su faire les bons choix, que si je pouvais retourner en arrière je serais le plus heureux des hommes. Je me trouvais embarqué dans une nouvelle aventure, dont je ne voulais pas. Je me résignai à partir, à laisser l’amour de ma vie la mort dans l’âme. Je désirai ardemment en sortir, mais comment ? Mon cœur se tordait dans les remords. Et mes pensées se brisèrent contre un mur d’incertitudes. Tu me diras que tout ceci est naturel, qu’il s’agit de ma famille : pas du tout !
Toutefois, si l’on m’avait demandé mon avis, j’aurais souhaité ne pas naître, cela m’aurait ôté bien des tourments.
19 Mortes utopies tome 1 : Kabylie sacrifiée.
20 Mortes utopies tome 1 : Kabylie sacrifiée.
21 Mortes utopies tome 1 : Kabylie sacrifiée.
Quand le destin vacille (Alger-Paris, 1867)
« C‘est l’endroit le plus bas et le plus ténébreux … alors l’attention fixée sur le haut de la tour à la cime embrasée, où je vis tout à coup se dresser trois furies, engeance de l’Enfer, toutes teintes de sang… Elles ceignaient leurs flancs avec des hydres vertes ; des touffes de serpents, pour toute chevelure »
Dante (Divine comédie – L’enfer)
Des cris et des éclats, qui leur parvinrent de la ville européenne, les distrayaient et obligèrent Mohand à se taire.
« — Aujourd’hui, je regrette certains de mes choix, poursuivit-il après un moment de silence, en ignorant cette agitation lointaine. Précisément, ma réticence à narrer la suite de ces vies gâchées, celle de ta mère et la mienne, vient de ce que je fus dupé. Oui, je fus abusé par l’Histoire, par mes amis, ma famille et par mes certitudes. Parvenu aux marches de l’au-delà, je veux, avant de mourir, remonter vers cet horrible passé et tenter de t’expliquer mon inexplicable légèreté, ma stupide irréflexion, mon absence d’esprit.
Les derniers mots qu’Aristide me lançait me paralysèrent, il me fallut un long moment avant d’en intégrer le sens. Je balbutiai horriblement, quand je pus parler à nouveau :
« — mais, mais… où… où cela ? Réussis-je, enfin, à articuler.
— A Paris, en France ! me rétorqua-t-il laconiquement ». Je m’appuyai contre un vieil arbre, pour ne pas m’effondrer, un figuier qui poussait à l’écart de ses semblables, comme un ermite ; tout de suite après, je me laissai glisser au sol, le dos contre son tronc. Ses feuilles frétillaient indifféremment sous le vent ; « que lui importait les malheurs de ce monde », pensai-je, rien ne le touche, et d’une certaine manière, je l’enviai. Au bout de quelques minutes, ou quelques heures, je pus poser une nouvelle question :
« — Comment les a-t-elle retrouvées ?
— Je ne puis rien te dire ! Le haut fonctionnaire, du ministère de la Guerre, qui lui a transmis ces renseignements, souhaite garder l’anonymat, car il craint de perdre son poste, voire d’être traduit en cour martiale. »
Une certaine mélancolie m’envahit, peu à peu. Plus tard, quand Baya et moi fûmes enfin seuls, je tentai de me justifier maladroitement. Plus je me répandais en explications et en excuses, plus elle semblait se renfermer, s’éloigner de moi comme une âme en peine.
« — Je ne peux faire autrement, ma tendre, lui répétais-je pour la énième fois, je dois les retrouver. Aujourd’hui, tu ne peux m’accompagner. Je suppose qu’il n’y a pas d’autres possibilités pour moi que de m’engager, dans le corps des zouaves22 ou des tirailleurs. »
Quelques larmes brouillèrent ses iris dorés, puis se déversèrent sur ses joues, qui pâlissaient et rougissaient tour à tour.
« — Te reverrai-je ? Me demanda-t-elle d’une petite voix enrouée. »
Je la serrai dans mes bras pour la réconforter, tout en lui susurrant quelques mots tendres à l’oreille comme nous avions l’habitude de le faire naguère, avant que les feux de l’ennemi ne se déchaînent.
« — Je reviendrai ! lui assurai-je, car je ne puis vivre sans toi, sois-en certaine.
— Tu m’avais déjà fait une pareille promesse, souviens-toi !
— Si tu le souhaites, je puis te le jurer sur le tombeau de mon père… »
Elle posa sa main sur ma bouche, pour m’empêcher d’ajouter le moindre mot.
« — Inutile de prêter serment sur ce que tu as de plus sacré, je te crois, me répondit-elle, si dans le passé tu n’as pas tenu parole, car tu pensais que j’étais morte ; je suis sûre que tu la respecteras à présent23.
— Aussi, comprends-moi, repris-je, mon devoir filial m’oblige à me rendre en France, retrouver ma mère et mes sœurs, je reviendrai dès que je me serai assuré de leur bien-être. Dans quelques mois, nous serons à nouveau réunis. »
Il faut dire qu’à cette époque une femme ou un homme qui n’honore point son serment était rejeté par sa communauté, et considéré comme un paria. Mais depuis les choses ont bien changé, hélas.
Malgré cela, notre nuit de noces fut torride et passionnée. Elle et moi refrénions nos désirs depuis trop longtemps.
Les dernières heures qui précédèrent mon départ furent parmi les plus effroyables de mon existence. Elle ne répandit aucune larme, elle ne hurla pas, elle n’exprima nul reproche, mais sa retenue était plus éprouvante que mille gémissements, son silence était plus bruyant que mille plaintes, plus blessants que mille blâmes. Nous restâmes un long moment côte à côte, nos mains étaient nouées, nos regards étaient arrimés, l'un à l'autre, par d’invisibles amarres. Devant l’insistance d’Aristide, qui me pressa d’abréger nos adieux, je les larguai à contrecœur. Un barbier s’occupa de moi, pendant qu’Aristide me choisit un costume dans sa garde-robe. Il avait tout prévu. J’étais coiffé à la française et, excepté une fine moustache, qui échappa au rasoir, j’avais le visage aussi glabre que la peau d'un nouveau-né. Je correspondais, paraît-il, en tous points au signalement d’un soldat disparu, dont je ne savais rien : le lieutenant Arnaud Lepierre, dont j’ai usurpé l’identité. Mais dès l’instant où je me fus affublé de ces accoutrements, lourds et encombrants, qu’affectionnent les Européens, sentant la naphtaline et l’eau de toilette, je devins méconnaissable et Baya en fut stupéfiée, presque effrayée.
« — N’avons-nous pas déjà endossé ces vêtements ? lui fis-je remarquer.
— Cette fois, c’est différent, me répondit-elle, tu t’en vas loin de moi. »
Elle avait raison, hélas !
De moins en moins rassurée, elle me fit promettre plusieurs fois de lui envoyer régulièrement de mes nouvelles. Elle ne fut totalement tranquillisée que lorsque je jurai de lui écrire toutes les semaines. Quand nous nous apprêtâmes à partir, elle se jeta à mon cou :
« — ne me laisse pas ! m’implora-t-elle. »
Je desserrai son étreinte tout en lui certifiant, une fois encore, que je serai de retour d’ici six mois, au plus tard. Puis, je mis mes effets dans une sacoche en lins, que je portais en bandoulière, et suivi Aristide, qui traînait un petit âne lourdement chargé à sa suite. Je lançai un regard désolé à Baya, qui s’était statufiée près du banc, derrière la maison, les yeux larmoyants et le sourire amer. À cet instant, je maudis le sort qui fit de moi un éternel voyageur, un apatride livré aux caprices du vent. En fin de journée, nous prenions du repos aux abords d’un faubourg algérois. Je revis en pensée cette magnifique ferme, où nous vécûmes heureux jusqu’à ce jour. Je me remémorai, surtout, le visage défait et assombri de Baya. Dans mon esprit, elle apparaissait presque comme une image jaunie et vieillie. Cela me terrifia, nous venions à peine de nous quitter que, déjà, elle s’apparentait presque à un souvenir. A cet instant, je réalisais, avec horreur, quel destin atroce était le nôtre.
Pendant cette halte, il me décrivit la vie l’homme que je remplaçai depuis quelques mois. Arnaud Lepierre était lieutenant d’infanterie, et servait dans le régiment des Zouaves. Il naquit et vécut en Bretagne, comme lui, une région de France dont j’ignorai l’existence avant qu’il m’en parle. Qu’est-ce qui le poussa à s’engager pour l’Algérie ? Vraisemblablement un sergent recruteur qui l’avait mystifié, avec une de ses fallacieuses histoires sur les colonies. Il perdit la vie non loin d’ici, près du lieu où fut perpétré le massacre de mes compagnons d’infortune ; parmi eux se trouvait celle qui fut pendant quelque temps mon amante, la tendre Tiziri24. Mais est-ce une ironie du destin ? Cet homme qui me ressemblait, cet homme dont je pris la place pour échapper à la guillotine, fut peut-être tué par moi !
Nous nous remîmes en route une heure plus tard. Tout en cheminant, côte à côte, nous continuâmes à discourir.
« — Vous avez évoqué « des événements graves et inattendus », il y a peu, qu’entendez-vous par là ? Quelle est cette femme « si importante » qui réclame notre aide ? » Il tira une bouffée sur sa pipe, son regard se perdit dans les frondaisons. Au lieu de répondre à mes questions, il me fit part de ses inquiétudes en prenant un air ennuyé : « — La politique de l’empereur va précipiter la France dans la guerre, la France n’est pas prête à soutenir un nouveau conflit contre une autre puissance européenne. »
Comme il lut de la perplexité sur mon visage, il ajouta :
« — Dans le pays où nous allons, vous évoluerez en terrain inconnu, dans un monde que vous ne comprendrez pas. Voyez-vous, mon ami, là-bas la société est dirigée par l’argent et certains cercles de pouvoirs qui se confondent avec les détenteurs de fortunes. Là-bas, tous ceux qui sont au sommet feront tout pour le demeurer ; même s’ils devaient, pour cela, sacrifier le reste de l’humanité. »
Tu ne peux savoir combien ses phrases me parurent obscures, sur le moment, et ces concepts complètement abscons. Plus tard, bien plus tard je compris le sens de ses propos, quand le destin me confronta aux habitants de cette France inconnue, à plusieurs centaines de lieues du pays où je suis né. A cette époque, il ne m’en dit pas plus. Par la suite, lorsque nous fîmes halte près d’un cèdre centenaire, c’est à peine s’il prononça deux ou trois paroles, il était perdu dans ses pensées. Il me faisait l’effet d’un être méditatif, dont l’esprit vagabondait selon sa fantaisie parmi les étoiles.
Alger, la fabuleuse capitale, dont on prétendait, jadis, qu’on y avait bâti mille minarets qui s’élançaient vers l’azur, jusqu’à percer les nues. Alger, mélange d’architecture haussmannienne rigoureuse, structurée et de la Casbah, la ville turque, désordonnée et indisciplinée. Toutes deux d’une blancheur éclatante, qui illuminait le ciel, presque autant qu’un soleil d’été. Parmi toutes les cités que j’ai visitées jusque-là, Alger était la plus somptueuse et la plus imposante aussi.
Quand nous dépassâmes l’une de ses immenses portes, je me sentis ridiculement petit, minuscule, écrasé par tant de gigantisme. Tous les immeubles, jusqu’à la moindre bâtisse, percée d’un nombre incommensurable de fenêtres, s’alignaient parfaitement le long des rues, comme des soldats au garde-à-vous. Toutes les voies étaient pourvues de vastes trottoirs, revêtues de granit, dallées comme la cour d’un palais ; elles étaient si propres, que l’on s’y serait couché. Elles apparaissaient tantôt laiteuses, tantôt grisâtres, selon que le soleil s’en empara ou pas. Des cabriolets, des carrosses de toutes tailles et des charrettes se répandaient en tous sens dans ses artères. Je pensai, en levant les yeux vers ses blanches façades, que toutes les décisions, nous concernant, venaient de derrière ses murs. J’appris subséquemment qu’un groupe restreint de personnes, résidant en France, dans de somptueuses demeures, contrôlent réellement, et dirigent toujours, nos misérables destinées. Je n’eus pas le loisir de m’attarder dans cette ville magnifique. En revanche, comme dans toutes les cités que j’ai visitées depuis, j’ai souvent remarqué que d’infâmes bouges succédaient aux beaux quartiers. Nos pas nous menèrent tout d’abord vers la Casbah. Ses immeubles nous apparurent beaucoup moins somptueux que les précédents. Ils étaient essentiellement peuplés d’indigènes ou plutôt de ses anciens habitants : des Turcs, des mercenaires, des janissaires, des Kouloughlis25 et, aussi, des descendants de morisques, de chrétiens et de juifs sépharades chassés d’Espagne par l’inquisition. Cette ville dans la ville était parcourue par un dédale, un lacis inextricable de ruelles étroites et tortueuses ; un véritable labyrinthe où je m’y serais perdu, sans Aristide. Néanmoins, cet endroit ne ressemblait en rien aux immondes torchis, empilés aux portes des grandes cités, où les nôtres s’entassaient. Malgré leurs façades défraîchies, voire lépreuses, je sentis que ces lieux dissimulaient un passé sombre, trouble.
Nous nous engageâmes dans un passage exigu, une venelle nauséabonde, où flottaient d’horribles pestilences qui m’indisposèrent ; puis, après une courbe, nous aboutîmes sur une voie foisonnante de monde. Je n’exagère pas, nous nous heurtâmes à toute une foule bruyante, cosmopolite ; je vis même quelques Européens perdus dans cette multitude, le visage hagard, ne sachant ce qu'ils font là, dans cette fourmilière ; égarés parmi une masse grouillante de mendiants aux mains décharnées, toujours tendues, ouvrant une bouche distordue par de vaines suppliques ; sans compter les camelots brandissant des toilettes surannées qu’ils enrobent de louanges ; des chalands bavards, affublés de costumes exotiques ou de loques, ne comprenant pas, au fond, ce qu’ils sont venus faire en ce lieu. On remarque, également, ces femmes souvent pubères, enveloppées dans de larges voiles, au travers desquels se devinaient leurs formes sensuelles, qui aguichaient les passants par des chuchotements langoureux, ou une jambe nue qu’elles exhibaient nonchalamment, ou encore des clins d’œil équivoques. A peine sorties de l’enfance, elles proposaient de partager leur couche pour quelques sous. Tout cela m’apparaissait d’un pathétique affligeant et cruel. Dans ce fatras d’humanité, émergeaient aussi les prédicateurs, car ils étaient les plus visibles et les plus virulents. Ceux-là s’égosillaient, à longueur de journée, à lancer des prêches enflammés, promettant un paradis hypothétique aux vrais croyants ; un endroit où couleraient des rivières de lait et de miel, un lieu peuplé de jeunes houris, à la peau blanche, éternellement jeunes, éternellement vierges, éternellement lascives, éternellement charnelles. C’est un signe des temps ! Ces boutiquiers de l’obscurantisme, ces hérauts séculaires du vieux monde, pullulaient dans les villes et les campagnes de l’Algérie conquise. Ils semaient à tous vents leurs discours aberrants, en affichant de manière ostentatoire leur religiosité qui peinait à cacher leur âme perverse. Je me désolai de voir mon peuple prêter l’oreille à toutes ces inepties ; avaient-ils oublié qu’hier encore, ces hommes les avaient vendus pour un burnous d’investiture26 ? Je marmonnai, à mon insu, en conjecturant sur la bêtise humaine. Aristide, tout sourire, me sortit de mes pensées. Il m’expliqua à voix basse :
« — Ce que nous avons donné d’une main, nous l’avons repris de l’autre. De ce fait, ils utilisent la religion, à leurs fins, pour accroître leur aura, pour manipuler les vôtres, pour se servir de leur désespoir afin de faire pression sur nous à leur profit. Ce qu’ils font en vain. Néanmoins, l’empire n’y voit rien de répréhensible, du moment qu’ils prônent la résignation et la soumission aux autorités. D’ailleurs, l’Empereur n’est-il pas le protecteur de la foi des musulmans ? »
Tandis qu’il me disait tout cela, je ne pus m’empêcher de penser à Fadhma, à tous mes pauvres compagnons sacrifiés pour rien. Que sont les hommes ? Des êtres changeants, dont les sentiments et les croyances varient au rythme des saisons, des modes et des circonstances.
« — Sais-tu que ces gens valent moins que chacun de ceux qui luttaient à mes côtés ? Lui fis-je remarquer. »
Son regard clair s’attarda longuement sur ma veste boutonnée de travers et ma cravate défaite.
« — La société est ainsi faite, me répondit-il, certains hommes donnent le meilleur d’eux-mêmes, puis disparaissent, souvent de manière tragique. Pour survivre le système, qu’ils combattirent, récompense ses valets obséquieux et ses pâles courtisans. Je sais que tout cela est inique et te révolte à juste titre, mais mon monde, notre monde, est naturellement injuste. »
Telles sont, à peu près, ses paroles. Je ne puis te les répéter avec exactitude, mais si je te dis qu’elles ne m’influencèrent aucunement, ce serait un mensonge.
Perdu dans mes pensées, je réalisai à peine que nous venions de quitter la ville. Nous traversâmes un endroit délaissé, abandonné, un lieu infâme, où hommes et bêtes vivaient ensemble, où les immondices corrompaient l’air et s’entassaient sur la chaussée. En fait de rues, ces chemins misérables n’en avaient que le nom ; des bouges indescriptibles s’y succédaient, tout au long, jusqu’en haut de la colline, comme autant d’enflures. Quelques jeunes gens assis, à même le sol, sur le pas de leur porte semblaient résignés devant leur dénuement extrême ; ils ne nous remarquaient même pas, comme si nous étions invisibles. Seules les femmes, dissimulées sous des voiles sales et grisâtres, nous tournèrent le dos pour aller se cacher dans leur sordide logis. J’eus mal pour elles, pour elles et toutes les autres ; il y a peu de temps encore, on les respectait et nombre d’entre elles étaient glorifiées et portées aux nues ; aujourd’hui, les voilà cloîtrées dans leur prison, dans leur gourbi, dans leur misère, dans leur vie dégradante en ce monde nouveau. J’eus mal pour ce peuple, si généreux et si vaillant dans le passé, maintenant égoïste et couard.
Nous quittâmes ce lieu sans nom et sans futur, pour nous aventurer dans la garrigue ; en cet endroit, il y a peu, on y plantait des oliviers, on y élevait des ovins, à présent il n’y subsiste que quelques broussailles. Peut-être que les nouveaux maîtres en feront quelque chose ou peut-être pas. Pour un enfant de la terre, comme moi, de voir cela me désolait profondément.
Avant que la nuit ne se propage, telle une fumée sombre, dans tous les recoins du pays, nous nous arrêtâmes devant une imposante silhouette en pierre grise, qui nous barrait le passage. Sa façade haute et austère semblait absorber les ombres naissantes. Nous nous dirigeâmes vers un portail de fer monumental, gardé par des tirailleurs. Ils étaient engoncés dans leur uniforme bleu et rouge, aux accents orientaux ; ils se moquaient, en kabyle, de mon costume trop ample et mal mis en pensant que je ne comprenais pas.
Deux d’entre eux nous barrèrent le chemin et aussitôt un gradé apparut, comme par magie ; à la différence des autres soldats, il portait une vareuse marine, un pantalon européen écarlate et un képi rehaussé de dorures. Aristide lui glissa quelques mots à l’oreille, tout en lui confiant un pli. L’officier le lit attentivement avant de le lui rendre. Il fit un signe à ses hommes, qui s’écartèrent promptement. Le soleil couchant s’empara de leur chéchia, de leur sarouel27 et de leur boléro, pour projeter au sol leurs silhouettes grotesques, dont les pantomimes rappelaient un théâtre d’ombres, sans paraître aussi drôles.
Ils ouvrirent le lourd portail pour nous laisser le passage. Evidemment, à cause de nos vêtements civils, ils ne nous gratifièrent d’aucune autre considération. Nous confiâmes notre âne à un palefrenier, qui le mena aux écuries, nous traversâmes un second corps de garde puis nous nous engageâmes dans une cour immense.
Tout me donnait l’impression que je pénétrai dans une fourmilière. Quel que soit le lieu, où que mon regard se porte, je voyais des hommes occupés à d’étranges besognes. Là, des soldats vêtus d’uniformes bariolés défilaient dans un ordre parfait. Dans quel but ? A l’époque, ce comportement me laissait songeur et dubitatif. A l’écart, des sous-officiers les observaient d’un œil satisfait. Ailleurs, d’autres s’exerçaient au maniement de leurs effroyables fusils à baïonnettes, répétant les mêmes gestes indéfiniment. Plus loin, des clairons lançaient l’appel du soir.
Aristide me donna l’impression de connaître les lieux parfaitement, il me mena vers un grand immeuble, sans hésiter un instant. Nous y pénétrâmes en passant sous un porche de pierre, identique à ceux des mosquées, ensuite il m’entraîna à travers une multitude de couloirs et de galeries. Nous y croisâmes une foule innombrable d’hommes en uniforme, visiblement pris par quelque tâche obscure. Certains, chargés de dossiers, entraient ou sortaient d’une infinité de portes, qui s’ouvraient ou se refermaient avec une régularité de métronome.
Notre course débridée nous mena, finalement, devant un bureau. Aristide frappa et poussa le panneau sans attendre la réponse. Ensuite, nous pénétrâmes dans la pièce meublée d’une table derrière laquelle était assis un jeune soldat, occupé à trier des fiches en papier cartonné, je me souviens qu’il sentait fortement l’eau de toilette. Il interrompit sa tâche et leva la tête vers nous. Il nous toisa un moment, puis il nous demanda quel était l’objet de notre visite. Au moment où Aristide lui remit son pli, il se redressa, il endossa son képi, puis, d’un geste aussi raide qu’un minaret, il nous salua gravement. Nous en fîmes autant. Aristide m’avait fait répéter maintes fois cette gestuelle, avant notre départ. L’homme nous pria de patienter quelques instants, puis disparut aussitôt derrière une issue dérobée que j’avais confondue avec la cloison. En fait, l’attente dura plusieurs heures. Lorsqu’il revint, je me réjouissais de découvrir, enfin, ce que dissimulait cette étrange porte. Hélas, il nous devança vers l’entrée qui menait vers l’un de ces horribles corridors. Je fus fasciné par tout cet exotisme, la contre-porte, ces longues galeries percées d’une multitude de fenêtres et de portes, qui débouchaient on ne sait où, sans compter cette fourmilière humaine parfaitement organisée. Toutes ces choses inhabituelles me donnaient le vertige. Après une équipée, qui me semblait interminable, après maints détours, il s’arrêta devant une ouverture à double battants, imposante, tout en moulures et en dorures. Il tira sur une chaînette, suspendue sur le côté droit, et attendit patiemment, tandis que la chaîne continuait son tressautement. Comme la réponse tarda, il s’apprêta à renouveler l’opération, quand il se ravisa ; peut-être craignait-il la réaction de l’homme qui se trouvait derrière la porte. Moi j’estimai, compte tenu de ses dimensions, qu’un géant devait y résider. Un grognement bref, poussé d’une voix tonnante et sèche, me fit sursauter. L’officier d’ordonnance ouvrit l’un des panneaux, nous le suivîmes tandis qu’il franchissait le seuil d’une immense pièce. Mon regard la parcourut rapidement, et s’attarda sur une grande carte d’état-major, accrochée au mur. Elle représentait l’Algérie, c’est à cet instant que je lus ce nom pour la seconde fois. Je me fatiguai la vue en vain à vouloir comprendre la logique des lignes, des contrastes et des taches de couleur qui la couvrait ; quand la puissante voix de notre hôte me sortit de mes pensées.
Le colonel était un homme affable, entre deux âges, il devait approcher la cinquantaine, il avait les tempes grisonnantes et avait un nez fort, un visage plat, les yeux resserrés, les sourcils broussailleux, de longues moustaches et une barbiche au menton. Ses cheveux bruns qui bouclaient, sur le côté, et le monocle qu’il portait à l’œil droit lui conféraient un air aristocratique. Il nous toisa de biais, comme s’il se défiait de nous, comme s’il redoutait quelque mauvais coup. Le ton de sa voix était dur, il nous abreuva de mots blessants, avant de se calmer. L’officier d’ordonnance en profita pour disparaître. Mais je vis que le colonel bouillait intérieurement. Il s’adressa à Aristide en des termes polis, mais offensants.
« — Delhomme, tonna-t-il, vous avez quitté l’armée pour vous lancer dans l’agriculture. Ah la bonne affaire ! Que s’est-il passé, pour que vous reveniez, vous vous êtes lassé des moricauds ? Vous faites selon votre bon plaisir, vous pensez peut-être que nous devons nous plier à vos caprices ? »
Il prit, sur son bureau, la lettre qu’Aristide avait remise à l’officier d’ordonnance et il la brandit.
« — Malgré vos soutiens, je tiens à préciser, commandant, que l’armée ne souffre pas l’amateurisme et encore moins les touristes. »
Sans attendre une réponse, qui ne vint pas, il reporta directement sa fureur sur moi.
« — Quant à vous, Lepierre, vous me faites honte ! »
Il ne cachait point son mépris.
« — Nous vous croyions mort au champ d’honneur, alors que vous vous trouviez dans les bras d’une de ces souillons d’indigènes. »
Il ne fit même pas mine de dissimuler son dégoût. Cette fois, il ne se retint pas, il fulminait de rage.
« — Nous vous rendîmes les hommages militaires, comme il sied à tout officier, à tout soldat, victime du devoir. Vous ne faites pas honneur à votre compagnie, à votre rang, à notre armée, à notre empereur ! Avant que je décide de votre sort, répondez à ma question : pourquoi êtes-vous revenu, elle vous a laissé pour un de ces sauvages, mieux pourvu que vous ? À la suite de cela, réintégrez-vous l’armée pour oublier votre chagrin ? »
Il jeta rageusement la lettre sur le bureau.
« — J’en ai assez, continua-t-il, l’armée impériale n’est pas un refuge pour les aventuriers ou amoureux blessés. Etes-vous conscient que vous risquez la cour martiale et le peloton d’exécution ? »
Contrairement à ce que mon silence laissait croire, autre chose occupait mon esprit. Je venais de comprendre que « la souillon indigène », qu’il souillait de ses mots, n’était autre que Baya. Je bouillais de rage et étais torturé, en même temps, par la curiosité. Pendant un moment, j’étais comme suspendu entre ciel et terre, j’étais partagé entre questionnement et colère, ne sachant quelle conduite tenir. Comment connaissait-il son existence ? Puis, ma main glissa furtivement vers un coupe-papier, posé sur un tas de lettres. Le mouvement de mon bras n’échappa point à l’attention d’Aristide, qui l’arrêta.
« — Mon colonel, s’exclama-t-il soudainement, le lieutenant Lepierre fut grièvement blessé, et abandonné sur les lieux du charnier, où tant de nos valeureux soldats sont tombés. Laissé pour mort, il ne doit la vie qu’à l’intervention courageuse de cette indigène, que vous évoquiez à l’instant ; cette dernière est membre d’une tribu amie. Les parents de cette jeune fille accueillirent notre compagnon d’armes, ils le soignèrent comme l’un des leurs. Sa guérison est miraculeuse, mais, hélas, consécutivement à ses traumatismes, il souffre d’amnésie. Je l’ai rencontré, par hasard, lorsque mes affaires me menèrent sur le versant nord du Djurjura. Méthodiquement, patiemment, je pus raviver quelques souvenirs dans son esprit troublé. Je lui rappelais qui il était, son engagement sous nos drapeaux pour notre pays, La France. »
Aristide se tut et, aussitôt, la pièce fut plongée dans un silence de mort. Silence que le colonel se garda bien de rompre, il se laissa choir sur un fauteuil en cuir, accolé à une grande table. Il tendit la main et prit l’un des rouleaux de parchemin, qui s’entassaient sur l’un des pupitres, à côté de lui ; il l’examina et l’étala devant moi, sur le bureau. Il posa l’index sur l’une des nombreuses taches de couleur cendre, figurant un endroit précis sur le plan.
« — C’est à cet emplacement qu’eut lieu l’embuscade. » Ce n’était pas une question, une indication tout au plus, néanmoins je hochai lentement la tête, pour corroborer ses propos ; bien qu’à l’époque je n’entendisse rien à ces tracés noirs ou grisâtres, dessinés sur une planche appelée cartes d’état-major, désignés par des noms ou des numéros. Il ne dit plus aucun mot ensuite. Derrière lui, accroché au mur, pendait un sabre à la garde dorée. Après qu’il l’eut extrait de son étui richement ouvragé, son regard m’effleura.
« — Mon fils était avec vous, lâcha-t-il, avant de nous ordonner de nous retirer, d’un ton plus martial. »
Nous sortîmes du bureau et, d’emblée, Aristide repartit dans la direction opposée à celle que nous avions prise et je lui emboîtai le pas. Nous nous aventurâmes dans un corridor étroit, sans fenêtre, qui paraissait sans fin, jusqu’à ce que nous débouchions devant une autre porte monumentale. Contrairement à la précédente, aucune décoration ne s’ajoutait à sa démesure. Je m’apprêtai à frapper, quand Aristide me retint.
« — souviens-toi que tu es amnésique, me souffla-t-il en rivant son regard acier sur le mien. »
Il actionna la poignée du battant, nous pénétrâmes dans une immense salle, bruyante et enfumée. Des nuages bleuâtres et denses, que la lumière peinait à percer, planaient au-dessus de nos têtes ; je suffoquais alors que j’étais moi-même fumeur. Mais ce mélange de senteurs chaudes et froides formait un effluve insupportable. Pourtant, personne ne semblait incommodé. Certains étaient accoudés au bar, tandis que d’autres suivaient, avec intérêt, les parties de billard, qui se disputaient autour de deux grandes tables recouvertes de tapis verts. Progressivement, ils s’en détournèrent. Une centaine d’hommes nous rivèrent de leurs regards à la fois torves et stupéfaits. Je pouvais presque y contempler mon reflet, qui s’insinuait entre curiosité malsaine et questions inquisitrices.
Nous passâmes près d’eux tout en les saluant courtoisement. Certains nous reconnurent et se contentèrent de grimacer, ou de nous lancer de vagues paroles, tandis que d’autres nous jetaient des coups d’œil suspicieux. Je ne sus jamais si leur méfiance et leur agressivité étaient dues à nos vêtements civils ou aux allégations qui pesaient sur moi.
Puis, un à un, comme si de rien n’était, ils reprirent le cours de leur activité. J’observai un joueur qui s’échinait, à faire se percuter trois boules entre elles. Celles-ci bondissaient sur les bordures en suivant des voies aléatoires, malgré toute son application à vouloir les aiguiller selon un schéma précis. A cet instant, Aristide me laissa et se dirigea vers un haut gradé. Il le salua, puis lui parla longuement.
Après avoir patiemment écouté mon ami, ce dernier hocha gravement la tête, se leva et réclama l’attention de tous. Cet homme devait jouir d’une forte aura auprès des siens, car tous se turent et cessèrent toute besogne pour tendre l’oreille. Il toussota, se racla la gorge, tous étaient suspendus à ses lèvres ; au bout de quelques minutes, enfin, il parla d’une voix chevrotante, mais sèche et impérative, pour dissiper les rumeurs mensongères qui pesaient sur ma personne ou plutôt sur l’infortuné lieutenant Lepierre.
Aussitôt des officiers de tous rangs, que je ne connaissais pas, vinrent me souhaiter un bon retour et un parfait rétablissement. Curieux, pensai-je, à quel point les sentiments et les opinions des gens sont interchangeables. Il suffisait qu’une individualité détienne quelque influence pour les piloter à sa convenance.
Tu remarqueras que les soldats sont imprégnés de tradition militaire, qui prête au plus haut gradé un fort charisme, un grand ascendant sur tous. Mais qu’en est-il de mon peuple ? Qu’en est-il des hommes libres28 ? Ceux qui, hier encore, ne reconnaissaient nulle autre autorité que la leur, au point d’éconduire l’émir venu leur imposer sa loi. Je constatai à quel point ils ont changé ; à présent, ils se soumettent gracieusement au moindre bonimenteur ou faiseur de miracles. Je les vis dociles et facilement manipulables, par l’administration, les colons, les bachaghas, les caïds, les marabouts, les ulémas et tout ce qui possédait un brin de pouvoir, parmi cette ploutocratie, ce gotha du Nouveau Monde. Ils me faisaient l’effet d’orphelins, prêt à suivre le premier quidam, qui leur garantit un espoir ou une promesse autant éphémère que mensongère.
Mouillés dans une rade, près d’Alger, en un lieu isolé, attendaient un grand clipper29 et un vapeur. Malgré l’éloignement, nonobstant l’heure matinale, une foule de badauds vint nous acclamer. Nous embarquâmes dans le bateau à aubes sous leurs vivats. Le navire, lui-même, gonfla le panache de fumée gris et blanc qui s’échappait de son incommensurable cheminée, telle une gigantesque voile, comme s’il voulait se joindre à la multitude qui nous ovationnait.
Avant que je ne m’en avise, le voilà glissant sur les vagues écumeuses teintées d’émeraude et de saphir, déchirant une mer aussi chiffonnée que du papier froissé. Jusque-là, je n’imaginai pas qu’elle fut si vaste, et je pris peur. Je m’agrippai au garde-corps du pont tout en jetant un regard craintif alentour. Tout autour du paquebot, les flots olivâtres et céruléens s’étiraient vers des azurs lointains où ils se paraient d’indigo.
Aristide ne me laissa guère le loisir de scruter cette immensité aqueuse. Il m’entraîna jusqu’à nos quartiers, pour que nous en prenions possession. Les soldats et les sous-officiers s’installèrent où ils purent : dans la soute, sur le pont ou dans le réfectoire ; les officiers bénéficièrent d’un meilleur traitement, Aristide et moi eûmes droit à une cabine pour quatre personnes, un luxe ! Des lits superposés étaient disposés de part et d’autre du hublot. A gauche de la porte, un petit secrétaire était coincé contre l’un d’eux ; il servait, ainsi que l’unique chaise de la chambrée, à supporter notre équipement. Une table de toilette, fixée sur le mur opposé, supportait une bassine en étain et un broc en argile rempli d’eau. Je m’allongeai immédiatement sur l’un des lits bas, quand je m’éveillai, tard dans la soirée, les autres couchettes étaient occupées par Aristide et deux officiers que je ne connaissais pas. Je me débarbouillai et je sortis prendre l’air sur le pont supérieur. La mer était agitée. De partout déferlaient des vagues monstrueuses, qui rappelaient d’immense colosses façonnés à partir de flots noirs et d’écume scintillante, qui cernaient notre navire. Enveloppé dans un brouillard aqueux, il tanguait de gauche à droite, selon le bon vouloir des éléments. Mon regard se troubla, j’étais presque étourdi, je redescendis dans la cabine, non sans difficulté, puis je me recouchai sur-le-champ. Plus tard, la tempête se calma, le ballottement du bateau me berça, lentement, comme un enfant dans un couffin. Tout le jour, je sentais un malaise, inconnu jusque-là, une alternance de chaud et de froid, la tête lourde et l’estomac retourné. Le surlendemain, quoi que je fasse, je ne pus surmonter le mal qui m’étreignait.
Cependant, lorsque le beau temps s’imposa définitivement, les vapeurs délétères s’estompèrent comme un mauvais rêve. Je me levai à grand-peine. Ensuite, je restais un moment assis avant de m’avancer vers le miroir, fixé au-dessus de la table de toilette, pour y scruter mon reflet. Mon visage était hérissé d’une barbe disgracieuse qui me creusait les joues en les peignant de nuances bleuâtres. Je rasai cette pilosité hideuse, puis je me rafraîchis la face et les aisselles à l’eau froide. Ce débarbouillage suffit pour que je reprenne mon assurance, et pour me revigorer. Par le hublot, je vis au loin une forme massive et foncée qui se détachait de l’horizon, nous approchions de la France.
Le navire frôlait à peine la surface des flots, à présent bleuissant. Sous cette douce plénitude, cet agréable glissement sur la mer, mon âme vagabonda et des scènes plaisantes me revinrent à l’esprit, mon village, accroché à une crête entre les monts et les nues, puis Baya. Elle était là, en fait, elle hantait toutes mes pensées, tout le temps, même lorsque mon esprit s’immergeait ailleurs, dans cet inconnu. Alors mon cœur se meurtrit, la contrition et la morosité m’envahirent ; pourtant, pas une fois l’idée de lui écrire, de lui faire parvenir de mes nouvelles ne m’effleura. Pour me donner bonne conscience, je me répétai, à moi-même, pour la énième fois, que mon absence sera brève et que nous nous retrouverons dans deux ou trois mois. Bientôt, Marseille apparut comme une oasis perdue entre ciel et mer et ma mélancolie s’évanouit. Le soleil étincelant jouait avec ses ombres qui se pelotonnaient au fond de ses rues, ornant ses façades de mille et un reliefs, peignant ses toits de traînées ocre et écarlate. Quelle ville fascinante ! Hélas ! De cette cité, je ne vis pas grand-chose, notre troupe la traversa au rythme endiablé du tambour et au son strident du clairon. Sur chaque boulevard giclaient des brassées de vivats et des charmantes passantes nous illuminaient de leurs sourires délicieux ; le tout était agrémenté des chants patriotiques des flâneurs éméchés. Ce jour-là, j’entendis le sobriquet de « Turcos30 » pour la première fois. Les promeneurs hurlaient « Vives les Turcos ». Ne t’ai-je pas dit déjà que le destin peut être espiègle, à certains moments ? En effet, les gens nous appelaient du nom de ceux que nous avions combattus, avec acharnement, avant l’arrivée des troupes françaises. Une bourrasque soudaine se leva, déséquilibrant le joueur de grosse caisse. La fanfare s’arrêta immédiatement et nous poursuivîmes notre chemin sans musique, les rangs clairsemés, désorganisés, luttant contre le vent, tandis que les badauds, les jolies femmes