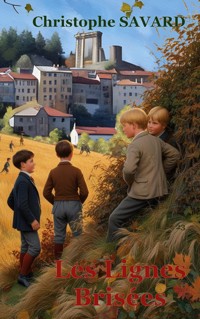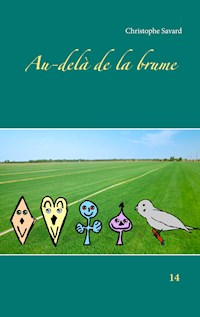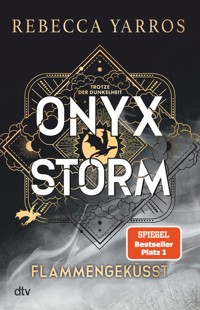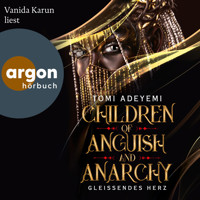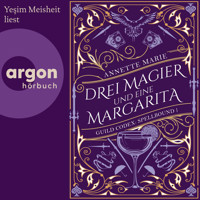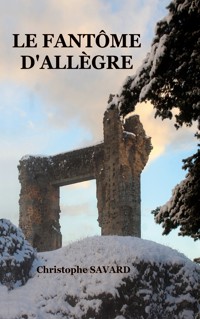
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: ouvrages de Christophe Savard
- Sprache: Französisch
Je me sens presque renaître... Non ! Ce n'est pas cela. Lorsque l'on vient au monde, on ne sait rien. On n'a même pas conscience d'être un enfant de Dieu ! Je vais enfin savoir... Bizarre. Ce qui vient maintenant me semble surprenant. J'ai l'impression de me trouver à plusieurs endroits à la fois. C'est comme si je me trouvais dans les environs de Grazac, dans le bas de la vallée, mais également au sommet du volcan, tout en étant également dans une de ces forêts à champignons situées à une lieue au Nord d'Allègre ! Je ne comprends pas. Suis-je mort ou suis-je vivant ? Je me sens comme éclaté en des milliers de morceaux, en une multitude de fragments de moi... pourtant avec une conscience une et indivisible. Et puis, du néant surgit la lumière. Celle que j'attendais vient enfin à moi. Tout est tellement lumineux que je ne perçois plus rien. Je ne ressens plus rien non plus. Je suis prêt ! Si je le pouvais, je cesserais de respirer et je fermerais les yeux. Mais ce sont désormais des sensations que je ne pourrai plus jamais ressentir !
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DU MÊME AUTEUR
Anticipation :
La Cueillette
Albert's Brain
De Glaise et de Sang
Les Chevaliers de l'apocalypse
Chasse aux Loups
Un Monde Paisible
AdamS et Eve
La Ballade de Woinic
La Butineuse
La Caverne Oubliée
Au-delà de la brume
La Cité d'Arèv
Dégénérescence
Sommeil de Plomb
Dea Arduinna
Poésie :
Une vie d'Alexandre
Biographies :
Nouveau Chemin
Incarnation
Amalia
Technique :
Le stockage de l'énergie électrique
Merci à André Louppe pour tous les éclairages historiques qui ont permis à ce roman d'anticipation de s'inscrire dans un cadre réaliste et plausible.
Sommaire
PREAMBULE
ACTE 1 – CULPABILITE
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
CHAPITRE 4
ACTE 2 – DEVENIR FANTÔME
CHAPITRE 5
CHAPITRE 6
CHAPITRE 7
CHAPITRE 8
ACTE 3 – LES PLAISIRS DE HANTER
CHAPITRE 9
CHAPITRE 10
CHAPITRE 11
CHAPITRE 12
ACTE IV – COMBAT ENTRE LES DEUX MONDES
CHAPITRE 13
CHAPITRE 14
CHAPITRE 15
CHAPITRE 16
ÉPILOGUE
PREAMBULE
Eudes, du haut de ces dix étés, court dans la rue du centre du village. Si, habituellement, à cette heure, de nombreux badauds vaquent à leurs occupations, ce n'est pas le cas en ce jour si particulier.
Si Eudes est si pressé, c'est parce qu'il a été retenu par la mégère chez qui il s'occupe des poules. Et comme, jamais, elle ne sort de sa demeure en dehors des dimanches – et ce pour exclusivement se rendre aux offices religieux – rien ne l'incitait en ce jour à déroger à sa discipline légendaire. Pourtant, le gamin a bien entendu les cloches sonner l'annonce de l'événement du jour, du mois, de l'année. Il a pesté : alors qu'il n'avait pas encore répandu tout le grain dans l'étable, tout le monde se rendait devant la place à l'entrée du château. Alors, il s'est dépêché à répandre le grain, sous la surveillance de la bourgeoise, sans pour autant négliger sa tâche. Il est juste parti en vitesse, en expliquant que pour rien au monde il ne manquerait le « spectacle » offert au bon peuple d'Allègre en cet an de grâce 1497, en précisant qu'il demanderait sa solde seulement le lendemain. Et avec l'espoir que la rombière n'ait pas oublié qu'elle ne l'avait pas payé !
ACTE 1 – CULPABILITE
CHAPITRE 1
Dans la foule, un mouflet parvenait à peine à se glisser entre les corps mouvants des badauds, accompagnant le cortège en chemin, pour voir passer le condamné. Ce dernier l'aperçut néanmoins au milieu de toute cette lie. Malgré la souffrance qui se lisait sur son visage meurtri et malgré les divers résidus de toute sorte – allant des simples fanes de légumes au contenu peu alléchant d'un pot de chambre – l'homme fixa l'enfant un instant. Eudes supporta son regard. C'était comme s'il parvenait à sentir ce que ressentait le supplicié, comme s'il était en communion avec lui, comme si leurs esprits parvenaient à échanger. En un instant, Eudes ressentit la douleur, la peur, l'humiliation, l'incompréhension et le regret. De son côté, le condamné esquissa un sourire, ce qui entraîna encore plus d'animosité dans la foule en retour, interprétant ce signe comme un défi à leur endroit. Pourtant, Louis, par ce sourire, ne cherchait en aucune manière à offusquer la foule des mécontents, des haineux et des jaloux. Non, il venait simplement de ressentir l'innocence, la curiosité et l'incrédulité qui émanaient de l'enfant.
Louis reçut un coup d'un badaud : le manche d'un outil le frappa au bas ventre. Il cessa de sourire et accusa le coup, tombant à genoux. Les deux gardes qui étaient censés lui éviter d'être lynché par la foule en délire l'obligèrent à se relever, usant pour cela de toute leur force physique en lui assénant à leur tour de nombreux coups de bâton sur le dos.
Un instant arrêté, la procession reprit son cheminement qui partait de la prison, installée dans la ville-basse de Grazac (héritière de la cité romaine de Grazacum), implantée au pied du vieux volcan éteint. Le calvaire se terminait aux pieds du château, devant une potence improvisée, dressée sur la place, entourée des bâtiments perchés au plus haut de la ville-haute. Une potence qui permettrait – comble de l'ironie – au supplicié de profiter du spectacle qui l'avait incité à demeurer en cette bonne ville du Velay : une vue imprenable sur la plaine et les monticules, des lieues à la ronde, allant presque jusqu'à la sainte ville du Puy-Sainte-Marie. Depuis l'entrée du château, néanmoins, le volcan du Mont Bar, résultant d'une éruption antique, masquait la grande ville.
Louis abandonna son échange purement visuel et mental avec l'enfant et se remit à avancer, marchant difficilement, lourdement contraint par les fers qui enserraient ses chevilles. D'ailleurs Eudes, sans doute perturbé par cette forme de communication non-verbale, jusqu'ici inconnue de sa part, s'était reculé. En quelques secondes, il avait ainsi reculé de trois ou quatre rangées de spectateurs, jusqu'à venir en butée contre les lourdes pierres volcaniques servant de fondation à un hôtel particulier, implanté à mi-pente sur la longue rue serpentante qui montait jusqu'au château. Plus large que les habituels charreyrons qui jalonnaient la cité, elle permettait surtout à la foule de s'agglutiner et ainsi de dresser une rangée de déshonneur au condamné.
L'enfant n'avait plus envie de poursuivre la procession. Il était dégoûté du spectacle. Il préféra s'en retourner, revenir au camp des parsonniers, implanté en limite de Grazac, juste devant les champs que ses parents, comme la plupart des membres de cette communauté, faisaient prospérer malgré les frimas qui frappaient régulièrement les printemps et les hivers souvent précoces en ses terres riches quoique peu hospitalières à qui ne savait pas s'impliquer dans un travail vigoureux.
Un supplice en public était rare et toujours la conséquence d'un crime grave. Le passage par le pilori était fréquent, dans toutes les cités médiévales. L'exposé à la vindicte populaire se faisait cracher dessus, recevait des légumes, servait de cible aux enfants apprenant à viser... L'exposition à la vindicte publique était tout autant habituelle, en accompagnement de punitions diverses. Pour les crimes particulièrement graves, comme ceux dont avait été reconnu coupable le supplicié du jour, après un jugement d'ordinaire expéditif et sans réelle défense, la sentence pouvait conduire à son exécution, selon un cérémonial précisément codé.
Louis souffrait dans sa chair et dans son âme pour son dernier voyage. Il souffrait même beaucoup. Cependant, jamais il n'aurait osé comparer son supplice au chemin de croix qu'avait connu le fils de son Dieu près de quinze siècles auparavant en Palestine. Car il était croyant, Louis. Comme tout le monde. Comme quiconque voulait s'insérer dans la société médiévale occidentale. Comme tout à chacun en ses terres paysannes tantôt intégrées en Auvergne, tantôt en Pays d'Oc. Comme tout le monde dans la ville dans laquelle il avait choisi de s'installer quelques mois plus tôt.
Il souffrait, essayant de rester digne et silencieux, malgré les quolibets et les déjections de toutes sortes. En progressant vers son sort funeste, il récitait ses prières. Au fond, il n'avait qu'un seul regret : celui de ne pas avoir pu bénéficier de l'extrême onction. Le prêtre qui l'avait écouté en confession n'avait pas voulu lui accorder cette grâce. En effet, même devant son ultime juge en ce bas-monde, il avait encore nié être l'auteur du principal forfait qui lui était reproché. Le prévôt avait alors indiqué :
— Puisqu'il en est ainsi, mon fils, je me vois dans l'obligation de rejeter ta demande de pardon. Seul Dieu lui-même, par l'intermédiaire de Saint Pierre, saura t'accorder ou non le pardon pour tes nombreux péchés capitaux.
Puis il avait justifié sa décision en rappelant que l'extrême onction était destinée aux malades en fin de vie et que cela n'était pas son cas. Pourtant, les condamnés à mort étaient en quelque sorte des « malades de la vie », aussi ce sacrement avait été entendu à ces derniers. Mais le cas de Louis était véritablement désespéré aux yeux du prélat. Dame ! À quelques minutes de son trépas, il niait encore ses pêchés !
Qu'à cela ne tienne, puisque son salut se négociera directement avec Dieu ou son premier représentant dans l'au-delà, Louis s'était résigné. Il psalmodiait ses prières tout en avançant vers la potence. Il savait que la prière de la foi sauvait le malade, et qu'ensuite, une fois le dernier souffle rendu, le Seigneur le relevait. Puis, si par jamais, il avait commis des péchés non encore expiés, il lui serait pardonné.
Un homme de forte corpulence envoya alors une botte de paille sur la tête du supplicié. Il en fut à moitié assommé, mais se redressa une nouvelle fois. La botte lui barrait le passage. Les deux cerbères refusèrent de la déplacer pour lui faciliter le passage. D'ailleurs, l'aurait-il voulu qu'il ne l'aurait pas pu tant la foule était dense et agglutinée autour d'eux. Cette haie du déshonneur était à la hauteur de l'injure commise envers le maître de la ville-haute et, par reflet, du Seigneur des lieux. Louis dut donc enjamber la botte de paille, dont certaines tiges étaient mal ficelées – était-ce fait exprès ? – et lui blessèrent la voûte plantaire, plus encore que les pierres du passage étroit dans lequel il avait dû bifurquer avant de rejoindre la place. Ce chemin – ce charreyron – était plus destiné plus aux pas d'ânes qu'aux pas des suppliciés.
Ainsi, après être revenu sur la voie principale, avec plusieurs brins de paille encore enfichées dans ses doigts de pieds, il reprit sa dernière ascension de la voie dénommée « charreirha cuminal par ont hom vai de basse-ville au Chastel devers nuyt » (chemin de la commune menant de Grazac jusqu'au château depuis le Sud).
Le condamné ne montait pas seul vers le lieu du supplice. Il était en effet accompagné de quelques pénitents. Le premier des pénitents qui suivait le supplicié se pencha, attrapa la botte de paille. Aidé par un acolyte, ils la jetèrent dans la foule, en direction du colosse qui l'avait envoyé. Celui-ci la rattrapa d'une main, pas mécontent au final de n'avoir pas sacrifié un bien aussi précieux. Il la posa à terre et grimpa dessus afin de mieux pouvoir suivre le reste de la procession, tout en vilipendant Louis avec les quelques mots déplaisants que comprenait son maigre vocabulaire.
Derrière le supplicié, donc, plusieurs pénitents l'accompagnaient, revêtus de leurs habits de procession. Ils faisaient tous partie de la confrérie des flagellants, fort puissance dans la cité. Comme à chaque fois qu'ils défilaient dans les rues, ils étaient très ostentatoires, se flagellant entre eux et eux-mêmes tout en s'efforçant de ne rien laissait paraître de leurs éventuelles souffrances. À la longue, ils avaient le cuir tanné et bien dur. Si les pénitents avaient un comportement souvent jugé excessif par le bon peuple de France, leur obédience était telle, y compris en haut-lieu, que personne n'aurait jamais tenté quoi que ce soit contre leur domination. Il se murmurait même qu'un jour, ils parviendraient à convaincre un Roy de France de se joindre à leur confrérie1. Aussi, s'ils avaient décidé de défiler, ils défilaient, accompagnant leur déambulation de chants liturgiques et se frappant avec leurs fouets perlés de plomb. Et nul n'aurait osé condamner ni même commenter leur décision.
Ils possédaient leur propre chapelle à Allègre : un bâtiment sans style, austère et dépourvu de vitraux aux ouvertures, laissant entrer les frimas l'hiver, malgré leur étroitesse qui les faisait ressembler plus à des meurtrières. Mais, si Dieu avait décidé de les éprouver en leur envoyant du froid, ils se devaient de l'endurer sans broncher, ni sans tousser pour ceux dont les bronches se retrouvaient ainsi encombrées.
En revanche, ils jugeaient cette bâtisse trop étroite compte tenu de leur nombre sans cesse croissant. Ils rêvaient de pouvoir, un jour, se réunir dans une chapelle plus grande, telle que celle qu'il était projeté d'aménager justement à l'endroit où le cortège passait présentement, en plein milieu d'une petite place aménagée là où la pente était la moins raide, formant presque un plateau horizontal2.
Pourtant, s'ils étaient forts en nombre, les conditions pour devenir un pénitent étaient rédhibitoires et exigeantes. D'abord, il fallait être parrainé par un membre de la confrérie pour pouvoir devenir un impétrant. Il fallait avoir mené une vie jusqu'ici irréprochable de bon chrétien, de bon pénitent, avoir toujours suivi de manière stricte et inconditionnelles les injonctions et les préceptes de l’Église chrétienne d'Occident. Sans négliger qu'il fallait être financièrement aisé. Un pénitent se devait d'être plus qu'un simple gueux et même plus qu'un simple bourgeois. Il devait avoir souvent effectué des dons pour les pauvres et devait lors de son intronisation s'engager à poursuivre cet engagement, tout en restant en position d'acheter des indulgences directement auprès de l’Église romaine. Ces indulgences lui assureront la rémission partielle ou totale devant Dieu de la peine temporelle encourue suite à un péché ainsi pardonné sur Terre par le représentant de l’Église. Mais cette dette spirituelle ne serait pas pour autant entièrement réglée dans l'autre monde. Les pénitents s'inscrivaient totalement dans cet esprit de repentance perpétuelle puisque la période de probation avant d'accéder au royaume des saints constituait justement la pénitence encourue par un bon chrétien. Tous les actes de piété sur Terre, tels que les prières, les pèlerinages, les dons et la mortification, contribuaient ainsi à raccourcir le temps de séjour au purgatoire.
Donc, sans cynisme aucun, il apparaissait évident que les membres de la confrérie en question étaient sans nul doute des individus qui avaient beaucoup pêché de leur vivant, s'étaient fait beaucoup pardonner par les prêtres, mais possédaient une ardoise d'une telle longueur qu'ils pouvaient redouter de passer au purgatoire la durée de plusieurs vies avant de rejoindre le paradis. Et au moins, leurs forts généreux dons effectués de leur vivant permettaient d'amoindrir les souffrances des pauvres. Ces dons étaient tellement généreux qu'un hôtel-Dieu avait été aménagé à Allègre, accueillant les orphelins, indigents et pèlerins et directement administré par l'Église.
S'il était difficile d'entrer dans la confrérie, cette appartenance devait en outre demeurer secrète, du moins tant que le pénitent était vivant. Une fois décédé, les manants pouvaient se rendre compte de la grandeur d'âme du défunt, même s'ils le pensaient être dépravé, vicieux ou amoral. Son honneur était sauf, sa réputation et celle de sa famille aussi.
C'est pourquoi les pénitents défilaient tous masqués, affublés d'une longue cagoule de couleur claire, terminée par un sommet pointu. La cagoule était uniquement percée de deux trous dans lesquels une fine maille était cousue pour protéger l'intimité des yeux de son porteur. Si, d'ordinaire, ils accompagnaient les malades et les aidaient, à l'hôtel-Dieu ou à la paroisse, ils avaient aussi comme mission d'accompagner les condamnés. Et comme ces deniers n'étaient généralement pas légions, les pénitents mettaient un point d'honneur à accompagner comme il se doit Louis pendant ses ultimes instants qu'il devait passer sur Terre, jusqu'à l’échafaud.
Encore quelques centaines de coudées à franchir. Le charreyron se séparait en deux et la foule massive orientait nettement le défilé dans celui de droite, celui qui redescendait avant de faire un tour supplémentaire entre les bâtisses agglutinées les unes aux autres pour conserver la chaleur en hiver et réduire la prise au vent, qu'il vienne du Nord ou du Sud, qu'il glace le sang ou qu'il rende fou ! Tel un axe de passage principal, ce charreyron demeurait suffisamment large pour permettre le croisement de deux chars en temps normal, l'un montant plein de victuailles et d'eau jusqu'au château et l'autre en redescendant, et ceci malgré son tracé sinueux. Aujourd'hui, il ne saurait être question que quoi que ce soit puisse l'emprunter à contre-sens tant la foule s'y massait densément. La plupart des habitants ne se contentaient pas de houspiller le condamné au passage devant leur lieu d'habitat. Les badauds profitaient des diverses ruelles, plus encombrées, tortueuses et sombres qui constituaient le dense réseau laissé entre les divers bâtiments, pour rejoindre le cortège lorsque celui-ci était déjà passé devant eux. Le convoi mortuaire empruntait maintenant un tronçon rempli de diverses petites impasses, aussi la foule se fit momentanément moins dense, le dédale de charreyrons ne facilitait pas la possibilité de revenir en tête du défilé.
Contrairement aux jours de fête, tels que ceux où les riverains étaient appelés à décorer les rues avec des tentures pour accompagner le passage de la statue de Notre-Dame, celles-là demeuraient austères pour ce cortège. Dame ! Il ne s'agissait nullement d'un jour de fête, mais plutôt d'une libération, la société médiévale en cet an de grâce 1497 était soulagée de se débarrasser d'une telle brebis galeuse que celle qui était conduite à l’abattoir.
Louis, en bon chrétien, acceptait son sort, son destin. Même s'il se savait innocent, il s'était résigné. Si Dieu en avait décidé ainsi... Plaise à Dieu de lui faire subir le martyr avant de l'accueillir. Peu lui importait la durée de son indulgence, peu lui importait le temps qu'il allait passer au purgatoire. Il se savait en paix avec lui-même. Cela le réconfortait un tant soit peu et lui permettait de supporter son tourment.
Encore un virage. Encore des pierres mal taillées et mal scellées qui lui entaillaient une nouvelle fois les pieds. Son long calvaire pouvait dès lors se suivre à la trace.
Il aurait pu finir pendu. Il aurait pu finir bouilli, passé à la marmite, sentant lentement ses chairs cuire et se détacher de ses os, après qu'on lui eut coupé la langue pour qu'il n'effraie pas le public. Il aurait pu finir noyé. Mais il n'était ni assassin, ni voleur. Il n'était ni conspirateur, ni sorcier. Il lui était réservé une fin plus spectaculaire encore : il allait mourir en connaissant les affres réservées aux auteurs de crimes contre-nature. Tout comme les sorciers, il allait périr par le feu. Tout comme l'auteur d'un infanticide, il était vilipendé par la foule, excitée de bénéficier d'un spectacle auquel elle n'assistait au mieux qu'une fois par génération.
Le condamné, habillé par l'occasion avec une belle chemise d'un blanc immaculé – du moins au début de son chemin de croix – se devait d'être présentable devant l’Éternel qui, bien entendu, assistait depuis le Ciel à l'exécution de Son jugement. Comme il ne s'agissait pas de faire un exemple pour le peuple, son corps allait échapper au sort des pendus : rester accroché au gibet jusqu’à la décomposition totale du corps ou jusqu'à ce que les corbeaux en aient terminé de se repaître des chairs exposées aux quatre vents. Non ! Il s'agissait plutôt de faire disparaître cet énergumène et même de faire oublier jusqu'à son existence.
Il savait, et cela l'attristait et l'inquiétait quant au devenir de son âme, qu'il ne serait pas enseveli en terre chrétienne. Il connaîtrait une mal mort, risquant de ne pas pouvoir ressusciter le jour du Jugement dernier, son corps ne pouvant pas être reconstitué à la fin des temps. D'autant que la confession lui avait été refusée. C'est pour cela qu'il acceptait son sort, qu'il priait de toutes ses forces face à l'adversité et qu'il ne tenterait rien contre le jugement des Hommes, s'en remettant à celui, ultime, de son créateur. Heureusement qu'il n'avait pas d'enfant. Heureusement qu'il n'était pas natif de la contrée. Sans cela le déshonneur du supplicié aurait rejailli sur toute sa parenté. Il était venu seul. Il s'en allait seul. Lui, n'avait pas vécu dans la crainte de Dieu-le-Père, mais ses descendants auraient-ils voulu, ou pu, en faire autant ?
La première partie de son supplice s'achevait. Combien de temps avait-il mis pour parcourir le quart de lieu qui séparait la geôle du gibet ? Une heure ? Plus encore ?
L'esplanade finale. Aux pieds du château. Le bûcher y était érigé, en place publique.
La foule se tenait désormais à distance respectueuse, craignant les futures flammes et pétons qui ne manqueraient pas de s'échapper du brasier.
Le bûcher n'était qu'un amoncellement de branches et de troncs, dans lesquels étaient agglutinés des restes de mobilier détérioré et des botes de paille, avec quelques vases et amphores devant contenir des huiles et d'autres produits destinés à attiser le feu. Un poteau – simple tronc d'arbre à peine écorcé – était plaqué contre le bûcher, prêt à être érigé dès que les flammes allaient prendre. Deux cordes solidement fixées à son extrémité permettront de faire basculer le poteau au-dessus du bûcher. Deux autres cordes serviront à retenir la potence au lieu de la laisser tomber dans le brasier. Quatre pierres placées à chaque azimut permettront de fixer le poteau.
Ces derniers instants se passèrent plus vite que Louis n'aurait pu l'imaginer au regard de la lenteur de son précédent supplice. Deux pénitents lui détachèrent les fers de ses chevilles. Ils l'accompagnèrent jusqu'au poteau où ils lui placèrent les mains dans le dos avant de solidement le lier à l'arbre. Ils en firent de même au niveau des mollets. L'un d'eux lui demanda s'il voulait un foulard ou s'il souhaitait être estourbi avant que le feu ne soit mis au brasier. C'était surtout pour le pénitent moyen de montrer son empathie envers le supplicié, moyen de prouver sa bonté auprès de Celui qui assistait au spectacle depuis son trône...
Louis refusa, préférant lui aussi se montrer devant son créateur fier et rempli d'honneur, malgré l'indignité de sa situation.
Quatre pénitents attrapèrent chacun une corde tandis que deux autres s’apprêtaient à déplacer un bloc de bois destiné à maintenir le poteau contre le bûcher. Un dernier tenait une torche dans ses mains. Quelqu'un que Louis ne pouvait voir donna le signe de procéder à l'exécution. Dans la foule, Louis aperçut quelques personnes se signer, plus pour expier leur péché de gourmandise, de luxure et d'orgueil de se régaler ainsi du spectacle, que pour contribuer au salut de l'âme du condamné.
Rapidement le brasier prit. Les deux premiers pénitents hissèrent le poteau. Louis jouissait une dernière fois de cette vue spectaculaire, qui lui avait tant plu à son arrivée en ces lieux magiques. Après avoir observé le ciel sans nuages d'un bleu immaculé et sombre, son regard était maintenant dirigé vers la vallée et l'horizon cerné de bleu clair, presque blanc.
Les autres pénitents s’affairaient à leur tâche respective puis, une fois le poteau mis en place, s'écartèrent vivement pour laisser le feu accomplir son œuvre.
Rapidement, le ciel bleu fut remplacé par de la fumée grise et blanche qui dansait devant les yeux du supplicié. Il commença à ressentir la chaleur qui se dégageait de l'incendie du tas de bois. Il regarda vers le bas, mais apeuré par le spectacle, préféra se tourner vers le ciel, encore immaculé des fumées. Il s'en remit alors à Lui, hurlant le « Notre Père » aussi fort qu'il le put. Dans la foule, ce comportement, venant d'une personne impie, suscita des réactions hostiles, des injures, des sifflets et des hourras de satisfaction de voir justice enfin faite.
Il sentit d'abord la chaleur croître. Sa première impression était qu'il était soumis à une douce chaleur. Rapidement, il sentit que les flammes venaient à brûler ses vêtements et sa peau, mélangeant les uns à l'autre. Ensuite, il commença à renifler les vapeurs et les fumées. En pénétrant dans son nez, elles lui brûlèrent la gorge et les poumons. Enfin seulement, il sentit ses chairs s'embrasser, avant de succomber sous la douleur, l'esprit piégé dans la boîte crânienne, sentant le contact avec chaque partie de son corps disparaître après avoir senti la vie s'échapper de chacune d'elle.
Il s'éteignit ainsi tandis que le brasier redoublait d'intensité.
1 : Ce sera d'ailleurs le cas ultérieurement avec Henri III.
2 : C'est là que plus tard sera construite la chapelle Notre Dame de l'Oratoire.
CHAPITRE 2
Le consul d'Allègre était, en cette époque de paix relative, fort précautionneux. Il mettait un point d'honneur à ce que les espaces communs de la cité demeurent le plus propre possible. Ainsi, il avait demandé et obtenu du Seigneur d'Allègre que les bouchers ne puissent plus tenir d'échoppe dans les tortueux charreyrons accrochés aux remparts du château. Il faut dire que le passage du bétail dans les étroits boyaux urbains non seulement posaient des problèmes d'encombrement, mais engendraient également des inconvénients olfactifs et gluants tout le long de cette longue ascension du volcan du Mont Baury au sommet duquel le château avait été bâti, avant qu'un nouveau faubourg ne vienne relier la ville-basse de Grazac plus au Sud, sanctifiant alors l'annexion de cette dernière par la ville-haute, enceinte de sa fortification. D'autre part, l'activité de boucher étant, comme toutes les autres, pratiquées directement dans les rues, il n'était pas rare que les pluies fassent charrier des litres de sang sur les pierres des cheminements, les rendant encore plus glissantes qu'à l'accoutumé. Aussi, investi de sa mission de pouvoir public, dès son arrivée à ce poste hautement honorifique, le consul avait proposé et obtenu du Seigneur des lieux que les bouchers ne soient cantonnés que dans Grazac.
Ce fut là sa première marque d'autorité. Ou de pouvoir...
À peine un lustre plus tard, il instaura une division de nettoyeurs, précisément chargés de maintenir la propreté dans les rues, et payés par les subsides que le Seigneur octroyait, directement perçus sur les taxes et impôts qu'il prélevait sur ses gens. Ainsi, les charreyrons étaient loin d'être sales et insalubres, avec de telles mesures destinées à enrayer ces problèmes. Le consul avait, par la suite, proposé de doter les « nettoyeurs » d'un pouvoir d'amender toute personne prise sur le fait de transformer les voies pavées en dépotoirs ou en merdanson. Las, le Seigneur n'avait pas accédé à ces souhaits et les sbires du Consul durent continuer à se contenter de nettoyer les déjections diverses et variées qui encombraient les charreyrons. Cela aurait constitué un précédent et une forme de perte de pouvoir de la part du Baron.
Le Consul avait cependant poursuivit les travaux de son prédécesseur pour canaliser les excréments charriés par les eaux de pluie de manière naturelle, profitant de la déclivité de la pente du volcan, de manière à ce que chaque charreyron soit relié à des sortes de canaux, charriant de tout temps des eaux de ruissellement vers le bas de la vallée, y charriant les déchets de toute sorte.
Aussi, le lendemain de l'exécution de Louis, ce sont les nettoyeurs qui furent chargés d'éliminer les traces du fourneau.
Il fallait avoir le cœur bien accroché pour exécuter cette tâche indigne. Car, tant qu'il s'agissait de ramasser des chats crevés ou des rongeurs à demi-dévorés et de les balancer dans le merdanson humide, cela ne posait pas de difficultés aux deux hommes réquisitionnés. Mais aujourd'hui, il s'agissait d'une première pour eux : ils devaient se débarrasser des restes d'un homme passé par le bûcher. Et malgré la chaleur dégagée au centre du brasier, la plupart des os du supplicié étaient toujours intacts. Noircis, rongés, mais parfaitement identifiables. Surtout le crâne. Le plus jeune des deux nettoyeurs ne parvient pas à contenir le repas dans son ventre. Il contribua ainsi à salir les pierres recouvrant la place où s'était tenu le supplice, ce qui contribuera aux railleries de son camarade.
Vexé, il s'efforça de ramasser avec une pelle la hure du proscrit et l'enfouit dans un sac en toile de bure qu'il jeta dans la charrette à bras qui ne le quittait jamais lorsqu'il besognait à sa tâche. Les autres restes humains furent mélangés avec les restes des rondins non-entièrement consumés et déposés dans une autre charrette, plus grande, tirée par un âne celle-ci. Le nettoyeur abandonna sa charrette sur place pour conduire l’étalage jusqu'aux bas du volcan, bien au Sud de la cité, dans un endroit qui servait habituellement de décharge pour tout ce qui ne présentait aucune utilité aux habitants de la ville. Les accipitres diurnes aimaient à venir se repaître des restes de chair mélangés aux autres détritus balancés dans cette sorte de fosse commune. De multiples rongeurs leur disputaient cette nourriture abondante puisque c'était là également que les bouchers et autres artisans de chair devaient – suite à une demande du Consul – se débarrasser de tous leurs restes. Il se murmurait d'ailleurs que, certaines nuits d'automne, proches des nuits où les anciens Celtes pratiquaient encore des rituels païens, les esprits des animaux morts revenaient à la vie et hurlaient à la Lune. C'était surtout une légende permettant d'écarter les curieux et de les dissuader de venir se promener innocemment dans le coin.
Il n'était donc pas surprenant que, puisqu'il s'agissait d'effacer toute trace du passage en ce bas-monde de l'ignoble individu exécuté la veille, ses restes trouvent en ces lieux leur destination ultime.
Alors que le soleil déclinait déjà en cette belle journée de fin d'été, le nettoyeur revint enfin sur les lieux de l’exécution, après avoir ramené l'âne à son étable. S'il retrouva bien sa charrette, il n'y retrouva point le sac contenant les restes humains. Un instant il se demanda qui aurait bien pu avoir l'outrecuidance de dérober le crâne. Un adorateur de Satan cherchant à acquérir un bien si précieux pour ses messes noires ? Pourvu que ce ne soit pas l'explication de la disparition du sac ! Car si c'était le cas, il serait complice par imprudence... Et il risquerait tout autant que l'impie de finir, à son tour, au bûcher !
Mais il se rassura en se disant que, non, ce scénario n'était pas plausible. Il y avait une explication bien plus simple et évidente. C'était son comparse qui avait balancé le sac dans l'autre charrette, juste avant qu'il ne la descende à la décharge. Rassuré, il se dit qu'il demanderait le lendemain à son complice ce qu'il en était... Oui, mais si ce dernier n'avait pas balancé le sac ? Si un suppôt de Satan était vraiment passé par là ?...
Il préféra oublier son idée de demander à l'autre nettoyeur s'il était bien l'auteur de cette disparition. Contrairement à Louis, il craignait la fureur de Dieu et de ses multiples représentants sur Terre. C'était décidé : il ne demanderait rien, ne serait-ce que pour ne pas passer pour un benêt qui ne sait même pas ce que deviennent ses affaires ! C'était l'autre qui avait pris le crâne, l'avait balancé dans la charrette ; et c'était lui qui avait, comme toujours, vidé la charrette sans faire attention à ce qu'elle contenait. C'était une explication simple. Et les explications simples résolvaient bien des problèmes...
Il rentra chez lui, en poussant sa petite charrette, et préféra oublier l'incident.
Ainsi, Louis ne fut pas enterré, ni en terre consacrée, ni même comme un chien. Ces restes furent dispersés, laissés au bon vouloir des rats et des vautours fauves, qui disputaient aux aigles les hautes branches des arbres au sommet des multiples volcans de la région.
De toute façon, Louis n'aurait jamais eu les moyens de faire procéder à un enterrement digne de ce nom. Son corps perdu corps et bien, il restait à ses proches de se partager ses maigres biens, d'autant plus maigres que Louis avait été accepté dans la confrérie des parsonniers au printemps dernier.
En cette époque reculée, les gens pouvaient posséder des biens. Les premiers qu'ils possédaient étaient les animaux. Louis possédaient trois mules à sa venue sur Allègre. Le servage avait été supprimé. Cependant, les gens du peuple n'avaient pas les moyens de sortir de leur condition précaire. Quelqu'un naissait pauvre, vivait pauvre et mourrait pauvre, à de très rares exceptions près. Et en plus, la progression dans l'échelle sociale demandait, non pas des années, mais des générations.
Dans ce contexte, certains hommes et certaines femmes du peuple avaient décidé de placer tous leurs biens en commun : les parsonniers. Dès le XIIème siècle, certaines familles, dans les campagnes françaises, décidèrent que vivre en commun – comme le faisaient les lointains vikings dans leurs villages d'origine – était une façon de partager les joies et les douleurs, de manière à accroître les premières et à amoindrir les secondes. Ces regroupements de familles se fondaient sur les principes des communautés initiées sous Charlemagne
Chaque communauté plaçait à sa tête à la fois un homme et une femme, obligatoirement non-mariés entre eux et issus de deux familles différentes. Il n'était pas possible qu'il existe un lien de sang – direct ou indirect – entre eux. Interdit les frères et sœurs dominants ou les couples dictateurs. Le maître de la communauté décidait seul de la répartition du travail des hommes, de tous les travaux concernant l'agriculture et de toute autre activité permettant de faire rentrer de l'argent dans les caisses de la communauté. Il était le seul représentant de la communauté à l'extérieur. Ainsi, il s'arrogeait les ventes dans les foires, la représentation de la confrérie ou d'un de ses membres à un procès et les relations avec tout autre partenaire extérieur. Il donnait aussi son approbation à chaque mariage entre confrères ou avec des personnes extérieures. C'est pourquoi, peu importait les connaissances intrinsèques du maître, ses qualités personnelles prévalaient, quel que soit son âge, son ancienneté dans la confrérie ou son pédigrée. Le maître pouvait choisir de diriger la communauté jusqu’à sa mort, ou de démissionner lorsqu'il se sentait trop faible ou incapable de défendre les intérêts de la communauté ou de chaque membre du groupe.
De son côté, la maîtresse assurait les fonctions d’intendante de la société. Comme pour le maître, elle est désignée par ses consœurs. Elle gérait toutes les tâches traditionnellement dévolues aux femmes et le quotidien de la communauté : cuisine, laiterie, fabrication du pain, beurre, fromage, gestion de la basse-cour, réalisation de vêtements et éducation des enfants ainsi que toute activité « sociale » vers les malades, blessés et personnes âgées. Elle pilotait tout ce qui concernait le gardiennage des animaux, tâches confiées par ailleurs aux femmes et aux enfants. Elle assumait aussi un rôle primordial pour la communauté : celui d'être une hôte universelle. En effet, l'hospitalité n'était pas un vain mot pour les parsonniers. N'importe qui ne pouvait pas devenir parsonnier. Mais n'importe qui pouvait demander l'hospitalité à un parsonnier.
En dehors des deux maîtres, le principe d'égalité entre tous était souverain : personne n'avait plus de droits ou de devoirs qu'un autre membre. Tous les membres travaillaient ensemble, accomplissant les besognes confiées à leur communauté, en fonction de ses capacités et de ses possibilités. Ainsi, ils mangeaient à leur faim, élevaient même leurs propres ovins. Ils représentaient une force que ni le Seigneur, ni le Consul, ne devait négliger. D'autant, qu'au fil des générations, les parsonniers étaient devenus plus érudits. Cherchant à éviter le triste sort qu'il advint des confréries devenues trop puissantes, telles que les Chevaliers du Temple, ils restaient cantonnés à leur fonction première : constituer une communauté de paysans qui entretenaient les terres et les travaillaient pour assurer leur propre subsistance. Ils s'interdisaient de briguer toute forme de pouvoir. Cependant, au fil des temps, ils s'étaient arrangés pour intégrer en leur sein des érudits, principalement férus en termes juridiques, ce qui leur permettait de ne pas se faire spoiler de leurs droits et même, depuis quelques lustres, de commencer à acheter des terres de manière collective. Ces biens n'étaient aucunement individuels, mais uniquement collectifs. Ces terres, comme toute chose, appartenaient à la communauté de pères en fils. La solidarité entre membres constituait également une règle, non-officielle, contrairement aux nombreuses autres règles communes de la communauté, telles que par exemple, celles imposées pour quitter la communauté. Ainsi, si l'impétrant à devenir parsonnier devait se présenter dans le plus simple appareil à la communauté, dépouillé de toute propriété matérielle, s'il était autorisé à quitter la communauté, il repartait de même (avec toutefois une culotte et une chemise), puisque tous les biens était indivis.