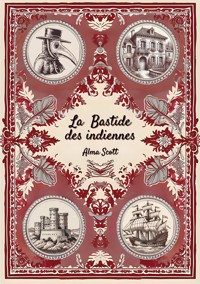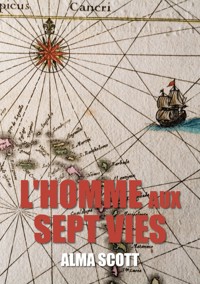Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
An 779. Charlemagne gouverne d’une main ferme un empire unifié par une administration rigoureuse et une foi chrétienne fervente. Lorsque Loup de Carry, son vassal, reçoit une mission secrète, il est contraint de retourner en Provence, terre de son enfance et de ses blessures enfouies.
Pourquoi doit-il dissimuler son identité et accompagner Pépin, un moine érudit et bougon, dans son inspection des scriptoria, ces ateliers où se copient les manuscrits ? Pourront-ils surmonter leurs différends, accomplir leur mission et affronter les périls qui les guettent ?
Aux abords de l’abbaye de Psalmodi, au cœur des marais de Septimanie, d’étranges figures se dressent sur leur chemin : Constance, victime ou complice d’une vaste manigance, Amalia, magicienne insaisissable et persécutée, Elric, intendant banni au passé trouble. Tous semblent liés à de sombres machinations impliquant l’abbaye et le puissant seigneur Rodaldus.
Entre complots et trahisons, quête de vérité et luttes d’influence, Le Glaive et la Plume entraîne le lecteur dans un voyage fascinant au cœur de la Renaissance carolingienne, des marais de Septimanie aux scriptoria des abbayes, des jeux de pouvoir aux combats pour l’honneur.
À PROPOS DE L'AUTRICE
Linguiste de formation et passionnée d’histoire,
Alma Scott écrit des romans d’aventures qui mêlent faits historiques et destins particuliers.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Du même auteur
La Bastide des indiennes, 2024
L’Homme aux Sept Vies, 2024
Les Filles du Mississippi, 2022 et édition 2024.
Publishroom Factorywww.publishroom.com
ISBN : 978-2-38625-860-2
Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Page de titre
ALMA SCOTT
Le Glaive et la Plume
Carte
Note de l’auteur à propos du vocabulaire historique
Le monde du VIIIe siècle que j’ai voulu restituer impose ses propres mots : missi dominici, vassus dominicus, scara, broigne, esclave chasé, manse… Autant de réalités qui n’ont plus d’équivalents aujourd’hui. Ces termes, parfois techniques, ne sont pas là pour l’effet, mais pour désigner ce qui structurait la vie d’alors.
Pour accompagner le lecteur sans alourdir le récit, j’ai ajouté des notes de bas de page quand cela m’a semblé nécessaire, ainsi qu’un glossaire en fin d’ouvrage pour ceux qui souhaiteraient approfondir.
J’ai essayé de rester fidèle à l’époque sans renoncer à la fluidité du texte, en faisant confiance à la curiosité du lecteur, invité à parcourir un monde disparu, dont les mots sont la mémoire.
Préface
Charlemagne, Carolus Magnus, est sacré roi des Francs en 768, puis roi des Lombards en 774 avant de devenir empereur en l’an 800.
Son royaume est une mosaïque de peuples, de langues et de traditions. Pour unifier cet ensemble disparate, il impose une administration rigoureuse et renforce la foi chrétienne comme ciment du pouvoir. L’Empire carolingien s’étend alors du nord de l’Italie à la mer du Nord, de la péninsule ibérique aux confins de l’est du Rhin, illustrant la puissance militaire du souverain.
Pour gouverner efficacement, Charlemagne divise le territoire en comtés, dirigés par des comtes sous son autorité. Il nomme les missi dominici, représentants itinérants de son pouvoir, chargés d’inspecter les provinces et d’assurer l’application de la justice royale.
L’empereur légifère par capitulaires, des décrets qui encadrent la vie politique, sociale et économique de son empire.
La Renaissance carolingienne marque une période de renouveau culturel et intellectuel.
Convaincu que l’éducation est essentielle à la prospérité de son règne, Charlemagne attire à sa cour des érudits de tout le continent, dont Alcuin d’York, qui réforme l’enseignement et la calligraphie. Les monastères, dotés de scriptoria, deviennent les foyers d’une intense activité intellectuelle, où est utilisée la minuscule caroline, une écriture claire et régulière favorisant la diffusion des manuscrits.
C’est dans ce contexte qu’évoluent les personnages du Glaive et (de) la Plume.
Personnages principaux
Loup de Carry : vassal du roi (vassus domenicus) chargé d’une mission par Charles.
Pépin : moine.
Constance : fille d’Elric.
Elric : intendant banni.
Amalia : magicienne.
Rodaldus : noble.
Personnages secondaires
Bernard : frère de Loup.
Gui de Carry : père de Loup.
Frédégonde d’Autun : fiancée de Loup.
Thierry d’Autun : père de Frédégonde.
Rémi : esclave.
Corbilianus : abbé de Psalmodi.
Frère Artaud : scribe et écolâtre à Psalmodi.
Frère Clarinus : bibliothécaire à Psalmodi.
Frère Gerbert : scribe à Psalmodi.
Personnages historiques : page 385
Certains personnages de ce roman, comme Thierry et Alleaume d’Autun, ont réellement existé. Toutefois, leur relation, leurs actions et leurs paroles relèvent entièrement de la fiction.
Note sur l’abbaye de Psalmodi : page 399
Histoire et histoire : page 401
Le signe * renvoie aux notes historiques, page 389. Certaines notes de bas de page y sont développées.
Les Lieux du Glaive et de la plume
PrologueAnnée 779
La litière de la reine se frayait avec peine un chemin à travers la forêt ; chaque soubresaut lui arrachait un gémissement. Hildegarde* souleva la bâche du chariot que d’épaisses langues de brume tentaient de retenir. La souveraine se cala le dos contre des coussins ; une nausée la prit, plus virulente que lors de ses autres grossesses. Un mauvais signe ?
Cette quatrième maternité s’annonçait plus difficile que les précédentes. En épousant Charles*, elle avait redouté de subir le même sort que Désirée1, mais, très vite, elle avait donné le jour à plusieurs fils*, des enfants légitimes qui avaient préséance sur le petit bossu d’Himiltrude2. Fière de lui avoir offert une descendance, à vingt et un ans à peine, elle s’inquiétait toutefois de ne pas garder ses enfants en vie.
Hildegarde, choisie pour des raisons politiques, tenait sa vengeance, acquise, certes, au prix de son bien-être et de sa sécurité. Ses jumeaux Louis et Lothaire étaient venus au monde durant la campagne contre l’émirat de Cordoue et Adélaïde, lors du siège de Pavie. La pauvre enfante n’avait hélas pas survécu aux rudesses du voyage de retour et Lothaire avait trépassé. La reine priait à présent tous les jours pour que l’héritier à venir soit un mâle qui affermirait la descendance de Charles.
Une secousse plus forte que les autres lui provoqua un haut-le-cœur ; le convoi se mit à l’arrêt.
Les hurlements terrifiés de sa suite lui firent craindre une attaque de brigands. Elle avait souhaité une escorte réduite pour rejoindre plus rapidement la cour, mais regrettait maintenant son choix. Derrière les toiles huilées de son chariot, elle épiait le vacarme pour deviner l’issue de la bataille, réticente à risquer un regard à l’extérieur. Cris de douleur, de détresse, d’agonie, de rage et de combats ; fer contre fer, bâtons contre glaives ; les coups pleuvaient si proches, si effrayants. Une de ses dames vint chercher refuge auprès d’elle ; une main sanglante la saisit par les cheveux et la tira dehors ; elle agonisa dans un gargouillis rougeâtre. Agitée de tremblements, incapable de penser, Hildegarde roulait des yeux affolés en attendant ses bourreaux.
La main meurtrière écarta la bâche ; l’homme éclata d’un rire dément.
– Eh, par ici vous autres ! Le trésor est là, bien caché. Et quel trésor ! À voir sa mise, il vaut une belle rançon.
Deux trognes hirsutes s’encadrèrent dans l’ouverture. La reine tira une couverture de fourrure au-dessus de sa tête pour fuir ce cauchemar ; un des bandits l’écarta avec rudesse.
– Ne te cache pas ! Mais regardez-moi un peu ça ! C’est qu’elle est grosse la femelle !
Il la découvrit complètement pour exposer son ventre et enleva ses mains qu’elle tentait d’interposer pour protéger son enfant. Hildegarde, dans un sursaut de courage, protesta :
– Je suis la reine ! Le roi vous fera mourir si vous me molestez !
Cette déclaration sembla refroidir l’enthousiasme des va-nu-pieds qui se figèrent, indécis ; un répit de courte durée. Incapables de saisir l’énormité de leur prise et bien trop abrutis par la colère pour en percevoir toutes les conséquences, ils en revinrent aux menaces :
– Alors, on se contentera de ta fibule3, de tes bagues et de tes bracelets et, quand on t’aura dépouillée, on va s’amuser un peu avec toi. Ton roi de mari, il aura même plus envie de te toucher.
Joignant le geste à la parole, celui qui semblait être le chef baissa ses braies et invita ses hommes à en faire de même. Hildegarde jeta ses forces dans une ultime bravade :
– Le viol est sévèrement puni par la loi.
Mais son autorité ne lui fut d’aucun secours.
Ses assaillants avancèrent, concentrés sur leur débauche. Un cri guttural secoua la reine ; elle se vit meurtrie et souillée, abandonnée au bord du chemin, en pâture à une horde de loups affamés. Elle n’était plus que douleur et chair.
Un troisième guenilleux, sur le point de monter dans le chariot, écarquilla les yeux et tomba à la renverse avec de grands moulinets de bras. Les deux autres, les braies sur les genoux, se retournèrent, désorientés. Un poignard se planta dans la poitrine du chef qui s’effondra à genoux, incrédule, puis tomba face contre terre. Dans sa fuite, le second trébucha sur son comparse, avant de se faire égorger.
Hildegarde, pétrifiée, suivit la scène sans comprendre.
– N’ayez aucune crainte, Majesté, vous êtes en sécurité. Vos assaillants sont partis.
Dans un geste de pudeur inconscient, la jeune reine rabattit sa tunique sur son ventre et tira la fourrure sur elle. Son cœur battait à tout rompre tandis que son enfant, sensible à son angoisse, lui martelait les flancs. Le souffle encore court, la gorge nouée, elle affermit sa voix pour s’adresser à l’étranger.
– Tout danger est-il écarté ?
– Oui, Majesté, vous pouvez sortir.
Hildegarde, livide, saisit la main tendue et descendit de sa basterne4, la tête haute. Autour d’elle, les corps de ses suivantes, des brigands et de ses gens d’armes gisaient dans un entrelacs sanglant. Une nausée irrépressible eut raison de sa feinte dignité et, appuyée contre un arbre, elle rejeta de la bile dans de grands arrachements qui la laissèrent sans force. Son sauveur éloigna deux soldats rescapés et appela la seule dame d’escorte encore vivante pour qu’elle veille sur sa souveraine, puis il se mit en retrait pour préserver son intimité. La reine revint quelques instants plus tard, altière et d’apparence sereine ; seuls son extrême pâleur et le tremblement de ses mains trahissaient son tourment. Elle envoya sa suivante quérir son protecteur.
– Tu as fait preuve d’un courage exemplaire en volant ainsi à mon secours, sans l’aide de quiconque. D’aucuns auraient passé leur chemin sans se soucier du sort d’une femme, escortée de surcroît. Quel est ton nom que le roi puisse te récompenser à la hauteur de ta bravoure ?
1 Désirée, première épouse officielle de Charlemagne, fille de Didier roi des Lombards avait été répudiée en raison de sa stérilité.
2 Pépin le bossu, fils de la concubine Himiltrude.
3 Agrafe en métal qui sert à fixer les extrémités d’un vêtement.
4 Litière.
1Année 774
– Tu es sûr que c’est lui ?
– Certain ; il correspond à la description. Il faut le prendre maintenant.
Les deux silhouettes sortirent de l’ombre du porche
Loup, allongé sur la terre battue de la cour de la villa familiale, mettait en scène une bataille entre Charles Martel* et les Sarrasins. De vagues souvenirs des récits de son père, entretenus par son précepteur, alimentaient son jeu. De petits cavaliers de terre cuite, censés représenter les troupes franques, faisaient rendre gorge au patrice5 Mauronte6* et à ses alliés barbaresques. Alors que l’armée franque avançait triomphante vers Arles, un nuage de poussière balaya le champ de bataille et renversa le cortège des vainqueurs. Loup crut à une bourrasque et tenta de rassembler les soldats éparpillés, mais une main gantée le souleva du sol et l’enveloppa dans une étoffe.
Désorienté par la surprise, étouffé par le drap sur sa tête, il se débattit comme un animal pris au piège et hurla de toutes ses forces pour alerter sa mère. Quand il parvint enfin à se libérer du tissu, la main le plaqua contre un torse sanglé dans une broigne7. L’odeur du cuir et de la sueur, l’étau du bras qui l’enlaçait, les griffures des pièces de métal et un sentiment d’abandon l’emprisonnèrent dans une solitude de terreur transpercée par les cris de sa mère.
Elle protestait, menaçait puis suppliait son ravisseur de la prendre à sa place. Ses mains s’agrippèrent au garçonnet pour l’arracher à l’étreinte d’airain. Pendant un court instant, il s’accrocha à sa tunique et sentit son parfum. Son agresseur lui fit lâcher prise, la déchirant dans sa brusquerie. Il jeta la femme à terre et monta à cheval, l’enfant toujours dans ses bras. Loup aperçut sa mère, agenouillée, les bras tendus dans une supplique muette, avant que la poussière ne l’efface. Il ne lui resta d’elle que sa fibule accrochée à un morceau de son voile, dérisoire souvenir d’un amour si parfait. L’évidence de la séparation s’imposa alors à lui : la reverrait-il jamais ? Il serra le demi-cercle d’or si fort, que l’épingle d’attache lui transperça la peau. Cette douleur qui, quelques heures auparavant, l’aurait jeté, en pleurs, dans ses bras, l’apaisa. Le regard embué de larmes, il se concentra sur sa posture pour ne pas chuter.
Une course effrénée jusqu’à Arles les conduisit devant une échoppe, à la tombée de la nuit. Le garçonnet de quatre ans, la fibule toujours plantée dans sa paume, se força à ouvrir les yeux. Il avait envie de pleurer, mais l’homme l’avait menacé de lui ouvrir le ventre d’un coup d’épée, au moindre bruit. Loup, épouvanté, vit une lampe à huile percer l’obscurité. La flamme vacillante approcha, révélant des lambeaux de tunique, un menton masculin, une moustache. Ce visage sans regard se pencha sur lui et lui sourit, chassant sa peur. Une femme le prit dans ses bras pendant que le soldat donnait des consignes à son mari. Loup perçut la douceur de son étreinte ; un murmure apaisant l’encouragea à laisser libre cours à son chagrin. Il pleura sans pudeur, sans penser aux injonctions de courage de sa mère dans ses moments de faiblesse. Il n’avait cure d’être un homme, il voulait qu’on le console.
Rachel, c’était ainsi que se nommait la femme, le cajola, le nourrit, le lava et le coucha avec tendresse. Mais il ne voulait pas de sa tendresse, il voulait rentrer chez lui. Les jours suivants, il s’enferma dans un mutisme hostile et refusa de manger pour protester contre les violences qu’il avait subies. Les jeux avec sa mère, sa douceur, l’insouciance du lendemain ; disparus en un instant. Pourquoi ? La lancinante question le tourmentait et l’isolait. Il rejeta tout contact pendant plusieurs semaines et ignora les tentatives de paix de Rachel. Il revoyait le visage de sa mère englouti par la poussière, ses bras tendus. Elle allait tout faire pour le retrouver et venir le chercher. Mais personne ne vint. Alors, il fit mine de se laisser apprivoiser, acceptant sans réagir tout ce qu’on lui proposait. Rachel et David n’étaient pas dupes de cette soumission de façade et détestaient le trouver aussi docile, mais ils étaient condamnés à obéir aux ordres qu’on leur avait donnés. Peu à peu, la tendresse pour ce petit garçon prit le pas sur leur mission et ils se consacrèrent à lui faire oublier le traumatisme de son enlèvement.
Loup devint, au fil des ans, un garçon enjoué, puisant sa force dans l’arrachement qui l’avait fait un peu homme.
David lui racontait son négoce d’épices et de tissus précieux venus d’Orient. Même s’il ne comprenait pas toutes ses explications, Loup aimait imaginer les mondes lointains dont il lui parlait. Il se perdait dans les odeurs de cannelle, et la caresse de la soie, inventait les routes empruntées par ces précieuses marchandises et fantasmait un Orient mystérieux. Il passait des heures, à l’abri des ballots de tissu, à épier les marchands juifs venus rendre visite à son père adoptif. Leurs marchandages incessants, cérémonial social et mercantile, précédaient la plus insignifiante des transactions. Loup s’amusait à les singer pour convaincre David de lui céder au meilleur prix un morceau de soie ou quelques grains de poivre que l’autre était prêt à lui offrir. Il s’évertuait à trouver les formules habiles, les attitudes matoises qui, sous des aspects bienveillants, lui obtiendraient le produit convoité.
Loup se serait satisfait de ces apprentissages de comptes et de tissus ; on lui en imposa pourtant d’autres.
Quand il eut six ans, un homme se présenta à l’échoppe muni d’un parchemin attestant de sa légitimité. David ne fit aucune remarque et expliqua à Loup qu’il devrait suivre ses leçons avec sérieux et assiduité.
À l’aide d’armes en bois taillées pour lui d’abord, puis de véritables lames, le maître d’armes l’initia à l’usage du glaive, de l’épée à double tranchant, du scramasaxe8 et même de la hache. Il apprit tant bien que mal à monter à cheval, à lancer la javeline, à manier l’écu rond et à décocher des flèches.
À dix ans, Loup était en voie de devenir un combattant passable, sans goût particulier pour le carnage toutefois. Quand David lui parlait de scara9, de conquêtes et d’ennemis du royaume, il l’interrogeait sur la raison de cet entraînement et sur son obligation de persévérer.
– Tu es peut-être destiné au métier des armes.
– Mais je ne veux pas devenir un guerrier, je veux devenir un marchand comme toi et en rencontrer d’autres, venus d’Orient ou d’ailleurs. Je veux apprendre à négocier.
– Tu es déjà un excellent négociateur, lui répondit David avec un sourire amusé. Tu n’as pas ton pareil pour arriver à tes fins. Tu pourrais aider les grands à convaincre leurs ennemis ou leurs alliés.
Mais les ambitions de Loup étaient bien plus modestes et il reprochait à son père adoptif de vouloir lui forger un illustre destin. Il en voulait surtout à son père de sang, dont il sentait l’influence dans toutes ces contraintes.
Il le connaissait indirectement par les récits de son entourage ou les souvenirs entretenus à grand-peine et sentait sa volonté derrière ces apprentissages. Même s’il avait abandonné l’idée de percer les desseins de cet homme, sa présence diffuse, violente, l’intriguait. Pourquoi ne le laissait-il pas en paix ? Pourquoi s’obstinait-il à vouloir le façonner à son image, rude, effrayante et mystérieuse ?
Quand Loup songeait à sa mère, son visage se dissolvait dans la poussière du temps. Il se sentait coupable de la laisser s’enfoncer dans la nuit de l’oubli. Il s’en était quelques fois confié à Rachel, mais elle n’avait pas besoin de mots pour comprendre sa solitude. Elle savait pourtant que se mêler de son histoire la mettrait en danger. La peine de Loup finit par avoir raison de sa prudence : elle se mit en tête de rencontrer sa mère. Elle s’assura avec hypocrisie que ce n’était pas pour lui donner des nouvelles de son fils, mais simplement pour satisfaire sa curiosité. Elle décida de ne jamais évoquer cette rencontre avec Loup.
C’est dans cet état d’esprit qu’elle se mit en route pour Carry.
5 Titre honorifique carolingien désignant un chef militaire ou noble influent dans une région stratégique, héritage du patricius romain.
6 Noble provençal, gouverneur d’Avignon et de Marseille vers 730.
7 Vêtement sur lequel sont fixés des renforts rigides protégeant le thorax.
8 Couteau de combat.
9 Cavalerie d’élite de Charlemagne.
2Année 780
Loup enlaça la taille de Rachel ; pour la deuxième fois, on le privait de la tendresse d’une femme. Il avait toutes les peines du monde à retenir ses larmes, mais à dix ans, il devait se conduire en homme. David était parti en voyage quelques semaines plus tôt ; on l’arrachait à présent à sa mère adoptive. Cette double séparation fit remonter des émotions profondément enfouies, des sensations confuses de son enlèvement : les cris, la poussière, l’odeur du cuir et l’épingle de la fibule plantée dans sa paume. Il s’assura qu’il l’avait bien emportée et demanda :
– Rachel, pourquoi dois-je rejoindre mon père ? Je ne l’ai jamais vu depuis que je suis ici et je n’ai aucun souvenir de lui. Il n’éprouve aucune affection pour moi, j’en suis persuadé.
– Un garçon de ton rang ne doit pas être élevé par une femme, et puis ton père a pourvu à tous tes besoins pendant ces années ; il doit bien t’aimer un peu.
– J’ai promis à David de veiller sur toi. À quoi me servira tout ce qu’il m’a appris si je ne peux t’aider ?
À l’évocation de son mari, Rachel fondit en larmes, mettant Loup à la torture.
– Ne complique pas les choses, Loup. Tu ne veux pas m’attirer d’ennuis, hein ?
Loup maudit ce père dont il ne connaissait que les actes d’autorité. Rachel, se voulant persuasive, dénombrait les avantages d’une vie à la cour, mais cette sinistre litanie amplifiait son désarroi. Sa soumission forcée avait un goût de fiel.
Le jour même, il partit pour Worms10, un voyage risqué en cette fin d’automne. Le bourbier des routes pouvait se transformer en piège, mais il devait rejoindre la cour avant le départ de son père qui allait combattre les Saxons.
Entouré d’une importante escorte, le char s’ébranla dans un jour indécis et frileux peinant à chasser l’obscurité. Rachel, serrée dans son voile de laine, était venue lui dire au revoir, sans effusions, avec la distance qui seyait avec un jeune seigneur.
Loup souleva le rideau censé repousser le froid et regarda la frêle silhouette s’éloigner. Quand il ne la vit plus, il le rabattit et se laissa aller à son chagrin.
Ils traversèrent des forêts hostiles, des tourbières, des marais dont s’échappaient des vapeurs de brume, inquiétantes et glacées. Ils s’aventurèrent sur des surfaces trompeuses, à travers des campagnes désertes, et entrèrent dans des villes de la taille de bourgs. Ils empruntèrent d’anciennes voies romaines cahoteuses, s’enlisèrent dans des chemins bourbeux, dormirent dans des abbayes dont il oublia le nom et parvinrent enfin à Worms.
Cette immense cité, située sur la rive ouest du Rhin, comptait plus de cinq mille âmes. Loup n’avait jamais vu autant de monde. L’escorte avait du mal à leur ouvrir un passage dans la foule.
Tout était si différent de sa Provence : le ciel bas, les maisons de bois et de terre, le parler des habitants. Une pluie fine estompait les détails des rues et des costumes ; seuls persistaient l’agitation, le bruit et l’odeur de terre mouillée et d’immondices. Loup, la tête passée par la bâche entrebâillée, s’imprégnait de l’atmosphère de cette cité monstrueuse et scrutait la brume pour apercevoir le palais. Cette arrivée sous un ciel d’encre, dans une ville aux contours indécis, lui sembla de mauvais augure.
Le capitaine de son escorte lui annonça qu’ils ne se rendraient pas au palais, mais dans la résidence de son père. Loup ignorait l’existence de cette demeure. Dans sa naïveté, il avait, jusqu’à ce jour, imaginé Gui de Carry vivant de façon itinérante dans des camps de soldats ou à la cour de Charles. La découverte de cette vie organisée, inconnue, l’éloigna un peu plus de lui.
Ils franchirent une palissade de bois par un portail voûté et s’arrêtèrent devant une grande bâtisse à étage, au toit couvert de bardeaux et à l’allure de ferme fortifiée. Des poules s’égayaient dans la cour où des esclaves tiraient de l’eau d’un puits à balancier.
Personne ne vint lui souhaiter la bienvenue. Un homme fit signe au garçon de le suivre. Les jambes encore secouées par les soubresauts du chariot, il avança d’une démarche incertaine et banda ses muscles pour l’affermir. Il passa devant une écurie, une cuisine, une boulangerie et des locaux fermés au rez-de-chaussée. On le fit monter ; plusieurs pièces donnaient sur une galerie qui courait tout le long de l’étage. Il s’arrêta devant une porte, plus large que les autres, gardée par un homme en broigne.
– Ton père va te recevoir dans l’aula, lui dit son escorte en le faisant pénétrer dans une très grande salle aux murs blanchis.
C’est dans ce lieu impersonnel où se tenaient les banquets et les réceptions officielles que Gui de Carry allait rencontrer son fils unique pour la première fois.
Des bancs de bois disposés le long des murs, une table massive encombrée de gobelets sales et d’aiguières renversées, une chaire11 sculptée peinaient à remplir l’espace et le faisaient apparaître encore plus grand. Une fresque peinte, représentant une scène de bataille, en constituait le seul luxe. Loup, écrasé par l’immensité du lieu, se sentit plus seul que jamais.
Il se demandait si son père le recevait ici plutôt qu’au palais parce qu’il avait honte de lui.
Des pas retentirent à l’extérieur. Loup se redressa et rejeta les épaules en arrière.
Le garde ouvrit les deux battants et introduisit un homme très brun à la taille modeste et à l’allure fière. Un adolescent, vêtu d’une broigne l’accompagnait ; il lui ressemblait trait pour trait. Loup le prit pour un garde du corps, mais son assurance et son sourire hautain contredirent cette supposition.
– Tu es Loup, avança son père bien inutilement. Voici ton frère, Bernard. C’est un combattant valeureux qui est destiné à rejoindre la scara. Il est éduqué à l’usage des armes et à la chasse au faucon. J’espère que tu emprunteras la même route, mais à ce qu’on m’a rapporté, il te faudra travailler dur.
Loup esquissa un mouvement des lèvres pour se défendre, mais son père l’interrompit d’un geste. Nous sommes à présent attendus par le souverain qui souhaite nous faire part de ses plans pour le futur.
Ce fut tout. Loup, resté seul, se demanda s’il n’avait pas rêvé. Il avait échafaudé mille scénarios pour ces retrouvailles, du plus sombre au plus optimiste, mais aucun n’anticipait une telle indifférence. Aucun, non plus, n’avait prévu l’existence d’un frère. Devait-il s’en réjouir ?
Les mois qui suivirent lui apportèrent la réponse : Bernard l’ignora, tout occupé à s’entraîner au combat et à se rendre digne de l’orgueil de son père. Sa présence intimidait Loup : son frère serait amené à participer à des manœuvres difficiles, à des raids en territoire ennemi ; autant d’occasions d’actes héroïques qu’il n’aurait jamais l’occasion d’accomplir.
Bernard, lui, était rongé par une peur sourde de n’être plus le seul fils, celui qui comptait.
D’abord désorienté par le froid mordant, le changement de vie, de rythme – son père s’entêtait à lui faire enseigner le combat plusieurs heures par jour – Loup apprit à apprécier son existence itinérante dans l’entourage du souverain qu’ils accompagnaient au gré de ses déplacements de palais en palais. Il suivait, avec quelques nutriti12, des leçons dispensées par des érudits dont le roi aimait s’entourer. Il profita des exposés du grand Alcuin* qui enseignait au prince, à ses enfants, à sa cour et même à ses domestiques, lecture, écriture, grammaire et des notions de philosophie. Le roi encourageait le progrès des élèves par sa présence et par des dignités et des emplois attribués aux plus méritants.
– Je préférerais te voir manier le glaive que la plume ! Prends exemple sur ton frère. Quel avenir t’attend ? Comptes-tu devenir scribe ou notaire, à moins que tu ne sois tenté par une vie de moine ? Tu pourras ainsi passer ton temps à copier des manuscrits et à donner des leçons aux enfants des pauvres !
– Le souverain lui-même est avide de savoir. Ne parle-t-il pas le latin et le grec ?
– Mais il sait aussi guerroyer ! Qu’espères-tu devenir ? Comte ? Missus ? Ne te fais aucune illusion, Loup, d’autres ont de meilleures références que toi, même si tu n’as pas à rougir de ta noblesse. Tu descends des Goths, ne l’oublies jamais.
Loup ne s’attendait pas à accéder à ces illustres fonctions, mais il prenait goût à l’apprentissage et mettait un point d’honneur à exceller. Au grand dam de son père, il ne tarda pas à se faire remarquer.
10 Ville d’Austrasie*.
11 Siège élevé à dossier et accoudoirs, utilisé par les personnages de haut rang.
12 Fils de grands envoyés à la cour par leurs pères dès l’âge de sept ans, nourris à l’enseignement des lettrés palatins et destinés à devenir comtes.
3Année 782
Loup avait atteint l’âge de prêter serment. Ces deux années à la cour étaient passées plus vite qu’il ne s’y était attendu. La fréquentation de l’école du palais lui avait donné le goût de l’étude et le respect du pouvoir du verbe. Reconnaissant d’être autorisé à suivre l’enseignement des Arts libéraux avec les fils de nobles, il apprenait la langue latine et la grammaire, s’entraînait à la rhétorique et à la dialectique ; deux disciplines dans lesquelles il avait très tôt montré des aptitudes.
Il était devenu un garçon réfléchi, apprécié pour son habileté dans des joutes verbales au cours desquelles il parvenait presque toujours à convaincre son interlocuteur. Sa fréquentation des marchands juifs, en affaire avec David, n’était sans doute pas étrangère à son savoir-faire. Ses maîtres vantèrent ses talents à Charles, qui se mit en tête de ne pas les laisser inexploités.
La même harmonie ne présidait pas aux relations de l’adolescent avec sa famille. Son père s’absentait souvent, au gré des campagnes militaires et quand il était présent, il se consacrait à l’entraînement de Bernard, dont il encourageait les progrès. D’abord jaloux, Loup goûtait à présent cette indifférence, qui le laissait à ses livres pendant que Bernard s’illustrait dans l’art du combat.
– Allez, mon frère ! Viens monter avec moi, si tu es capable de sortir la tête de tes manuscrits ! Bernard avançait en tenant deux chevaux par leurs guides.
Loup savait déjà comment cette promenade fraternelle allait se terminer.
– Je dois répéter mon serment de fidélité.
– Loup, ne sois pas naïf. Que crains-tu ? Que Charles te refuse sa protection ? Tu sais très bien que père a fait le nécessaire pour que tu deviennes vassal du roi.
Il parlait trop fort ! Frédégonde, la fille du comte d’Autun, pouvait l’entendre. Loup se demanda d’ailleurs si Bernard n’essayait pas de le ridiculiser à ses yeux. Même s’il refusait d’admettre cette jalousie, il ne voyait pas d’autre explication à son attitude. S’il venait à capter l’attention du fils d’un grand, Bernard tentait de le supplanter en le rabaissant. Il avait même cru, à deux ou trois reprises, qu’il lui enviait ses connaissances et son habileté intellectuelle, mais il avait dû se méprendre.
Auréolé de sa future gloire, Bernard séduisait de jeunes filles nobles, dont certaines espéraient que leur père le choisirait pour époux. Lui, conseillé par Gui, agissait avec prudence, ne fermant aucune porte, déterminé à faire un mariage susceptible de renforcer sa position.
Si Loup convoitait l’aisance de Bernard et l’affection que lui témoignant leur père, il ne cherchait jamais à lui nuire.
Loup se résigna à suivre son aîné ; il était assez bon cavalier, mais moins à l’aise que lui. Bernard s’élança sans effort sur sa monture, posant les mains sur la croupe du cheval et bondissant avec une souplesse maîtrisée. Une fois en selle, il tourna la tête vers son frère.
– Alors, Loup ? Vas-tu rester longtemps les pieds dans la poussière ?
Sans répondre, Loup prit son élan et tenta de se hisser d’un bond. Sa jambe glissa, il se rattrapa de justesse à l’encolure du cheval, luttant un instant pour trouver son équilibre. Bernard laissa échapper un ricanement, léger, mais suffisant pour piquer son orgueil.
Comme il s’y était attendu, la chevauchée dégénéra vite en une course effrénée en forêt. Loup se tenait allongé sur sa selle pour éviter les branches meurtrières, tandis que Bernard s’en jouait dans de grands éclats de rire. Une fois dans la clairière, il ralentit l’allure pour laisser à son cadet le temps de reprendre son souffle.
– Allez, mon frère, tu t’es bien défendu. Si tu veux, je te donnerai quelques leçons. Tu pourras alors monter à cheval comme un cavalier de la scara.
Comme à son habitude, Bernard soufflait le chaud et le froid. Loup, désorienté, ne savait jamais s’il devait s’en méfier ou lui faire confiance. Cette relation le déstabilisait et l’empêchait de construire un rapport apaisé avec son aîné. Dans cette cour où chacun cherchait des alliances puissantes, Loup se lamentait de ne pouvoir compter sur personne.
À deux ou trois reprises, il avait essayé de lui parler de leur mère, mais Bernard, pourtant de quatre ans plus âgé, affirmait n’en avoir aucun souvenir. De nombreuses questions tourmentaient l’adolescent : à supposer que son père l’ait emmené à la naissance de Loup, comment pouvait-il avoir oublié sa mère ? Et pourquoi ne lui avait-elle jamais parlé de lui ? Ce mystère en cachait sans doute d’autres, trop sombres pour être déterrés.
***
Quand le jour de la commendatio13* arriva, Loup se rendit au palais d’Attigny14, où le roi était de passage. Ce palais rural s’élevait au milieu d’un domaine qui occupait un emplacement stratégique entre l’est et l’ouest du royaume.
– Tu vas te commander au service du roi, ton seigneur, qui te garantira protection en retour. Tu lui dois un dévouement complet.
Loup hocha la tête sans manifester son impatience à entendre sans cesse les mêmes choses de la bouche de ses maîtres.
– Tu deviendras alors un vassus dominicus15, un vassal direct du roi, mais tu ne seras pas doté ; tu ne recevras aucun bénéfice16 et devras te contenter d’une prébende quand tu seras en âge de remplir une tâche au palais. As-tu bien compris ?
– Oui, maître, je le sais.
– Ce titre de vassal royal te place au-dessus des autres vassaux, mais te donne aussi des devoirs bien plus importants. Tu seras un vassal pauvre, tenu en piètre estime par ceux qui ont reçu des terres en bénéfice ; tu devras pourtant résister à la corruption.
– J’en suis bien conscient.
– Intéressons-nous à présent à la cérémonie proprement dite. Qu’as-tu retenu ?
Loup récita :
– Je dois m’agenouiller devant le roi et poser mes mains dans les siennes.
– Pourquoi ?
– Par ce geste, je me place en sa protection et l’assure de mon dévouement complet. Je donne toute ma personne, corps et âme ; je ne m’appartiens plus et je deviens l’homme du roi.
Satisfait de sa réponse, le maître l’incita à poursuivre.
– Je dois ensuite prêter le serment de fidélité sur les saintes reliques. Pour m’engager aussi envers Dieu.
Juste avant la cérémonie, grelottant dans sa tunique brodée à la porte de l’aula, Loup avait tout oublié. Quand on le fit entrer, il ne vit que le souverain entouré des témoins de son serment ; tous les autres courtisans, son père et son frère n’existaient plus. Paniqué à l’idée d’avoir oublié les formules rituelles, il avança vers le trône le cœur battant, d’un pas qu’il voulait assuré. Et s’il bafouillait devant le roi ? Les autres l’entendaient-ils aussi ? Il ferma les yeux un instant. L’image de sa mère, son parfum perdu dans la poussière lui revinrent. Il serra les dents, s’agenouilla sur la pierre froide et plaça ses mains dans celles du souverain.
– Ainsi, moi, Loup de Carry17, promets aux parties de mon seigneur, Charles le roi et de ses fils, que je leur suis et serai fidèle aux jours de ma vie sans fraude ni mal engin18.
L’évêque portant les reliques vint alors se placer à ses côtés. Le moment du serment de fidélité était venu.
Les mains jointes, Loup se torturait pour retrouver les mots si souvent répétés. La gorge nouée par l’émotion, il craignait de ne pouvoir prononcer une parole.
– Je prête serment sur les reliques et je promets fidélité à Charles, comme vassal par droit et par justice, de tout mon dévouement le doit à mon seigneur.
Bernard, en retrait, observait la scène, le visage impassible. Mais, sous ses paupières mi-closes, perçait l’inquiétude. Peut-être redoutait-il, derrière l’apparente faveur royale, un rival capable d’ébranler la place qu’il s’était arrachée auprès de leur père.
À la fin de la cérémonie, l’adolescent, encore imprégné de sa solennité, vit son père approcher, sans doute pour le congratuler.
– J’ai bien cru que tu n’allais pas t’en sortir. Je suis sûr qu’on ne t’entendait pas du fond de la salle.
Un amer sentiment de découragement remplaça sa fierté passagère, puis la rage fit face au mépris. Loup réprima sa colère et fit bonne figure. Son embarras était donc la seule chose que Gui avait choisi de mettre en exergue. Bernard, lui, resta silencieux et se laissa happer par la foule des courtisans.
– Je pars, dans quelques jours, au combat avec ton frère. Je ne te verrai plus, car je dois soutenir l’armée qui va prier et jeûner avant la guerre.
13 Entrée en dépendance vassalique.
14 En Francie*.
15 Vassal du seigneur qui prêtait fidélité directement au roi.
16 Bénéfice ou bienfait : lot de terres remis à titre viager, permettant aux fonctionnaires de vivre.
17 Avant 1054, toutes les localités qui bordent l’étang de Berre, de Fos à Carry, dépendaient du diocèse d’Arles.
18 Sic promitto ego ille partibus domini mei Caroli regis et filiorum ejus quia fidelis sum et ero diebus vitae meae sine fraude et malo ingenio.
4Année 796
Loup, perché sur une estrade, attendait, avec une impatience teintée d’énervement, l’arrivée triomphale de Pépin le Jeune. Autour de lui, les fils de grands, les nutriti, arboraient des mines hautaines conformes à leurs futures responsabilités. Le fils de Charles et de la feue reine Hildegarde ramenait le trésor des Avars*. On le disait prodigieux, le plus important jamais saisi par les armées royales ; plus fabuleux encore que celui rapporté l’année précédente par le duc de Frioul. Le premier convoi envoyé par Pépin à son père avait laissé augurer de mirifiques splendeurs. La cour bruissait de légendes depuis qu’un pigeon avait annoncé la prise du Ring19 de ce peuple païen. L’imagination des courtisans vagabondait sur ce trésor phénoménal, fruit de trois siècles de pillages, de tributs et de rançons. Cette manne attisait toutes les convoitises et grands du royaume, alliés de l’empereur, prélats et comtes se demandaient quelle part leur serait échue.
Le jeune homme attendait surtout le retour de son père, parti guerroyer aux côtés de Pépin pour soumettre cette tribu belliqueuse capable de résister à la redoutable scara. Il revenait couvert de gloire pour recevoir les honneurs dus à sa bravoure. Loup espérait le rendre fier ; le roi ne l’avait-il pas remarqué, loué même, pour son habileté verbale et ses talents de persuasion ? Il s’en voulut de ce sentiment puéril toujours aussi vivace. Ses joutes oratoires lui parurent soudain dérisoires, comparées à des combats de douleur et de sang.
Le peuple d’Aix-la-Chapelle20 était massé au bord de la route, depuis la veille, pour attendre le passage des vainqueurs et apercevoir le trésor dont il n’aurait pas une pièce. Le jeune homme se souvint des scènes mystiques qui avaient précédé le départ des guerriers, des clercs nu-pieds, récitant des psaumes pour glorifier cette guerre sacrée destinée à étendre le règne du Christ.
Le martèlement des sabots sur les pavés de l’ancienne voie romaine le tira de sa rêverie. Il annonçait la formidable cavalerie de Charles qui ouvrait la route, gonfanons21 au vent, auréolée de sa puissance destructrice. Vêtus de leurs broignes et de leurs casques en cuir bouilli, l’écu sur le dos, la lance à la main et le glaive à la ceinture, les cavaliers se scindèrent en deux pour dégager un espace au vainqueur, le livrant ainsi aux vivats de la foule. Pépin le Jeune avança, la tête haute, rempli d’orgueil, sa cape flottant derrière lui, aura rouge de tout le sang versé. Le jeune homme essaya de deviner ce qui occupait ses pensées dans ce moment de triomphe : la fierté de son père ? Sa récompense ? Le prestige que ce trophée lui conférait ? Ou tout simplement la reconnaissance d’être encore en vie ? Quand il passa devant lui, il eut l’impression que le prince lui jetait un regard sombre. Il sourit de cette illusion.
Cette imposante mise en scène avait pour but de célébrer la gloire du prince tout en exhibant des richesses, gages de la fidélité des grands et des vassaux royaux. Elles permettraient aussi de doter largement les églises pour rendre grâce au Seigneur ; Angilbert* allait être dépêché à Rome pour offrir une partie du trésor au nouveau pape Léon III.
Loup scruta la troupe de cavaliers à la recherche de son père, un germe d’inquiétude planté dans la poitrine. Les exclamations de la foule le ramenèrent au spectacle. Le premier char, tiré avec difficulté par quatre bœufs, fut suivi de quatorze autres, chargés de bijoux, d’étoffes précieuses, de vaisselle d’or et d’argent, d’armes, d’objets liturgiques, de coffres remplis de pièces. Un seizième, un peu en retrait, clôturait le convoi. Un homme à cheval lui ouvrait la route. Il se demanda si cet arrangement était destiné à dévoiler une ultime merveille ou à glorifier un soldat particulièrement valeureux. Le cavalier regardait droit devant lui, grave, imperturbable. Un détail dérisoire retint l’attention de Loup : ses pieds étaient calés dans deux anneaux de fer fixés à la selle ; sans doute les fameux étriers des Avars. Un char ouvert s’avança, recouvert d’un drap rouge. Il portait la dépouille d’un guerrier en tenue de combat, exposée à l’hommage de la foule.
Loup se décomposa. La scène se brouilla, le silence se fit. Il ressentit un vide immense.
19 Principal centre fortifié des Avars.
20 Aachen au temps de Charlemagne.
21 Un gonfanon est une bannière ou un drapeau, généralement de forme triangulaire, utilisée comme symbole de ralliement, notamment dans les armées médiévales.
5Année 796
Pépin devint l’homme de confiance d’Angilbert quand, de poète de cour, il fut nommé abbé du monastère de Centula de Ponthieu, futur Saint-Riquier22, en reconnaissance des services rendus au roi.
Angilbert menait une vie très mondaine et se déplaçait dans son abbaye pour y superviser les travaux de réfection lancés dès sa désignation. Pour le seconder sur place, il avait choisi un moine, soustrait à la sottise d’un abbé laïc, qui, insensible à son intelligence et à son érudition, lui confiait des tâches indignes de son savoir.
Angilbert avait été séduit par la culture de Pépin, mais aussi par la clarté de ses idées sur les questions qui agitaient l’Église et le roi. Il pouvait aborder sans fard avec lui le problème du pédantisme et des rivalités au sein de l’académie palatine*, la qualité des textes sacrés, l’éducation des clercs ou l’adoptianisme23*. Pépin aurait eu sa place parmi les évêques, mais ses origines — il était issu d’une famille de marchands — compromettaient gravement ses chances de le devenir. Le moine n’en était pas affecté le moins du monde, mais son ami ne désespérait pas d’amener le souverain à remarquer cet homme d’exception.
Les deux compagnons discutaient aujourd’hui de l’état des textes sacrés :
– Les textes sacrés à notre disposition sont sans valeur, s’énerva Pépin.
– Tu ne manques pas d’aplomb !
Pépin feuilleta un évangile, le front barré d’un profond sillon. L’amas de lettres imbriquées les unes dans les autres formait une énigme plus qu’un message divin. Même lui, pourtant familier de ces écrits, devait marquer une pause pour déchiffrer les phrases.
– Regarde… Une faute ici, une lettre effacée là. Comment veux-tu qu’un clerc ne se trompe pas ? Que reste-t-il du message originel quand la lecture elle-même devenait une épreuve ?
Il tapota la phrase du doigt, puis se tourna vers son ami.
– Dis-moi, crois-tu vraiment que Dieu tolère qu’on déforme ainsi sa parole ?
Angilbert esquissa un sourire amusé.
– Tu veux donc changer des siècles de tradition ? Les moines qui copient ces textes te diront qu’ils ont toujours fait ainsi.
Pépin ignora la remarque.
– Tous les clercs sans exception doivent pouvoir consulter des écrits sûrs.
– Des manuscrits exempts de fautes ! ? Ta passion t’a embrumé l’esprit, Pépin. C’est une tâche titanesque !
Pépin s’enferma dans un silence buté, comme chaque fois qu’il était contrarié ou en pleine réflexion, avant de poursuivre :
– La minuscule caroline y contribuera. Plus lisible que l’onciale ou la mérovingienne, elle…
– Quel optimisme ! Les scribes ont leurs habitudes.
– Je sais qu’ils résisteront, mais ils finiront par se plier à la volonté du roi.
– Tu en parles comme d’une conquête.
– Toute réforme est une conquête.
– Les abbés et les évêques y verront une ingérence dans leur autonomie.
– Et une diminution de leur pouvoir, je sais ! Diffuser largement des textes religieux et des capitulaires renforcera de facto l’autorité de Charles. Mais nous pouvons surmonter ces difficultés.
Angilbert resta pensif un instant, puis revint à sa préoccupation du moment :
– Tu m’expliqueras au cours de notre voyage à Rome comment tu comptes t’y prendre.
– Tu veux entreprendre un pèlerinage ?
– Non, le roi m’a chargé d’une mission : je dois apporter à Léon III une part conséquente du trésor des Avars. Le souverain tient à entretenir de bons rapports avec la papauté.
– C’est d’une solide escorte dont tu as besoin, pas d’un moine gêné par son embonpoint. Que ferai-je si des brigands nous attaquent, leur donnerai-je l’absolution ? Les pourfendrai-je avec mon goupillon ?
Il accompagna sa remarque d’un rire qui agita sa panse.
– Tu me seras précieux sur place : sache que je n’apporte pas que des richesses au pape. Charles m’a confié une lettre qui expose la position carolingienne concernant les pouvoirs respectifs du roi et du pontife.
– C’est d’un miracle dont tu as besoin, pas d’un moine radoteur.
– Tu n’as pas tort. Je ne suis pas convaincu que la missive d’Alcuin sera bien accueillie. Il en cita un extrait de mémoire :
« À moi, il appartient, avec l’aide de la divine piété, de défendre en tout lieu la sainte Église du Christ par les armes : au-dehors contre les incursions des païens et les dévastations des infidèles ; au-dedans en la protégeant par la diffusion de la foi catholique. » Charles est malin, il sait que le pontife a besoin de lui. Gageons que le sirop du trésor dissipera l’amertume de ses exigences.
– Je ne vois toujours pas en quoi je puis t’être utile.
– La mission s’accompagne d’un volet… Comment dire ? Savant.
Pépin feignit l’indifférence, mais dressa l’oreille.
– Léon III souhaite offrir au souverain des manuscrits ; j’ai besoin de ton aide pour les sélectionner ; le pape nous laisse une totale liberté.
***
Le convoi conduisant les deux hommes à Rome s’ébranla trois jours plus tard. Pépin se demandait s’il avait eu raison d’accepter tant les secousses du chariot l’incommodaient. Il n’était pas fait pour cette vie aventureuse et préférait la bibliothèque de l’abbaye à ces routes cabossées. La lenteur de leur train encourageait les longues conversations entre les deux amis. Chemin faisant, Angilbert se laissa aller à des confidences. Pépin, peu habitué à recevoir ce genre de confessions, et plus à l’aise avec les abstractions qu’avec les sentiments, se tint longtemps sur la défensive avant d’accepter qu’Angilbert se mette à nu.
Le poète, que Charles appelait son Homère, son homme de confiance, était déchiré entre son devoir et sa passion pour Berthe, la fille du souverain, avec qui il entretenait une relation secrète depuis plusieurs mois. Cet homme de cinquante ans24, amoureux d’une femme de plus de trente ans sa cadette, était conscient de l’incongruité de cette situation et s’imposait des pénitences pour expier cette coupable passion.
Pépin, plus surpris que choqué de trouver derrière la façade assurée de l’homme de cour, un être fragile, tenté par la chair, reçut ces confessions avec une bienveillance exempte de jugement, une fois son affolement surmonté. Angilbert découvrit en cette occasion ses qualités humaines insoupçonnées, considéra qu’il avait bien placé sa confiance et tint le moine en une encore plus haute estime.
À Rome, Pépin fut récompensé au-delà de ses espérances et se demanda comment il avait pu hésiter à entreprendre ce périple. Il resta enfermé dans la bibliothèque papale tout le temps que dura leur séjour, n’en sortant que pour se sustenter ; les stimulants intellectuels ne supplantaient jamais chez lui les nourritures terrestres. Son séjour fut hélas gâché par les affres de l’indécision, son choix devant se limiter à cinq manuscrits. C’est le cœur déchiré qu’il dut se décider la veille de leur départ.
22 Neustrie*.
23 Doctrine religieuse selon laquelle Jésus serait devenu le fils de Dieu par adoption.
24 Ou 56 ans selon les sources.
6Année 796
De retour à Aix-la-Chapelle, Angilbert insista pour que Pépin vienne présenter en personne les ouvrages sélectionnés au souverain. Le moine se fit violence pour vaincre sa sauvagerie habituelle et sa réticence à se mêler aux grands. Il serait reparti dans son monastère, laissant Angilbert se charger de l’exposé s’il n’avait tenu qu’à lui, mais la ténacité de son ami le força à s’exécuter.
– Tu as impressionné le roi par ton érudition, lui annonça-t-il après l’entrevue, un sourire satisfait aux lèvres. Je serais étonné s’il ne te confiait pas de nouvelles responsabilités.
– Je n’en veux point. Je me plais parmi mes manuscrits.
– Justement !
– Que veux-tu dire ?
– Tu verras ! Je ne désire point gâcher les effets de Charles.
Quand Pépin fut à nouveau mandé auprès du roi, il s’attendait à recevoir un titre ou à être nommé à la tête d’une abbaye. Il se demandait s’il était possible de décliner l’offre du souverain sans s’attirer ses foudres. Sans doute ne s’était-il jamais vu refuser un honor25. Il regrettait de s’être mis dans cette situation et se sentait pris au piège. Il n’avait cure de gloire et de richesses et ne voulait pas sacrifier sa sérénité sur l’autel de la réputation. Sa proximité avec Angilbert et, à travers lui, avec les membres de l’Académie, lui avait fait percevoir l’atmosphère de rivalité qui régnait à la cour. Elle n’épargnait pas les intellectuels qui auraient pourtant dû s’élever au-dessus de ces guerres d’influence. Aussi est-ce empli d’appréhension qu’il se rendit à la convocation du souverain.
À Aix-la-Chapelle, résidence privilégiée par Charles pour ses eaux thermales, les travaux d’agrandissement allaient bon train. Il voulait en faire un palais digne de rivaliser avec celui des empereurs d’Orient, un espace sacré, centre du monde religieux, comme Byzance. Il avait fait venir de Ravenne des colonnes de marbre et construit une chapelle octogonale inspirée des églises du Saint Empire romain d’Orient pour magnifier le lieu. On avait même ouvert des fonderies pour la fabrication de ses grilles et de ses portes de bronze.
Pépin franchit le porche en forme d’arc triomphal romain d’un pas incertain ; il avait entendu parler de l’aula regia, la salle d’apparat, aussi vaste qu’une cathédrale26, et s’effrayait de devoir subir cet entretien dans un si auguste lieu. Venir au palais lui avait coûté de gros efforts et il ne se sentait pas capable d’en affronter les fastes. Aussi est-ce avec un soulagement évident qu’il se vit introduire dans une pièce aux proportions beaucoup plus modestes, réservée à l’école du palais. Charles s’y trouvait avec Alcuin.
– Angilbert m’a chanté tes louanges ; tu as fait preuve d’un grand discernement en choisissant à Rome les ouvrages offerts par le pape. Je voudrais connaître tes idées pour remédier à la pénurie de manuscrits dont souffre mon royaume.
On avait dit à Pépin que le souverain ne s’embarrassait pas de détours ; c’était la stricte vérité. Loin d’être désarçonné par une question aussi complexe, et soulagé de ne pas se voir proposer un présent dont il n’aurait su que faire, il se lança dans une impertinente diatribe sur l’état des textes et les nécessaires réformes.
– Les textes sacrés dont disposent les évêques, les moines et les prêtres sont au mieux lacuneux et confus, au pire, fautifs.
Les sourcils froncés de l’empereur auraient dû calmer son ardeur ; il n’en fut rien.
– Les classiques latins ne valent pas mieux.
– Et que suggères-tu pour pallier cette situation ?
– Il faut avant tout corriger les textes sacrés existants.
– Et comment comptes-tu t’y prendre, s’ils sont tous défectueux ? Quels seront les modèles ?
Charles le regardait à travers ses yeux étrécis, curieux de le voir se sortir de ce syllogisme. Emporté par sa passion, Pépin ne vit pas le piège et poursuivit sa démonstration.
– Il est urgent de se procurer des écrits filables là où ils se trouvent afin de rectifier ceux existants. L’adoption de la minuscule caroline facilitera le travail des scribes.
Il marqua une brève pause, gêné de se montrer trop impulsif. Ses joues s’empourprèrent. Il prit une profonde inspiration pour ordonner les phrases qui se bousculaient dans sa tête.
– À condition de bien la maîtriser, intervint Alcuin.
– Une formation s’avère en effet indispensable, votre Majesté.
Dans le feu de la conversation, Pépin donnait du « Majesté » au lettré, ce qui lui arracha un sourire. Son statut d’écriture officielle sera d’un grand secours. Des modèles de calligraphie, des guides expliquant les techniques aux scribes leur permettraient de s’exercer. Ainsi…
Charles s’appuya sur l’accoudoir de sa chaire.
– Voilà un programme ambitieux. Te rends-tu compte de ce que cela implique ?
Pépin sentit la sueur couler dans son dos.
– Élaborer des manuels exemplaires, inventorier les bibliothèques, vérifier l’état des manuscrits, acquérir les textes indispensables et les acheminer d’Italie ou de l’Orient, les faire reproduire, visiter les scriptoria et s’assurer de la qualité du travail des copistes. Il faudrait aussi…
Il parlait avec fougue, emporté par sa passion. Il n’avait pas remarqué le silence qui s’était installé. Ce fut seulement quand il croisa le regard d’Alcuin qu’il comprit. Trop tard.
– Parle sans crainte, Pépin, l’encouragea Alcuin.
– Il ne serait pas inutile de contrôler les connaissances des clercs qui diffusent le savoir.