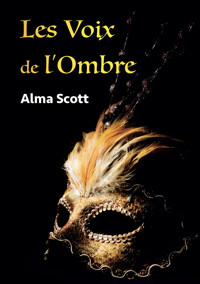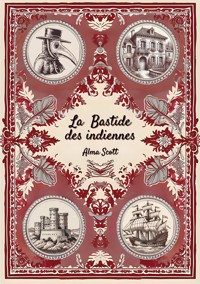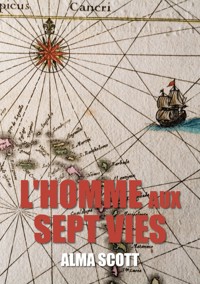Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Pour peupler son vaste territoire qui s’étendait des lacs Michigan et Érié au golfe du Mexique, la France avait besoin de femmes. Elle envoya donc en Louisiane quatre-vingt-huit orphelines pour qu’elles y épousent des colons. Iris, une jeune veuve entraînée dans cette expédition par un malheureux concours de circonstances, connaîtra une existence jalonnée de dangers, de trahisons et de violences. Sur fond de guerres indiennes, de rivalités incessantes avec les Anglais et les Espagnols, cette fresque historique suit le parcours d’une femme résolue à poursuivre un bonheur sans cesse hors d’atteinte. Les voix des cinq narrateurs se croisent pour tisser le récit, mais une sixième, énigmatique et malveillante, se fait entendre. Qui est ce personnage aux desseins obscurs ? Un mystère résolu au terme de cette histoire d’aventures, d’amitié et d’amour.
À PROPOS DE L'AUTRICE
Linguiste de formation et passionnée d’histoire,
Alma Scott s’inspire de ses recherches pour tisser des récits historiques d’une grande précision. Ses romans allient rigueur académique et imagination, plongeant les lecteurs dans des aventures palpitantes. "Les filles du Mississippi" a été autopublié pour la première fois en 2022.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 613
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur
La bastide des indiennes,2024
L’homme aux Sept Vies,2024
Le glaive et la plume, à paraître
ALMASCOTT
LES FILLESDUMISSISSIPPI
Narrateurs par ordre d’apparition
Manon Martin : amie d’Iris ; pensionnaires du couvent des Ursulines àAix.
Voix inconnue
Iris, Trotula Espérandieu : orpheline élevée au couventdes
Ursulines.
Sœur Gertrude : sœur officière à la Salpêtrière ; accompagnatrice des demoiselles de la Cassette au Mississippi.
Charles Desjardin : ingénieur ordinaire duRoi.
Philippe Beaupré : capitaine de la frégate L’Audacieuse.
Personnages secondaires
Amarok : Indien natchez, homme de confiance de Philippe Beaupré.
Honoré Barthélémy : négociant marseillais encafé.
Eugène Boulin : planteur de tabac.
Catherine : demoiselle de la Cassette.
René Duroux : négociant en sucre.
Monsieur de Kéralo : capitaine de la flûte La Baleine.
Personnages historiques
Page 531
ILes demoiselles de la Cassette1716 – 1721
1Manon, Saint-Domingue,1728
Je suis si impatiente de revoir Iris ! Philippe est parti la quérir au Cap. Je prie pour qu’elle arrive à temps.
Que de lieues parcourues, que de luttes engagées, que de rivalités vaincues depuis notre rencontre chez les sœurs Ursulines d’Aix.
Quand Iris est arrivée au couvent des Andrettes, en mille sept cent seize, me semble-t-il, j’avais depuis longtemps renoncé à compter les jours et les années. La sœur tourière1 m’avait trouvée, entourée d’une méchante couverture ; on y avait glissé un morceau de papier portant quatre mots : « fille de Jeanne-Marie ». Que cherchait donc ma mère en me laissant cet héritage ? Voulait-elle atténuer ma détresse ou s’imposer à tout jamais dans mon souvenir ? Elle avait laissé un vide que je m’étais épuisée à combler en lui inventant un visage, une vie, des excuses, mais je finissais toujours par la maudire de m’avoir condamnée à finir dans ce lieu engourdi.
À douze ans, je décidai que plus rien, même pas l’hypothèque des religieuses sur mon avenir, n’altérerait ma joie de vivre. Toutes ces années à me morfondre avaient exalté mon désir de vie ; l’arrivée d’Iris ne fut d’ailleurs pas étrangère à cette soif de bonheur.
C’était un mardi, le jour du gruau. Nous avalions sans joie notre bouillie en faisant mine d’écouter la voix monocorde des lectrices. Leurs paraboles illustraient l’abnégation, le sacrifice, la charité, la piété entre autres valeurs chrétiennes. L’assistante de la Mère supérieure leur succéda pour nous faire part des nouvelles de la communauté :
Le deuxième de ce mois, mademoiselle de Villeneuve est entrée au noviciat pour faire les trois mois d’épreuve. Elle a pris l’habit de novice des mains de l’abbé Juliac et a reçu le voile blanc. Le treize, la sœur Catherine de Jésus a fait vœu de chasteté, obéissance, stabilité et a fait profession en présence de monseigneur de Vintimille, archevêque d’Aix, et a reçu le voile noir de sa main après avoir fini les deux années de son noviciat.2 ;
Je cessai d’écouter la litanie de celles qu’on allait enfermer pour une vie placide et terne et laissai vagabonder mon imagination au-delà des murs, vers des espaces proscrits où on menait une existence libre, riche de bonheurs temporels.
Ma divagation s’interrompit à l’ouverture de la porte du réfectoire : la Mère supérieure entra, flanquée d’une fille d’à peu près mon âge. Elle avançait bien droite, les yeux rivés sur une ligne imaginaire qui passait au-dessus de nos têtes pour aller buter sur le mur, derrière l’estrade où se trouvait le lutrin. À peine arrivée, elle n’avait pas encore revêtu la robe de laine grise et la coiffe blanche des pensionnaires. La Mère supérieure l’installa en bout de table, face à moi et la présenta :
–Iris, Trotula3 Espérandieu nous a rejointes aujourd’hui. Je compte sur vous pour l’aider à respecter les règles de notre maison et à adopter une conduite conforme à nos préceptes.
Elle sortit après cette annonce, jetant Iris en pâture à nos regards curieux.
Comme les autres, je la détaillais par en dessous en essayant de deviner si ses pommettes hautes, sa crinière châtain mal contenue par une tresse, et ses yeux baissés annonçaient une personnalité généreuse ou perverse. Faisait-elle partie de ces filles de bonne naissance placées ici pour y être éduquées dans tous les domaines que requerrait leur future vie en société ? Avait-on payé les trois mille livres exigées pour lui permettre de rejoindre la communauté à ses seize ans ? Son air grave et ses gestes maîtrisés semblaient le confirmer. Iris avait alors levé les yeux de son écuelle. Ah quel étrange regard ! Je ne parvenais pas à définir pourquoi il exerçait une telle fascination. Ses yeux vous pénétraient sans pour autant se livrer. Plus tard, nous nous rapprochâmes, reconnaissant sans doute dans l’autre la même blessure ; j’osai alors la dévisager pour essayer de percer le mystère de son regard.
–Ne me fixe pas ainsi, Manon. Ne fais pas comme les autres, je t’enprie.
–Ne t’offusque pas de mon insistance ; j’essaie simplement de comprendre pourquoi il est si troublant de te regarder dans lesyeux.
–La nature m’a joué un tour en me peignant les prunelles de couleurs différentes.
Je compris le trouble provoqué par son regard. La déclinaison du gris de ses yeux, l’un gris acier, l’autre gris vert, vous captivait comme les reflets d’un ciel d’orage dans lamer.
–On m’a souvent traitée de sorcière à cause de ça ; je n’en ai hélas aucun pouvoir, même si ma mère… Son silence piqua ma curiosité.
–Même si quoi ? Ta mère était sorcière ! ?
J’attendais avec avidité qu’Iris me dévoile ses secrets les plus obscurs.
–Non, rebouteuse. Empirique4 aussi, unpeu.
Très impressionnée, j’imaginais le trépas de sa mère sur un bûcher.
–Et ton père ?
Elle me laissa inventer une réponse.
Très vite, nous devînmes inséparables, pourtant tout nous opposait : je dépendais de la charité des sœurs ; on payait la pension d’Iris. Je m’en rendis compte dans le traitement qu’elle recevait. Apparemment toutes logées à la même enseigne, la laine rugueuse de nos robes était là pour masquer nos origines. Nous mangions la même nourriture, portions toutes l’uniforme, respections des règles identiques, mais les enseignements différaient selon que nous étions vouées au couvent ou au monde séculier. Pour les filles abandonnées comme moi, condamnées à devenir sœurs domestiques : des travaux d’aiguille, de jardinage et de ménage et quelques rares rudiments de lecture. On veillait en revanche à faire de celles dont on payait la pension des femmes accomplies en leur apprenant la lecture, l’écriture, la musique, le dessin, la broderie et les bonnes manières.
De nature enjouée, je me délectais des maigres plaisirs de la vie, encore possibles malgré l’austère routine du couvent : les fruits chapardés au verger, les araignées glissées dans le lit de la zélatrice5, les bésicles de cette pauvre Adélaïde, la sœur infirmière, que je cachais pour avoir le plaisir de les chercher pour elle et de passer ainsi de précieux moments en sa compagnie. D’orpheline vouée à une vie de servitude, je me transformais alors en pensionnaire digne qu’on lui fasse la conversation.
Iris se rendait souvent à l’infirmerie ; elle y aidait sœur Adélaïde à préparer onguents et potions. Je ne savais pas qui tirait le plus de bénéfice de cette complicité.
Un jour où je venais de retrouver les bésicles de la sœur infirmière dans un pot de poudre blanche, sœur Adélaïde me demanda de lui passer le Poterium sanguisorba6.Je connaissais mes lettres et savais déchiffrer des mots simples, mais la lecture des noms latins inscrits sur les étiquettes dépassait largement mes capacités. Je restai indécise devant l’alignement de pots en faïence, me demandant comment j’allais justifier mon ignorance ; sœur Adélaïde ne voudrait plus jamais de moi dans son infirmerie si elle découvrait que je ne savais pas lire. Iris, se rendant compte de ma gêne, vint à mon secours et lui tendit lepot.
–Tu m’as évité bien de l’embarras, lui dis-je en guise de remerciement lorsque nous fûmes seules.
–Il ne tient qu’à toi de ne plus jamais te trouver dans pareille situation. Veux-tu que je t’apprenne à lire ?
–Mais je connais déjà mes lettres et… quelquesmots.
–Tant mieux, nous irons ainsi plusvite.
L’effort à fournir ne me faisait pas peur, mais je craignais de ne pas être à la hauteur des espérances de monamie.
–Une sœur domestique n’a pas besoin de savoirlire.
–Tu sais, la bibliothèque de l’infirmerie regorge de livres interdits ; ceux que l’on range sur les plus hautes étagères.
Cette perspective de plaisir défendu eut raison de mes réticences ; j’entamai donc l’apprentissage de la lecture avec l’espoir exagéré d’échapper à mon destin tout tracé. Le sable des allées, les tableaux de l’infirmerie puis quelques morceaux de papier dérobés servirent de support à mes débuts de lectrice. À chaque moment de découragement, Iris me montrait le sommet de la bibliothèque. Quand enfin je fus en mesure de déchiffrer sans trop d’hésitation, j’exigeai ma récompense.
–Je veux lire les livres défendus.
–Ils sont encore un peu trop difficiles pour toi ; ce sont des traités de médecine, comme celui de Monsieur Mauriceau7 sur les maladies des femmes grosses et accouchées.
–Est-ce qu’il y en a un sur la façon de ne pas se retrouver grosse ?
–Prends garde Manon ! Tu crois que je n’ai pas vu ton manège avec le jardinier ?
Depuis mes quinze ans, je me sentais envahie d’un émoi dans les entrailles lorsque je croisais les rares visiteurs masculins du couvent : les gentilshommes parents des pensionnaires, le meunier qui livrait la farine, le jardinier surtout. Je passais des heures, dissimulée derrière un buisson à admirer ses bras musculeux et les morceaux de chair blanche entrevus sous sa chemise retroussée.
–Je n’y peux rien, moi, si j’ai le sang qui bouillonne et les sens qui s’emballent quand je le vois. Ne me juge pas, Iris ! Ne m’as-tu pas dit que j’étais libre de faire ce que bon me semblait ?
–Je ne te juge point Manon, je crains seulement que tu n’aliènes ta liberté pour une satisfaction éphémère. Ne sois pas esclave de tes sens, envisage les conséquences. Que se passera-t-il si,si…
–S’il m’engrosse ? Pourquoi faut-il toujours que tu penses au pire ? Tu n’as qu’à me donner le livre que je te demande et ça n’arriverapas !
Tous les arguments d’Iris ne parvinrent pas à me faire renoncer à mon projet. Je me gardais toutefois de me vanter de ces rencontres qui me donnèrent envie d’approfondir mon expérience. Les malheurs dépeints par Iris n’arrivèrent pas, et mon sentiment d’impunité enfla au fil de mes aventures, au point de m’en faire perdre toute prudence.
Malgré nos différences, notre solitude – je n’avais aucun parent et on ne venait jamais la visiter – cimentait notre amitié. À défaut des manuscrits maudits de la sœur infirmière, Iris emprunta des livres et me fit découvrir des mondes que mon imagination, pourtant fertile, n’aurait pu concevoir. Pour la remercier, je lui appris à chaparder à l’office et à mentir de façon éhontée pour éviter châtiments et remontrances. Plus d’une fois, nous fûmes prises sur le fait et punies en conséquence ; nous égrenions alors d’interminables chapelets, debout au réfectoire, livrées à l’opprobre des pensionnaires, fières de notre statut de rebelles. Malgré tous mes efforts, je ne parvins pourtant pas à lui faire envisager la vie avec insouciance. Ses réactions, ses paroles restaient empreintes de gravité, comme si quelque malheur diffus la guettait.
–Ne prends pas cet air sérieux, Iris. Je te le dis, la vie nous réserve mille bonheurs, mais si tu ne lui fais pas confiance, elle t’en gardera rancune.
Malgré notre proximité, Iris continua à se dérober quand je l’interrogeais au sujet de son père. Elle me répondait, de façon évasive, qu’elle l’avait très peu connu, mais en gardait un doux souvenir. Il venait de temps en temps les visiter, sa mère et elle, les couvrait de cadeaux, l’appelait sa poupée et jouait avec elle. Il lui avait promis de ne jamais l’abandonner, de lui offrir une éducation décente et un avenir radieux. Après le trépas de sa mère pourtant, ses visites cessèrent ; sans doute avait-il trouvé d’autres poupées pour le distraire. En guise d’avenir radieux, Iris avait connu le couvent auquel un tuteur payait sa pension. Sans l’avouer, elle espérait qu’il s’agissait de son père, fidèle en secret à la parole donnée. J’étais pour ma part persuadée que, ne voulant pas s’encombrer d’une bâtarde, il s’en était débarrassé en la confiant aux Ursulines.
Nous fuyions nos existences sans surprise en inventant notre futur au gré de nos envies. Je me voyais enlevée par le frère d’une pensionnaire victime de mes charmes ; il m’évitait le noviciat pour me faire découvrir le monde. Je n’aspirais pas particulièrement au mariage, mais plutôt à l’aventure en compagnie d’un homme dont la condition importait peu. Les rêves d’Iris restaient raisonnables : on la marierait à un gentilhomme et elle aurait plusieurs enfants ; peut-être l’aimerait-elle. Tout au plus, dans des moments d’optimisme débridé, envisageait-elle de poursuivre l’étude des simples8 entamée avec sa mère et de devenir apothicaire ou guérisseuse. Son incapacité à s’évader de ce bonheur médiocre me rendait folle.
–Mais ose, enfin, ose ! À quoi bon rêver si ce n’est pour embellir le futur ?
–À quoi bon fantasmer un avenir tout tracé ? rétorquait-elle, lucide.
Je ne vis pas passer les années. Notre amitié et l’affection d’Iris me fortifièrent ; elle m’encouragea à faire confiance à mon intelligence et en ma nature contre laquelle les religieuses m’avaient si souvent mise en garde :
–Ne doute pas, aie confiance en toi, persévère dans tes efforts et tu seras récompensée. Il n’y a pas de nature bonne ou mauvaise, les circonstances de la vie nous modèlent et chacun est libre de devenir ce qu’ilveut.
Je pris son plaidoyer pour la liberté donnée à chacun de s’épanouir, sans se soumettre à la prédestination de ses origines, pour un blanc-seing qui m’absolvait de facto de tous mes errements.
Pendant que je découvrais les plaisirs charnels, Iris était occupée à distraire une vieille marquise, venue s’installer au couvent avec deux domestiques pour y faire retraite. Il avait fallu faire des dépenses pour lui aménager des appartements, mais les sœurs, en bonnes gestionnaires, espéraient tirer quelque avantage de la présence de cette noble personne. Après le repas, on envoyait Iris lui faire la lecture et je me hâtais le soir de lui demander le compte rendu de son après-midi, car j’y voyais l’opportunité pour elle d’y faire une rencontre qui aurait pu changer son destin. Iris se gaussait :
–Les visiteurs de la marquise sont encore plus vieux qu’elle ! Elle reçoit une comtesse aussi replète que stupide qui passe son temps à se plaindre d’avoir trois filles à marier et un antique marchand de Marseille qui fait dans le café. Il est si vieux que ses membres sont devenus aussi noueux que les branches d’un vieux chêne.
Un jour, au grand dam de la sœur dépositaire9, la marquise quitta le couvent sans avoir payé sa pension ; je m’en réjouis, car Iris redevint disponible.
Quelques mois plus tard, après la messe, on la fit appeler ; la Mère supérieure voulait la voir sur-le-champ. Je cherchai immédiatement quelle faute elle avait commise et me demandai si les leçons d’écriture qu’elle me donnait n’allaient pas lui causer des ennuis. J’allai l’attendre dans la cour, dissimulée derrière le grand orme devant la porte du bureau de sœur de Cormis.
Quand Iris sortit, je voulus me précipiter vers elle, mais, ses épaules voûtées, sa démarche lente, le léger tremblement de son menton, me clouèrent sur place. Que s’était-il donc passé dans le bureau de la Supérieure ? Elle resta deux jours sans m’adresser la parole ; je crus qu’elle m’en voulait d’avoir retenu mes confidences au sujet de mes galants. Son désespoir, hélas, n’avait rien à voir avec mes cachotteries.
J’appris par sœur Adélaïde que son tuteur avait décidé de ne plus payer sa pension le jour de ses seize ans ; conformément aux recommandations testamentaires de son père, il fallait lui trouver un mari au plus preste. Iris mit toute une semaine à digérer la nouvelle. Elle me confia alors ses craintes :
–Je vais rester ici jusqu’à ce que l’on me trouve unmari.
–Inutile de te tourmenter, Iris, c’est bien l’avenir que tu attendais, non ? Quelle importance que ton futur époux soit choisi par ton père, ton tuteur ou par les religieuses ?
–Sans doute, mais une fille sans dot ni famille doit se contenter de qui la choisira, en dépit de son âge ou de son caractère.
Iris avait raison : quelques jours plus tard, un vieil homme à la perruque passée et à la démarche mal assurée se présenta au couvent et l’emporta dans un fiacre noir au toit râpé et à la soupente éraflée, sans lui laisser le temps de faire ses adieux. Quand elle se pencha à la portière, nos yeux se croisèrent. La mesure, dont elle avait toujours fait preuve en imaginant son destin, ne l’avait pas préparée aux flétrissures qu’on allait infliger à sa jeunesse. Son dernier regard me fit comprendre que la réalité venait de s’imposer à elle. Quant à moi, je perdais à jamais l’occasion de gagner en confiance et en dignité.
Les rumeurs les plus folles circulèrent parmi les pensionnaires : son époux était tour à tour gentilhomme, roué10, riche comme Crésus ou ruiné. Iris habitait une bastide dans le terroir, un hôtel particulier en ville, ou le bordeau11 qu’il tenait. Les filles lui inventaient un sort à la hauteur de leur pitié ou de leur jalousie.
Son vieux mari était en fait un des visiteurs de la marquise. Il avait remarqué Iris quand elle lui faisait la lecture et avait demandé à l’épouser. J’avais espéré qu’elle ferait là-bas une rencontre propre à changer son destin ! L’ironie de la situation me laissa un goûtamer.
J’eus de ses nouvelles de loin en loin par l’intermédiaire d’un commerçant qui venait au couvent décharger ses marchandises. Selon la rumeur, son barbon12 de mari, marchand de café, avait amassé une fortune conséquente qu’il répugnait à dépenser. La sœur tourière qui avait revu Iris m’avait simplementdit :
–Elle accomplit la volonté de Dieu avec courage.
En mon for intérieur, je me révoltais contre ce Dieu dont la seule volonté était de condamner mon amie à un calvaire que je redoutais d’imaginer.
Si on me marie contre mon gré, j’aurai au moins profité des plaisirs de l’amour, pensais-je. J’ignorais encore que j’allais bientôt quitter le couvent dans des circonstances qui rendaient le sort d’Iris enviable.
Affectée au tour où l’on faisait passer les nouveau-nés abandonnés, la sœur tourière s’occupe aussi des relations avec l’extérieur.
Archives départementales des Bouches du Rhône, Aix-en-Provence : Documents 83 h 3.
Trotula de Salernes : femme médecin née à Salernes vers 1050, auteur d’un traité sur les maladies des femmes avant et après l’accouchement.
Individus qui pratiquaient la médecine sans diplôme officiel. Guérisseurs.
Responsable des novices
Carminatif et vulnéraire dont le suc était utilisé contre le mal caduc (épilepsie), les vertiges et la migraine.
1637-1709
Plantes médicinales.
Économe.
Sans scrupules.
Vieilli pour bordel.
Vieillard
1716
L’injustice est réparée. Je vais enfin pouvoir envisager sereinement l’avenir et réaliser mes rêves d’un destin à la hauteur de mes aspirations. Finie la vie provinciale étriquée ! Je brûle de connaître le monde.
2Iris, Paris,1719
Depuis notre départ de Marseille, une angoisse inexpliquée a envahi mon cœur. Pourtant, je ne laisse rien derrière moi ; même Manon semble m’avoir oubliée, sinon elle aurait répondu à mes lettres. En quittant la sécurité monotone de la maison de mon époux, le train-train de ses affaires, je pars vers un inconnu rempli d’incertitude. Que me réserve-t-il ?
Nous sommes arrivés à Paris après un voyage harassant mené à un train d’enfer. Depuis qu’il avait reçu un billet d’une certaine dame Chaumont, mon mari ne tenait plus en place. Lui, d’habitude avare de ses mots comme de ses écus, ne cessait de me vanter les mérites de monsieur Lass13. Il allait, selon lui, rendre riches tous les Français suffisamment astucieux pour saisir leur chance. À l’en croire, les agioteurs14 couraient à Paris de tout le royaume et il était le seul à n’être point encore parti. J’ai eu beau lui faire remarquer qu’il n’était pas à plaindre et qu’on parlait aussi de fortunes perdues et de malheureux ruinés qui s’homicidaient en se jetant dans la Seine, il n’a point voulu entendre raison. N’étant pas de nature aventureuse, il a tergiversé jusqu’au jour où il a appris par un client que, pour inciter les gens à changer leurs espèces d’or et d’argent en billets de banque, on en avait réduit la valeur. Je le revois encore, claudiquant jusqu’à moi en brandissant un exemplaire du Mercure de France15 qu’il agitait sous mesyeux.
–Je le savais ! Je vous l’avais dit ! Je n’aurais jamais dû écouter vos avertissements timorés ! Comme s’il avait un jour écouté mes conseils ou sollicité mon avis ! Un arrêt du Conseil d’État a réduit les louis à trente-cinq livres ; trente-cinq livres, vous rendez-vous compte ! À ce train-là, je serai ruiné sous peu. Vous pouvez d’ores et déjà faire préparer nos malles. Nous partirons dès que j’aurai réglé mes affaires.
Depuis ce jour-là, il n’a eu de cesse de liquider tous ses biens afin de convertir ses espèces d’or et d’argent en billets de banque.
Ma vie à Marseille était bien monotone, et l’assister dans son commerce n’avait rien d’exaltant puisqu’il ne me confiait que ses paperasses, mais les événements qui ont jusqu’ici bousculé mon existence m’ont toujours laissée dans une situation pire que la précédente. Cet enchaînement vicieux m’a conduite d’une vie simple, mais heureuse auprès de ma mère, dans un couvent d’où le mariage m’a sortie, pour me faire prisonnière d’un mari sans tendresse qui m’a épousée, je ne sais pour quelle raison, les plaisirs de la chair lui étant indifférents et mes perspectives de fortune inexistantes. Plus j’y réfléchis, et plus je me dis qu’il m’a choisie comme on acquiert un objet, pour étoffer ses possessions, les seules choses qui lui procurent de la jouissance. Me voilà à présent enfermée dans une chambre froide et triste, perdue dans une ville où je ne connais personne.
Je n’ai pas pu dissimuler ma déception en découvrant notre sinistre logis, mais Honoré m’a représenté que nous n’y resterions que le temps nécessaire à ce qu’il fît fortune et que, de toutes les façons, il n’avait rien trouvé d’autre à cause des nombreux étrangers et des habitants des provinces de France qui affluaient vers Paris, comme des phalènes attirés par la flamme d’une lanterne, ai-je pensé. Je dois donc m’estimer heureuse d’avoir un toit où dormir.
Dès notre arrivée, il a demandé à un petit vas-y-dire16 d’apporter un message à la dame Chaumont. Pour la énième fois, il m’a raconté qu’elle venait de déménager dans un hôtel particulier après avoir gagné en huit ou neuf mois la valeur de six millions à l’agio. Il se goberge des succès de cette femme comme s’ils étaient siens, car il est déterminé à suivre le même chemin. J’avoue que l’enrichissement éhonté de cette cuisinière a de quoi laisser pantois.
Notre vie serait-elle meilleure s’il devenait aussi riche qu’elle ? Mènerions-nous grand train ? Serais-je plus libre de mes mouvements ? Ce sentiment de suffocation qui me saisit si souvent me laisserait-il en paix ? J’en doute fort, ce qui rend à mes yeux sa course aux millions encore plus absurde. Serait-il riche comme Crésus qu’il deviendrait encore plus farouche à défendre sa fortune. Depuis que nous sommes ici, il rentre tard et me réveille pour me conter les fortunes qui se font en quelques heures rue Quincampoix : tel officier, pour avoir mis quarante mille livres dans les actions de la Compagnie des Indes17, s’est trouvé quelques jours plus tard avec cent mille écus, tel laquais a gagné huit cent mille livres en une journée. Il m’assure que Monsieur le duc de Bourbon a profité de vingt millions de livres sur les actions de la Compagnie et que Monsieur le prince de Conti y a aussi gagné quatre millions cinq cent mille livres. Comme si cela m’importait !
Il est ivre d’espérance et moi d’inquiétude, car je me demande où cette fièvre va nous mener.
La proximité de l’argent, les bénéfices qu’il pourrait faire ont agi comme un élixir de jouvence : lui qui passait son temps à se plaindre des douleurs qui vrillaient ses articulations a le pas plus sûr, l’allure plus vive, les doigts plus agiles ; si ce n’était sa peau fripée et son dos voûté, il pourrait passer pour un homme dans la force de l’âge.
Je pensais que son agitation avait atteint son paroxysme, mais je me trompais : quand il a entendu dire que de nouvelles actions de la Compagnie allaient être émises et qu’il n’y en aurait pas pour tout le monde, il s’est mis à sortir en pleine nuit, me laissant parfois un billet pour m’avertir qu’il rentrerait fort tard ou point dutout.
Son état de surexcitation permanent use mes nerfs et me fait par moments croire qu’il va trépasser d’une attaque d’apoplexie. Je ne sais plus si je dois mettre sa fébrilité sur le compte de biens fabuleux ou de pertes considérables, mais sa mine renfrognée me fait craindre le pire. Je n’ose pas l’interroger de peur de déclencher des torrents de chiffres et de jérémiades, alors je me tais en me demandant si nous allons un jour rentrer cheznous.
L’atmosphère ici est étouffante ; la propriétaire, une dame Sylvestre, est sale, obséquieuse et sa mine chafouine me met mal à l’aise. Ce qui m’insupporte par-dessus tout, c’est la proximité dans laquelle nous vivons. Au moins à Marseille, je disposais d’une chambre pour moi toute seule et je n’avais pas à supporter les divagations nocturnes de mon époux, aussi, je me délecte de chaque moment de solitude.
Il m’a sortie du sommeil tout à l’heure, trop impatient de m’annoncer une nouvelle d’importance :
–Ma chère, réjouissez-vous !
–Nous allons rentrer chez nous ?
–Quelle drôle d’idée ! Non, la dame Chaumont nous fait le privilège de nous recevoir demain en sa seigneurie d’Ivry-sur-Seine. Vous rendez-vous compte de l’honneur qu’elle nous fait ?
Il est dans tous ses états de se trouver ainsi distingué par cette richissime femme, comme si en le recevant chez elle, elle en faisait son héritier. Il arpente notre chambrette en agitant sa canne qui heurte l’armoire ou le lit à chacun de ses gestes. Je me demande ce que doivent penser les autres pensionnaires. Savez-vous combien elle l’a payée ?
Une fortune à n’en point douter. Se mettrait-il dans de tels états s’il en était autrement ?
–Soixante-quatre mille livres ! Oui, vous avez bien entendu : soixante-quatre mille !
–Je joue la surprise pour avoir la paix. Peut-être cessera-t-il de s’enivrer des dépenses de cette femme.
–Mettez votre plus belle robe ; je veux que vous apparaissiez sous votre meilleur jour. Ce n’est pas n’importe qui qui est reçu chez cettedame.
Je suis impatiente de voir à quoi ressemble l’inspiratrice de mon époux, celle dont il veut suivre l’exemple pour l’égaler, la surpasser peut-être. Aura-t-elle su garder un peu de bon sens ? Je suis surtout soulagée de sortir de ce garni et de notre tête-à-tête étouffant.
John Law ou Lass (1671-1729) : économiste et financier écossais. Il a fondé en 1716 la Banque Générale, une banque privée ayant des liens avec le gouvernement. Elle a émis du papier-monnaie, convertible en espèces. En 1719, la Banque Générale est devenue la Banque Royale et Law a obtenu le contrôle de la trésorerie publique et de la perception des impôts, consolidant ainsi un monopole sur les finances de la France.
Spéculateurs.
Périodique.
Messager.
En 1719, sous l’impulsion de Law, la Compagnie des Indes, fondée en 1664 a fusionné avec d’autres compagnies commerciales françaises pour former un monopole sur le commerce extérieur français. Elle a obtenu le monopole du commerce avec les colonies françaises d’Amérique. Law l’a utilisée pour attirer des investissements massifs en promouvant le potentiel de richesse des colonies.
3Iris, Paris,1719
La journée d’hier s’est transformée pour Honoré en une série d’incitations à persévérer dans sa quête. Nous sommes partis pour Ivry, dans un coche de location dont il a négocié le prix jusqu’à rendre le cocher fou. Il n’a cédé que lorsqu’il a compris qu’il allait perdre son moyen de locomotion. J’avais si honte que je me suis éloignée pour le laisser parlementer.
Àcause de son impatience, nous sommes arrivés beaucoup trop tôt et avons dû attendre dans la voiture au bord de la route que midi arrivât, ce qui lui a coûté une coquette somme pour le délai. Il était d’une humeur massacrante et me regardait d’un air mauvais comme si j’étais responsable de ce débours inattendu. Pourtant, dès qu’il s’est trouvé en présence de la dame Chaumont, il a changé d’humeur comme on change de justaucorps, devenant doucereux et souriant.
Il a gratifié notre hôtesse d’un panégyrique à faire pâlir d’envie Bossuet. Elle s’est rengorgée et nous a annoncé en guise de bienvenue qu’elle venait de faire l’acquisition de l’hôtel de Pomponne en la place des Victoires pour la somme de quatre cent quarante-deux mille livres. Honoré en a perdu l’usage de la parole.
Cette femme m’a tout de suite déplu, non pas à cause de ses origines modestes qu’elle n’essaie même pas de cacher, tant elle est persuadée qu’avec la richesse est venue la distinction, mais parce qu’elle vous jette sa fortune au visage en vous donnant la valeur de tous les objets qui l’entourent. Que vos yeux se posent sur un bronze ou une commode, elle vous en livre immédiatement le prix, à tel point que, lorsqu’elle me regarde, j’ai l’impression qu’elle m’évalue pour me vendre à l’encan18. La journée a mal commencé pour Honoré. Alors qu’il pensait être distingué en étant invité ici, nous nous sommes retrouvés mêlés à une cinquantaine de personnes, agioteurs de tout poil : avertis, néophytes, heureux ou ruinés. Cette cour empressée comptait aussi quelques ecclésiastiques, une demi-douzaine de nobles espérant des jours meilleurs, une bouchère qui arborait un diamant sur chacun de ses doigts boudinés et nombre de profiteurs. Les conversations n’avaient qu’un sujet : tous se vantaient des profits qu’ils avaient faits ou ne manqueraient pas de faire. Peu habituée à côtoyer une telle foule, je me suis réfugiée dans un coin avant de me rendre compte que personne ne faisait attention à moi, chacun étant trop occupé à accrocher l’attention de notre hôtesse.
On a servi, dans de la vaisselle d’argent finement ciselée, un bœuf, deux veaux et plusieurs moutons ainsi que profusion de volailles et de gibier arrosés de vins de champagne et de Bourgogne de la meilleure qualité. Cette orgie de nourriture m’a donné la nausée. C’était comme si tout devait être plus cher, plus abondant, plus extraordinaire pour que la dame Chaumont pût exister.
Ma première impression s’est confirmée tout au long du banquet. Tout imbue d’elle-même, elle parlait et riait trop fort, feignant de se plaindre des quémandeurs qui sonnaient à sa porte pour faire appel à son sens de la solidarité et récolter les miettes de son immense richesse. Elle les méprisait, les conchiait et donnait ordre à ses gens de les envoyer au diable. Peut-être un jour, ferait-elle un don à la Salpêtrière19, mais, pour l’heure, elle n’en avait point le temps. Je prie le ciel de ne jamais me trouver en position de devoir faire appel à la générosité de cette femme. Quand j’ai demandé à mon voisin de table ce qu’était la Salpêtrière, il m’a regardée avec des yeux ronds comme des soucoupes. J’ai compris plus tard qu’il s’agissait d’un hôpital pour les malheureux et les orphelins lorsqu’un convive a raconté que le sieur Lass s’y était rendu pour réclamer au Supérieur de la maison, des filles vertueuses pour être mariés au Mississippi.
À les écouter, ce Mississippi serait un eldorado qui regorge de mines d’or et d’argent. Tous ceux qui y partent sont assurés de faire fortune. Pas étonnant que l’on s’arrache les actions de la Compagnie des Indes ! Peut-être serais-je plus heureuse au Mississippi qu’ici ? Si j’étais suffisamment audacieuse, je m’embarquerais pour ce pays béni des dieux et laisserais Honoré courir après les actions de la Compagnie, mais je suis trop timorée, aussi je me contente de ce que le sort me réserve.
Au cours du banquet, mon mari a compris que plus il attendrait, plus les actions augmenteraient. Dès la dernière bouchée avalée, nous sommes repartis sans même prendre congé, comme si le diable était à nos trousses. Il voulait retourner le soir même à la rue Quincampoix.
Honoré m’a avertie qu’il ne rentrerait pas, je vais donc en profiter pour me rendre dans cette rue Quincampoix dont tout le monde parle ; au moins me rendrai-je compte par moi-même si ce que l’on raconte est vrai. Je n’en reviens pas de mon audace, mais il est vrai que tout ce que j’ai entendu chez la dame Chaumont a piqué ma curiosité. L’excitation me gagne à l’approche de ce lieu sulfureux.
Une fois dans le quartier, je n’ai qu’à suivre le grondement avide de la foule pour trouver mon chemin. Plus j’avance, plus la presse se fait forte et, dans la rue même, qui est fort longue et étroite, il devient impossible de se frayer un chemin tant ça grouille. Le prince de sang et le docteur de Sorbonne font commerce avec le laquais et le vendeur de regrats20 sans distinction de rang ni de titre. Les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, les parfumés ou les puants sont piqués par un même aiguillon : les gains qu’ils pourraient engranger en un minimum de temps. Les tire-laines sont à lafête.
Cette foule oppressante m’entraîne contre mon gré parmi des vagues d’agioteurs qui avancent et refluent au gré des affaires qui se présentent. J’ai le sentiment qu’ils vont m’étouffer ; si j’en réchappe, je ne m’aventurerai plus jamais dans ce quartier ! Ballottée comme un fétu de paille, je me laisse emporter par un tourbillon qui me dépose devant une échoppe où je m’empresse d’entrer.
–Bonjour, madame. Vous avez fait le bon choix en venant ici. Prenez un siège, je vous en prie. Une belle dame comme vous doit prendre garde aux mécréants qui hantent la rue. On les croirait échappés tout droit de l’Hôpital. Le cordonnier me fait moult courbettes en me désignant un fauteuil. Que désirez-vous ? Une paire de bottines peut-être pour affronter l’automne qui approche. Les rues de Paris sont si bourbeuses qu’il devient périlleux de se promener en souliers de satin. Il s’empresse de me présenter deux paires de chaussures qu’il tient en hauteur, à la lumière, comme un joaillier présenterait une parure de pierres précieuses.
–Je vous remercie, monsieur, mais je suis simplement entrée chez vous pour trouver un peu de calme et reprendre mes esprits. Il y avait tant de mondeque…
–Je me disais aussi… Vous êtes la seule chalande que j’ai vue aujourd’hui. Plus personne ne vient faire ses emplettes dans cette rue maudite. Nous, commerçants, subissons un préjudice considérable, car nul n’ose plus s’aventurer dans le quartier.
Je comprends que je ne peux pas m’attarder, au risque de déclencher sa colère ; je prends congé en marmonnant quelques paroles confuses qu’il n’écoute pas et je parviens enfin à m’enfuir de ce piège où l’on se bat pour entrer.
À la pension, je retrouve mon mari qui gesticule en vociférant contre une ordonnance du lieutenant général de police, monsieur de Machault.
–Il est fait défense à toutes personnes de s’attrouper en la rue Quincampoix, avant huit heures du matin, avec ordre d’en sortir à neuf heures du soir au son d’un tambour de la ville. C’est une conspiration pour empêcher les honnêtes citoyens de faire leur main21. Je parierais que quelques grands seigneurs ont obligé le roi à prendre cette ordonnance pour se réserver les transactions les plus lucratives qui se concluent lanuit.
–La nuit ? Je croyais que la banque fermait et puisqu’il est interditde…
–Taisez-vous, petite bécasse. Nul besoin de banque ; les chambres et les boutiques la remplacent avantageusement. Une fois que le gros de la populace est rentré, on y fait les meilleures affaires. Je ferai fi de ce papier et ne laisserai personne endiguer ma liberté !
Honoré est donc passé outre l’interdiction. Il rentre au petit matin, les joues enflammées, les vêtements déchirés, ne s’étant nourri que d’agiotage, de négociations et de rumeurs.
Ce soir, l’inquiétude me ronge, car il n’est pas rentré depuis deux jours. Il est parti avec toutes les espèces qu’il a emportées de Marseille et ses actions de la Compagnie des Indes, sans doute pour une ultime négociation qui doit le rendre encore plus riche.
Il est minuit passé ; j’ai un mauvais pressentiment.
De la fenêtre de notre garni, j’essaie de percer la noirceur de la ruelle, mais, à part les brigades d’archers de la maréchaussée qui patrouillent pour arrêter les contrevenants, il n’y a pas âme qui vive. Que vais-je devenir s’il lui est arrivé malheur ? Il est deux heures, je pars à sa recherche.
Aux enchères.
Annexe de l’Hôpital général de Paris. Appelée ainsi, car construite sur l’emplacement d’une fabrique de poudre.
Denrées achetées pour être revendues à un prix plus élevé.
S’enrichir.
4Iris
Persuadée qu’il me faut aller du côté de la rue Quincampoix, je me mets en route, recherchant l’obscurité des encoignures pour échapper aux patrouilles du gué qui sillonnent le quartier. Sans but précis, mes chances de retrouver mon mari sont minces, mais l’état de désarroi dans lequel je me trouve m’empêche de concevoir un plan. Je sais seulement que, si je reste à me morfondre, j’aurai l’impression de l’avoir abandonné.
Quel contraste avec le tumulte de la semaine dernière ! Plus aucun bruit, la rue est déserte, tout au plus devine-t-on des chandelles allumées derrière les battants de bois qui ferment les boutiques. Honoré ne m’a-t-il pas parlé d’échoppes où l’on agiote encore, l’heure du couvre-feu passée ? Je prends mon courage à deux mains pour taper aux volets clos, craignant qu’on ne me chasse ou qu’on ne m’attire dans un traquenard. On me répond de façon fort distraite que non, on ne connaît pas mon mari, qu’on ne l’a pas vu et qu’on ne sait pas où il peut être. J’ai frappé en vain à toutes les échoppes, même les plus sombres. Sa disparition paraît inéluctable, je refuse pourtant d’en envisager les conséquences, espérant en reculer l’inexorabilité. À bout de ressources et épuisée, je rentre dans notre garni, me raccrochant à l’espoir de l’y trouver, à défaut de quoi, j’irai, dès le matin, signaler sa disparition à la maréchaussée. Je ne me fais pas grande illusion quant à l’utilité de ma démarche, les disparus sont bien trop nombreux, mais il me faut bien faire quelque chose. J’avance donc comme un automate, indifférente à ce qui m’entoure, avec la sensation d’un vide au creux de l’estomac qui aspire toute mon énergie. Je ne cherche même plus à me cacher, persuadée qu’une arrestation me soustrairait momentanément à mon désarroi.
Mon cœur s’accélère au fur et à mesure que je me rapproche du garni ; ma dernière chance de retrouver Honoré se trouve derrière cette porte décrépite. En montant l’escalier branlant qui conduit à notre chambre, j’entends un grand remue-ménage au-dessus de ma tête ; sans doute un malheureux qui se fait expulser. J’aperçois, sur le palier, deux uniformes bleus en compagnie de la propriétaire qui tambourine à notre porte. Je m’arrête pour domestiquer les battements de mon cœur et tenir à distance l’horreur de ce qu’on va me dévoiler.
Les archers me tendent un papier :
C’est une quittance de loyer avec l’adresse de ce garni ; on l’a trouvée près d’un cadavre ; un homme lardé de coups d’épée. Alors on s’est dit que peut-être…
Avant même d’avoir vu le corps, je comprends que je suis veuve. J’écoute la suite malgré moi, taraudée par l’envie de m’enfuir.
–Il a été dépouillé de sa bourse, de ses habits, et même de ses chaussures. On a juste retrouvé cette quittance.
Comme je reste sans réaction, ils veulent savoir si j’ai bien compris ce qui s’est passé. Je me ressaisis et, dans un réflexe, je demande à récupérer le corps pour organiser des funérailles, sans même savoir si j’en ai les moyens.
–Ben c’estque…
Ce qu’il a à me dire doit être fort embarrassant, car il triture son tricorne et se tourne vers son collègue pour chercher un secours qui ne vient pas. Alors il reprend : Ceux qui l’ont trouvé, ils ont cru que personne ne le réclamerait. Il y en a tant qui se font trucider. Alors, ils l’ont donné à des apprentis médecins à ce qu’ils ontdit.
Une affreuse pensée que je ne contrôle pas tourne dans mon esprit et refuse de me laisser en paix : Le sieur Honoré Barthélémy, obsédé par la fortune, a fini dépecé comme une pièce de viande.
Des visions sanguinolentes de mon mari dénudé, éventré, amputé, hantent ma nuit. Vais-je devoir passer toute ma vie avec ces images répugnantes ?
Pour atténuer le choc de cette fin odieuse, je mets toute mon énergie à survivre. Mes maigres économies me permettront à peine de tenir une quinzaine de jours tant la vie est chère, mais je préfère mourir de faim plutôt que de faire appel à la pitié de la veuve Chaumont. À la recherche d’un garni moins onéreux, je visite des trous immondes et puants, dans des venelles envahies d’immondices où des filles de joie peinturlurées me lancent des obscénités. Paniquée à l’idée de finir comme elles, je décide de proposer mes services à la mère Sylvestre.
–Bonsoir, dame Sylvestre,je…
–Vous me devez une semaine de loyer. Faut pas croire que je vais vous en faire cadeau.
–Justement, je voulais vous proposer mes services.
–Et qu’est-ce que c’est donc que vous savez faire, ma bon’dame ? Elle me toise d’un air goguenard.
–Je pourrais vous aider à tenir vos comptes et à organiser votre commerce.
Elle se gausse de toute la laideur de sa bouche édentée.
–J’ai besoin de personne pour tenir mon commerce, mais la souillon qui récurait les pots de nuit m’a laissé tomber. Vous pouvez prendre sa place si ça vous chante, à moins que vous vouliez pas tremper vos jolies mains dans la merde. Elle éclate d’un rire énorme qui se termine dans une quinte de toux. C’est une soupe par jour et une paillasse sous la soupente. Vous commencez dans deux heures et si vous êtes pas là un quart d’heure avant, c’est tant pis pourvous.
Je prends de plein fouet la profondeur de ma déchéance et juge odieuses les conséquences de l’état de soumission dans lequel mon mariage m’a tenue. Pourquoi n’existons-nous que dans l’ombre des hommes ?
J’accepte la place, déterminée à en chercher au plus vite une autre mieux adaptée à mes connaissances, mais le temps me manque.
Peu habituée aux travaux difficiles, j’achève les journées dans un tel état d’épuisement que je n’ai plus la force de sortir pour essayer de trouver un autre emploi. En quelques semaines, mon apparence physique se détériore au point qu’un agioteur, avec qui j’avais longuement parlé à Ivry-sur-Seine, prend peur quand j’essaie de l’aborder alors qu’il dîne à la pension de la mère Sylvestre. Je me dissous inexorablement dans un océan de fatigue, de faim, de puanteur qui engloutit ma jeunesse et ma résistance.
Dans un dernier sursaut, je décide d’aller vendre mes robes à une couturière qui travaille dans la rue aux Ours et à qui mon mari, saisi d’un élan de générosité inattendu, avait commandé un caraco. Je quitte subrepticement la pension Sylvestre un peu avant vingt et une heures.
En cette fin mars, l’hiver persiste. Une pluie glacée qu’un mauvais vent fait tomber en rafales me cingle ; j’avance courbée en deux, incapable de maintenir mon capuchon en place. Je m’inquiète de l’allure que je vais présenter à la couturière. Peut-être croira-t-elle que j’ai volé les robes et me dénoncera-t-elle à la maréchaussée. Il me faut de surcroît être de retour avant onze heures, au risque de trouver porte close et de devoir dormir dans la rue. Au croisement de la rue aux Ours et de la rue Quincampoix, je me détends : une lampe à huile brûle dans la boutique de la couturière.
Soudain, des mains brutales me jettent au sol et m’y maintiennent. Ma tête a cogné le pavé ; je suis étourdie. Je me crois victime de tire-bourses, et leur crie que je ne possède que quelques hardes sans valeur. Des mains indiscrètes sondent mon corps à la recherche de quelque bien dissimulé. La poussière mouillée me brûle les lèvres.
–Mettez-la avec les autres, vite, on se gèle, lance une voix d’homme.
On me soulève, on me jette sans ménagement dans une charrette. J’atterris sur le dos d’un homme qui se dégage en m’injuriant. Je parviens à me caser entre un jeune homme à la mise correcte et une harengère22 qui me dit qu’on va nous conduire au Châtelet avant de nous envoyer au Mississippi. Le froid et la terreur me paralysent.
Recroquevillée sur la paille d’une cellule, je me retrouve au milieu d’un tas de pauvres filles qui, comme moi, ont été emmenées de force parce qu’elles n’ont pas respecté le couvre-feu, ou tout simplement parce qu’elles passaient par là comme cette jeune femme tout droit arrivée de sa province pour se mettre en condition23. Elle a reçu une pierre sur la tempe alors qu’elle tentait de s’enfuir ; je la panse comme je peux avec un morceau de mon jupon. J’essaie de repousser les pensées terrifiantes qui m’assaillent ; j’ai encore plus peur que le jour où Honoré est venu me chercher au couvent : je me vois déportée à l’autre bout du monde, aux mains de malandrins, terminant ma vie comme une de ces pauvres créatures qui n’ont d’autre solution que de faire commerce de leur corps.
Femme querelleuse et grossière.
Se placer comme servante.
Lorient,1717
Les doutes qui m’ont assailli à la veille de mon grand saut vers l’inconnu n’avaient pas lieu d’être. Je ne regrette pas ma décision. Mes qualités, mes diplômes et, avouons-le, mon audace m’ont ouvert les portes nécessaires. J’exerce enfin un métier à la hauteur de mes compétences.
J’apprécie Lorient où je suis installé depuis quelques mois. C’est le point stratégique des activités de la Compagnie d’Occident24, c’est là que se trouvent ses bureaux, particulièrement celui de son directeur général dont j’ai su gagner la confiance.
Peut-être devrai-je m’exiler pour obtenir une promotion, mais c’est un sacrifice auquel je suis prêt, d’autant que les conditions dans lesquelles j’émigrerais seraient des plus favorables et que rien ne me retient ici. On dit qu’en Louisiane le poids des privilèges est moins important que dans le royaume et qu’un homme riche jouit d’autant de considération qu’un membre du second ordre25.
Je passe des heures à me documenter sur ce vaste pays qui va du golfe du Mexique jusqu’au Canada. La Compagnie y supervise une douzaine de comptoirs, incluant des postes au pays des Illinois, à la Balise, à Mobile, chez les Indiens Natchez, Yazoos, Missouris et Alabamas.
On dit qu’elle y est toute-puissante et que ses représentants y font leur main. Je peine à croire les bruits qui courent à ce sujet : la pierre d’émeraude, les mines d’or et d’argent
Il y a, paraît-il, des Sauvages26 qui habitent le haut pays du Mississippi qui ont apporté des échantillons de minerai d’or, qu’ils disent trouver dans les montagnes voisines de leur nation. Quant au minerai d’argent, les épreuves qui en ont été faites assurent qu’on peut en tirer jusqu’à six livres d’argent par quintal ! Tout porte à croire que je vais m’épanouir dans ce pays de cocagne.
Compagnie de commerce française fondée en 1717 pour exploiter et coloniser la Louisiane française.
De la noblesse.
Appellation de l’époque pour les Indiens.
5Sœur Gertrude, Paris,1719
D’Argenson27 dans la finance,
S’est emporté comme unfou,
Mais il nous fallait en France,
Un esprit bien plus filou.
Lass en a donc pris la place ;
Il nous mènera grandtrain
Dans un carrosse sans glace,
Tout droit chez la Pataclin28.
Ça me met hors de moi d’entendre le nom de notre Révérende supérieure dans une chanson de rue, surtout aux abords du Châtelet. Ce n’est pas parce que je n’ai pas prononcé de vœux que je ne respecte pas cette sainte femme.
–Qu’est-ce qu’une femme vient faire ici à cette heure ? me demande le garde d’un ton bourru.
–Je suis sœur Gertrude, officière29 à l’Hôpital Général de la Salpêtrière. La Mère supérieure m’a demandé de venir ici pour quérir un groupe de pauvres filles parmi les prisonnières qui ont été raflées la semaine dernière.
–C’est une bonne sœur qui vient chercher des drôlesses, traduit-il pour son collègue de l’autre côté de la porte.
Je me contrôle pour ne pas le reprendre. Non, ce ne sont point des filles de mauvaise vie que je viens chercher. Celles que j’emmènerai doivent avoir une moralité irréprochable.
–Faites-moi accompagner chez votre officier.
Un archer me précède le long d’un corridor éclairé par la lumière vacillante de torches qui déposent sur les murs de grandes langues fuligineuses, sans parvenir à dissiper les ténèbres. Il me conduit à une cellule où un officier biffe des noms sur une liste de plusieurs pages. Il lève les yeux et me dévisage grossièrement.
–C’est pourquoi ? dit-il d’un ton revêche.
–Je suis sœur Gertrude, officière à l’Hôpital Général de la Salpêtrière. Je suis envoyée par mère Pataclin pour emmener douze filles dans notre hôpital, lui dis-je en lui tendant la lettre de notre Révérende supérieure.
Je renonce à préciser ma demande ; je ferai moi-même le tri. Aujourd’hui, je suis ici pour une raison bien particulière : je viens choisir, parmi ces malheureuses, celles qui nous manquent pour satisfaire la demande de monsieur Lass. Les consignes sont claires : uniquement des jeunes filles de bonne moralité ; nous avons déjà des orphelines à ne plus savoir qu’en faire.
Un archer en habit bleu tout neuf me conduit. Pour atteindre la salle où sont rassemblées les filles raflées, nous en traversons plusieurs autres remplies de valets, de bourgeois, de paysans, de vagabonds, victimes de la fièvre de l’agiotage, qui risquent d’être déplacés au Mississippi. Depuis qu’on ne peut plus s’attrouper la nuit dans la rue Quincampoix, les archers sont si prompts à ramasser tous ceux qui bravent l’interdit que les prisons regorgent de ces pauvres hères.
Quand Dieu enverra-t-il le soufre et le feu pour punir ces débordements ? On ne compte plus les cadavres de ceux que l’on a détroussés, la disette menace et l’honnête artisan ou le pauvre gueux ne sont plus à l’abri.
–Faites votre choix, ma sœur, y en a pour tous les goûts. Vous pouvez les voir par ce judas. Un amoncellement hétéroclite de corps jonche le sol d’une cellule bien plus petite qu’un de nos dortoirs : quelques filles débauchées, des bourgeoises qui ont voulu tenter leur chance à l’agio, des filles nouvellement venues à Paris pour se mettre en condition et même des fillettes qui ne doivent pas avoir plus de neuf ou dixans.
Ces malheureuses ne se doutent pas qu’elles vont être sacrifiées sur l’autel de la Compagnie pour peupler la colonie. Les besoins sont si grands qu’en moins de huit jours, les bandouliers du Mississippi30 ont enlevé plus de cinq mille personnes des deux sexes, même des artisans et des manœuvres qui n’avaient jamais fait profession de mendier. Paris se débarrasse de ses pauvres et les familles de leurs membres gênants : les pères se délivrent de leurs fils ingrats, les femmes de leurs maris joueurs et les époux de leurs femmes volages.
Qui suis-je pour décider ? Comment vais-je choisir celles qui vont finir au commun de notre hôpital et celles que je vais condamner à la déportation ? Dans un cas comme dans l’autre, leur sort n’est guère enviable. Peut-être les déportées auront-elles une infime chance d’une vie meilleure.
Une fille, qui a dû recevoir un mauvais coup sur la tête, se plaint ; un filet de sang coule le long de sa tempe. Une femme se lève, déchire son jupon et panse sa plaie, sans un mot. À ses gestes rapides et précis, on voit qu’elle a l’habitude de prodiguer des soins. Elle regagne sa place et croise mon regard. Pourquoi suis-je persuadée qu’elle n’a pas sa placeici ?
Visiblement marquée par ce qui lui arrive, elle se tient recroquevillée sur elle-même, resserrant autour de ses épaules, d’un geste pudique et illusoire, les lambeaux de sa robe déchirée pendant son arrestation. Elle détaille les autres avec minutie, comme si elle essayait de leur trouver quelque point commun avec elle, pourtant son regard n’est pas hautain, il est empli de curiosité et je crois d’empathie.
Doux Jésus, donnez-moi la force et le discernement ! prié-je en entrant dans la salle. La plupart des femmes m’ignorent, quelques-unes ricanent et échangent des obscénités. Elles feront moins les fières lorsqu’on les conduira à l’hôpital. La fille au regard étrange lève les yeux versmoi.
–Je suis sœur Gertrude de la Salpêtrière. Pourquoi es-tulà ?
–J’allais vendre mes robes. J’avaisfaim.
Sa réponse digne et son accent chantant me donnent envie d’en savoir davantage.
–D’où viens-tu ? Quel âge as-tu, mon enfant ?
–Je m’appelle Iris, Trotula Barthélémy, née Espérandieu.
Elle a égrené son patronyme comme un rempart contre la déchéance.
–Tu es donc mariée ?
–Mon mari était dans le négoce du café. Il a voulu venir à Paris pour faire fortune. Il s’est fait dépouiller et homicider.
–Te voilà donc veuve et sans ressources.
–J’ai trouvé un emploi de souillon dans une pension, rectifie-t-elle dans un sursaut de fierté,mais…
Cette ultime pudeur qui l’empêche de se plaindre me touche plus que de raison.
–Tu t’exprimes bien. Sais-tu lire ?
–Écrire aussi ; j’ai été élevée chez les Ursulines d’Aix et j’ai peur d’être déportée au Mississippi.
–Tu vas venir avecmoi.
Jamais décision ne fut plus spontanée et évidente ; il me reste à trouver les arguments pour convaincre mère Pataclin de la pertinence de mon choix.
1696-1764 ; homme politique.
Supérieure de l’hôpital de la Salpêtrière.
Les sœurs officières n’avaient de sœurs que le nom et faisaient partie du personnel d’encadrement.
Soldats qui arrêtaient les vagabonds avant leur déportation en Louisiane.
6Iris
Quand sœur Gertrude s’est approchée de moi, j’y ai vu un signe du destin.
Je l’ai suivie sans me poser de questions, reconnaissante d’être soustraite à mon enfermement, persuadée que j’échappais à l’enfer, malgré l’incertitude qui pesait sur mon avenir.
Je n’étais pas la seule à quitter le Châtelet ce matin-là. Alors que je montais dans un chariot bâché avec une dizaine de filles qui devaient avoir entre quinze et dix-sept ans, toutes aussi terrorisées que moi, un autre groupe rejoignit notre convoi. Une vingtaine de créatures échevelées, condamnées pour débauche publique parce qu’elles offusquaient la moralité des bourgeois, vociféraient des insultes à notre escorte d’archers, aux bandouliers qui les avaient arrêtées, à nous-mêmes et à sœur Gertrude. Leur charrette s’est ébranlée en même temps que la nôtre. Affalées sur la paille, elles invectivaient les rares personnes qui bravaient le matin frileux, nous distrayant de notre propre malheur.
Un brouillard épais faisait surgir les passants comme des pantins sortis de nulle part pour les engloutir aussitôt. Les bâtiments de l’hôpital se dessinèrent soudain devant nous ; comme pour dramatiser cette menaçante apparition, une clameur sinistre s’en éleva, rauque, sauvage, refluant puis enflant à nouveau telle une lame de détresse. Sœur Gertrude nous dit qu’il s’agissait de « la plainte de l’hôpital », comme si ce truisme suffisait à satisfaire notre curiosité et répondait aux questions que nous n’osions poser. Lorsqu’elles ont entendu ces gémissements, les filles de la charrette s’en sont fait l’écho et ce dialogue lugubre nous a accompagnées jusque dans l’enceinte de l’hôpital.
Le portail franchi, nous avons pénétré dans une vaste cour bordée de petites maisons. Sœur Gertrude, se sentant chez elle et non sans une certaine fierté, nous a désigné les cuisines où l’on préparait le brouet de quelque six mille âmes. Elle a houspillé au passage une fille grosse qui s’était aventurée en dehors du quartier qui lui était réservé.
Je ne m’attendais pas à une telle effervescence ; en fermant les yeux, j’aurais pu me croire sur le port de Marseille, parmi les cabanes des forçats. Dans une atmosphère exubérante, toutes sortes de marchands installaient leurs étals pour vendre leurs produits aux pauvres. Quel contraste avec la solennité du bâtiment vu de l’extérieur ! Sans la présence de silhouettes grises qui se faufilaient furtivement entre les éventaires, les yeux rivés au sol, on se serait cru sur une foire.
Sœur Gertrude nous a montré les logements des ouvriers et leurs ateliers, en nous expliquant que presque tous les corps de métiers y étaient représentés. Quand elle a ajouté qu’il y avait même des charrons qui forgeaient les fers des folles et des prisonnières, je me suis demandé si je n’aurais pas mieux fait de me porter volontaire pour le Mississippi. Nous avons longé des écuries, des étables et différentes remises dont je n’ai su deviner la fonction, nous avons dépassé une chapelle, des ateliers de couture et un bâtiment qu’on nous a désigné comme l’école des filles. J’ai été soulagée d’apprendre que ce lieu sinistre n’était pas uniquement dédié à l’enfermement et à la punition.
Une vingtaine31 de sœurs officières, qui sont des laïques portant l’habit de religieuses, a en charge la surveillance de toute cette population de malheureuses et d’infirmes.
Sœur Gertrude m’a fait rejoindre un groupe de filles qui, outre celles qui sont arrivées avec moi du Châtelet, comprend soixante-dix-huit jeunes femmes qui ont entre quinze et dix-sept ans. Orphelines, elles ont toutes été élevées dans cet hôpital. Leur présence me rassure ; elles ont l’air bien traitées et contentes de leursort.
–Je m’appelle Adeline. Toi aussi, tu vas partir au Mississippi ? me demande ma voisine de table.
–Je… Non pas, je… Je me rends compte que je ne sais pas pourquoi je suis ici et ce que je vais y faire.
–Ne crains rien, tu t’y habitueras. Nous allons toutes partir à la Louisiane pour y être mariées.
Je me tais, sidérée par cette révélation. J’étais si heureuse d’échapper à la prison que j’ai fait une confiance aveugle à sœur Gertrude, un peu imprudemment sans doute. Ce Mississippi semble m’attirer inexorablement ; depuis un mois, je n’entends parler que de lui. Pourvu que je ne sois pas tombée dans un piège.
Les paroles de l’invité de la dame Chaumont me reviennent à l’esprit : Filles vertueuses… Mariage… Mississippi…
Dès que je pourrai parler à sœur Gertrude, je lui demanderai ce qu’il enest.
–Tu te rends compte, nous, des orphelines, allons être dotées par leroi !
–À combien s’élèvera votredot ?
–Elle ne sera point en écus ; qu’en ferions-nous là-bas ? Mais en choses bien plus utiles dans notre nouveaupays.
–Plus utiles que des écus ?
–Des paires d’habits, trois exactement, deux jupes et deux jupons !
–Six chemises et six corsets, enchaîne avec enthousiasme mon autre voisine. Et six garnitures de tête et d’autres fournitures nécessaires pour nous faire convoler au plus vite en légitime mariage.