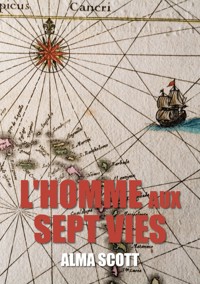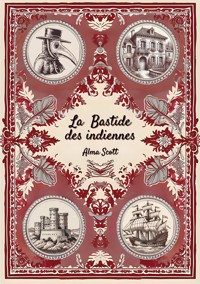
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"La Bastide des Indiennes" est une fresque romanesque où s’entremêlent les destins d’un médecin iconoclaste et d’une jeune femme audacieuse, fille d’un fabricant d’indiennes. Au cœur du XVIIIe siècle, de 1709 à 1722, leurs aventures palpitantes les entraînent, à travers l’Europe, jusqu’aux rivages exotiques du royaume d’Alger, pour les ramener en Provence, une terre ravagée par la peste.
Naïs et Jean-Baptiste seront entraînés dans un tourbillon d’événements qui mettront à l’épreuve leur courage et leur détermination. Ils seront confrontés à la violence, à l’esclavage, à l’exil, à la maladie et au deuil avant d’accomplir leur destinée.
Une aventure historique passionnée, pleine de défis et d’intrigues qui fait revivre une époque de tumultes et de dangers.
À PROPOS DE L'AUTRICE
Linguiste de formation et passionnée d’histoire,
Alma Scott écrit des romans d’aventures qui mêlent faits historiques et destins particuliers.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 821
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur
Les Filles du Mississippi,2022
L’homme aux Sept Vies,2024
AlmaScott
LA BASTIDE DES INDIENNES
Depuis le début de toute l’histoire, le fléau de Dieu met à ses pieds les orgueilleux et les aveugles. Méditez cela et tombez à genoux.
L’Exode.
Personnages principaux
Naïs Clary : fille de Benoît et d’Honorine Roubaud.
Jean-Baptiste Fabre : médecin, fils d’Isabella et d’Augustin.
Isabella Fabre : femme d’Augustin.
Louis Gaudemar, marquis de Saint-Louis : noble vivant sur les terres deBouc.
Hugues de Saint-Louis : fils du marquis.
Adelet Barthélémy : manouvrier.
Aimée Roure : servante et filleule de Benoît Clary, sœur de lait deNaïs.
Personnages secondaires
Mauro Arpente : ami de Jean-Baptiste Fabre.
Mehmet Chelabi : Turc, marchand de chevaux vivant à Alger.
Benoît Clary : négociant en tissus.
Duc de Coulanges : ami de Marie de Sauvecanne et du Régent.
Dawya : fille de Mehmet Chelabi.
Augustin Fabre : ancien associé et ami de Benoît.
Honorine Clary née Roubaud : femme de Benoît.
Pancrace : berger, guérisseur.
Pécoul : homme de confiance du marquis.
Joséphine Roure : sœur d’Aimée.
Rosalie et Bastien Roure : parents d’Aimée et de Joséphine.
Marie de Sauvecanne : marraine de Naïs et demi-sœur d’Honorine.
Personnages réels et historiquesPage 684
Lieux
Aix : Aix-en-Provence.
Bouc : village au sud d’Aix-en-Provence, actuel Bouc-Bel-Air.
Gardanne : commune à 15 km au sud d’Aix-en-Provence.
Marseille.
Septêmes : commune limitrophe de Marseille, actuel Septêmes-les-Vallons.
Simiane : village proche de Bouc, appelé Collongue ou Simiane au fil du temps ; actuel Simiane-Collongue.
Mesures
Canne : mesure de longueur utilisée dans le sud de la France. Valait 1 m, 99 environ à Aix et Gardanne, mais 2,01 m à Marseille.
1 canne carrée = 3,9549 m2 à Aix-en-Provence.
Toise : = 6 pieds = 1,9490 m.
Perche : 5,847 m.
Lieue : 4 km environ.
Monnaies
Unités de règlement :
Livre : = 20 sols ou sous = 240 deniers
Pièces de monnaie :
‒ Louis : monnaie d’or = 20 livres en 1709 et 54 en1721
‒ Écu : monnaie d’argent = 6 livres (1726)
‒ Liard : monnaie de cuivre = ¼ de sol = 3 deniers
ILes indiennesDécembre 1708 – juin 1709
1
Deux sillons creusaient le front du marquis. Ce contretemps devait être réglé au plus vite. Louis Gaudemar de Saint-Louis se ressaisit. Il fit bouillonner la dentelle de son jabot, boutonna son gilet et enfila le justaucorps de velours ponceau1 que lui tendait son valet. Il repositionna sa perruque qui cracha un nuage d’amidon de riz et s’aspergea de parfum.
Il recula alors d’un pas pour admirer son reflet dans le miroir et, satisfait de ce qu’il vit, prit son feutre empanaché et se rendit dans le salon où ses trois filles attendaient leur maître de musique. Il déposa un baiser distrait sur leur tête et se tourna vers sa femme :
–Hugues n’est point céans ?
–Il doit être encore chez les Clary, soupira-t-elle en respirant un flacon de sels qu’elle gardait en permanence à portée de main. La marquise avait depuis longtemps renoncé à se tenir informée des allées et venues de sonfils.
Louis Gaudemar fronça les sourcils. À dix-sept ans, Hugues devenait incontrôlable quand il s’agissait de Naïs Clary. Il n’avait découvert la puissance de l’attraction que cette drôlesse exerçait sur son cadet que tardivement et commençait à se demander s’il n’aurait pas dû faire preuve de plus d’autorité en lui interdisant de la fréquenter.
Pendant qu’il attendait sa voiture, une servante vida un seau d’aisance qui faillit gâcher ses bas de soie. Il chassa la malheureuse d’un coup de canne et promit de lui faire tâter du bâton le soirmême.
Les soubresauts de son carrosse brinquebalant l’empêchaient de se concentrer sur sa visite à Benoît Clary. Ses pensées se dissolvaient, comme le paysage, dans les linceuls de brume en suspension dans l’air.
Des cris provenant de la cour de la bastide des indiennes chassèrent sa rêverie. Quel était donc l’objet d’un si grand tumulte ? Les servantes s’agitaient en tous sens, l’une d’elles traînant une oie à demi plumée par le cou ; l’associé de Clary, Augustin Fabre, s’énervait pour que des manouvriers poursuivent le déchargement d’une charrette, tandis que sa femme et son fils, une sacoche de cuir sous le bras, traversaient la cour en toutehâte.
Contrarié que l’événement qui mettait la communauté de la bastide en émoi l’empêche d’être accueilli avec les honneurs dus à son rang, il ordonna à son cocher de se diriger vers la serre où tout le monde semblait converger.
Voilà que ce bourgeois prétentieux veut imiter l’orangerie de Versailles ! se moqua-t-il en son for intérieur à la vue de la construction aux parois de verre. Il arriva à l’entrée en même temps qu’Isabella et Jean-Baptiste Fabre qui le bousculèrent pour se frayer un chemin à l’intérieur, de sorte qu’il dut se contenter d’observer la scène depuis le pas de la porte, avec les serviteurs.
Naïs Clary était assise au milieu d’éclats de verre. Sa jupe retroussée à mi-cuisses laissait apparaître un filet de sang qui coulait le long de son mollet tandis que, sur la manche déchirée de sa chemise, une tache rouge vif s’élargissait au rythme des pulsations de soncœur.
Le marquis ne fut pas tant choqué par les blessures de la jeune fille, ni même par la façon dont il avait été cantonné avec les valets, que par l’attitude de son fils pendant que le médecin pansait les plaies de la blessée. Hugues se tenait à l’écart, pétrifié, sous l’emprise dévorante de cette donzelle de quatorze ans. Le marquis fut parcouru par un frisson d’appréhension, terrorisé à l’idée que la malédiction pût se répéter dix-huit ans plustard.
Bien qu’il eût l’impression que la scène s’était étirée sur de longues minutes, elle n’avait duré que quelques secondes. C’est la voix de la jeune Naïs qui le ramena à la réalité :
–Hugues, va-t’en ! Je ne veux plus tevoir.
Quand il l’entendit congédier son fils de la sorte, son sang ne fit qu’un tour. Il entra dans la serre, empoigna Hugues par le coude et l’entraîna vers la cour tandis que celui-ci, sorti de sa transe, hurlait en direction de l’adolescente :
–C’est bien fait pour toi, tu n’avais qu’à m’obéir ! Agité de tremblements rageurs, il secoua le bras pour se libérer de la poigne de sonpère.
–Hugues ! Dans quelle situation vous êtes-vous fourré ? Mille dieux ! Pourquoi vous obstinez-vous à fréquenter n’importe quelle fille de basse extraction ? Prince ne peut déchoir à fréquenter manant !
–Je ne sais de quel prince vous parlez, père. Quant à Naïs Clary, ce n’est pas n’importe quelle fille, ne vous en déplaise. Il jeta un regard sournois à son père qui jugea plus sage de battre en retraite.
–Venez, je vous emmène ; nous allons vous choisir un cheval. Benoît Clary ne semble pas être là et de toute façon le moment est mal choisi pour les affaires qui m’amènent.
Hugues suivit son père à contrecœur, se retournant plusieurs fois pour voir ce qui se passait du côté de la serre. Alors que leur voiture faisait demi-tour, il aperçut Naïs qui sortait en boitillant, pendue au bras de ce démon de Jean-Baptiste.
Chaque fois qu’il venait aux Indiennes, le marquis ne pouvait s’empêcher de comparer la propriété de Clary à la sienne. Sans doute aurait-il pu s’en accommoder si les terres qui y étaient attachées avaient été dignes de ce nom, mais elles comprenaient en tout et pour tout neuf cents cannes carrées, pentues et difficiles d’accès, rendant irréalisable son projet de jardins à la française. Quant à la bastide, un quadrilatère élevé d’un étage couvert d’une toiture à quatre pentes et flanqué de deux tours, elle avait un air austère et moyenâgeux qui jurait avec les constructions élégantes qui émaillaient le terroir. Il enrageait que son père ait pu se contenter de l’aumône faite par le seigneur de Bouc en lui cédant ce lieu maudit.
Tout au long du trajet, Hugues ne desserra pas les dents. Ses yeux bleu-gris avaient pris la teinte d’un ciel d’orage. Il lissait d’un geste machinal une mèche de cheveux blond filasse échappée de son catogan en ruminant sa contrariété. Élevé dans l’illusion de sa toute-puissance, il ne supportait pas que le monde ne se conformât point à son désir. Il revoyait la scène de la poursuite avec Naïs, le moment où il l’avait rattrapée et poussée et où elle s’était affalée contre la paroi en verre qui avait éclaté sous son poids. Son imagination s’attardait sur sa jupe retroussée qui avait dévoilé si haut ses cuisses. Jamais il ne l’avait tenue sous sa férule de la sorte ; si ses cris n’avaient pas donné l’alerte, elle aurait pu se vider de son sang sous sesyeux.
Le marquis s’enfonça dans les coussins de son siège et passa deux doigts sur sa fine moustache. Rassuré par le sourire satisfait de son fils, il n’en était pas moins préoccupé par les quelque cent livres qu’il allait devoir débourser pour lui offrir le cadeau promis. Il savait qu’Hugues enviait l’étalon du jeune Fabre. Il se demandait d’ailleurs où il avait pu trouver la somme exorbitante pour s’offrir un tel animal. À en croire les clabaudages2, un éleveur qu’il avait soigné en Camargue le lui avait cédé pour un prix dérisoire.
Convaincu qu’il ne devrait pas devancer tous les désirs de son fils, il ne pouvait cependant résister à la fascination qu’exerçait sur lui son insolente insouciance. La crainte du déshonneur et de la dérogeance3 avait hypothéqué sa vie ; Hugues, lui, s’emparait avec avidité de tout ce qui le tentait, qu’il s’agisse d’un poignard ou d’une servante. Sa voracité, la hargne qu’il mettait à s’approprier l’objet de ses désirs avait quelque chose d’inquiétant et d’envoûtant à la fois. Rien ne semblait lui résister, surtout pas la volonté de sonpère.
Il trouverait bien un moyen de financer ce présent !
Son héritage avait fait long feu depuis longtemps. Était-ce sa faute s’il aimait les chevaux, le jeu et les femmes ? Il eut un frisson de dégoût au souvenir de la vie étriquée que son ladre de père lui avait fait mener à leur retour de Nouvelle France4. Le corps crispé par le froid alors qu’il se recroquevillait en cherchant le sommeil, la lumière chiche et l’odeur écœurante des chandelles de suif, la tristesse des soirées dans la cuisine en compagnie du cocher, du valet et du souillon. Combien de fois n’avait-il pas maudit ce père, si peu préoccupé de tenir son rang ?
Quant à son mariage… Lui qui avait cru, comme tout un chacun, pouvoir régler ses créances en sortant sa femme de sa roture ! L’amie qui avait ménagé une rencontre avec sa future épouse lui avait fait miroiter une dot de cinquante mille livres et une rente annuelle de dix mille livres au moins, sans parler des millions à venir. En deux semaines, il avait mandé un notaire pour demander à son perruquier de père la main de sa fille. Comment deviner qu’il ferait faillite ?
Il gardait de cette mésalliance inutile une rancœur inextinguible pour sa pellucide épouse qui avait poussé le mauvais goût jusqu’à lui donner trois filles, avant que ses pèlerinages et les poudres, dont elle avait fait grand usage, lui fissent enfin la grâce d’un héritier.
Pour être honnête, eût-elle été à la hauteur des promesses qu’on lui avait faites, il ne l’eût pas aimée davantage. Aimer sa femme faisait bourgeois ! Il chassa ce souvenir d’un geste de la main comme s’il se fut agi d’une mouche importune.
Louis Gaudemar de Saint-Louis redressa le menton, bomba imperceptiblement le torse et retrouva sa bonne humeur à l’idée des nouvelles affaires qu’il avait lancées.
1 Rouge vif.
2 Bavardages, commérages.
3 Acte ou activité qui faisait perdre à quelqu’un sa qualité de noble.
4 Ensemble de territoires coloniaux français (capitale Québec), cédés à la Grande Bretagne en 1763.
2
–Tu as eu beaucoup de chance, Naïs, tu aurais pu te taillader une artère et te vider de ton sang. Cesse donc de faire fi du danger ! Tu n’as plus dix ans, voyons !
–Oh, Jean-Baptiste, ne me fais pas la leçon, on croirait entendre monpère.
–Je pourrais l’être.
Naïs se renfrogna. Un grand frère tout au plus ; Jean-Baptiste n’avait que treize ans de plus qu’elle ! Pourtant il était si mature, si expérimenté ! Il savait tant de choses qu’elle ignorait ! Il avait voyagé, étudié la médecine à Montpellier et à Paris, alors que ses déplacements ne l’avaient pas menée plus loin qu’Avignon.
–Pense à ton père. Tu imagines son chagrin s’il t’était arrivé malheur ?
Naïs détourna le visage pour qu’il ne voie pas qu’il avait fait mouche. Rien ne pouvait la rendre plus triste que l’idée d’infliger une quelconque souffrance à sonpère.
–Arrête de la gronder, caro mio. Tu ne vas pas gâcher une si belle journée.
Jean-Baptiste sourit à sa mère. Il n’allait, en effet, pas ternir sa joie de le revoir, d’autant plus qu’il ne passerait que quelques jours à la bastide, une semaine tout au plus pour les fêtes de Noël, avant de rejoindre Padoue où il allait parfaire son étude de la médecine auprès de Giacomo Ramazzoni, un ami de sa mère connu pour ses travaux sur les fièvres pesteuses.
–J’avais l’intention de profiter de la berline toute neuve du notaire qui envoie son cocher récupérer un habit à Aix. Sa femme m’a dit qu’elle était bien plus maniable et confortable que leur ancien carrosse. J’en profiterai pour faire quelques emplettes, crois-tu que Naïs puisse supporter le voyage ?
–Oh oui ! Oh, oui ! Jean-Baptiste, je t’en supplie, dis oui ! Regarde, je n’ai plus mal. Elle sautillait sur sa jambe blessée et agitait les bras en s’efforçant de ne pas grimacer pour lui prouver que ses blessures n’étaient plus qu’un mauvais souvenir.
–Arrête de t’agiter, tu vas rouvrir tes plaies. Puis se tournant vers Isabella, il ajouta : Veille à ce qu’elle ne commette pas d’imprudence et ne la fais pas marcher trop longtemps.
–Naïs, couvre-toi chaudement, arrange tes cheveux, tu ressembles à une bohémienne, et dis à Aimée de nous accompagner, je veux faire des achats pour la veillée.
Naïs voulut exprimer sa gratitude à Jean-Baptiste, mais il s’éloignait avec samère.
–Voilà une enfant qui n’a pas froid aux yeux ! Il fit cette remarqueà voix haute, sans pour autant solliciter l’avis d’Isabella.
–Pas aussi enfant qu’il y paraît, le corrigea-t-elle. Naïs est une jeune fille accomplie qui sait lire, écrire, poser des opérations et jeter5.
–C’est au couvent qu’elle a appris toutça ?
–Pas du tout. Son père le lui a enseigné, ainsi que l’anglais d’ailleurs et, lorsqu’il n’a plus été en mesure de répondre à ses questions, il s’est adjoint les services d’un précepteur qui lui donne des leçons d’histoire, de géographie, de botanique et de mathématiques.
–L’anglais ! Voyez-vous ça ! Est-ce que la fille d’un indienneur6 a besoin d’apprendre l’anglais ?
–Ton mépris me déçoit, Jean-Baptiste. Je pensais que tes études t’avaient ouvert l’esprit, mais je vois qu’il n’en est rien. Pourquoi les femmes n’auraient-elles pas le droit au savoir ? Seraient-elles inférieures aux hommes ? Penses-tu, toi aussi, comme les disciples d’Aristote que notre naissance, comme celle des monstres, est un accident et que notre humeur humide nous rend corrompues et dangereuses ? Naïs a le goût d’apprendre et de comprendre. C’est un esprit curieux nourri de lectures éclectiques. Cette gourmandise de connaissances en fait une personne digne d’intérêt, et la met en danger, ajouta-t-elle à regret.
Jean-Baptiste agita les mains en signe de soumission, honteux d’avoir donné à sa mère l’impression qu’il partageait les préjugés dont elle avait souffert.
Isabella s’était opposée à son père, un gentilhomme toscan, qui voulait la marier pour asseoir sa situation et menaçait de l’enfermer dans un couvent si elle se rebiffait. C’est dans sa fuite qu’elle avait rencontré Augustin, venu en Italie pour apprendre le métier chez des indienneurs arméniens de Gênes. Chaque fois qu’ils se chamaillaient, il ne manquait jamais de lui rappeler qu’il l’avait sauvée du couvent et elle répondait avec le plus grand sérieux qu’elle était tombée de Charybde en Scylla en l’épousant.
–Cette enfant est dotée d’une intelligence acérée qu’il est réconfortant de voir s’exercer sur le monde qui l’entoure. J’ai commencé à lui enseigner l’italien et je dois dire qu’elle est très douée.
–Attention de ne pas priver son précepteur de ses revenus, osa-t-il pour détendre l’atmosphère.
Ils furent interrompus par Augustin qui appelait son fils pour lui demander de l’aide.
Naïs eut le souffle coupé en entrant dans la cuisine. Dans la grande cheminée de pierre brûlait un feu d’enfer entretenu par le fils du garçon d’écurie. Il activait avec frénésie le soufflet tout en rêvant au bol de bouillon gras que lui vaudrait peut-être son travail. À la table rectangulaire, sous les salaisons et les tresses d’ail suspendues, une servante sablait les cuivres, les joues empourprées par l’effort.
Aimée debout devant une grande marmite pendue à la crémaillère, une main posée sur la hanche, remuait la soupe au chou et aux lardons avec une cuillère à pot. Même dans cette posture domestique, elle conservait un port altier.
–Dépêche-toi Aimée, Isabella nous emmène à Aix. Viens, aide-moi à me préparer.
Aimée essuya la sueur qui inondait son visage, ramena une mèche échappée de son béguin, rajusta son casaquin dont elle avait libéré quelques agrafes et emboîta le pas à Naïs, non sans avoir chapardé un morceau de pain au passage.
Bien qu’elle ne fut que de quelques mois son aînée, Aimée arborait un air grave qui lui conférait une maturité peu commune chez les filles de sa condition. Ses yeux, d’un gris hivernal, ne s’animaient que lorsque sa maîtresse lui confiait ses secrets ou la faisait complice de ses espiègleries. Aimée lui vouait une affection sans retenue, renforcée par le fait qu’elles avaient été sœurs de lait et par le lien de parrainage qui l’unissait à Benoît Clary.
Elle poussa Naïs vers la coiffeuse pour essayer de domestiquer sa chevelure ébouriffée. En retirant de ses épaules le châle d’indienne, elle vit que la manche de sa chemise était couverte desang.
–Mon Diou, pecaïre la pitchoune ! s’exclama-t-elle en portant les mains à la bouche.
Elle ne parlait que le provençal, mais Naïs s’adressait à elle en français.
–Ce n’est rien ! C’est ce gredin de Hugues qui m’a poussée dans la serre. Il était furieux que je le batte à la course.
Aimée délaça le corset de Naïs et fit glisser sa camisole déchirée par-dessus sa tête. Elle ne pouvait retirer ses yeux du bandage souillé.
–C’est Jean-Baptiste qui a pansé ma plaie. Il m’a appliqué une embrocation7 de thym et de romarin, il paraît que ça va m’aider à cicatriser. Une chance qu’il se soit trouvé là aujourd’hui.
Comme autrefois.
Elle leva les bras pour qu’Aimée lui passe une chemise propre. L’odeur de la toile, les balles de coton dans l’atelier de son père, le rouleau de drap qui avait basculé sur elle, l’étouffement. Que serait-il advenu d’elle si Jean Baptiste ne l’avait délivrée, emportée dans la cour et aidée à reprendre son souffle ?
Aimée s’attaqua à l’écheveau desa tignasse brune.
–Oh, Aimée, la tête du marquis quand il a vu son fils ! Il était incapable de faire un geste. J’ai cru qu’Hugues allait s’évanouir à la vue de mon sang. Le couard ! Il veut tout régenter, mais se décompose devant une blessure.
5 Calculer avec des jetons.
6 Professionnel impliqué dans le commerce des indiennes, tissus de coton imprimés.
7 Préparation huileuse destinée à calmer les douleurs et à détendre les muscles. Le thym, le romarin et la rhubarbe ont un effet désinfectant.
3
Benoît Clary resserra autour de ses épaules la vieille robe de chambre d’indienne8 qu’il ne quittait plus, rajusta le cucuphe9 censé soulager sa migraine et regarda s’éloigner la voiture qui emportait Naïs versAix.
Quand il avait eu vent de la visite du marquis, il s’était réfugié dans la bibliothèque en verrouillant la porte à double tour. Seul Augustin, fidèle parmi les fidèles, était dans la confidence.
Lorsqu’il avait compris qu’un accident s’était produit dans la serre, Benoît avait accouru jusqu’au perron ; la vue du carrosse de Saint-Louis l’avait dissuadé d’aller plus avant. Dissimulé derrière les tentures de la fenêtre, il avait aperçu Jean-Baptiste et Isabella passer en courant et son cœur s’était serré à l’idée que Naïs pût être concernée. Il s’était même risqué à sortir de sa cachette, espérant intercepter un domestique pour savoir ce qui se passait, mais toute la maisonnée avait disparu. Quand ce fut au tour de Saint-Louis de traverser la cour dans une discussion animée avec son fils, l’implication de Naïs ne fit plus de doute.
Il tergiversa quelques instants, mais son désir de lui porter assistance fut plus fort que sa crainte. Au moment où il allait sortir, il la vit sautiller sur un pied, souriante au bras de Jean-Baptiste et, mis à part le désordre de sa tenue et le pansement autour de son bras, il aurait juré qu’elle n’avait subi aucun dommage. Il résista alors à l’envie d’aller à sa rencontre pour lui épargner l’embarras de ses effusions inquiètes.
Benoît se rassit à son bureau et se remit au travail de mise en ordre qu’il avait entrepris. Trois tas désordonnés occupaient la quasi-totalité de la table : des reconnaissances de dettes, des lettres retraçant les moments importants de sa vie et des papiers non encore classés. Il en prit un au hasard : il s’agissait d’une liste de marchandises que son père importait des échelles10 du Levant, d’Inde et de Turquie et revendait jusqu’à Paris, aux dames de la cour qui raffolaient de ces étoffes chamarrées dont les couleurs vives avaient supplanté les céladon, amarante et cuisse-de-nymphe.
Si seulement il s’était contenté de reprendre l’affaire et de vendre des indiennes aux Espagnols et aux Italiens, il n’en serait pas à se terrer dans cette pièce comme un gibier aux abois.
Il se leva pour ranimer le feu. L’incandescence des étincelles qui voletaient raviva le souvenir du rouge d’Andrinople dont il avait voulu percer le secret. Il resta près de l’âtre à se laisser envelopper par la chaleur et les souvenirs qui remontaient du passé comme les flammèches le long du conduit.
Ce mois d’avril 1669avait été particulièrement doux à Marseille, il venait d’avoir dix-neuf ans. Il s’échappait dès qu’il le pouvait de l’échoppe familiale, qu’il avait reprise à la mort de son père, pour flâner sur le quai de la rive nord où seules les galères du roi avaient le droit de s’amarrer.
Ce jour-là, accompagné de son ami Elzéar, le fils d’un drapier concurrent, il allait assister aux préparatifs des douze galères qui devaient appareiller dans une quinzaine de jours sous le commandement du comte de Vivonne, pour secourir Candie11 assiégée par les forces ottomanes.
Leurs coques noires et rouge sang, alignées le long du quai, du fort Saint-jean à l’église des Augustins, présentaient à la ville leurs poupes chargées de bas-reliefs dorés. Les pêcheurs, furieux de devoir se faufiler pour accoster leurs barques et décharger leur poisson, les invectivaient, indifférents à leur majesté.
Les capitaines avaient fait retirer les tentes en grosse laine brute censées protéger la chiourme12 pendant les mois d’hiver, libérant de ces cocons monstrueux des navires parés d’oriflammes, de bannières et de pavesades13 de Damas frangés d’or. La foule des passants, des marins, des colporteurs et des portefaix bravait l’enchevêtrement des charrettes et des carrosses pour admirer le spectacle. On disait que les galériens troqueraient leurs casaques rouges contre des tenues bleues, ornées d’une fleur de lys jaune. Pour l’heure, ils s’affairaient autour des cordages, chargeaient de la viande, du biscuit, des légumes secs, du bois à brûler, de l’eau et de la poudre ou calfataient les navires sous les coups de corde des argousins14.
Benoît et Elzéar avaient traîné parmi les baraques, recouvertes de haillons tendus sur des arceaux, où sept à huit cents forçats, enchaînés dès le matin, tenaient toutes sortes de commerces plus ou moins licites. On y trouvait perruques, bottes, bijoux volés ou habiles faussaires. Parmi elles, des femmes en jupon piqué, des hommes au bonnet de laine enfoncé jusqu’aux oreilles erraient à la recherche d’une bonne affaire ou de sensations fortes. Auffiers15, pêcheurs, porteurs de chaises, rémouleurs, jongleurs et avaleurs de feu croisaient les tricornes empanachés des officiers de la royale dans une atmosphère de vice, de souffrance et de fête. Le mistral colorait le ciel de bleu indigo et répandait une odeur d’iode, de goudron et d’épices qui ne parvenait pas à masquer la puanteur des eaux usées et de la nourriture avariée qui traînait sur les étals.
Benoît et Elzéar contournèrent les amoncellements de caisses entassées sur les quais, dépassèrent les bassins de construction de l’arsenal, pratiquement terminé, longèrent les cultures maraîchères de la rive Neuve, avant de grimper au sommet de la tête de More16. Ils aimaient se réfugier dans ce lieu désert et sauvage qui dominait leport.
Songeur, Benoît imaginait dans les reflets des navires disloqués par le caprice des vagues les destins qui allaient basculer dans les affrontements à venir : la gloire pour les capitaines, la mort pour la chiourme enchaînée, la liberté peut-être pour les Turcs qui voguaient aveceux.
Elzéar, assis au bord de l’eau, l’apostropha :
–Tu ferais mieux de venir, Benoît. Ça rafraîchit ! Torse nu, il trempait les pieds dans l’eau mousseuse, quand une vague, plus haute que les autres, l’éclaboussa.
Benoît éclata de rire à la vue de son ami qui remontait vers lui, dégoulinant.
–Tu ressembles à une ratepenade17.
Elzear se sécha aux manches de sa chemise.
–On ferait mieux d’y aller ; c’est pas bon de laisser l’échoppe aux commis.
–On a bien le temps d’y retourner.
Elzéar savait depuis longtemps que Benoît s’intéressait plus à la teinture qu’au négoce des draps.
Comme pour confirmer ses pensées, Benoît poursuivit :
–L’édit de Monsieur Colbert va rebattre les cartes18. Avec la franchise du port, Marseille obtient le quasi-monopole du commerce avec les échelles du Levant. Nous recevrons les filés et les toiles blanches que nous pourrons teindre. Ah si seulement nous maîtrisions les techniques des artisans levantins ! Espérons qu’ils viendront nombreux.
–Te voilà bien optimiste. Marseille sera comme un territoire étranger. Le marché français va se fermer ànous.
Il n’obtint qu’un haussement d’épaules pour toute réponse.
Sur le chemin du retour, à hauteur de l’église des Augustins, un carrosse les croisa. De la portière flottait un châle d’indienne que le vent déployait comme une bannière. Il frôla le visage de Benoît qui tendit la main et le laissa couler entre ses doigts.
–Regarde Elzéar ce rouge magnifique. Le rouge du manteau de César ! Le rouge d’Andrinople !
La lumière sublimait les reflets du tissu incarnat parsemé de fleurs blanches.
–Je veux produire des indiennes, Elzéar, pas des cotonnades qui ne résistent ni au lavage ni au soleil. Non, je veux dompter la couleur des chaffarcanis19 du Levant.
–Tu ferais mieux de faire prospérer ton affaire, elle t’assurera une existence aisée.
–Tu ne comprends pas. Si je parviens à fabriquer des indiennes aux teintes résistantes, j’aurai, comment te l’expliquer… dominé la matière, imprimé ma marque. Je veux qu’on admire mon travail, qu’on me loue pour mon doigté, qu’on me respecte parce que je maîtrise les couleurs.
Elzéar émit un sifflement où l’admiration le disputait à la moquerie.
Benoît mesurait aujourd’hui à quel point il s’était montré présomptueux.
Il présenta la liste aux flammes et regarda l’auréole brunâtre dévorer le papier. À quoi bon ressasser un passé douloureux ? Le crissement de la feuille qui se recroquevillait dans les flammes n’emporta toutefois pas ses regrets.
Il prit ensuite un coffret incrusté d’ivoire acquis sur le marché de Seyde20 dans lequel il serrait les courriers de valeur. Il écarta les lettres échangées avec sa chère Honorine à l’occasion de ses déplacements et sortit la missive que Melchion, son premier associé arménien,21 lui avait envoyée de Vienne.
Vienne, Autriche,1679
Mon bonami,
Je vous envoie ces quelques lignes pour expliquer mon retard. J’ai depuis quelques jours des maux de tête épouvantables qui s’accompagnent de fièvre et de toux. On m’a envoyé dans un hôpital, car, comme vous en avez sans doute entendu parler, la peste bubonique sévit ici. J’ai bon espoir, car aucune grosseur n’est apparue sur mon corps et je n’ai eu aucun contact avec des pesteux, occupé que j’étais dans les entrepôts de tissus pour nos affaires.
Sa lettre, comme s’il avait senti sa fin proche, prenait ensuite un tour plus intime :
Je me souviens encore de notre première rencontre lorsque je débarquais à Marseille, attiré par les conditions faites par monsieur Colbert. J’ai été conquis par votre maîtrise de ma langue, votre passion pour les indiennes, votre esprit d’entreprise et votre désir d’apprendre la technique des colorants.
Malgré le feu, Benoît sentit le froid l’envahir jusqu’à lui saisir le cœur dans une étreinte glacée. Qu’en était-il de son esprit d’entreprise ? Qu’avait-il fait de ses rêves ?
8 Tissu de coton à fleurs, feuillages et oiseaux coloriés qui était importé des Indes :.
9 Bonnet à double fond, contenant un mélange de poudres aromatiques.
10Ports et villes de l’Empire Ottoman pour lesquelles le sultan avait renoncé à certaines de ses prérogatives en faveur de négociants français, essentiellement marseillais.
11 Héraklion. La Crète était une possession vénitienne.
12 Nom donné aux galériens.
13 Étoffe tendue autour des flancs de la galère, ici pour décorer.
14 Surveillants.
15 Fabricants de cordages et de filets à grandes mailles.
16 Actuel Pharo.
17 Chauve-souris.
18 Création du port franc de Marseille en 1669.
19 Cotonnades importées des Indes, de Perse et de l’Empire ottoman, imprimées à fond rouge ou violet et à fleurs blanches, colorées à la garance. Leur importation et leur fabrication furent interdite en France en 1686, notamment pour protéger les manufactures textiles françaises.
20 Sidon ou Saïda au Liban.
21 La diaspora arménienne constituait un réseau d’affaires très efficace pour le commerce de la soie et des indiennes car elle était implantée partout en Orient.
4
Recroquevillées sous plusieurs épaisseurs de couvertures piquées, emmitouflées dans leurs mantes de laine, Naïs et Aimée s’amusaient de la buée qui accompagnait chacune de leur parole et couvrait les vitres de la berline d’un voile diaphane. Naïs traçait des mots qu’Aimée déchiffrait et s’émerveillait de la rapidité de ses progrès. La campagne poudrée de frimas s’étalait, vierge de végétation. De temps en temps, en bordure de route, un arbre surgissait de l’uniformité glacée ; ses branches, fragilisées par le gel, se brisaient avec un bruit sec au contact du toit de la voiture.
–Si le froid persiste, les récoltes vont pourrir, les oliviers vont geler et nous allons connaître un nouvel épisode de disette.
Naïs, gagnée par l’inquiétude d’Isabella, frissonna sous sa couverture. Bien que les privations lui soient inconnues, elle n’ignorait pas la pauvreté du petit peuple et des paysans et considérait comme un privilège de manger tous les jours à sa faim. Peut-être était-ce la peur du lendemain qui affectait son père. Son attitude depuis quelques mois la laissait perplexe : il était préoccupé, distant presque. Alors qu’il l’avait toujours intéressée aux arcanes de ses affaires, elle se sentait exclue depuis qu’il s’était reconverti dans les colorants. Il restait évasif lorsqu’elle l’interrogeait et ne lui confiait plus ses projets. Augustin n’avait pas voulu lui en dire davantage, quant à Isabella, elle feignait d’ignorer ce qu’elle qualifiait « d’affaires d’hommes ».
Une tache noire sur le sol immaculé attira son regard. Elle reconnut une perdrix, couchée les pattes en l’air, raidie par le froid, mais refusa d’y voir un mauvais présage.
Ils entrèrent dans Aix par la porte des Augustins et se dirigèrent vers le cours à carrosses. Entre deux rangées d’ormes décharnés par l’hiver, des dizaines de chevaux et quelques porteurs qui avaient du mal à se frayer un passage entre les véhicules pataugeaient dans la boue. À hauteur de l’hôtel de Pontevès, une chaise s’était mise en travers de la chaussée. Son occupant lançait ordres et contre-ordres à deux laquais affolés qui tournaient en rond, sous les quolibets de quelques harengères qui, à défaut de poisson, débitaient des paroles salées. Elles retroussaient leurs jupes de laine pour en exhiber la doublure de toile imprimée, fières de se parer comme les dames de la meilleure société et de braver les interdits. Oubliant pour une fois leur révulsion à se mêler à la bourgeoisie et aux marchands, quelques nobles qui circulaient à pied, s’étaient arrêtés pour assister au spectacle.
Incapable d’aller plus loin, le cocher déposa les trois femmes pour qu’elles poursuivent à pied. Soulevant leurs jupes pour enjamber les immondices, elles se dirigèrent vers la ville comtale où se tenait le marché.
Sur leur chemin, une troupe de comédiens nomades, autorisée à dresser son théâtre, donnait une représentation gratuite de Sganarelle ou le Cocu imaginaire de monsieur Molière devant un parterre de guenilleux et de petites gens. Curieuse, Naïs écarta le rabat de toile qui masquait l’entrée du chapiteau.
Si mon bras sait encore montrer quelque vigueur.
Votre plus court sera Madame la mutine,
D’accepter sans façons l’époux qu’on vous destine.
L’idée que son père la battait froid parce qu’il n’osait pas lui annoncer qu’il lui avait choisi un époux, l’effleura, mais le ridicule de cette pensée lui arracha un sourire. S’il l’avait élevée dans le goût de l’indépendance, s’était refusé à la placer chez les religieuses pour qu’elle y apprît les bonnes manières et la discipline, ce n’était pas pour la forcer à épouser un homme qu’elle n’aurait pas choisi.
Le précepteur qui fait répéter laleçon
À votre jeune frère, a fort bonne raison,
Lorsque nous discourant des choses de la terre,
Il dit que la femelle est ainsi que le lierre
Qui croît beau tant qu’à l’arbre il se tient bienserré
Et ne profite point s’il en est séparé.
La réplique déchaîna l’hilarité des gueux qui assistaient au spectacle ; même les femmes ricanaient ! Naïs, hors d’elle, faillit interrompre la représentation pour leur dire leur fait, mais Isabella l’entraîna à l’extérieur.
–Ne pars pas encore en guerre contre des moulins à vent. Le monde est ainsi fait que nous ne pouvons nous épanouir que dans l’ombre des hommes.
–Jamais ! Je refuse de vivre en parasite et de m’élever grâce à celui qui m’accompagnera. Je veux réussir par ma valeur.
–Si fait, jeune fille ; c’est une situation plus enviable que de s’abaisser des turpitudes de celui qui te donne le bras !
–Pourquoi me dis-tu cela ? À qui penses-tu ? Naïs avait très bien compris l’allusion à Hugues de Saint-Louis ; elle défiait pourtant Isabella du regard pour provoquer une discussion apte à purger la colère suscitée par la réaction des spectateurs.
–À personne en particulier, mais veille à tes fréquentations si tu ne veux pas déchoir.
À l’approche de la place aux Herbes,22 la presse se faisait si forte qu’Isabella prit Naïs et Aimée par le coude pour avancer. Naïs se laissa faire sans renauder, répondant par un sourire à la pression exercée sur sonbras.
Autour de la place, des jardiniers avaient étalé leurs légumes sur les bancs de pierre. Au milieu et dans les rues adjacentes, des éventaires dressés en désordre délimitaient des allées sinueuses où se promenaient bourgeois et paysans au milieu des déjections de volailles et des restes flétris de légumes.
Elles croisèrent un vendeur de tisane, sa fontaine en fer-blanc sur le dos. Elles achetèrent des oublies23 dont l’odeur de beurre chaud se mêlait aux relents de chair cuite qui s’échappaient de l’échoppe d’un rôtisseur devant laquelle un marchand d’orviétan24 vantait sa marchandise.
Un arracheur de dents qui offrait une rasade d’eau-de-vie à ses patients remportait un franc succès à en juger par la queue devant son étal. Naïs s’arrêta devant celui d’un apothicaire ambulant qui vendait des potions pour calmer le foie, les spasmes, la bile, les menstrues, la toux et bien d’autres maux dont elle n’avait jamais entendu parler. Elle en acheta une pour soulager la méchante toux d’Espéride, la cuisinière, et prit aussi de la verveine pour tempérer l’excitation des nerfs de sonpère.
À un coin de rue, un joueur de fifre entonnait un air enjoué à deux pas d’un guenilleux, vêtu de lambeaux d’uniforme, qui exhibait ses moignons. Des lettres tracées sur un morceau de bois expliquaient qu’il avait eu les deux jambes amputées à la suite d’une blessure infligée à la bataille de Ramillies25. En se baissant pour mettre une pièce dans sa sébile, Naïs croisa son regard et eut peur du vide qu’elle yvit.
Devant le palais, des enfants harcelaient d’injures et de crachats un Boucain26 convaincu de contrebande, enchaîné au carcan, un écriteau dénonçant sa vilenie pendu autour ducou.
Alors que Naïs attendait Isabella, qui achetait du massepain et des fruits confits, une jeune bohémienne s’approcha d’elle ; ses traits poupins, sa tignasse brune et ses yeux pétillants lui ôtèrent toute méfiance. Elle se laissa prendre la main de bonne grâce en posant sur la fille un regard amusé, curieuse de voir comment elle allait singer ses aînées pour lui dire la bonne aventure.
–Tu vas aller vers le soleil, revenir dans les larmes. Tu montreras courage dans la tempête.
Elle parlait lentement, détachant chacun de ses mots, comme pour se donner le temps d’inventer la suite. Naïs eut pitié d’elle et voulut retirer sa main pour lui donner quelques pièces, mais la fille la retint. La parole libérée, elle termina alors sa prédiction sans s’interrompre, les yeux plantés dans les siens. Douleur et confusion, vengeance et trahisons, amour venu de loin, noblesse en croissant et… Naïs crut voir une ombre passer dans sesyeux.
–Et quoi ? termine sinon tu n’auras point d’argent.
–Va, princesse, j’en veux pas de ton argent.
Naïs ouvrit sa bourse et en sortit quelques liards qu’elle glissa entre les doigts de la gitane qui se volatilisa dans la foule.
Confuse, elle éclata d’un rire nerveux qui ne parvint pas à dissiper son trouble.
–Pourquoi ris-tu ? lui demanda Aimée, la bouche encore grasse des beignets qu’elle venait de dévorer.
–Qu’as-tu encore mangé ? Tu ne seras donc jamais rassasiée ! Naïs espérait ne pas avoir à répondre à la question de sa sœur de lait. Celle-ci ne désarma pas et la fixa de ses grands yeux sérieux pour la faire céder.
–On vient de me prédire tout un océan de malheurs.
–Et ça te fait rire ?
–Et un amour venu deloin.
Les deux filles rejoignirent Isabella en riant.
22 Actuelle place Richelme.
23 Pâtisserie cuite entre deux fers comme une gaufre.
24 Faux antidote des dix-sept et dix-huitièmes siècles.
25 23 mai 1706 ; bataille majeure de la guerre de succession d’Espagne.
26 Habitant de Bouc. Les habitants de ce village étaient spécialisés dans le transport clandestin de marchandises.
5
Une neige épaisse se mit à tomber en tout début d’après-midi, s’accrochant au sol glacé qu’elle recouvrit presque instantanément d’une couche immaculée par-dessus la saleté. Le ciel était si bas qu’il faisait presque nuit, une lumière blafarde enveloppait le marché où, dans un désordre précipité, les marchands débarrassaient leurs étals. Les trois femmes se hâtèrent vers le cours à carrosses où le cocher devait les attendre. Elles rencontrèrent quelques difficultés à le trouver, car le brave s’était réfugié dans une taverne. Il revint les joues rouges, l’air penaud et la démarche mal assurée.
–Espérons qu’il lui reste assez de jugement pour nous conduire à bon port, remarquaNaïs.
Une fois sorties d’Aix, elles baissèrent les rideaux pour faire barrière au froid.
Bercée par le rythme lent de la berline enténébrée, Aimée s’était endormie sur l’épaule de Naïs qui, heureuse du refuge que lui procurait la pénombre, pouvait penser aux prédictions de la gitane sans qu’Isabella, toujours attentive à ses humeurs, se rende compte de sonémoi.
Qui était donc cet amour venu de loin ? Un marin ? Un négociant des Échelles ? Elle semblait avoir oublié les autres facettes de la prophétie pour se focaliser sur ce grand voyageur qui accomplirait son destin en venant la rejoindre. Naïs était à l’âge où l’imagination, pour peu qu’elle soit encouragée par un événement inattendu ou une rencontre surprenante, remodelait la réalité au gré de ses désirs. Non qu’elle fût insatisfaite de son sort, mais elle se plaisait à dessiner les contours d’un avenir teinté de passion et d’aventure.
Le cocher avait allumé les lanternes et guidait les chevaux avec précaution. Les bêtes étaient gênées par les flocons que les bourrasques chassaient devant elles. On n’y voyait pas à plus de quelques cannes. La neige se déposait sur le sol glacé en un tapis épais qui unifiait le paysage et confondait la route et le fossé qui la bordait. Une heure après avoir quitté Aix, ils n’avaient parcouru qu’une lieue. Isabella tendit une oublie àNaïs.
–Que t’a dit cette bohémienne ?
Naïs appréciait d’ordinaire l’intérêt qu’elle lui témoignait et se confiait volontiers à elle pourtant, elle éprouvait aujourd’hui quelque ressentiment face à cette tentative d’intrusion dans son intimité.
–Quelle bohémienne ?
–Celle avec qui tu parlais pendant que j’achetais du massepain27 ; je vous aivues.
–Rien de notable, lança la jeune fille, contrariée d’avoir été dérangée dans sa rêverie.
–Prends garde Naïs de ne pas te laisser influencer par ceux qui prétendent connaître ton avenir. Tu es la seule à pouvoir façonner ton destin. Rien n’est fixé à l’avance ; chacun est libre d’agir comme il l’entend, quelles que soient les circonstances.
–Tu me tiens là un discours contraire à tes propos de ce matin au sujet de notre inévitable soumission aux hommes.
Isabella éclata derire.
–Vous ne vous en sortirez pas avec des arguties, jeune fille. La gitane vous a-t-elle au moins prédit la rencontre avec un parfait gentilhomme comme dans les contes de monsieur Perrault ?
–Plutôt comme dans ceux des Mille et une nuits ! rétorqua Naïs, trahie par son impétuosité.
–Ah, je vois, le beau Simbad ! Ces prévisions ne sont que calembredaines, Naïs. On ne rencontre pas souvent de beaux marins venus de lointaines contrées.
–Isabella, raconte-moi la rencontre de mon père et de ma mère, lui lança Naïs à brûle-pourpoint.
Isabella sourit de la diversion.
–Je te l’ai déjà racontée.
–S’il te plaît, encore. Elle ne se lassait pas de cette histoire qui ressuscitait sa mère et accréditait ses rêves les plus romanesques.
Isabella se cala dans son siège, rassembla ses idées et raconta :
–C’était en 1691. Ton père et Augustin étaient associés depuis quelques mois. Ils s’étaient installés à Avignon.
–C’est là que tu as rencontré Augustin ?
–Non, nous étions déjà mariés. Je l’avais rencontré en Italie où il était venu se perfectionner dans l’art de la teinture. À l’époque dont je te parle, Jean-Baptiste avait quatre ans. Je savais que je ne pourrais plus avoir d’enfant. Elle s’interrompit quelques instants pour se perdre dans d’obscurs méandres, avant de reprendre le cours de son récit. Nous avions accompagné ton père à la foire de Beaucaire.
–Vous y alliez tous lesans ?
–Difficile pour un négociant en indiennes de ne point s’y rendre. La foire attirait des marchands de toutes sortes et des acheteurs venus pour affaires, car aucune taxe ni redevance ne frappaient les produits que l’on y échangeait.
Depuis que le roi était passé à Beaucaire quelques années auparavant,28 le succès de la foire ne cessait de croître. Protégée par les galères royales qui surveillaient l’entrée du golfe de Fos, la ville attirait une foule de marchands venus de Lyon ou du Nord à cheval, en charrette, en carrosse ou en voguant sur le Rhône comme ceux arrivés du Levant dans des navires accostés à Marseille. Il fallait les voir déballer leurs cargaisons dans le port aménagé pour l’occasion. Si tu avais pu entendre toutes ces langues et ces dialectes ! On eût dit Babel : arabe, espagnol, catalan, italien, turc ou persan, certains s’exprimaient même dans des langues inconnues à nos oreilles de Provençaux ; il n’était pas rare de croiser des marchands anglais ou allemands.
–Je regrette que père n’ait jamais voulu m’y emmener. Il disait que ce n’était pas la place d’une fillette et qu’il y régnait une ambiance de bacchanales.29
–Il n’avait pas tort. Les distractions étant nombreuses. À la tombée du jour, lorsque les écus et les louis avaient changé d’escarcelle, des bals s’organisaient. On se regroupait par ville ou pays d’origine et les bourgeois ne dansaient pas le rigaudon ou la farandole avec les gens du peuple. La lumière des torches et des flambeaux, le son mêlé des fifres, des luths d’Orient, des galoubets et des tambourins, le vin qui coulait à flots… Oui, des saturnales30 favorisées par la promiscuité qui régnait dans la ville.
–Il y avait pourtant des auberges ?
–Plus une chambre dans les hôtelleries, plus une maison qui ne soit louée. Les propriétaires se réfugiaient dans leur cave ou leur grenier pour tirer tout le parti possible de leur demeure. Certains bailleurs laissaient même leurs locataires ouvrir des cafés dans leur maison pour le temps de la foire et il n’était pas rare de voir, devant leur porte… Isabella hésita.
–Oh ! Je t’en prie, Isabella, je sais très bien que certaines femmes font commerce de leur corps.
–Qui t’a appris de telles choses ?
–Tu oublies que mon père m’a toujours laissé libre accès à sa bibliothèque.
–Je ne le sais que trop ! Peut-être que s’il l’avait restreint, tu ne serais pas toujours à tout mettre en doute et à te révolter.
–Alors ? C’était qui devant les portes ?
Isabella termina sa phrase dans un rire : des ribaudes qui interpellaient les passants pour les détourner de leurs affaires.
–C’est au bal que ma mère et mon père se sont rencontrés ?
–Non, au milieu des indiennes. C’était le vingt-deux juillet. Je m’en souviens parce que c’était le jour de l’ouverture de la foire. Il devait être onze heures, la température avoisinait les trente degrés. Ta mère et son père avaient assisté à la messe de l’Ouverture puis à la procession en l’honneur de Sainte Magdeleine dont la statue traversait la ville portée par de jeunes filles. Pendant que son père discutait avec un négociant, Honorine l’a attendu près de notreétal.
–Comment était-elle ?
–Brune comme toi, mais moins grande. Elle avait des yeux moins sombres que les tiens, mais tout aussi remarquables et la même fossette sur la joue droite lorsqu’elle souriait. Je la revois : elle portait un jupon sur un casaquin en falbalas, un corset à fleurs et un velours orné d’une croix autour du cou avec un chapeau de paille à larges bords par-dessus sa coiffe en dentelle. Ton père était subjugué. Il la regardait caresser nos indiennes en faisant chatoyer leurs couleurs au soleil. Alors qu’il aurait dû en profiter pour lui vanter sa marchandise, il restait comme une statue de sel à l’admirer.
–Et elle ? Avait-elle remarqué papa ?
–Je ne saurais dire. Sur le moment, je ne le crus pas, mais après l’avoir mieux connue, je sais quelle fine mouche elle était. Elle prenait son temps pour choisir une vanne31 ; son père la rejoignit. Un enfant d’une dizaine d’années s’est approché d’eux par-derrière, attiré par l’énorme bourse qui faisait une bosse sous les basques de l’habit de ton grand-père. Tu vois, toutes les affaires se traitaient au comptant ; le petit voleur et l’homme qui l’avait envoyé et qui se tenait à distance savaient que les acheteurs transportaient des sommes importantes.
–Et la maréchaussée ? Ne la craignaient-ilspas ?
–Sans doute. Elle patrouillait pour assurer la sécurité des passants, mais la presse était si forte que le garçon espérait parvenir à se sauver. Ce jour-là, des milliers de personnes déambulaient sur le Pré au milieu de la ville de cabanes de bois dressées pour l’occasion. Ils avaient même envahi le pont de bateaux qui reliait Beaucaire à Tarascon.
–Il a donc dérobé la bourse de grand-père.
–Sans barguigner. Le vieil homme était trop occupé à conseiller sa fille. Lorsque son complice lui a fait signe, le garçon a avancé une main et saisi la bourse, tandis que de l’autre, il coupait le cordon. En un clin d’œil, ton grand-père a été délesté de son argent sans qu’il ait senti le moindre frémissement. Le petit voleur a alors gagné du pied 32aussi vite qu’il a pu, en direction de la rive du Rhône où le chef de bande s’était replié. Il venait de franchir un étal de piqués de soie lorsqu’il s’est affalé au sol ; une main puissante lui maintenait le nez dans la poussière.
–Où cours-tu ainsi petit gueux ? À qui appartient cette bourse ?
–La maréchaussée ! s’exclamaNaïs.
–Non, ton père ! Il avait tout de suite compris ce qui s’était passé lorsqu’il avait vu le tire-laine déguerpir et était sorti de sa transe pour se lancer à sa poursuite. Le jeune garçon a craché la terre qu’il avait dans la bouche : ton père a alors un peu relâché son étreinte pour qu’il puisse s’expliquer.
–Je le reconnais bien là : il donne la parole à un malandrin pris la main dans lesac !
–Ses dénégations d’innocence ont attiré un soldat d’un régiment voisin, venu prêter main-forte à la maréchaussée. Ton père a compris que l’enfant allait passer un très mauvais quart d’heure, alors qu’il n’était que le bras dans une organisation montée par des adultes qui profitaient de la pauvreté des malheureux.
–Il l’a libéré ? !
–Le garçon s’est enfui en direction de la ville sans demander son reste, espérant sans doute échapper à son complice. Et ton père s’est excusé auprès du brigadier comme s’il lui avait échappé.
–Et ensuite ? Maman a admiré son héros ?
–Non pas ! Ton grand-père, s’étant enfin rendu compte qu’on l’avait dépouillé, est arrivé en criant Au voleur ! Au voleur ! Il a même pris Benoît, qui tenait sa bourse à la main, pour le coupable et l’a menacé de sa canne ; c’est ta mère qui lui a sauvé la mise en empêchant son père de le rosser.
–Papa devait être très fâché, lui qui ne supporte aucune injustice.
–Furieux, tu veux dire. Jusqu’à ce qu’il croise le regard de ta mère et prenne le parti de rire de cette mésaventure. Pour le remercier, ton grand-père a voulu l’inviter à boire du vin du Languedoc dans une taverne, mais ton père l’a habilement attiré vers notre étal : Je ne puis laisser mon étal d’indiennes sans surveillance plus longtemps… Si vous voulez bien me suivre, nous pourrions… Ah l’habile homme !
–Et grand-père l’a suivi sans rechigner.
–Mieux que ça ! C’est le Seigneur qui vous a mis sur mon chemin. Je suis marchand drapier et je souhaite acheter des, lui a-t-il déclaré.
–Ils ont fait affaire ?
–À cette époque, ton père savait se montrer déterminé lorsqu’il désirait quelque chose.
–Pourquoi a-t-il tant changé, Isabella ? Il est toujours d’humeur morose et ne sort presque plus de la bibliothèque.
Isabella hésita quelques secondes, puis choisit de se taire.
–Ne veux-tu pas savoir comment s’est terminée l’histoire d’Honorine et de Benoît ?
–Si fait, Isabella, sifait.
–Séduite par la passion qu’il mettait à convaincre son père de la qualité de ses tissus, ta mère m’a avoué plus tard qu’elle avait été incapable de résister à la force qui irradiait de ton père et qu’elle avait su très vite qu’elle ne pourrait plus vivre sans lui. Ils se sont mariés à Noël, ce qui n’a pas plu à tout le monde.
–Ah bon ? Mais à qui donc ce mariage a-t-il déplu ? Ma mère avait-elle un prétendant ?
Isabella se tut, persuadée que Naïs n’était pas prête à connaître ce secret.
27 Confiserie à base d’amandes pilées, de blanc d’œuf et de sucre.
28 Janvier 1680
29 Fêtes célébrées dans l’antiquité en l’honneur de Bacchus et Dionysos.
30 Fêtes célébrées dans l’antiquité romaine durant la semaine du solstice d’hiver.
31 Courtepointe.
32 Se sauver
6
–Je me demande si nous sommes encore loin de la bastide. Isabella tapa au plafond de l’habitacle pour attirer l’attention du cocher qui tira sur les rênes et immobilisa le véhicule. Son visage s’encadra derrière la vitre de la portière ; il avait perdu son aspect rubicond et affichait un teint blême et las. Il plissa les yeux pour ajuster sa vision.
–Où sommes-nous, cocher ?
–Serons-nous bientôt arrivés ? Cela fait très longtemps que nous roulons.
–Peut-être.
–Comment peut-être ! Sommes-nous perdus ?
–Peut-êtrebien.
–Billevesée ! Même si vous aviez oublié le chemin, vos chevaux, qui le font plusieurs fois par semaine, nous auraient ramenés à bonport.
–La neige a tout recouvert, on n’y voit goutte. J’ai suivi la route tant que j’ai pu, mais depuis un moment je sais plus où on va. Les chevaux sont rompus, ils iront pasloin.
Naïs se pencha par la portière, espérant trouver quelque repère qui leur aurait permis de retrouver leur route. Seules de rares silhouettes d’arbres dénudés émergeaient de l’étendue poudreuse. Pas le moindre indice pour les aider.
–Il ne faut pas nous arrêter, trancha Isabella. Nous allons être surpris par la nuit. Fouettez vos chevaux, cocher, jusqu’au sang s’il le faut. S’il n’avait pas forcé sur l’eau-de-vie, nous n’en serions pas là ! ajouta-t-elle à l’attention deNaïs.
Le cocher remonta sur son siège et fit claquer son fouet au-dessus de la tête des chevaux pour les remettre en route. La voiture s’ébranla avec difficulté. Naïs scrutait à présent l’immensité glacée à la recherche d’une bâtisse où ils pourraient trouver refuge.
–Vois-tu quelque chose ?
Elle n’eut pas le temps de répondre ; elle se retrouva projetée sur Isabella et heurta le plafond avec une telle violence qu’elle faillit perdre connaissance. Aimée, surprise dans son sommeil, avait roulé au sol, tandis qu’Isabella gémissait dans l’ombre. Naïs fut incapable de se redresser à cause de l’inclinaison du plancher.
–Mon Diou ! Nous avons versé dans le fossé ! hurla Aimée.
–Calme-toi, Aimée, nous sommes toujours sur la route. Nous avons dû perdre une roue. Le cocher va nous sortir delà.
Naïs se cala comme elle le put et appela. N’obtenant aucune réponse, elle donna de violents coups de pied dans la portière qui finit par céder et parvint à se hisser à l’extérieur, malgré la gîte de la berline dont une des roues était en équilibre au-dessus du fossé. Elle se laissa glisser à terre, s’enfonçant dans la neige jusqu’aux chevilles et aida Aimée à descendre à son tour. Un des chevaux, entraîné par le poids de la voiture, avait les pattes avant, coincées dans le ravin ; il donnait des ruades tandis que l’autre bête tirait dans le sens opposé pour se libérer du harnais qui les maintenait solidaires. Ils hennissaient de terreur en roulant des yeux affolés.
–Aimée, aide-moi, nous allons guider la pauvre bête. Il suffit de la sortir du ravin. Fais attention, ils sont paniqués. Ne les laisse pas partir.
Après plusieurs tentatives, elles parvinrent à les calmer et à remettre l’attelage en ordre de marche.
–Tiens-les bien Aimée, je vais chercher le cocher.
Naïs balaya la campagne du regard et aperçut une masse sombre au-delà du fossé. Comprenant que le cocher avait été projeté de son siège, elle se précipita pour lui porter secours et se retrouva prisonnière d’une gangue glacée qui l’enveloppa jusqu’à la taille.
–Naïs, ! Naïs ! sanglotait Aimée à la vue de sa maîtresse à demi ensevelie.
Naïs ne pouvait plus bouger ; le froid rampait dans ses veines et lui coupait le souffle. Elle sentit la mort la frôler. Les mots de la bohémienne tournaient dans sa tête, occultant toute pensée cohérente : douleur et confusion, douleur et confusion.
–Attrapez, Mademoiselle ! Attrapez et tenezbon !
Le cocher, qui avait quelque peu repris ses esprits, lui tendit une branche à laquelle elle s’agrippa. Malgré sa blessure à la tête, il la tira vers lui, la saisit sous les aisselles et la ramena sur la route. Naïs grelottait, ne pouvant détacher son regard des petits trous rouges que faisait le sang de l’homme en gouttant sur la neige.
Elle comprit qu’elle risquait une fluxion si elle ne changeait pas de vêtements au plus vite et lui ordonna d’ouvrir la malle qui contenait l’habit dont il était allé prendre livraison àAix.
–Le maître va me faire donner du bâton, à coup sûr, dit-il en serrant contre lui le paquet qu’il venait d’extraire de la malle de cuir glissée sous un siège.
–Vous préférez mourir de froid et de faim sans doute, se rebiffa Naïs en claquant des dents.
L’argument eut raison de ses scrupules. Il hésita encore quelques secondes, puis prenant conscience de l’urgence de la situation, s’exécuta. Il lui tendit à contrecœur le paquet qui contenait l’habit du notaire pour le bal de l’intendant. Aimée poussa un petit cri d’admiration à la vue du gilet cuisse-de-nymphe33 en soie brodée et du justaucorps gorge-de-pigeon34.
Naïs troqua ses vêtements trempés pour ceux de maître Lavigne qui, à défaut de la réchauffer, la tiendraient au sec. Le notaire était de constitution malingre avec des jambes maigres et arquées ; sa tournure lui avait d’ailleurs valu son surnom de Le rat, pourtant ses vêtements étaient encore trop grands pour la fluette Naïs. Quant aux chaussures vernies… Elle les bourra de papier, emprunta le balandran35 que le cocher gardait sous son siège et annonça à ses compagnes qu’elle partait chercher des secours. Isabella essaya faiblement de l’en dissuader, mais sa tête lui faisait si mal qu’elle ne trouva pas l’énergie nécessaire pour argumenter. Ignorant ses mises en garde, Naïs se mit en route, déclinant l’offre du cocher qui voulait l’accompagner ; il avait déjà perdu trop de sang et devait veiller sur Aimée et Isabella qui n’était pas bien vaillante.
À peine avait-elle parcouru quelques dizaines de cannes que Naïs regretta son initiative : elle s’enfonçait dans la neige jusqu’à mi-mollet et perdait ses chausses. Elle voulut rebrousser chemin, mais la berline avait disparu derrière un écran de neige. La gorge serrée, elle repartit dans la direction d’où elle croyait venir, courbée en deux, tête rentrée dans les épaules, pour lutter contre les bourrasques qui soulevaient des nuages de neige. Un aboiement lui redonna espoir.
Elle sentit l’homme avant de le voir ; il exhalait une odeur de sueur et de sang. Vêtu d’une capote qui descendait jusqu’aux talons, il avançait d’un pas lourd, laissant un sillage rouge derrièrelui.
–Où allez-vous ? C’est pas un temps pour la promenade. Il parlait d’une voix forte ; le ton était bourru et la menace sous-jacente.
–Nous sommes perdus ; un de nos chevaux a glissé dans le ravin, une roue de notre berline est endommagée. Elle dut lever les yeux pour apercevoir son visage dissimulé sous un bonnet fourré de peau de lièvre et noué sous le menton. La dureté du regard la frappa ; ces yeux, dont elle ne pouvait pas distinguer la couleur sous la broussaille des sourcils, la jaugeaient, la fouillaient, la mettaient ànu.
–Mais c’est une femelle ! s’exclama l’homme en partant d’un rire tonitruant qui découvrit ses chicots noircis par le tabac. Une femelle habillée en jouvenceau pour aller au bal ! L’incongruité de la situation lui fit lâcher les deux lièvres qu’il venait de braconner. Son chien se précipita pour lécher leurs museaux sanguinolents déchiquetés par les pièges. Naïs ne pouvait détacher son regard de leurs gros yeux vitreux.
–Fous le camp, sale bête, sinon… Il accompagna sa menace d’un coup de pied qui envoya le chien à une toise de distance.
À la fois terrorisée par cette brute et furieuse de son comportement, Naïs rassembla son courage pour trouver le ton adéquat.
–Je suis la fille du sieur Clary de la bastide des indiennes. Si vous nous aidez, mon père vous donnera une bonne récompense, mon brave.