
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Un jeune homme écrivain découvre que ses écrits prennent vie...
Au départ, Bill a tout contre lui. Il est jeune, il vient de rater son bac, il n’a pas d’argent, il a été élevé dans une cité au milieu des bandes et des trafics, son père est parti depuis longtemps… et Bill s’appelle en réalité Jean-Pierre Duchemin.
Malgré ce contexte, il aime la littérature au point de se lancer dans l’écriture d’un roman. Son éducateur, sa mère, les autres jeunes du quartier, personne ne l’en croit capable sauf une prof de français et un vieux manutentionnaire. Une histoire peu ordinaire, qui vire à l’exceptionnel lorsque Bill se rend compte que les événements qu’il consigne entre les pages se déroulent autour de lui. Avec un tel pouvoir entre les mains, le jeune homme devra affronter les affres endurées par les apprentis écrivains, mais également celles qui jalonnent la vie d’adolescent.
Plongez-vous dans un récit tendre où réalité et fiction se mélangent. Le jeune homme arrivera-t-il au bout de son histoire ?
EXTRAIT
Manu nous a réunis pour nous prévenir. Il nous a détaillé son point de vue : nous sommes de misérables décrocheurs scolaires, des fainéants de première classe, des fripouilles en puissance, en conséquence de quoi, il nous cassera la figure au premier écart de conduite. Pour le cas où nous aurions cru à un sketch comique, il a ajouté qu’il ne plaisantait pas.
Après ce premier échange de vues viril, il nous a fait parler de nous. J’ai dit que j’habitais chez ma mère qui n’est jamais là ou alors qui dort car elle travaille de nuit à nettoyer les bus qui circulent en ville. Quant à mon père, il s’est barré, le jour où j’ai entendu maman crier : « bon débarras. » J’ai tenu à préciser à Manu que je contestais l’appellation de décrocheur, puisqu’au lycée, je me suis accroché jusqu’en terminale. Certes, je n’ai pas eu le bac, ayant été particulièrement handicapé par une épreuve de maths dont il ne pouvait même pas imaginer la difficulté, mais quand même, je n’ai « décroché » qu’à l’extrême limite de mes forces...
J’ai aussi essayé d’expliquer à Manu que j’aime les mots. Il m’a regardé avec l’air de se demander si je ne me fichais pas de lui. J’ai craint un instant qu’il ne s’énerve. Quand je lui ai dit que j’avais lu Alexandre Dumas, Guy de Maupassant, Flaubert, Balzac… Il s’est replongé dans mon dossier pour s’assurer qu’il n’y avait pas erreur sur ma personne. Normalement un délinquant ne fait pas ça.
–Comment as-tu fait pour manquer ton bac ?
Je lui ai répondu que les sujets de philo ne m’ont pas beaucoup plu, vu que je n’aime pas Rousseau. Pour revenir à la géométrie, les mots me semblaient agréables à prononcer : cosinus, arc, tangente, homothétie, parabole…
À PROPOS DE L'AUTEUR
Philippe Laperrouse a 69 ans et vit dans la banlieue lyonnaise, sa région de naissance. Après des études scientifiques et économiques, il rejoint la fonction publique, dont il est aujourd'hui retraité.
Il a publié six romans, deux essais et deux recueils de nouvelles. Il a également écrit quelques pièces de théâtre. Il gère un site d’auteur : www.monpied.net, sur lequel on retrouvera toutes ses productions.
Outre la littérature, il s’intéresse et pratique à temps perdu la BD, le foot et le jardinage.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Philippe Laperrouse
Le journal de Bill
Roman
Du même auteur :
Histoire d’histoires, 2014, Édilivre (Recueil de nouvelles historiques)
À deux mains, 2015, La compagnie littéraire (Roman policier)
À la poursuite de Roger, 2016, Mon petit éditeur (Roman)
Les phrases hypocrites, 2016, 7écrit (Essai)
Pensées épistolaires, 2017, Publishroom, (Essai)
Les choses ne sont pas ce qu’elles sont, 2017, Édilivre (Roman)
Balivernes et pitreries, 2017, Publishroom (Album de dessins humoristiques)
Vices et vilénies d’aujourd’hui, 2018, Édilivre (Recueil de nouvelles)
Les 1001 morts de Norbert Dupont, 2018, Publishroom (Roman)
L’endroit, 2018, Éditions Caroline Durand (Roman d’anticipation, à venir)
1er septembre 2015.
Les résultats sont tombés. Je n’aurai jamais mon bac.
Une nouvelle vie s’ouvre, celle d’un type qui ne sera jamais bachelier. Peu importe, je sens que je vais faire quelque chose de cette existence. Quelque chose de digne.
En attendant la gloire, je dois parer au plus pressé. Dans mon quartier, les mecs me dévisagent d’un air sceptique : je suis tout de même celui qui a été au lycée jusqu’en terminale, même si j’ai raté la dernière marche. Si je ne veux pas être complètement mis à l’écart, il faut que je fasse semblant de me ficher de mon échec. Donc je proclame qu’il m’indiffère royalement.
Ce n’est pas tout à fait le cas de Paulette, ma mère, qui m’enjoint de faire quelque chose « de mes dix doigts. » Si possible quelque chose de légal et de rémunéré.
J’habite un quartier que les technocrates et les journalistes qualifient de « difficile. » Je ne sais pas ce que ça signifie. Un quartier ne peut pas être facile ou difficile. Un quartier, c’est un quartier. C’est tout.
Trois barres d’immeubles de douze étages, avec – dans chacun d’entre eux – un ascenseur dûment tagué et en panne une semaine sur deux. Rien que du classique ! Aussi haut que porte mon regard, j’observe des colonnades de balcons, décorés d’étendages, d’antennes paraboliques ou de parasols aux couleurs défraîchies. Les gens se mettent rarement aux fenêtres ou alors ce sont des chômeurs endurcis qui y passent des après-midi entiers. Je pense que c’est pour fumer parce que la vue n’est pas terrible.
Pour espace « vert », nous avons le terrain de foot aux dimensions d’une aire de hand-ball où s’exprime, sur quelques touffes d’herbe, une horde hurlante d’apprentis du ballon rond. Trois bancs publics, plus ou moins vandalisés, permettent aux anciens de bénéficier de quelques rayons de soleil en plein été, tamisés par un vieux chêne au feuillage maladif.
Plus loin, l’arrêt de bus nous relie au reste du monde. Du moins, lorsque les chauffeurs n’ont pas été insultés la veille par la bande des Rosiers.
Trafics divers et petites violences assurent l’animation du quartier. Les mères se sont groupées pour que ces activités se passent gentiment sans dériver vers l’extrême banditisme. Nous sommes presque civilisés. Au lycée, nous n’avons jamais dépassé le stade de l’incendie de voiture. Seul le gang des Rosiers nous donne parfois un peu de souci, mais globalement, nous vivons plutôt tranquillement. Il faut savoir s’intégrer, c’est tout.
Il y a la supérette de Rachid qui pourvoit au nécessaire. Et même un peu plus. Rachid, c’est un facteur de stabilité. Il parle avec les parents de l’activité des jeunes, qu’elle soit ou non légale. Il apprend à lire aux gamins qui oublient d’aller à l’école. Il cache des paquets bizarres que lui confient certains ados. Il est très aimable avec les uniformes qui viennent parfois se renseigner. Rachid informe, il ne « balance » pas. Il tient à la nuance.
Les bas d’immeuble sont les lieux privilégiés de nos rencontres. C’est là que nous nous exprimons, enfin… Après avoir ôté nos écouteurs. Nos conversations sont sans intérêt, mais personne n’a envie d’être intéressant. Pour parler avec des assistantes sociales, il y a bien un local associatif, mais on ne peut pas dire autant de conneries que dans la rue. Il paraît que dans les beaux quartiers de la ville, l’activité principale d’un adolescent est de refaire le monde. Nous, nous ne rebâtissons rien. La glandouille est le cœur de notre univers. Seul le vol d’un téléphone ou d’une paire de baskets neuves éveille légèrement notre attention.
Notre « parler », à nous les loubards, va au plus simple. Afin de ne pas nous perdre dans des discours interminables, nous avons réduit l’étendue de notre vocabulaire et érigé en règle absolue l’utilisation d’onomatopées chaque fois que c’est possible.
Je dis ça parce que moi, je m’intéresse aux mots, mais c’est une anomalie dont j’évite de me vanter devant les autres. Si je suis pris à faire des phrases, je serai traité au mieux de « bouffon », au pire « d’intello de mes deux. » Avec un peu de chance, je ne serai pas passé à tabac. Je ne suis pas malheureux pour autant. Il faut connaître les règles, c’est tout.
Il arrive qu’un ancien débarque dans le quartier pour se souvenir du bon vieux temps. S’il sort de prison, il est immédiatement entouré des jeunes et de leur respect. S’il a réussi dans les « affaires », les mecs se ruent sur sa BMW, toujours avec respect.
Des étudiants de la ville viennent nous parler de temps à autre. Ils disent qu’ils font une « enquête. » Ils ont l’air étonnés de nos modes de vie, et ils s’empressent de le retranscrire fébrilement pour leurs « rapports. » Quand un ministre est dans le département, le maire nous l’apporte pour qu’il nous voie et qu’on le voit. Alors, on se regarde, et après, le ministre repart avec sa belle voiture et ses motards.
12 octobre 2015.
Lorsque Paulette est venue me chercher au poste de police, le commissaire lui a bien spécifié que j’ai 17 ans et qu’elle est encore responsable de mes conneries. J’ai précisé que j’ai 17 ans et demi, mais ça n’a pas eu l’air d’impressionner le fonctionnaire.
Lorsque nous avons regagné l’appartement, ma mère a d’abord gardé le silence. Paulette n’est pas une agressive, c’est plutôt quelqu’un de pacifique. Elle lève rarement la voix. Quand elle a des choses désagréables à me dire, elle préfère braquer ses yeux bleu clair sur moi et user d’un ton froid et tranchant.
Cette fois, j’ai passé les bornes en attaquant le vieux avec Momo. La voix de Paulette était donc très froide et très tranchante :
–Tu es fier de toi ? Tu crois que je vais supporter ça longtemps ? Tu crois que je me tue au travail pour nourrir un imbécile ?
La suite n’a pas été plus plaisante. De l’entretien, j’ai retenu que je m’étais conduit comme un connard d’une part et que j’étais invité à gagner ma vie au lieu de « rester vautré sur le divan. » J’ai l’impression que Paulette n’était pas très contente. Je vais lui obéir : dans le quartier, les mères sont respectées.
26 octobre 2015.
Il paraît que nous avons eu droit à une procédure ultrarapide. Je ne me plaindrai donc plus des lenteurs administratives.
Quand le juge a dit trois mois avec sursis, Momo et moi, on s’est regardé par en dessous et on a étouffé un grand soupir de soulagement. Nous avions craint d’être victimes d’une nouvelle erreur judiciaire. Une injustice de la Justice en quelque sorte. Après tout, nous n’avions rien fait à monsieur Radisson, c’est même lui qui s’est rendu coupable de ce que notre avocat a appelé des voies de fait.
Rétablissons la vérité. Nous avions repéré le dénommé Radisson au marché. Comme il n’envoyait pas sa femme à la corvée des commissions comme tout le monde, nous en avions déduit qu’il était célibataire ou veuf ou divorcé, enfin seul quoi ! Son dos était voûté, sa démarche lente, sa peau flétrie. Il ne devait donc pas y avoir de problème. Quand on est « bad boy », agresser une telle personne aurait dû être une formalité.
Nous avons sonné chez lui sous un prétexte que Momo avait entendu à la télé. Il suffisait de dire que nous venions prendre de ses nouvelles de la part de la mairie. Nous avions de la chance, grâce au dérèglement climatique, il faisait chaud comme au mois d’août. Nous devions nous assurer que monsieur Radisson ne souffrait pas de la température et qu’il buvait de l’eau régulièrement. Au début, tout s’est bien passé, il nous a priés d’entrer dans son vestibule en nous affirmant qu’il savait prendre soin de lui et s’abreuver quand il le fallait, surtout s’il avait soif. C’est à ce moment que Momo a sorti les mots dont nous avions convenu en même temps que son cran d’arrêt.
À propos de la phrase, nous avions beaucoup hésité entre : « ton fric, vieille peau ! » ou « de l’argent, on veut de l’argent ! » Nous avions repoussé la première formulation, car j’avais fait remarquer à Momo qu’il n’était pas très correct d’insulter monsieur Radisson, alors que nous envisagions de le dépouiller. Il m’a demandé si le moment était bien choisi pour se répandre en politesses, mais il a quand même accepté la seconde solution.
–De l’argent, on veut de l’argent !
C’était tout de même plus clair et plus convenable. Momo a mis le ton et le maximum de conviction. Même moi, j’ai eu peur.
Ce que nous n’avions pas prévu, ce sont les deux paires de baffes qui ont jailli des mains de monsieur Radisson. Momo a valsé par terre, son couteau aussi. Le vieux avait dû suivre des cours de self-défense sans nous prévenir. Il nous a bourrés de coups de pied en nous parlant très mal. Le temps que nous réagissions, monsieur Bartolon est sorti du salon. Nous avons appris plus tard que c’était son copain de palier avec qui il était en train de boire un coup. Quand les vieux solitaires prennent l’apéro ensemble, ça complique tout.
–Bouge pas, Louis ! J’appelle les flics !
La suite : panier à salade, interrogatoire, garde à vue, cellule, comparution devant le juge… Tout cela ne s’est pas déroulé dans une ambiance très agréable, mais selon les autorités, ces désagréments devaient nous permettre de réfléchir à notre conduite qui laissait à désirer.
31 octobre 2015.
Trois mois avec sursis… L’avocat, très content de lui, n’en revenait pas d’être aussi habile. Il nous a dit que nous nous en tirions bien et qu’il serait intelligent de nous tenir à carreau. Pour nous aider dans cette entreprise, le juge nous a encadrés d’un nouvel éducateur : Manu.
J’ai annoncé au magistrat que j’aimais mieux l’ancien, Anselme. Je me suis dispensé d’ajouter qu’Anselme nous récitait son catéchisme, puis qu’on allait boire un coup et qu’il nous fichait une paix royale jusqu’à la fois suivante. Mais voilà, il paraît qu’Anselme est parti à la retraite. Je note mentalement, au passage, que les éducateurs ont le droit d’arrêter de bosser, alors que nous, les mecs de la rue, tout est fait pour ne nous laisser aucun repos.
L’ennui avec Manu que nous connaissions puisqu’il opérait déjà dans notre quartier, c’était qu’il était petit, râblé, muni de bras monstrueux, capables de filer une rouste mémorable à n’importe lequel d’entre nous. Il allait donc falloir lui rendre des comptes. Momo m’a dit de ne pas m’inquiéter, il se chargeait de paraître « convenable » avec Manu, tout en continuant de nous activer selon nos envies. Pour Momo, l’éducateur n’a pas à se mêler de nos affaires. Il doit se limiter à son domaine : la théorie de la bonne éducation. Un truc qui ne peut pas nous concerner.
4 novembre 2015.
Manu nous a réunis pour nous prévenir. Il nous a détaillé son point de vue : nous sommes de misérables décrocheurs scolaires, des fainéants de première classe, des fripouilles en puissance, en conséquence de quoi, il nous cassera la figure au premier écart de conduite. Pour le cas où nous aurions cru à un sketch comique, il a ajouté qu’il ne plaisantait pas.
Après ce premier échange de vues viril, il nous a fait parler de nous. J’ai dit que j’habitais chez ma mère qui n’est jamais là ou alors qui dort car elle travaille de nuit à nettoyer les bus qui circulent en ville. Quant à mon père, il s’est barré, le jour où j’ai entendu maman crier : « bon débarras. » J’ai tenu à préciser à Manu que je contestais l’appellation de décrocheur, puisqu’au lycée, je me suis accroché jusqu’en terminale. Certes, je n’ai pas eu le bac, ayant été particulièrement handicapé par une épreuve de maths dont il ne pouvait même pas imaginer la difficulté, mais quand même, je n’ai « décroché » qu’à l’extrême limite de mes forces...
J’ai aussi essayé d’expliquer à Manu que j’aime les mots. Il m’a regardé avec l’air de se demander si je ne me fichais pas de lui. J’ai craint un instant qu’il ne s’énerve. Quand je lui ai dit que j’avais lu Alexandre Dumas, Guy de Maupassant, Flaubert, Balzac… Il s’est replongé dans mon dossier pour s’assurer qu’il n’y avait pas erreur sur ma personne. Normalement un délinquant ne fait pas ça.
–Comment as-tu fait pour manquer ton bac ?
Je lui ai répondu que les sujets de philo ne m’ont pas beaucoup plu, vu que je n’aime pas Rousseau. Pour revenir à la géométrie, les mots me semblaient agréables à prononcer : cosinus, arc, tangente, homothétie, parabole… Mais le contenu ne me passionnait pas tellement. J’ai même trouvé tout à fait poétique que le prof de maths essaie de nous intéresser à des choses qui tendent vers l’infini. J’aurais voulu partir moi-même en voyage pour l’infini. J’ai adoré le fait qu’il puisse exister deux infinis : « plus l’infini » et « moins l’infini. »
Manu n’a pas eu l’air de partager mon goût pour ces concepts. Il a dit : « oui, bon, d’accord, mais tiens-toi à carreau, tout de même ! »
Puis, l’entretien est venu sur le sujet le plus désagréable qui soit. Selon Manu, nos parents (qui se résument à une seule mère) ne nous nourriraient pas jusqu’à la fin de nos jours. Il nous fallait donc trouver un boulot. Comme Paulette, il a ajouté : payé et légal. Manu a insisté sur « légal. » Au cas où ne nous n’aurions pas saisi la portée du mot, il nous a précisé qu’il se ferait un plaisir de nous aplatir comme des crêpes s’il nous surprenait à trafiquer.
Puis la conversation a évolué. Nous avons enfin quitté le registre des menaces de violences.
Il nous a demandé ce que nous aimerions faire comme boulot. Je sentais bien que la question était de pure forme. Momo a répondu qu’il veut être pilote de ligne. À cette nouvelle, Manu a soulevé un sourcil perplexe. Momo n’a pas osé ajouter, ce qu’il m’avait révélé auparavant, c’est-à-dire que s’il ambitionne cette carrière, c’est essentiellement pour « se taper » des hôtesses de l’air. Quant à moi, j’ai annoncé que mon choix n’était pas fait, mais que j’étais ouvert à toutes les suggestions raisonnables.
Sur ce, Manu nous a indiqué qu’il cessait de rire et qu’on allait passer aux choses sérieuses. Il nous a donné un mois pour lui apporter la preuve que nous nous décarcassions pour trouver un emploi.
–C’est compris ?
Momo a dit que oui, il avait saisi. En sortant, il a ajouté de ne pas m’en faire, car il avait des idées. Comme je l’aime bien, je ne lui ai pas fait remarquer que sa dernière initiative nous avait conduits aux portes de l’emprisonnement.
C’est à ce moment que j’ai décidé de mettre un frein à ma carrière de gangster.
17 novembre 2015.
Je me suis rendu compte assez vite que la vie est une succession d’injustices. Je ne parle pas de la fuite de mon père. Je ne me souviens même plus de son visage. Dans mon quartier, n’avoir qu’un parent à la maison (ou parfois zéro) n’a rien d’anormal. J’ai plutôt de la compassion pour ceux qui subissent à la fois un paternel, souvent un alcoolique cogneur, et une mère, dépassée par les évènements. Ceux qui sont dotés de deux « vieux » et qui ont gardé un peu d’humour me disent que je suis un privilégié.
Non, la première injustice qui m’a profondément affecté, c’est de m’appeler Jean-Pierre Duchemin. Dans mon immeuble, j’ai dénombré une majorité de patronymes à consonance nord-africaine. Ce n’est pas ça qui me dérange. La réalité, c’est que j’ai compris à la lecture du Comte de Monte-Cristo qu’avec un nom comme le mien, je ne peux envisager aucune carrière de héros alors que j’ai toutes les autres qualités requises. Comment rivaliser avec un type nommé Edmond Dantès quand on est Jean-Pierre Duchemin ? Imagine-t-on ce qui serait advenu des Trois Mousquetaires
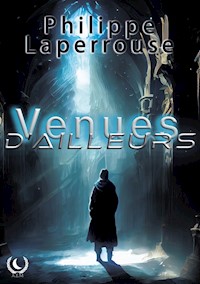
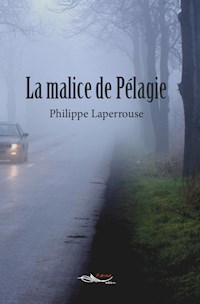

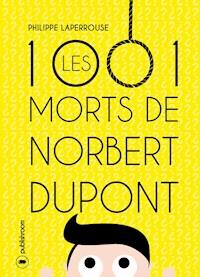

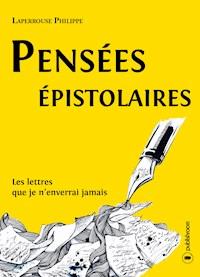













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









