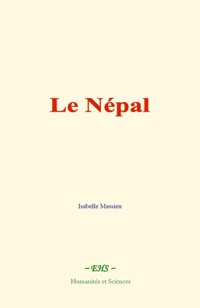Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Heureux qui comme…
- Sprache: Französisch
Sur les pas d'Isabelle Massieu en Indochine
Première Européenne venue seule en Indochine en 1897, Isabelle Massieu (1844-1932) s’est prise de passion pour les voyages aux alentours de la cinquantaine et parcourt l’Asie en tous sens. En pirogue ou à cheval, l’infatigable aventurière chemine à travers la jungle, de Luang Prabang à Vientiane, et se laisse séduire par les légendes et les mœurs laotiennes, dont elle admire l’authentique liberté.
Récit publié dans la Revue des deux mondes en 1900 sous le titre Le haut-Laos et le Mékong.
Une expédition surprenante et entraînante au gré des légendes locales
EXTRAIT
C’est à Xieng Sen que j’ai définitivement quitté les territoires britanniques pour entrer dans nos possessions françaises de l’Indochine en descendant le Mékong jusqu’à Luang Prabang. Un pittoresque sentier me permettra ensuite d’éviter le grand coude que fait le fleuve à Pak1-Lay et d’arriver en dix jours à Vientiane, ce qui constitue le « record » de la vitesse. Puis, tour à tour, une succession de bateaux me mènera jusqu’à Savannakhet, nouvelle création française, en face de Ban-Mouk, au-dessus des grands rapides de Kemmarat ; de là, par une large tranchée en forêts clairières, vers la chaîne annamitique, franchie par la brèche d’Aï-Lao, j’arrive au grand pénitencier d’Annam ; enfin Maï-Lane et la rivière de Quang-Tri : tel est l’itinéraire dont les principales étapes m’ont conduite à Hué, la capitale d’Annam.
A PROPOS DE LA COLLECTION
Heureux qui comme… est une collection phare pour les Editions Magellan, avec 10 000 exemplaires vendus chaque année.
Publiée en partenariat avec le magazine Géo depuis 2004, elle compte aujourd’hui 92 titres disponibles, et pour bon nombre d’entre eux une deuxième, troisième ou quatrième édition.
A PROPOS DE L’AUTEUR
On sait peu de choses sur Isabelle Massieu. Elle est née en 1844 en France. C'est une exploratrice, photographe et écrivain. Aux alentours de la cinquantaine, elle se prend de passion pour les voyages et parcourt l'Asie en tous sens. On ignore si elle remplissait des missions secrètes pendant ses voyages ou si elle voyageait de façon désintéressée. Elle décède en 1932.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 113
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LE « PAYS DE LA LIBERTÉ »
Présenté par Émilie Cappella
D’Isabelle Massieu (1844-1932), on ne sait presque rien à ce jour car aucune recherche approfondie n’a été entreprise sur cette femme pourtant illustre à son époque. Quelle vie menait-elle en France avant que la passion de l’Asie ne s’empare d’elle ? Commença-t-elle à voyager à la mort de son mari ? Était-elle professeure ? Réalisait-elle un rêve ancien en abandonnant derrière elle cinquante ans de vie sédentaire pour se lancer dans une nouvelle vie aventureuse ?
C’est en 1892 qu’elle quitte la France pour le Liban. Il s’agit d’un voyage touristique, et le pays lui paraît trop policé et francisé. Quelques années plus tard, elle jette son dévolu sur l’Asie qu’elle va parcourir en tous sens pendant dix ans. Nul ne sait si elle remplissait des missions pendant ses voyages, car elle n’y fait jamais allusion dans ses écrits. Il semble qu’elle voyageait de façon désintéressée, comme en témoigne le récit de sa traversée du Laos où elle déclare avec modestie avoir voulu « simplement noter les impressions sincères et personnelles que j’ai ressenties. » Cependant, pour peu que les missions aient été secrètes, il y a peu de chance qu’on en trouve mention dans des récits destinés aux magazines de l’époque.
Isabelle Massieu arrive au Laos à la fin du mois de décembre 1896. Elle vient de parcourir le Cambodge, la Thaïlande (avec le gouverneur Rousseau en visite officielle à la cour du roi Norodom), la Birmanie, et se prépare maintenant à rejoindre Hué, au Vietnam. La traversée du Laos dure un peu plus de trois mois puisqu’elle arrive à Hué le 21 mars 1897. De touristique, son voyage est devenu une véritable exploration : à partir de Xieng Sen, sur le Mékong, elle franchit les rapides en pirogue jusqu’à Luang Prabang, au cœur de la forêt. Puis, pour gagner Vientiane, Massieu traverse la jungle, malgré les tigres, et rencontre les Khas. À Vientiane, elle prend un vapeur à destination de Savannakhet, avant de reprendre la route de terre pour traverser le Laos dans sa plus grande largeur.
Si le texte s’arrête là, le voyage, lui, se poursuit par le Tonkin. Massieu visite la baie d’Along, Hanoi, et arrive en avril dans les Territoires militaires du nord, où elle est la première Européenne. Elle visite encore, mais sans laisser de relation de son voyage, Shanghai, le Japon, Pékin, avant de rentrer en France par la Mongolie, la Sibérie, le Turkestan et le Caucase.
En France, l’exploratrice a acquis une grande réputation. Elle écrit de nombreux articles sur les explorateurs français en Asie et publie ses récits de voyage : Comment j’ai parcouru l’Indo-Chine, aux éditions Plon, en 1901 ; et Népal et pays himalayens, chez Alcan, en 1914. Elle réalise également une anthologie personnelle de la production photographique commerciale au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Cette série unique de cinq albums couvre une période d’une trentaine d’années. On y trouve des travaux de photographes prestigieux ainsi que quelques photographies d’amateurs français en Indochine.
Le récit de sa traversée du Laos la présente d’emblée comme une voyageuse solitaire, du moins entourée seulement de quelques serviteurs du pays, qui portent ses bagages et lui frayent un chemin dans la jungle. Partout sa réputation exceptionnelle la précède, et, lorsqu’elle va à la rencontre des Khas, elle est accueillie avec les honneurs. À Luang Prabang, qu’elle appelle « la ville des fêtes », les Laotiens « ne se présentent jamais sans offrir un bouquet dans un cornet de feuille de bananier avec deux petites bougies en cire ; c’est, pour ainsi dire, la carte de visite du pays. »
Son récit offre une idée plaisante du voyage et de l’aventure : des peuples hospitaliers, doux et souriants, des fêtes populaires fastueuses, des obstacles qu’on surmonte sans souffrance, nulle maladie, la pauvreté occultée… L’image du Laos est celle d’un pays idéal offert avec grâce à la curiosité de la voyageuse. N’y a-t-il pas de la naïveté dans cette vision idyllique ? « Ces jolies filles de Luang Prabang vivent sans mérite et sans défaut, doux et charmants animaux, faciles et joyeux comme ce peuple indolent et bien portant, qui n’a de réelle énergie que pour rire, chanter et s’amuser. Un peuple de vrais païens, dont la jouissance et le plaisir sont les dieux ! »
Isabelle Massieu porte néanmoins un regard critique sur les Français, impuissants à exercer leur devoir de protection des populations. Le système colonial français lui paraît peu intelligent, comparé à celui des Anglais qui ont su notamment mettre au point des conditions sanitaires supérieures. Et, faisant l’inventaire des ressources du Laos, elle s’étonne que les mines d’or restent inexploitées : « Une exploitation technique s’impose, pour laquelle un capital sérieux serait nécessaire, si l’on veut ne pas arriver à un échec, et qui mettrait sans doute en lumière des richesses depuis trop longtemps inutiles. » Si elle ne remet pas en question le principe même du colonialisme, elle préconise toutefois des réformes modernes qui permettraient au peuple khas, considéré comme primitif, d’obtenir l’égalité devant la justice.
Observant avec acuité les mœurs, usages et légendes du pays, elle fait sienne la tradition littéraire française, qui, depuis Montaigne, contemple sa propre barbarie dans le regard « naïf » de l’étranger. Elle prend ainsi conscience de la violence des Occidentaux en observant les mœurs pacifiques des Laotiens. De même, alors qu’elle traverse la forêt où ses coolies taillent un sentier à la machette, elle discerne une forme de sagesse : « Quand on n’a plus besoin que de ce qui est vraiment nécessaire, c’est incroyable comme il faut peu de chose, et comme on comprend et on envie la supériorité de celui qui exige encore moins ! »
Il s’agit pour elle d’accéder à un mode de vie indépendant. Peu encline à la spiritualité, ironique envers les superstitions indigènes, elle a le bon sens de l’envisager du point de vue matériel. Comme la vie laotienne, qui a su s’appuyer sur l’utilisation presque exclusive du bambou – dont Massieu fait l’éloge –, une telle vie s’appuie d’abord sur le choix des ressources. L’usage, par exemple, d’objets rudimentaires, simples et ingénieux : « Tout le monde sait créer cet outillage usuel, et on n’est pas arrêté, comme chez nous, par la plus petite avarie qui survient à nos ustensiles perfectionnés, qu’un spécialiste seul est capable de remettre en état. »
Si le sens de son voyage demeure un mystère, ces quelques considérations nous paraissent cependant témoigner d’une quête très moderne de liberté. Moderne parce qu’elle est une femme du XIXe siècle, et parce qu’elle découvre, bien avant les autres Occidentaux, que « le Laos est le pays de la liberté. »
Récit publié dans La Revue des deux mondes en 1900 sous le titre « Le Haut Laos et le Mékong ».
HAUT LAOS ET MÉKONG
I. – DE XIENG SEN À LUANG PRABANG
C’est à Xieng Sen que j’ai définitivement quitté les territoires britanniques pour entrer dans nos possessions françaises de l’Indochine en descendant le Mékong jusqu’à Luang Prabang. Un pittoresque sentier me permettra ensuite d’éviter le grand coude que fait le fleuve à Pak1-Lay et d’arriver en dix jours à Vientiane, ce qui constitue le « record » de la vitesse. Puis, tour à tour, une succession de bateaux me mènera jusqu’à Savannakhet, nouvelle création française, en face de Ban-Mouk, au-dessus des grands rapides de Kemmarat ; de là, par une large tranchée en forêts clairières, vers la chaîne annamitique, franchie par la brèche d’Aï-Lao, j’arrive au grand pénitencier d’Annam ; enfin Maï-Lane et la rivière de Quang-Tri : tel est l’itinéraire dont les principales étapes m’ont conduite à Hué, la capitale d’Annam.
J’arrivai donc à Xieng Sen, en pays français, au commencement de février 1897, et l’on comprendra aisément la grande satisfaction que j’ai ressentie, après quelques mois passés en pays étranger, de retrouver un compatriote en la personne d’un aimable officier de marine, isolé depuis un an sur le haut Mékong et dont j’ignorais la présence en ce lieu. Nul n’était venu, d’ailleurs, depuis ce temps, le visiter ni le troubler dans les travaux qui avaient pour but de mener le La Grandière à la hauteur de Muong-Sing.
Nous passons ensemble toute une journée en promenades et en fêtes, et dès le matin nous partons avec des coolies armés de coupe-coupe, sabres laotiens, pour débroussailler la route qui mène au grand Tât2. Du haut de son mamelon, la vieille pagode domine tout le pays de Xieng Sen. Peu de villes comptent autant de ruines perdues dans la grande brousse. On a compté soixante-quinze pagodes dans l’enceinte de la ville et soixante-cinq dans le voisinage. On aperçoit de-ci, de-là, des vestiges dorés et sculptés, de nombreuses statues de Bouddha entassées, abandonnées sous la végétation envahissante. Ce sont des Bouddha-Niouen, aux longues oreilles. Les plus beaux sont si lourds qu’il est impossible au collectionneur de céder à la tentation.
Le soir, il y a grand boun, concert laotien, auquel se presse toute la population, très curieuse de contempler la « madame Française » qui a traversé les pays hantés, les grandes forêts infestées de fauves et la plaine des pirates, toute la région où ce doux peuple n’oserait se rendre qu’en troupe. Aussi, le soir, sur les kenh, les harpes laotiennes, à tuyaux de bambou de deux et trois mètres de longueur, ou sur les flûtes en bambou des Khas-Moussouk, pirates descendus du nord, improvise-t-on des strophes en mon honneur, tandis que nous devisons du Laos, du Mékong et des rapides qui m’attendent. La musique laotienne, douce et un peu monotone, est beaucoup plus harmonieuse que la musique annamite, toujours criarde. Chanteurs-improvisateurs et musiciens viennent faire boun (fête) à la voyageuse, comme ils le feraient à tout autre personnage qu’ils voudraient honorer. Celui-ci d’ailleurs, pas plus que les assistants, n’est obligé de les écouter : on cause, on rit, on s’amuse ; c’est boun enfin, et c’est tout ce qu’il faut. La partie la plus originale de ce que nous appelons pompeusement le concert, c’est le duo, improvisé comme tous les chants laotiens, entre un jeune homme et une jeune fille. Ils sont assis à terre, comme tout l’auditoire. Ils s’approchent dans des mouvements de balancement, avec des gestes accompagnés de chants, tournent à demi l’un autour de l’autre, agitant dans leurs mains de minuscules petites bougies, qui éveillent une ressouvenance de feux follets, et donnent à ce jeu une grâce, une originalité qui n’est pas sans charmes.
Le lendemain, je quittais la large plaine de Xieng Sen, où le Mékong se répand superbement et baigne l’île Isabelle, gracieusement baptisée de mon nom par le lieutenant Simon, le chef savant et distingué de la mission hydrographique du haut Mékong. Il est d’usage sur le haut Mékong que toute pirogue qui porte un Français arbore notre drapeau ; et c’était pour moi une joie enfantine et une petite fierté de songer que nos trois couleurs flottaient une fois de plus dans ces hautes régions ! Je me souvenais d’une émotion analogue éprouvée au Liban : chaque Européen a coutume d’y abriter sa tente sous son drapeau national ; et lorsque, au premier jour, en arrivant à l’étape, j’ai aperçu nos trois couleurs battant au vent pour une humble femme, je crois vraiment que les larmes me sont venues aux yeux. Ce sont là joies de voyageur et d’autant plus intenses qu’on est plus loin et plus seul.
Aussitôt sortis de la plaine de Xieng Sen, les rapides, les kengs, comme on les nomme, commencent et se succèdent. Le Keng-Pakantoun, qui m’a été signalé comme le plus grand des rapides de cette première journée, me serait difficile à reconnaître parmi les autres, si un petit monument commémoratif ne le distinguait. Un fils de roi de Vientiane est mort en ce lieu, dans un combat contre les Hos ; et sur une grosse pierre, à peu près à l’état de nature, dressée à côté de pierres semblables, est représenté un personnage debout, en haut-relief grossièrement sculpté.
Le soir même j’arrivais à Xieng Khong. Sur la rive française, le village de Ban3-Houé-Saï, en face de Xieng Khong, est pittoresquement perché sur une éminence. De très loin, on croirait voir une ville fortifiée importante, dressée sur sa falaise, en un coude du fleuve ; et, à mesure qu’on approche, on ne distingue plus que quelques maisons, dont l’une porte le pavillon français. C’est celle du commissaire du gouvernement, dont le commissariat est maintenant transféré à Vien4-Poukha, à dix journées dans l’intérieur. Notre drapeau flottait également au-dessus de Xieng Khong, sur la rive droite. Une douzaine de femmes khas, tout habillées de bleu foncé, le coupe-coupe ou le bâton à la main, couraient, à la queue leu leu, montant et descendant allégrement la haute berge. Je les prenais pour de gentils miliciens.
Le commissaire, M. Marolles, m’attendait, tout fier d’une récente capture faite la veille au soir, et qu’il avait bien voulu me réserver. C’était, au fond d’un large puits de six mètres de profondeur, un magnifique tigre de la plus grande taille, qui, chose extraordinaire sur le haut Mékong, avait, la semaine précédente, enlevé un jeune milicien de garde au petit poste de la résidence. Effaré de son exploit, il avait traversé le feu avec sa proie, et, s’étant brûlé, il l’avait lâchée. Sans grandes blessures apparentes, l’infortuné milicien n’en était pas moins mort dans les trois jours. Un petit cochonnet avait été placé comme appât dans cette fosse recouverte de branchages. Le tigre, pris au piège, s’était trouvé si penaud de sa chute, qu’après quelques bonds verticaux effrayants, il n’avait pas même pensé à manger le cochonnet. Il l’avait pris pour oreiller ; et le lendemain, le pauvre petit animal était retiré intact. Aux cris que poussait à notre approche, le lendemain soir, le grand fauve, je pensai qu’il regrettait son cochonnet.