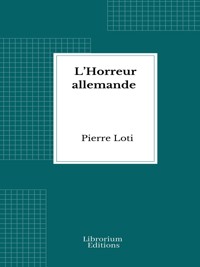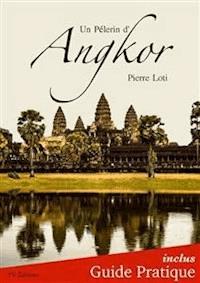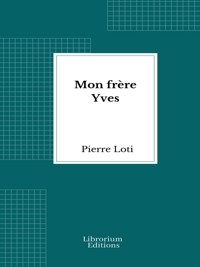Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Extrait : "Je voudrais connaître une langue à part, dans laquelle pourraient s'écrire les visions de mes sommeils. Quand j'essaie avec les mots ordinaires, je n'arrive qu'à construire une sorte de récit gauche et lourd, à travers lequel ceux qui me lisent ne doivent assurément rien voir ; moi seul, je puis distinguer encore, derrière l'à peu près de ces mots accumulés, l'insondable abîme."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335003246
©Ligaran 2015
À MA MÈRE
Je dédie ce livre,
Sans crainte, parce que la foi chrétienne lui permet de lire avec sérénité les plus sombres choses.
« Ah ! insensé qui crois que tu n’es pas moi. »
V. HUGO.(Les Contemplations.)
Ce livre est encore plus moi que tous ceux que j’ai écrits jusqu’à ce jour.
Il renferme même un long chapitre (le neuvième, pages 619 à 655) que je n’ai consenti à livrer à aucune revue, de peur qu’il ne tombât sous les yeux de gens quelconques, sans que j’aie pu les avertir.
D’abord, je voulais ne pas publier ce passage. Mais j’ai songé à mes amis inconnus : un seul mouvement de leur sympathie lointaine, je regretterais trop de m’en priver… Et puis j’ai toujours cette impression que, dans l’espace et dans la durée, je recule les limites de mon âme en la mêlant un peu aux leurs ; quelques instants de plus, après que j’aurai passé, la mémoire de ces frères gardera peut-être vivantes de chères images que j’y aurai gravées.
Ce besoin de lutter contre la mort est d’ailleurs – après le désir de faire quelque bien si l’on s’en croit capable – la seule raison immatérielle que l’on ait d’écrire.
Parmi ceux qui font profession d’étudier les œuvres de leur prochain, il en est bon nombre avec lesquels je n’ai rien de commun, ni les idées ni le langage. Moins que jamais je me sens capable d’irritation contre eux, tant j’ai appris à tenir compte, avant de juger les autres hommes, des différences naturelles ou acquises.
Mais cette fois est la première où leur gouaillerie aurait quelque chance de m’être pénible, si elle parvenait jusqu’à moi, parce qu’elle pourra porter sur des choses et des êtres qui me sont sacrés ; je leur donne vraiment la partie belle en publiant ce livre. Aussi vais-je essayer de leur dire ici : faites-moi donc la grâce de ne pas le lire, il ne contient rien qui soit pour vous, – et il vous ennuiera tant, si vous saviez !…
Je voudrais connaître une langue à part, dans laquelle pourraient s’écrire les visions de mes sommeils. Quand j’essaie avec les mots ordinaires, je n’arrive qu’à construire une sorte de récit gauche et lourd, à travers lequel ceux qui me lisent ne doivent assurément rien voir ; moi seul, je puis distinguer encore, derrière l’à peu près de ces mots accumulés, l’insondable abîme.
Il paraît que les rêves, même ceux qui nous semblent les plus longs, n’ont qu’une durée à peine appréciable, rien que ces instants toujours très fugitifs où l’esprit flotte entre la veille et le sommeil ; mais nous sommes trompés par l’excessive rapidité avec laquelle leurs mirages se succèdent et changent ; ayant vu passer tant de choses, nous disons : j’ai rêvé toute une nuit, quand à peine avons-nous rêvé pendant une minute.
La vision dont je vais parler n’a peut-être pas eu comme durée réelle, plus de quelques secondes, car elle m’a paru à moi-même fort courte.
La première image s’est éclairée en deux ou trois fois, par saccades légères, comme si, derrière un transparent, on remontait par petites secousses la flamme d’une lampe.
D’abord une lueur indécise, de forme allongée, – attirant l’attention de mon esprit au sortir du plein sommeil, de la nuit et du non-être.
Puis la lueur devient une traînée de soleil, entrant par une fenêtre ouverte et s’étalant sur un plancher. En même temps, mon attention, plus excitée, s’inquiète tout à coup : vague ressouvenir de je ne sais quoi, pressentiment rapide comme l’éclair de quelque chose qui va me remuer jusqu’au fond de l’âme.
Cela se précise : c’est le rayon d’un soleil du soir venant d’un jardin sur lequel cette fenêtre donne ; – jardin exotique où, sans les avoir vus, je sais à présent qu’il y a des manguiers. Dans cette traînée lumineuse sur le plancher, l’ombre d’une plante qui est dehors, se découpe et tremble doucement, – l’ombre d’un bananier…
Et maintenant les parties relativement obscures s’éclairent ; – dans la pénombre, les objets se dessinent, – et je vois tout, avec un inexprimable frisson !
Rien que de très simple pourtant ; un petit appartement dans quelque maison coloniale, aux murs de bois, aux chaises de paille. Sur une console, une pendule du temps de Louis XV, dont le balancier tinte imperceptiblement. Mais j’ai déjà vu tout cela et j’ai conscience de l’impossibilité où je suis de me rappeler où, et je m’agite avec angoisse derrière cette sorte de voile ténébreux qui est tendu à un point donné dans ma mémoire, arrêtant les regards que je voudrais prolonger au-delà, dans je ne sais quel recul plus profond.
… C’est bien le soir, c’est bien la lueur dorée d’un soleil qui va s’éteindre, – et les aiguilles de la pendule Louis XV marquent six heures… Six heures de quel jour à jamais perdu dans le gouffre éternel ? de quel jour, de quel année lointaine et disparue ?
Ces chaises ont aussi un air ancien. Dans l’une d’elles est posé un large chapeau de femme, en paille blanche, d’une forme démodée depuis plus de cent ans. Mes yeux s’y arrêtent et alors l’indicible frisson me secoue plus fort… La lumière baisse, baisse ; maintenant, c’est à peine l’éclairage trouble des rêves ordinaires… Je ne comprends pas, je ne sais pas, – mais, malgré tout, je sens que j’ai été au courant des choses de cette maison et de la vie qui s’y mène, cette vie plus mélancolique et plus, exilée des colonies d’autrefois, alors que les distances étaient plus grandes et les mers plus inconnues.
Et tandis que je regarde ce chapeau de femme, qui s’efface peu à peu, comme tout ce qui est là, dans des gris crépusculaires, cette réflexion me vient, faite en ma tête par un autre que par moi-même : « Alors, c’est qu’elle est rentrée. »
– En effet, ELLE apparaît. Elle, derrière moi, sans que je l’aie entendue venir ; elle, restant dans la partie obscure, dans le fond de l’appartement où ce reflet de soleil n’arrive pas ; elle, très vague comme une esquisse tracée en couleurs mortes sur de l’ombre grise.
Elle, très jeune, créole, nu-tête avec des boucles noires disposées autour du front d’une manière surannée ; de beaux yeux limpides, ayant l’air de vouloir me parler, avec un mélange d’effarement triste et d’enfantine candeur ; peut-être pas absolument belle, mais possédant le suprême charme… Et puis surtout c’était ELLE ! Elle, un mot qui par lui-même est d’une douceur exquise à prononcer : un mot qui, pris dans le sens où je l’entends, résume en lui toute la raison qu’on a de vivre, exprime presque l’ineffable et l’infini. Dire que je la reconnaissais serait une expression bien banale et bien faible ; il y avait beaucoup plus, tout mon être s’élançait vers elle, avec une force profonde et comme enchaînée, pour la ressaisir ; et ce mouvement avait je ne sais quoi de sourd, d’affreusement étouffé, comme l’effort impossible de quelqu’un qui chercherait à reprendre son propre souffle et sa propre vie, après des années et des années passées sous le couvercle d’un sépulcre…
Habituellement une émotion très forte éprouvée dans un rêve en brise les fils impalpables, et c’est fini : on s’éveille ; la trame fragile, une fois rompue, flotte un instant, puis retombe, s’évanouit d’autant plus vite que l’esprit – s’efforce davantage à la retenir, – disparaît, comme une gaze déchirée dans le vide, qu’on voudrait poursuivre et que le vent emporte au fond des lointains inaccessibles.
Mais non, cette fois, je ne m’éveillai pas et le rêve continua, en s’éteignant ; le rêve se prolongea en traînée mourante.
Un instant, nous restâmes l’un devant l’autre, arrêtés, dans notre élan de souvenir, par je ne sais quelle sombre inertie ; sans voix pour nous parler, et presque sans pensée, croisant seulement nos regards de fantômes avec un étonnement et une délicieuse angoisse… Puis nos yeux aussi se voilèrent, et nous devînmes des formes plus vagues encore, accomplissant des choses insignifiantes et involontaires. La lumière baissait, baissait toujours ; on n’y voyait presque plus. Elle sortit, et je la suivis dans une espèce de salon aux murs blanchis, vaste, à peine garni de meubles simples – comme d’ordinaire dans les habitations des planteurs.
Une autre ombre de femme qui nous attendait là, vêtue d’une robe créole, – une femme âgée que je reconnus aussi tout de suite et qui lui ressemblait, sa mère sans doute, – se leva à notre approche et nous sortîmes tous les trois, sans nous être concertés, comme obéissant à une habitude… Mon Dieu, que de mots et que de longues phrases pour expliquer lourdement tout cela qui se passait sans durée et sans bruit, entre personnages diaphanes comme des reflets, se mouvant sans vie dans une obscurité toujours croissante, plus décolorée et plus trouble que celle de la nuit.
Nous sortîmes tous trois, au crépuscule, dans une petite rue triste, triste, bordée de maisonnettes coloniales basses sous de grands arbres ; au bout, la mer, vaguement devinée ; une impression de dépaysement, de lointain exil, quelque chose comme ce que l’on devait éprouver au siècle passé dans les rues de la Martinique ou de la Réunion, mais avec la grande lumière en moins, tout cela vu dans cette pénombre où vivent les morts. De grands oiseaux tournoyaient dans le ciel lourd ; malgré cette obscurité, on avait conscience de n’être qu’à cette heure encore claire qui vient après le soleil couché. Évidemment nous accomplissions là un acte habituel ; dans ces ténèbres toujours plus épaisses, qui n’étaient pas celles de la nuit, nous refaisions notre promenade du soir.
Mais les impressions perçues allaient s’éteignant toujours ; les deux femmes n’étaient plus visibles ; il ne me restait d’elles que la notion de deux spectres légers et doux cheminant à mes côtés… Puis, plus rien ; tout s’éteignit à jamais dans la nuit absolue du vrai sommeil.
Je dormis longtemps après ce rêve, – une heure, deux heures, je ne sais ; au réveil, au retour des pensées, dès qu’un premier souvenir m’en revint, j’éprouvai cette sorte de commotion intérieure qui fait faire un sursaut et ouvrir tout grands les yeux… Dans ma mémoire, je retrouvai d’abord la vision à son moment le plus intense, celui où tout à coup j’avais songé à elle, en reconnaissant son grand chapeau jeté sur cette chaise, et où, derrière moi, elle avait paru… Puis lentement, peu à peu, je me rappelai tout le reste : les détails si précis de cet appartement déjà connu, cette femme plus âgée entrevue dans l’ombre, cette promenade dans cette petite rue déserte… Où donc avais-je vu et aimé tout cela ? Je cherchai rapidement dans mon passé avec une sorte d’inquiétude, d’anxieuse tristesse, me croyant sûr de trouver. Mais non, rien, nulle part ; dans ma propre vie, rien de pareil…
La tête humaine est remplie de souvenirs innombrables, entassés pêle-mêle, comme des fils d’écheveaux brouillés ; il y en a des milliers et des milliers serrés dans des recoins obscurs d’où ils ne sortiront jamais ; la main mystérieuse qui les agite et les retourne va quelquefois prendre les plus ténus et les plus insaisissables pour les amener un instant en lumière, pendant ces calmes qui précèdent ou suivent les sommeils. Celui que je viens de raconter ne reparaîtra certainement jamais, et reparaîtrait-il même, une autre nuit, que je n’en apprendrais pas davantage au sujet de cette femme et de ce lieu d’exil, parce que, dans ma tête, il n’y a sans doute rien de plus qui les concerne ; c’est le dernier fragment d’un fil brisé, qui doit finir là où s’est arrêté mon rêve ; le commencement et la suite n’existaient que dans d’autres cerveaux depuis longtemps retournés à la poussière.
Parmi mes ascendants, j’ai eu des marins dont la vie et les aventures ne me sont qu’imparfaitement connues ; et il y a certainement, je ne sais où, dans quelque petit cimetière des colonies, de vieux ossements qui sont les restes de la jeune femme au grand chapeau de paille et aux boucles noires ; le charme que ses yeux avaient exercé sur un de ces ancêtres inconnus a été assez puissant pour jeter un dernier reflet mystérieux jusqu’à moi ; j’ai songé à elle tout un jour… et avec une mélancolie si étrange !
C’est une bien petite histoire, qui m’a été contée par Yves, – un soir où il était allé en rade conduire, avec sa canonnière, une cargaison de condamnés au grand transport en partance pour la Nouvelle-Calédonie.
Dans le nombre se trouvait un forçat très âgé (soixante-dix ans pour le moins), qui emmenait avec lui, tendrement, un pauvre moineau dans une petite cage.
Yves, pour passer le temps, était entré en conversation avec ce vieux, qui n’avait pas mauvaise figure, paraît-il, mais qui était accouplé par une chaîne à un jeune monsieur ignoble, gouailleur, portant lunettes de myope sur un mince nez blême.
Vieux coureur de grands chemins, arrêté, en cinquième ou sixième récidive, pour vagabondage et vol, il disait : « Comment faire pour ne pas voler, quand on a commencé une fois, – et qu’on n’a pas de métier, rien, – et que les gens ne veulent plus de vous nulle part ? Il faut bien manger, n’est-ce pas ? – Pour ma dernière condamnation, c’était un sac de pommes de terre que j’avais pris dans un champ, avec un fouet de roulier et un giraumont. Est-ce qu’on n’aurait pas pu me laisser mourir en France, je vous demande, au lieu de m’envoyer là-bas, si vieux comme je suis ?… »
Et, tout heureux de voir que quelqu’un consentait à l’écouter avec compassion, il avait ensuite montré à Yves ce qu’il possédait de précieux au monde : la petite cage et le moineau.
Le moineau apprivoisé, connaissant sa voix, et qui pendant près d’une année, en prison, avait vécu perché sur son épaule… – Ah ! ce n’est pas sans peine qu’il avait obtenu la permission de l’emmener avec lui en Calédonie ! – Et puis après, il avait fallu lui faire une cage convenable pour le voyage ; se procurer du bois, un peu de vieux fil de fer, et un peu de peinture verte pour peindre le tout et que ce fût joli.
Ici, je me rappelle textuellement ces mots d’Yves : « Pauvre moineau ! Il avait pour manger dans sa cage un morceau de ce pain gris qu’on donne dans les prisons. Et il avait l’air de se trouver content tout de même ; il sautillait comme n’importe quel autre oiseau. »
Quelques heures après, comme on accostait le transport et que les forçats allaient s’y embarquer pour le grand voyage, Yves, qui avait oublié ce vieux, repassa par hasard près de lui.
– Tenez, prenez-la, vous, lui dit-il d’une voix toute changée, en lui tendant sa petite cage. Je vous la donne ; ça pourra peut-être vous servir à quelque chose, vous faire plaisir…
– Non, certes ! remercia Yves. Il faut l’emporter au contraire, vous savez bien. Ce sera votre petit compagnon là-bas…
– Oh ! reprit le vieux, il n’est plus dedans… Vous ne saviez donc pas ? il n’y est plus…
Et deux larmes d’indicible misère lui coulaient sur les joues.
Pendant une bousculade de la traversée, la porte s’était ouverte, le moineau avait eu peur, s’était envolé, – et tout de suite était tombé à la mer à cause de son aile coupée. Oh ! le moment d’horrible douleur ! Le voir se débattre et mourir, entraîné dans le sillage rapide, et ne pouvoir rien pour lui ! D’abord, dans un premier mouvement bien naturel, il avait voulu crier, demander du secours, s’adresser à Yves lui-même, le supplier… Élan arrêté aussitôt par la réflexion, par la conscience immédiate de sa dégradation personnelle : un vieux misérable comme lui, qui est-ce qui aurait pitié de son moineau, qui est-ce qui voudrait seulement écouter sa prière ? Est-ce qu’il pouvait lui venir à l’esprit qu’on retarderait le navire pour repêcher un moineau qui se noie, – et un pauvre oiseau de forçat, quel rêve absurde !… Alors il s’était tenu silencieux à sa place, regardant s’éloigner sur l’écume de la mer le petit corps gris qui se débattait toujours ; il s’était senti effroyablement seul maintenant, pour jamais, et de grosses larmes, des larmes de désespérance solitaire et suprême lui brouillaient la vue, – tandis que le jeune monsieur à lunettes, son collègue de chaîne, riait de voir un vieux pleurer.
Maintenant que l’oiseau n’y était plus, il ne voulait pas garder cette cage, construite avec tant de sollicitude pour le petit mort ; il la tendait toujours à ce brave marin qui avait consenti à écouter son histoire, désirant lui laisser ce legs avant de partir pour son long et dernier voyage.
Et Yves, tristement, avait accepté le cadeau, la maisonnette vide, – pour ne pas faire plus de peine à ce vieil abandonné en ayant l’air de dédaigner cette chose qui lui avait coûté tant de travail.
Je crois que je n’ai rien su rendre de tout ce que j’avais trouvé de poignant dans ce récit tel qu’il me fut fait.
C’était le soir, très tard, et j’étais près de m’en aller dormir. Moi qui dans la vie ai regardé sans trop m’émouvoir pas mal de douleurs à grand fracas, de drames, de tueries, je m’aperçus avec étonnement que cette détresse sénile me fendait le cœur – et irait même jusqu’à troubler mon sommeil :
– S’il y avait moyen, dis-je, de lui en envoyer un autre…
– Oui, répondit Yves, j’avais bien pensé à cela, moi aussi. Chez un oiseleur, lui acheter un bel oiseau, et le lui porter demain avec la pauvre cage, s’il en est encore temps avant le départ. Un peu difficile. Il n’y a du reste que vous-même qui puissiez obtenir d’aller en rade demain matin et de monter à bord du transport pour rechercher ce vieux dont je ne sais pas le nom. Seulement… on va trouver cela bien drôle…
– Oh ! oui, en effet. Oh ! pour ce qui est d’être trouve drôle, il n’y a pas d’illusion à se faire là-dessus !…
Et, un instant, tout au fond de moi-même, je m’amusai de cette idée, riant de ce bon rire intérieur qui à la surface paraît à peine.
Cependant je n’ai pas donné suite au projet : le lendemain, à mon réveil, la première impression envolée, il m’a semblé enfantin et ridicule. Ce chagrin-là, évidemment, n’était pas de ceux qu’un simple jouet console. Pauvre vieux forçat, seul au monde, le plus bel oiseau du paradis n’eût pas remplacé pour lui l’humble moineau grisâtre, à aile coupée, élevé au pain de prison, qui avait su réveiller les tendresses infiniment douces et les larmes, au fond de son cœur endurci, à moitié mort…
Rochefort, décembre 1889.
Un vieux chat galeux, chassé sans doute de son logis par ses maîtres, s’était établi dans la rue, sur le trottoir de notre maison où un peu de soleil de novembre le réchauffait encore. C’est l’usage de certaines gens à pitié égoïste d’envoyer ainsi perdre le plus loin possible les bêtes qu’ils ne veulent ni soigner ni voir souffrir.
Tout le jour il se tenait piteusement assis dans quelque embrasure de fenêtre, l’air si malheureux et si humble ! Objet de dégoût pour ceux qui passaient, menacé par les enfants, par les chiens, en danger continuel, d’heure en heure plus malade, et vivant de je ne sais quels débris ramassés à grand-peine dans les ruisseaux, il traînait là, seul, se prolongeant comme il pouvait, s’efforçant de retarder la mort. Sa pauvre tête était toute mangée de gale, couverte de croûtes, presque sans poils ; mais ses yeux, restés jolis, semblaient penser profondément. Il devait certainement sentir, dans toute son amertume affreuse, cette souffrance, la dernière de toutes, de ne pouvoir plus faire sa toilette, de ne pouvoir plus lisser sa fourrure, se peigner, comme font tous les chats avec tant de soin.
Faire sa toilette ! Je crois que, pour les bêtes comme pour les hommes, c’est une des plus nécessaires distractions de la vie. Les très pauvres, les très malades, les très décrépits qui, à certaines heures, se parent un peu, essayent de s’arranger encore, n’ont pas tout perdu dans l’existence. Mais ne plus s’occuper de son aspect, parce qu’il n’y a vraiment plus rien à y faire avant la pourriture finale, cela m’a toujours paru le dernier degré de tout, la misère suprême. Oh ! les vieux mendiants qui ont déjà, avant la mort, de la terre et des immondices sur le visage, les êtres rongés par des lèpres visibles qui ne peuvent plus être lavées, les bêtes galeuses dont on n’a seulement plus pitié !
Il me faisait tant de peine à regarder, ce chat à l’abandon, qu’après lui avoir envoyé à manger dans la rue, je finis un jour par m’approcher pour lui parler doucement. (Les bêtes arrivent très bien à comprendre les bonnes paroles, et y trouvent consolation.) Par habitude d’être pourchassé, il eut d’abord peur en me voyant arrêté devant lui ; son premier regard fut méfiant, chargé de reproche et de prière : « Est-ce que tu vas encore me renvoyer, toi aussi, de ce dernier coin de soleil ? » Puis, comprenant vite que j’étais venu par sympathie, et étonné de tant de bonheur, il m’adressa tout bas sa pauvre réponse de chat : « Trr ! Trr ! Trr ! » en se levant par politesse, en essayant même de faire le gros dos, malgré ses croûtes, dans l’espoir que peut-être j’irais jusqu’à une caresse.
Non, ma pitié, à moi qui seul au monde en éprouvais encore pour lui, n’allait pas jusque-là. Cette joie d’être caressé, il ne la connaîtrait sans doute jamais plus. Mais, en compensation, j’imaginai de lui donner la mort tout de suite, de ma main, et d’une façon presque douce.
Une heure après, cela se passa dans l’écurie où Sylvestre, mon domestique, qui d’abord était allé acheter du chloroforme, l’avait attiré doucement, l’avait décidé à se coucher sur du foin bien chaud au fond d’une manne d’osier qui allait devenir sa chambre mortuaire. Nos préparatifs ne l’inquiétaient point ; nous avions roulé une carte de visite en forme de cône, comme nous avions vu faire à des chirurgiens dans des ambulances ; lui nous regardait, l’air confiant et heureux, pensant avoir enfin retrouvé un gîte et des gens qui auraient compassion, de nouveaux maîtres qui le recueilleraient.