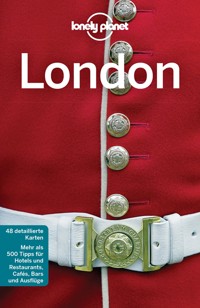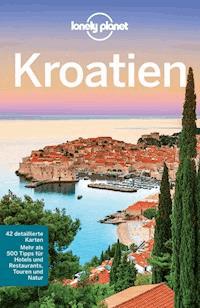Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions Intervalles
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Un témoignage décalé.
« Elles ont passé des heures à expliquer qu’habituellement nous avions tout : des lits, des draps, du linge de rechange brodé et même amidonné dans nos armoires ; des verres en cristal, des souvenirs, de la vaisselle en porcelaine, des passeports, des aspirateurs, des animaux domestiques, des goûts de luxe, des jours fériés, des odeurs, des bruits, et surtout, surtout, que nous nous aimions les uns les autres, que nous n’avions pas passé les cinquante dernières années à nous haïr en secret en attendant la première occasion de nous étriper au grand jour de la façon la plus sauvage qui fût. Elles voulaient expliquer que la guerre était une méprise, un stratagème inventé par des politiciens diaboliques, que ça n’avait rien à voir avec nous, les individus assis devant eux. »
Le récit plein d’humour de cet exil, qui désamorce avec tendresse, profondeur et une finesse inouïe les idées reçues sur le déracinement.
EXTRAIT
« Mon père m’a demandé de ne le dire à personne, mais nous quittons la ville. Il dit que c’est seulement pour quelque temps, jusqu’à ce que le calme revienne. Je serai bientôt de retour. Je voulais te le dire. »
J’étais complètement retournée. « Vous allez revenir bientôt alors. Tu vas me manquer. »
J’ai raccroché et suis allée regarder à la fenêtre, comme si, dehors, un indice allait m’indiquer si la guerre aurait lieu ou pas. Mon amie fut l’une des nombreuses Serbes à quitter définitivement la ville cette semaine-là. Les Serbes de ma famille ont aussi quitté la ville la même semaine. Nous sommes restés et avons manifesté pour la paix, comme des poulets attendant que quelqu’un arrive pour nous décapiter d’un coup de hache.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Au pathos, la romancière préfère une discrète mélancolie, un tendre désenchantement. En sa compagnie, la fin de l’innocence porte des promesses de recommencement. -
Christian Authier, Le Figaro littéraire
Une histoire puissante. -
The Independent
Vesna Maric donne une image très décalée de l’exil, pas du tout plombante, presque joyeuse, comme si la découverte d’un monde nouveau était plus forte que la perte de l’ancien, que le déracinement. -
Yves Mabon
À PROPOS DE L'AUTEUR
Née en 1976 à Mostar,
Vesna Maric a quitté la Bosnie à l’âge de seize ans dans un convoi de réfugiés à destination du Royaume-Uni.
Le Merle bleu retrace le chemin souvent drôle et toujours décalé de Vesna.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
À Rafael, à ma mère et à la petite Ima, tendrement
There’ll be bluebirds over
The white cliffs of Dover
Tomorrow, just you wait and see.
Il y aura des merles bleus
Au-dessus des falaises blanches de Douvres,
Demain, tu verras.
There’ll be love and laughter
And peace ever after
Tomorrow, when the world is free.
Il y aura de l’amour et des rires
Et la paix pour toujours
Demain, quand le monde sera libre.
The shepherd will tend his sheep,
The valley will bloom again
And Jimmy will go to sleep,
In his own little room again.
Le berger veillera sur ses brebis,
La vallée refleurira
Et Jimmy reviendra dormir,
Dans sa petite chambre, comme avant.
There’ll be bluebirds over
The white cliffs of Dover,
Tomorrow, just you wait and see.
Il y aura des merles bleus
Au-dessus des falaises blanches de Douvres,
Demain, tu verras.
NAT BURTON
BONJOUR, VOISIN
Je me souviens d’un bout de séquence télévisée devenu légendaire depuis. Des manifestants marchaient dans les rues de Sarajevo et s’affalaient soudain d’un seul mouvement, comme des herbes hautes fauchées par le vent. Les gens regardaient autour d’eux, déconcertés, se demandant ce qui avait sifflé à leurs oreilles et fait chuter cette fille si brutalement. Une fille de Dubrovnik, une étudiante, avait été abattue par un sniper sur un des ponts de la ville et son corps glissait au fil des eaux écumeuses et peu profondes de la rivière de Sarajevo. C’était la première victime de la guerre.
Les snipers étaient cachés dans le Holiday Inn, édifié huit ans auparavant pour les jeux Olympiques d’hiver de 1984. Au début, on le regardait avec sympathie. Les gens lui avaient donné des sobriquets comme « œuf au plat » parce qu’en hiver, sous une épaisse couche de neige, on devinait sa façade jaune. Tout le monde allait y prendre un café le dimanche. C’était le point de rencontre de la ville. Pendant la guerre, l’hôtel abritait des journalistes étrangers qui passaient la nuit dans les chambres obscures et froides à se demander quel sens avait la vie et ce qu’ils faisaient là, pendant que les obus grêlaient et ravageaient la ville grelottante. Et au début de la guerre, dans les mêmes chambres, siégeaient les snipers qui ont tiré sur la foule en dessous d’eux en ce jour ensoleillé de printemps. J’ai vu ça en direct à la télévision, avec ma famille, dans notre salon de Mostar.
Quand la fille est tombée, nous avons eu le souffle coupé. Ma mère, paniquée, a aussitôt téléphoné à sa sœur à Sarajevo. Vérifier que la famille et les amis étaient vivants allait devenir, dans notre vie, une activité redoutée et récurrente.
La radio déversait des appels à descendre dans les rues. « Pour vaincre les tyrans », disait le présentateur. Nous avions déjà manifesté pendant des jours. « Bonjour, voisin » était le nouveau mot d’ordre, humaniste, qui promouvait avec vigueur une Bosnie-Herzégovine multiethnique. C’était mon plus profond désir et j’ai dévalé les escaliers pour aller dans la rue. Ce jour-là, la foule était plus réduite. Des rafales de mitrailleuse se faisaient entendre dans les collines ; je n’en avais jamais entendu auparavant. Ça fait un drôle de bruit, une vraie rafale de mitrailleuse. Un bruit de dents qui claquent, ou de machine à coudre actionnée par un maître tailleur. C’était inquiétant de comprendre que le cliquetis pouvait désormais tuer au lieu d’appartenir à la bande son d’un film d’action américain. Ce jour-là, nous sommes rentrés à la maison plus tôt et le matin suivant, personne n’a dit : « Bonjour, voisin. »
Ce n’était pourtant pas mon premier contact avec la guerre. Quelques jours auparavant, en rentrant de l’école, une épouvantable explosion avait secoué la ville. Les vitres ont volé en éclats autour de moi, les gens hurlaient, le sol tremblait et chacun courait n’importe où au hasard. La guerre avait littéralement commencé par un bang où notre monde s’achevait, un bang semblable à celui d’où était sorti l’univers, il y a des milliards d’années. Je ne savais que faire et au lieu d’obéir à mon instinct et de me jeter par terre comme dans les films de propagande, je suis rentrée chez moi. J’ai frappé à la porte de mon voisin et nous avons tenté de comprendre d’où était partie l’explosion. Nous avons scruté l’horizon depuis sa terrasse. Il y avait de la fumée au nord de la ville. « Ça doit être le camp militaire nord », a-t-il annoncé. J’ai hoché la tête. Je ne savais pas où se trouvait le camp militaire nord et si ce qu’il disait était vrai.
C’était un jour de printemps nuageux, l’air était chaud et nous commencions tout juste à porter des vêtements à manches courtes et à prendre le café dehors. Les fleurs des tilleuls parfumaient les rues et c’était la période de l’année que je préférais.
Je me suis dirigée vers la boutique de ma mère, car je voulais voir ce qui se passait en ville. Les gens formaient de petits groupes. La confusion régnait et chacun tenait un discours différent. Des bouts de conversation ont frappé mes oreilles : « Ne croyez personne. Tout le monde ment. » « Ils disent que c’était un camion-citerne, plein d’essence, le conducteur y était encore. Il a cuit comme dans un four. Même mort, il avait encore les mains sur le volant. Ça devait être un conducteur modèle. »
En chemin, je me suis arrêtée près de la maison de ma meilleure amie. Son père, M. Dušan, était militaire et je pensais qu’il devait être capable d’éclairer la situation. M. Dušan était un homme trapu. Ce jour-là, il semblait encore plus trapu que d’habitude. Et anxieux. Il était assis à la table de la cuisine aux prises avec des mots croisés, et à en croire la quantité de ratures, il avait tout faux.
« Va-t-il y avoir la guerre, M. Dušan ? » lui ai-je demandé après quelques amabilités d’usage et une tentative pour trouver un équivalent au mot essence.
« Non, non, y’aura pas de guerre, ma chérie. C’est seulement un peu de désordre, mais rien de sérieux. Ne t’inquiète pas. » Je me demande encore s’il me mentait ou s’il croyait vraiment que ça pouvait s’arranger.
Dans la boutique de ma mère, les clients spéculaient sur ce qui s’était passé. Là aussi, chacun racontait une version différente. La seule chose sûre, c’était l’explosion du camion-citerne près du camp militaire nord. Mon voisin avait vu juste. Les gens parlaient d’une conspiration des militaires ou disaient que c’était une explosion accidentelle, ou que « l’ennemi » avait piégé le camion-citerne. Qui était « l’ennemi » ? me demandais-je sans rien dire, craignant d’être bombardée d’hypothèses supplémentaires. L’associé de ma mère a servi du café. C’était un homme doux qui devait mourir plus tard dans un camp de prisonniers.
Les médias donnaient des informations contradictoires, et très vite on a parlé de « désinformation » en précisant qu’il s’agissait surtout d’alimenter ainsi la peur et la haine. « Ne croyez rien de ce que vous entendez. La désinformation peut être meurtrière », disait-on à la radio.
Le lendemain matin très tôt, j’ai reçu un appel téléphonique. C’était mon amie, la fille de M. Dušan.
« Mon père m’a demandé de ne le dire à personne, mais nous quittons la ville. Il dit que c’est seulement pour quelque temps, jusqu’à ce que le calme revienne. Je serai bientôt de retour. Je voulais te le dire. »
J’étais complètement retournée. « Vous allez revenir bientôt alors. Tu vas me manquer. »
J’ai raccroché et suis allée regarder à la fenêtre, comme si, dehors, un indice allait m’indiquer si la guerre aurait lieu ou pas. Mon amie fut l’une des nombreuses Serbes à quitter définitivement la ville cette semaine-là. Les Serbes de ma famille ont aussi quitté la ville la même semaine. Nous sommes restés et avons manifesté pour la paix, comme des poulets attendant que quelqu’un arrive pour nous décapiter d’un coup de hache.
Ce jour-là, un orage a balayé la ville, badigeonné l’air d’un orange très Halloween et déraciné des arbres. J’ai regardé les ardoises tomber du toit et se fracasser dans la rue. C’était un bel orage. Après les gens ont dit : « C’est de mauvais augure. Il y aura la guerre », et face à l’exil d’une population fuyant la ville en plein mois de mars, à l’explosion de la veille, à la propagande nationaliste, à la suspicion généralisée, je me demandais s’il s’agissait là de mauvais présages. Pourquoi mettre son désastre sur le dos de l’orage ?
Le soir même, alors que j’observais les racines d’un chêne tombé dans la rue, une autre explosion a retenti, près de la maison. Une voiture était passée à toute vitesse et quelqu’un avait lancé une grenade dans un bar, faisant tout voler en éclats. Il y avait des cadavres dans la rue, des blessés, des cris, le hurlement des ambulances et des voitures de police. Des années plus tard, j’ai rencontré quelqu’un qui se trouvait dans cette voiture. Il a raconté qu’il rentrait chez lui quand un ami s’était arrêté et lui avait proposé de l’emmener. Il monta dans la voiture. « On a juste quelque chose à déposer avant », dit l’ami. Sur le coup, il ne se douta de rien. Ils descendirent la rue, et un type assis sur le siège passager – qu’il n’avait jamais vu auparavant ni revu depuis – descendit la vitre. La voiture ralentit et il lança un paquet dans le bar. Le conducteur appuya sur l’accélérateur et ils s’enfuirent, laissant derrière eux le fracas d’une explosion. Après ça, l’homme qui rentrait chez lui ne prononça pas un mot pendant une semaine.
Le bar était un endroit où les réservistes de l’armée de l’air venaient traîner. À cette époque, on trouvait beaucoup de réservistes dans les rues, en particulier dans les bars. C’étaient surtout des hommes assez âgés, avec des tenues de camouflage chiffonnées et des uniformes mal ajustés, et ils portaient des armes. Ils appartenaient à tant d’organisations militaires et paramilitaires que l’on n’avait aucune idée, la plupart du temps, de qui il s’agissait. Ils provoquaient énormément de dégâts ; ivres, ils prenaient d’assaut des lieux d’où ils chassaient tout le monde, tirant sur les murs avec leurs AK47 à bout de souffle.
Il y avait eu – et il y avait encore – des désordres en Slovénie et en Croatie, mais personne ne pensait qu’il y aurait une guerre en Bosnie-Herzégovine. C’était impossible. Nous nous aimions les uns les autres. Nous prônions la souveraineté d’un pays multiethnique. Puis, après les élections générales, nous nous sommes rendu à l’évidence : nous ne nous aimions pas tant que ça les uns les autres. Chacun n’aimait que son camp et votait pour son propre parti, nationaliste. Les médias tenaient des propos contradictoires et j’ai arrêté d’écouter la radio et de regarder les nouvelles. La désinformation, me rappelais-je, ne fait que semer la peur et la haine.
Après l’attentat contre le bar, ma mère a décidé que la meilleure solution était de nous envoyer, ma sœur et moi, à Sarajevo. C’est la capitale, disait-elle, et il ne pouvait rien y arriver. À ce moment-là, de façon irrationnelle, tous partageaient la conviction que Sarajevo serait épargnée. Le lendemain, nous sommes allés à la gare et avons découvert que tous les trains avaient été annulés en raison des barricades dressées autour de Sarajevo. Ce qui s’est révélé providentiel, avons-nous compris par la suite, puisque deux jours après commençait le siège de la ville. Tandis que les obus pilonnaient Sarajevo, ma tante pleurait au téléphone en disant que leur maison se trouvait exactement sous la base militaire installée au sommet de la colline d’où provenaient les obus. Et il était pratiquement impossible de fuir.
Les tirs d’obus commencèrent aussi à Mostar, et j’étais réveillée par les mugissements de l’alerte générale dont l’intensité enflait et diminuait à la façon d’un chien hurlant à la lune. Ma mère courait dans la maison en criant : « Allez, allez, préparez-vous, on va aux abris. » Nous descendions les escaliers en désordre et rejoignions tous nos voisins dans la cave obscure où seuls avaient cohabité jusque-là du charbon, du bois et des souris. On y retrouvait de vieilles femmes avec leurs petits transistors collés à l’oreille, des enfants jouant en toute inconscience, des mères inquiètes et Olja, une de mes voisines enceinte de huit mois. Des hommes entraient et sortaient, discutant d’armement et de la « défense des femmes et des enfants ». Des jeunes gens des alentours qui avaient rejoint l’armée territoriale, un groupe de défense improvisé composé d’hommes de la région, exhibaient leurs uniformes composés de pantalons de camouflage et d’un casque pour trois.
La désinformation faisait tache d’huile. Les gens revenaient dans l’abri en annonçant des nouvelles comme : « L’armée a enfoncé toutes les défenses et massacre tout ce qui bouge » ou « On a signalé l’usage d’armes chimiques dans un village proche. Tout le monde est mort ! » La panique s’emparait de l’abri, faisait fondre les mères en larmes, tandis que les pères se tordaient les mains et que le visage des vieilles s’allongeait et se renfrognait de plus en plus. Tout ça, ils l’avaient déjà vu.
Une fois, je suis allée avec une amie prendre un café dans un des rares bars encore ouverts. C’était une journée paisible et nous voulions faire quelque chose qui nous donne l’illusion d’être normales. Après, nous avons décidé d’aller marcher, mais un groupe de gens nous a arrêtées dans la rue. « Où allez-vous ? » « Nous promener. » « Vous êtes folles ? ont-ils crié, l’air terrifié. On se bat dans les rues. Rentrez chez vous ! » Nous sommes rentrées à la maison, alors que le ciel était si bleu, traversé de nuages meringués. Les jeunes feuilles prenaient toutes les nuances de vert : émeraude, crapaud, pois, menthe. Le parc fabriquait un oxygène printanier tout frais pour nous et je songeais à l’obscurité du sous-sol humide qui m’attendait au retour.
À la maison, maman était assise à côté de la radio et pleurait. « Cet homme, sanglotait-elle. Il a pris le contrôle du plus grand barrage de Bosnie et veut le faire sauter si l’armée ne cesse pas de bombarder sa ville. » J’ai monté le son. Murat, l’homme en question, avait fait appel à la radio nationale pour diffuser ses menaces. Alija Izetbegović et le général Kukanjac, le président de la Bosnie-Herzégovine et le chef de l’armée yougoslave en Bosnie de l’époque, ainsi que Fatima, la sœur de Murat, avaient tous été joints au téléphone par la station de radio pour un débat diffusé en direct. Murat prétendait qu’il avait cent kilos d’explosifs avec lui et qu’il était prêt à faire sauter le barrage et à noyer la moitié du pays si sa demande n’était pas satisfaite. Le problème, c’est que le général affirmait que son armée ne procédait à aucun tir d’obus. Évidemment, il mentait. L’armée effectuait bon nombre de bombardements.
À la radio, le président tentait de calmer la fureur de Murat. « Ne faites pas ça, Murat. Ne faites pas ça maintenant, disait-il.
— Qu’est-ce qu’il entend par “maintenant” ? ai-je demandé à ma mère.
— Je vais le faire, je vais le faire sauter », criait Murat. Sa voix tremblait.
Puis sa sœur a pris la parole : « Murat, pense aux gens que tu vas noyer si tu fais sauter le barrage !
— Alors, Fatima, dis au général d’arrêter de bombarder notre ville et de tuer notre peuple, a répondu Murat.
— Arrêtez les bombardements, général », a rétorqué sévèrement Fatima.
Le général, sur le ton du défi : « Nous ne procédons à aucun bombardement. C’est quelqu’un d’autre. Nous ne bombarderions pas un peuple innocent. Peut-être est-ce votre propre peuple qui se bombarde lui-même et nous en rend responsable. »
J’ai pensé que c’était une hypothèse ingénieuse, mais Murat a rugi en direct à la radio nationale : « Allez vous faire foutre, Kukanjac. Vous êtes un connard de menteur. »
Le général a raccroché et j’ai applaudi. La Bosnie-Herzégovine venait d’envoyer à la face de l’armée yougoslave une gifle, modeste mais lourde de sens. Récemment quelqu’un évoquait Murat et nous nous demandions ce qui lui était arrivé. On a découvert qu’il n’avait pas d’explosifs ; il bluffait complètement.
Nous avons quitté la ville ce jour-là. Les obus meurtriers retombaient en formant des courbes parfaites, laissant des « roses de pavé » sur l’asphalte. Une « rose de pavé », c’est une excavation constellée de petits trous disposés en cercles concentriques. Ça ressemble un peu à une rose, mais davantage encore à une giclée indélébile de vomi. Voici les souvenirs que nous avons de la guerre.
Nous avons quitté la ville dans une voiture de police, grâce à une policière amie de ma mère. En traversant les rues désertes, les soldats de l’armée serbe et des unités territoriales (constituées, à cette époque, de musulmans et de Croates) s’agonissaient d’injures sur leurs talkies-walkies, et la radio de la police interceptait leurs insultes fleuries :
« Bande d’enculés, on va écraser vos crânes d’islamo-catholiques. »
Grésillements.
« Votre poète le plus connu, Njegoš, est mort de la syphilis. Il enculait des moutons. »
Nouveaux grésillements.
La voiture gravissait la colline et bientôt on a pu voir la ville se déployer en contrebas. On a cessé de capter la radio.
COMME SI LA TERRE BASCULAIT
Pour m’obliger à quitter la ville sans faire d’histoire, ma mère m’avait amadouée en me promettant de me laisser partir seule en vacances au bord de la mer avec des amis. J’y ai cru et j’ai préparé un petit bagage. « Une semaine seulement », avait-elle dit. De toute façon, les choses s’aggravaient. Sans le vouloir, ma mère a tenu sa promesse – nous sommes partis vers la côte Dalmate, avec des centaines de milliers d’autres habitants de Bosnie-Herzégovine et les Croates touchés par la guerre. Et l’exil a pris la forme d’une errance interminable semblable à de tristes vacances. Je suis restée six mois au bord de la mer avec ma sœur et ma meilleure amie, pendant que ma mère se partageait entre Mostar où mon père était resté, et la Dalmatie. L’été 1992 a battu le record des foules balnéaires les plus sinistres au monde et à cause du manque de nourriture et de l’angoisse accumulée, celui des plages couvertes des corps les plus maigres qui soient. Et alors même que les chances de rentrer à la maison semblaient s’éloigner de plus en plus, la guerre ne paraissait pas réelle et je ne parvenais pas à y croire. J’étais persuadée qu’en septembre, je retournerais à l’école et que tout redeviendrait normal. Même le nombre croissant de morts, diffusé à la radio sur un ton monotone – le ton qu’on prend pour lire de la poésie, celle de T. S. Eliot par exemple –, paraissait irréel.
Puis un jour le téléphone a sonné dans la maison où nous étions réfugiées. Nous étions hébergées par une des familles locales qui avaient ouvert les pièces humides et les corridors sonores des étages supérieurs de leur maison, réservés habituellement aux vacances d’été, pour nous y faire dormir. Nous recevions peu d’appels téléphoniques. D’une voix affolée, mon oncle m’a dit d’aller chercher ma mère et de ne pas revenir avant de l’avoir trouvée ; il était arrivé une chose terrible, ma tante avait eu un accident en essayant de quitter la ville sur une route non éclairée au plus noir de la nuit, dans une voiture avec quatre autres personnes ; elle était seule à avoir été blessée et elle était peut-être en train de mourir.
J’ai couru, couru, essayant de trouver ma mère partie nous chercher une chambre, nos hôtes ayant décidé qu’ils en avaient assez d’avoir des réfugiés chez eux. J’ai détecté ma première varice alors que je courais, montant et descendant la seule rue du petit village de bord de mer, tout d’abord avec beaucoup d’énergie, puis à la longue au rythme d’un soldat blessé à la jambe et traînant la patte.
Il paraît qu’on avait trouvé ma tante gisant sur la route, tout près de la maison qu’elle occupait en ville, avec trois fractures à la colonne vertébrale. On l’avait prise en charge avec précaution et emmenée à l’hôpital. Les médecins, qui donnent toujours les mauvaises nouvelles de la même façon – en se frottant le menton, en se caressant le nez ou en essuyant leurs lunettes d’un bout de tissu doux – ne pouvaient rien pour elle et s’en remettaient à un meilleur centre de soins, plus important, puis à un autre. Pendant des kilomètres nous avons accompagné son corps brisé, d’hôpital en hôpital, à travers des villes et des villages ravagés et, finalement, jusqu’au cimetière. À certaines étapes, nous avons emprunté des moyens de transport poussiéreux et puants ; on ne voyait plus que le blanc de nos yeux dans la nuit noire. Nous en avons passé quelques-unes dans des carcasses de voitures où ne restaient que les sièges nus, et leurs pneus durcis faisaient crisser le sol comme des ongles sur un tableau noir. Nous avions pris place dans ces monstres de métal, silencieux et avachis, comme des victimes sans méfiance et résignées, la gorge serrée et les yeux écarquillés. Le dernier jour, ma mère était assise à côté de moi, drapée dans un châle de deuil, la bouche serrée, les lèvres pâles et affaissées, les yeux rouges et le regard perdu.
Pendant les mois qui ont suivi sa mort, je parvenais à me convaincre que ma tante était encore en vie et se portait bien, dans son F1 à l’est de la Bosnie, assise devant sa machine à coudre, joyeuse et bavarde, les yeux plissés derrière ses lunettes demi-lune. Ou qu’elle sculptait les dents de sa dernière création de prothèse – elle était prothésiste, et son appartement était toujours plein de caoutchouc pour dentiers et de fausses dents – pendant que de doux flocons de neige venaient fondre sur les vitres des fenêtres. Elle faisait les vêtements et les dentiers de toute la famille. Dès que quelqu’un perdait sa dernière véritable dent en mordant une pomme dure, tante Mira était là pour appliquer le moule en caoutchouc sur ses mâchoires et inventer l’éclat de son futur sourire. Je rêvais que j’allais cueillir à nouveau des fraises sauvages dans les bois proches de sa maison et je me rappelais son fameux gâteau glacé, un dessert si délicieux que je peux encore ressusciter la façon dont il fondait sur ma langue et cette sensation d’impatience et de respect alors que nous nous tenions debout devant le congélateur comme devant un autel.
À sa mort, il semble que le monde entier a changé. Finies les vacances en famille comme sur les photos décolorées ; elle ne klaxonnerait plus jamais devant la maison en garant sa Renault 4 au levier de vitesse à côté du volant, comme sur les voitures de sport. Nous n’irions plus jamais tous ensemble sur la côte, avec les enfants qui chantaient sur la banquette arrière et se battaient pour savoir qui serait le premier à repérer la mer (« Moi, moi, moi ! »). Nous n’irions plus la voir en hiver, ni faire de la luge, ni patiner sur la rivière gelée.
Il y avait du monde aux funérailles et le soleil cognait dur sur les proches endeuillés dont le cortège avançait lentement, comme un serpent noir. Les femmes en tête poussaient des cris, leurs bras formant une tresse si serrée qu’on ne pouvait savoir lequel appartenait à qui. Elles se soutenaient réciproquement, certaines défaillant de douleur, d’autres essuyant leurs larmes avec de petits mouchoirs blancs. Ma grand-mère, une larme sur la joue, remerciait Dieu que nous puissions au moins enterrer le corps avec dignité, contrairement à tant d’autres familles bien à plaindre qui n’avaient jamais retrouvé les corps de leurs parents. Étant donné les circonstances, je suppose que ma grand-mère avait raison. Nous avions de la chance, en pervertissant le sens du mot. Nous devions être reconnaissants d’avoir eu la possibilité d’honorer la mémoire de ma tante. Chaque membre de la famille prit une poignée de terre noire et la jeta sur le cercueil brillant. La terre fit un bruit sourd et brutal, et se répandit sur les côtés.
Pendant les funérailles, ma mère a parlé d’une occasion qui s’offrait d’aller en Grande-Bretagne. C’était un convoi réservé aux femmes et aux enfants et elle a ajouté que seules ma sœur et moi en ferions partie. « Et toi ? » ai-je demandé. « Je vais rester là », a-t-elle répondu, mais en voyant mon visage terrifié, elle a précisé : « C’est seulement pour six mois. Pas pour toujours, idiote. » Que ce soit sur une période courte ne me rassurait aucunement car je comprenais que le temps n’était rien face aux évènements. Je ne voulais pas penser au danger auquel j’allais échapper et que ma mère devrait affronter. Certes, l’ambiance était pourrie à la maison, je voulais partir. Mais si je m’en allais, est-ce que je trahissais, est-ce que je les abandonnais eux tous ? Et qu’allais-je devenir ? Les jours suivants, j’ai écouté une chanson populaire interprétée par une voix masculine à vous arracher le cœur : « Je ne quitterai jamais cette ville, tout ce qui est à moi est ici. » Une vraie torture. Devais-je quitter ma famille, ma langue, ma culture, mon enfance, mes amis, tout ce que j’avais ? Ou devais-je rester et essayer de me battre ? Ou devenir infirmière ? Je pouvais partir jusqu’à ce que la situation s’arrange, améliorer mon anglais et revenir. Certainement. Et ensuite, je pourrais être infirmière.
Je me demande souvent ce qui serait arrivé si j’avais décidé de rester en Bosnie. Que serais-je à présent ? Je pouvais devenir n’importe qui : une mère assise devant la télévision avec deux enfants à ses côtés ; une secrétaire se limant les ongles et soupirant en regardant l’horloge ; une femme d’affaires ayant réussi ; un corps gisant sous une stèle de marbre noir avec mon nom, mes dates de naissance et de mort ; un agent d’une organisation humanitaire ; une fleuriste.
Nous avons déménagé dans la maison de ma grand-mère, dans un petit village d’Herzégovine en attendant la date du départ. Les jours passaient lentement et les semaines s’étiraient comme des chenilles aveugles.
GRAND-MAMAN
La maison de ma grand-mère était une minuscule boîte blanche d’une seule pièce, avec un grenier en forme de triangle et un plafond bas et gris. Des souris couraient à travers le grenier, au milieu du blé et du maïs, et vous pouviez les entendre trotter au-dessus de votre tête. Au plafond, tête en bas, des mouches se frottaient les pattes. Elles s’activaient en bourdonnant et se calmaient dans l’obscurité quand grand-maman allait se coucher. La journée, elle restait sur son lit, la tapette en plastique levée, et elle frappait les mouches qui n’arrêtaient pas de tourner autour de sa tête, sans les regarder, comme un maître en karaté.
Grand-maman portait une robe noire à manches longues avec de minuscules boutons sur le devant, et un châle noir recouvrant deux nattes grises enroulées autour de sa tête comme des bretzels. Quand elle ôtait son châle, je la regardais peigner sa mince chevelure. Elle portait le noir depuis que mon grand-père était mort, en 1980, comme signe d’un deuil et d’un veuvage éternels, ce que les femmes du village étaient supposées faire à la mort de leurs maris. Elle vivait dans la petite maison depuis soixante ans, âge du mûrier à côté de la maison, l’arbre qu’elle avait planté lorsqu’ils avaient emménagé. Lorsqu’elle est morte, à un peu plus de quatre-vingt-dix ans (personne ne connaissait exactement son âge car personne ne savait vraiment quand elle était née), elle était plutôt en bonne forme, aussi bien mentale que physique. Elle avait eu huit enfants, des douzaines de petits-enfants puis plusieurs arrière-petits-enfants, et elle se rappela le nom de chacun d’entre eux jusqu’à sa mort.
Grand-maman était catholique et elle priait tous les jours, sans avoir jamais lu la Bible. Je le sais parce qu’elle était analphabète. Pourtant, elle avait des lunettes dont elle se servait quand elle tricotait. C’était une tricoteuse étonnante – elle faisait des pantoufles ou les ceintures que les franciscains portaient sur leurs bures brunes, ces cordons blancs qui ressemblent à des attaches de rideaux. Elle les tricotait avec huit aiguilles, dans un état de concentration absolu, ses épaisses lunettes pour voir de près se balançant sur son nez. Sa vue était encore assez bonne à plus de quatre-vingt-dix ans.
Une fois, j’ai essayé d’apprendre à écrire à grand-maman. J’avais environ sept ans et je voulais qu’elle puisse lire les journaux, sans être réduite à ne regarder que les images, alors j’ai pris un crayon et un morceau de papier, j’ai pris sa main dans la mienne et j’ai commencé à former les lettres. La mine de plomb a craché un A difforme, un B bouffi et un C bossu. Un temps, elle s’est prêtée au jeu, sans doute seulement pour me faire plaisir, mais un jour elle a décidé qu’elle en avait assez. Elle a compris que ce n’était pas histoire de m’occuper deux ou trois jours avant de me lasser, et que je voulais vraiment lui apprendre à écrire. Alors elle a dit : « Désolée, petite, mais je ne peux pas, je suis trop âgée. Ça me fait mal à la tête. »
Par la suite, quand nous allions voir grand-maman le week-end, j’attrapais les mouches au plafond, leur arrachais les ailes, et les mettais dans une boîte d’allumettes en observant leurs efforts pour en sortir. J’avais une méthode magique pour les attraper. Ça marchait seulement pour les mouches installées au plafond. Je remplissais à moitié un verre d’eau, j’y ajoutais un peu d’huile d’olive qui restait en surface, j’en appliquais le bord au plafond avec la mouche à l’intérieur. L’insecte s’abandonnait au liquide huileux, y plongeait la tête la première, comme si elle n’avait jamais rien souhaité d’autre.
Ma mère dit que quand elle était adolescente, grand-maman était très sévère. Elle ne laissait pas les filles sortir. Maman était la plus jeune de ses huit enfants et elle n’arrête pas de dire qu’elle n’avait pas vraiment de mère, qu’elle ne pouvait jamais parler avec grand-maman de ses problèmes ou demander un conseil, parce qu’elle était trop sévère. Un jour, elle est sortie avec un garçon du village, en jupe courte, et grand-maman l’a poursuivie avec une canne et a frappé ses jambes nues devant son copain. Bien sûr, elle n’a jamais revu le garçon. Ma mère était une adolescente pendant les années soixante et une jeune femme pendant les années soixante-dix, époque où les femmes étaient censées être libérées. Mais il n’y avait aucune liberté au village. Alors maman est partie pour aller chercher en ville du travail et la liberté.
C’était différent avec grand-papa. Il avait l’habitude de donner de l’argent à ma mère et la laissait sortir quand elle le voulait. Je me le rappelle assis près de la fenêtre, observant la rue, avec son béret noir. Il fumait du tabac qu’il cultivait lui-même. Quand j’étais toute petite, je sortais avec lui tôt le matin pour glaner les feuilles de tabac sèches sur le sol où elles prenaient le soleil et je les enfilais, en les transperçant avec une grosse aiguille rouillée, sur un fil épais pour les suspendre au mur. Elles avaient une légère odeur de moisi.
Quand grand-maman priait, c’était tout bas. Elle faisait naviguer entre ses doigts son chapelet dont elle testait le grain. Il était impossible de l’interrompre quand elle priait. J’ai essayé à de nombreuses reprises. C’était pour lui demander quelque chose, lui raconter des blagues ou des histoires tristes, mais elle m’ignorait, tout simplement. Parfois elle s’arrêtait pendant une seconde, crachait dans son mouchoir et se remettait à remuer les lèvres en silence, sa bouche laissant parfois échapper quelque fricative.
Quand la guerre a commencé, c’était pour grand-maman la troisième. Née autour de 1912, elle était encore enfant pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la seconde, elle était déjà une femme mariée avec des enfants et vivait dans la petite maison avec grand-papa. Pendant cette guerre, grand-papa a enterré leur machine à coudre afin que personne ne vienne la voler, partisans ou Allemands. Quand il l’a ressortie de terre en 1945, en parfait état, tout le monde en a parlé pendant des années. Ma grand-mère avait l’habitude de me montrer le mur en face de la maison où l’on pouvait lire le slogan écrit par les partisans à la peinture rouge : « la liberté pour tous. » À présent on ne peut plus le voir parce qu’on l’a chaulé, mais quand il pleut beaucoup, on aperçoit les lettres rouges sous la chaux.