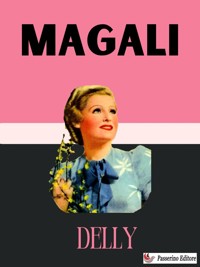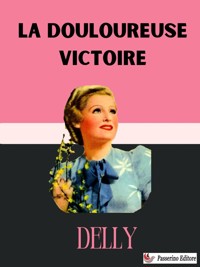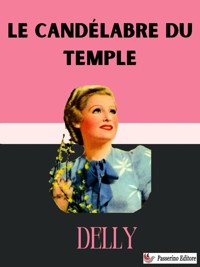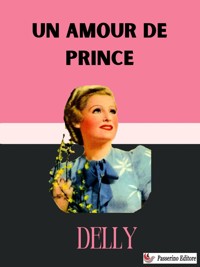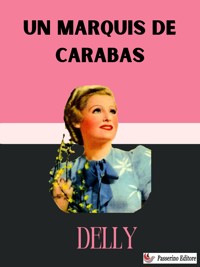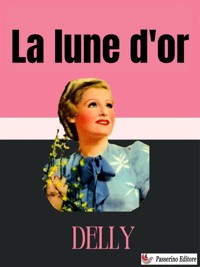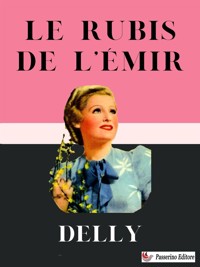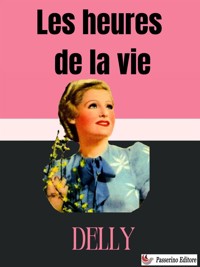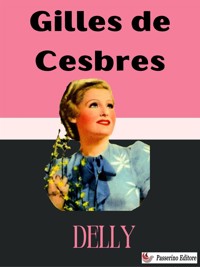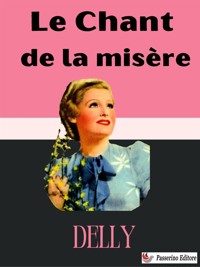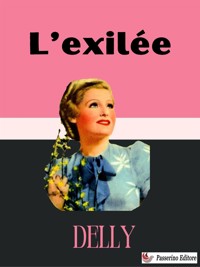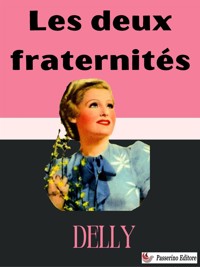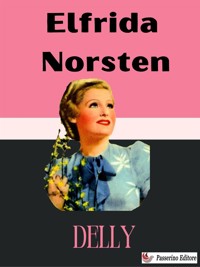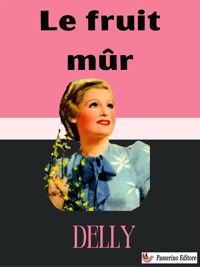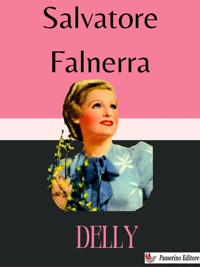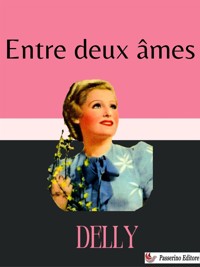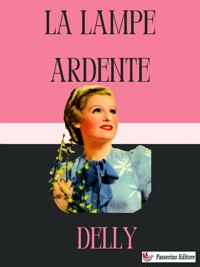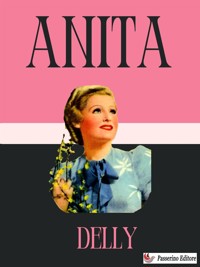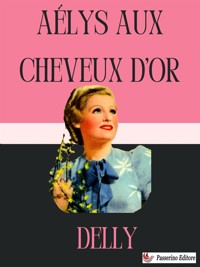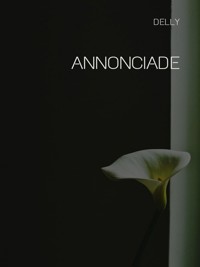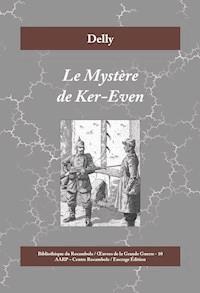
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encrage Édition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Œuvres de la Grande Guerre
- Sprache: Französisch
Romances et mystères en BretagneParu dix mois après La Fin d’une Walkyrie, toujours dans L’Echo de Paris, Le Mystère de Ket-Even, grand roman d’espionnage inaugure les « Delly double », romans plus longs qui vont désormais alterner, dans l’œuvre de l’auteur, avec ses romans habituels. Pour ce format, Delly va plonger vraiment dans le roman populaire et bâtir une intrigue remarquablement prenante, sur un fait d’actualité documentaire contemporain, la Grande guerre en cours, avançant son explication personnelle, si l’on peut dire, du conflit, dont les racines sont à rechercher loin dans le prologue de l’avant-guerre, dans les réseaux sournois que nos cousins « germains » sont sensés avoir tissé dans notre pays trop confiant. Delly s’appuie en fait tout simplement sur la littérature de propagande dénonçant l’espionnage allemand installé en France.Le crime, motif feuilletonesque essentiel, sature littéralement le récit, et la volonté criminelle est un moteur majeur de l’intrigue. Ici, cette volonté criminelle a comme nom le pangermanisme. De fait, les monstres moraux vont devenir de plus en plus noirs et monstrueux d’un roman dellyen à l’autre, dans une tentative sans cesse renouvelée d’atteindre à la noirceur sublime et totale, idéal toujours à surpasser, tandis que les anges de bonté opteront pour le chemin symétrique et inverse. Parcourir tous les échelons du Mal chez Delly semble être une source de délice pour cet auteur autant que pour ses lecteurs.Suspense, histoires d'amour, secrets : tout est au rendez-vous pour séduire le lecteur tout au long de ce romanEXTRAIT Il pleuvait depuis le matin — petite pluie fine, serrée, que les marins appellent « crachin ». Elle noyait l’horizon, étendait son triste voile gris, humide, sur la mer sombre presque tranquille aujourd’hui, sauf autour des récifs contre lesquels, toujours, elle écumait en vagues pressées, rageuses, comme demandant aux rocs sournois la proie qu’ils lui avaient si souvent procurée, depuis des siècles.La route conduisant au petit port de Conestel n’apparaissait pas cependant trop boueuse, grâce à son sol dur — un vrai sol de granit ! comme le répétait le colporteur qui avançait d’un pas lourd, en poussant devant lui une petite voiture recouverte d’une toile cirée.C’était un homme d’environ quarante-cinq ans, plutôt petit, maigre, les cheveux blonds grisonnants. Des yeux d’un bleu vif brillaient dans sa face blafarde, aux traits mous. Une longue pèlerine en drap verdi tombait sur ses épaules, un large béret noir le coiffait. Des bottes solides montaient jusqu’à ses genoux, et leurs semelles épaisses, leurs talons ferrés martelaient le sol, qui rendait un son mat.A PROPOS DE L'AUTEUR Derrière le nom de Delly se cache en réalité un frère et une soeur, Jeanne-Marie et Frédéric Petitjean de la Rosière. Ayant connu un succès retentissant, ces deux écrivains sont emblématiques de la littérature populaire de la première moitié du XXe siècle. Adoptant une attitude moraliste dans leurs oeuvres, leurs romans revêtent pour la plupart un caractère sentimental.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 724
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage est proposé dans le cadre des ressources du Centre Rocambole accessible par Internet à l’adresse :
www.lerocambole.net
Edition électronique réalisée avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Picardie
Bibliothèque du Rocambole
Œuvres de la Grande Guerre - 10
collection dirigée par Alfu
Delly
Le Mystère de Ker-Even
1916
AARP — Centre Rocambole
Encrageédition
© 2014
978-2-36058-915-9
Avertissement
de Philippe Nivet
Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Picardie
Directeur du Centre d’histoire des sociétés, des sciences et des conflits
Pendant la Première Guerre mondiale, la diffusion de la culture de guerre passe par différents vecteurs : la presse enfantine, à l’image du journalFillette, la presse illustrée, commeL’IllustrationouLe Miroir, ou les estampes, à l’exemple de celles de Jean-Louis Forain.
Le roman populaire, souvent publié d’abord en feuilleton, participe également de cette diffusion.
Exemple notoire : dans L’Eclat d’obus, roman de Maurice Leblanc, initialement publié dans les colonnes du Journal en 47 feuilletons quotidiens à l’automne 1915, on trouve ainsi de multiples dénonciations de la « guerre à l’allemande », marquée par les violations du droit des gens : « Assassiner et espionner, c’est pour [les Allemands] des formes naturelles et permises de guerre, et d’une guerre qu’ils avaient commencée en pleine période de paix ». Guillaume II y est présenté comme « le plus grand criminel qui se pût imaginer », tandis que les actes commis par les soldats allemands lors de l’invasion y sont résumés de manière saisissante : « Partout, c’était la dévastation stupide et l’anéantissement irraisonné. Partout, l’incendie et le pillage, et la mort. Otages fusillés, femmes assassinées bêtement, pour le plaisir. Eglises, châteaux, maisons de riches et masures de pauvres, il ne restait plus rien. Les ruines elles-mêmes avaient été détruites et les cadavres torturés ».
Si son insertion, en 1923, dans la série des Arsène Lupin a donné à ce roman une audience particulière, les thématiques qu’il développe se retrouvent dans d’autres textes de Maurice Leblanc et dans ceux de la plupart des auteurs populaires du temps, depuis Gaston Leroux jusqu’à Delly, en passant par Jules Chancel ou les auteurs des brochures de la collection « Patrie », tel Gustave Le Rouge ou Léon Groc.
Encrage Edition et le Centre Rocambole (centre de ressources international fondé par l’Association des Amis du Roman Populaire) ont la judicieuse idée d’exhumer ces documents et de les republier dans cette période marquée par la célébration du Centenaire de la Première Guerre mondiale. Le lecteur de ce début du XXIe siècle y verra comment étaient célébrés les soldats français, héroïques quels que soient leur âge et leur parcours antérieur, dénoncés les espions travaillant de longue date au profit de l’Allemagne et condamnées les atrocités de l’invasion. C’est toute une culture de guerre, assimilée par certains à un « bourrage de crâne », que l’on retrouve.
Préface
de Jean-Luc Buard
Quand Delly se dédouble
Dix mois après la fin de La Fin d’une Walkyrie (paru en 58 feuilletons dans L’Echo de Paris du 9 novembre 1915 au 2 janvier 1916) 1, le 2 octobre 1916, débute la publication du Mystère de Ker-Even, grand roman d’espionnage (101 épisodes jusqu’au 10 janvier 1917), neuvième roman de Delly dans ce journal depuis 1909.
Dans la bibliographie de Delly publiée dans Le Rocambole n°55-56 en 2011, ce roman est le 44e dans l’ordre chronologique des publications de l’auteur (depuis 1903), qui s’approche ainsi du milieu de sa production — en nombre de titres, 90 en tout.
En réalité, ce milieu théorique vient d’être franchi cette même année 1916, car il se trouve que Delly a publié, dans l’intervalle, quelques contes dans le même journal.
La guerre de 1914-1915 se prolongeant,L’Echo de Parisreprend, à la fin de l’année 1915, la publication de « Contes & récits » quotidiens, comme la plupart des journaux, telsLe JournalouExcelsior, alimentés de récits qui n’ont pas tous trait à la guerre en cours, mais qui ont pour mission de distraire le lecteur, brièvement et tous les jours, et de l’extraire d’un quotidien grisâtre et morose, le feuilleton de longue haleine n’ayant pas nécessairement cette fonction ou ne suffisant pas à la tâche.
Le 2 novembre 1915, le directeur littéraire de L’Echo de Paris, Charles Foley, présente un échange de lettres entre une marraine de guerre et son filleul, sous le titre « La vie militaire contée par les soldats ». Ce n’est pas le début d’une nouvelle rubrique régulière, mais presque. Du 20 novembre au 7 décembre, le journal publie « Les récits de guerre du comte Alexis Tolstoï », une série de nouvelles traduites du russe par Serge Persky, alors que s’achève la publication d’un document sensationnel, « Histoire secrète de Bertha Krupp », l’histoire de l’unique héritière des célèbres usines d’armement, signée Henry W. Fischer (publiée depuis le 22 septembre).
Les « Contes & récits deL’Echo de Paris» débutent formellement le 12 décembre, avecLa Chatte, signé Pierre L…, récit de guerre écrit dans la tranchée de V… Le 13, paraîtPeu de chose, une enfant… d’Alfred Machard, et le 14,Le Géranium rosede Delly, l’auteur du roman-feuilleton en cours,La Fin d’une Walkyrie. La rubrique est alimentée ensuite par les autres collaborateurs littéraires du journal, Lya Berger, Guy de Téramond, Marc Elder, François de Nion, Hernri Allorge, Eve Paul-Margueritte, André Doderet, Georges Montignac, Trilby, Maurice Vaucaire, Gustave Guesviller, etc. D’autres contes d’Alexis Tolstoï sont traduits, et même un conte de Phillips Oppenheim,Les Deux joueurs, le 20 décembre.
Delly apparaît cinq fois : après Le Géranium rose (qui sera réédité par Tallandier en 1960 à la suite de la nouvelle édition de La Colombe de Rudsay Manor), paraissent La Petite (13 janvier 1916), Le Chant de la paix (27 février), La Fille de la Roussalka (16 avril) et Madame Ambroise (3 juin, conte également reproduit en 1960 par Tallandier, voir les n°86 et 87 de la bibliographie du Rocambole). Il est à noter que deux de ces contes sont situés en Russie, lieu d’une partie de l’action de La Fin d’une Walkyrie.
Mais, probablement accaparé par la rédaction du Mystère de Ker-Even, et peut-être peu inspirée par le genre court, Delly délaisse la composition de ces contes, à notre grand regret bibliographique. Ce petit intermède permet de redater deux textes courts de notre inventaire des œuvres de Delly, et d’en ajouter trois autres, inconnus, entre les n°43 et 44 2.
Il résulte de tout ceci queLe Mystère de Ker-Evenoccupe désormais la 49e place (sur 93) dans la liste des œuvres publiées de l’auteur, c’est-à-dire que nous avons franchi la moitié de l’œuvre en nombre de titres entre le 27 février et le 16 avril 1916, mais Delly l’ignore, évidemment.
Par contre, Delly sait une chose, essentielle pour le développement de sa carrière littéraire. Avec la rédaction de ce nouveau roman, elle inaugure une phase entièrement nouvelle de son œuvre.Le Mystère de Ker-Evenest en effet le premier « Delly double », le premier « grand roman » de Delly, ceux que Tallandier publiera ensuite en deux volumes.
Ces « grands romans » seront désormais une des marques de fabrique de l’œuvre à venir. Ils alterneront avec la rédaction de romans de longueur standard, à raison d’un « grand roman » pour deux romans courts. Ils seront au nombre de 13, occupant 27 volumes de format ordinaire (car l’un d’eux,Ourida, demandera trois tomes), auquel on peut rajouter un 14e titre formant un volume plus épais qu’un volume simple,Le Repaire des fauves. Cinq d’entre eux paraîtront en feuilleton (dansL’Echo de Parispuis dansLe Petit Journal) jusqu’en 1924, les neuf autres seront posthumes. C’est une véritable rupture dans l’élaboration créatrice de Delly, qui passe du conte bref au début 1916 au feuilleton de longue haleine à la fin de l’année !
Une hypothèse permet d’expliquer ce renouveau créatif : l’implication accrue de Frédéric dans l’élaboration et l’écriture des romans 3. Cette hypothèse est d’abord purement mathématique : l’écriture à quatre mains permet de doubler le volume à écrire.
Elle s’étaie cependant sur une observation formelle : avec Le Mystère de Ker-Even, l’inspiration de Delly change résolument. Pour occuper 100 feuilletons, une « simple » intrigue sentimentale ne suffit pas, même compliquée de divers incidents annexes. Il faut autre chose, et cette autre chose, la guerre va d’abord la fournir. Il faut intégrer l’intrigue sentimentale dans un cadre plus vaste, tisser d’autres fils narratifs, mettre en marche des ressorts thématiques convenus ou inattendus, permettant de se lancer dans des développements, qui occuperont, pour commencer, une certaine « durée narrative ». Cette durée narrative est celle qu’offre le roman populaire ou le roman-feuilleton, véhicule idéal pour parcourir les générations ou du moins suivre ses héros (positifs et négatifs) depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte, et leur donner le temps de développer leur potentiel, de révéler leur essence, les uns tournés vers le Mal et la Noirceur (tentant de réaliser leur idéal de « Bonheur dans le crime »), les autres vers le Bien et la Blancheur (s’opposant aux premiers pour faire triompher le droit et la justice). Il faut alors corser la fiction et se jeter dans le roman d’aventures. Et pour cela, il apparaît que l’aide de Frédéric devient déterminante.
Delly s’était déjà essayé au roman d’aventures avant la guerre, en particulier avec Le Roi des Andes (1909). Mais ce roman fait une curieuse impression sur le lecteur. Il ne semble être qu’un galop d’essai, dans un genre peu familier à l’auteur. On voit bien comment Delly y explore le riche fonds du roman populaire, avec ses sociétés secrètes, ses intrigues parallèles, ses courses-poursuites, ses mystères et ses trésors. Cet essai honorable tranche déjà beaucoup sur la production antérieure de l’auteur. L’on est amené à se dire qu’une inspiration seconde se mêle à la trame principalement dellyenne, et que cette aspiration au roman d’aventures pourrait bien être le fait de Frédéric, qui interfère avec celle de sa sœur Marie, bien visible.
Avec Le Mystère de Ker-Even, le pas est franchi. Nous sommes désormais, à fond, en plein roman populaire et, de surcroît, en plein roman d’espionnage, ce qui, pour Delly, est une innovation sans précédent. Nous sommes dans une narration purement feuilletonesque, parfaitement maîtrisée, totalement assumée, jusqu’à la dernière ligne. Delly a assimilé ses classiques et bâtit une intrigue remarquablement prenante, sur un fait d’actualité documentaire contemporain, la Grande guerre en cours, et avance son explication personnelle, si l’on peut dire, du conflit, dont les racines sont à rechercher loin dans le prologue de l’avant-guerre, dans les réseaux sournois que nos cousins « germains » sont sensés avoir tissé dans notre pays trop confiant. Ainsi, on peut s’amuser à calculer en quelle année le récit commence (le lecteur attentif repérera qu’il s’écoule un espace de douze ans avant le début de la guerre). Delly s’appuie en fait tout simplement sur la littérature de propagande dénonçant l’espionnage allemand installé en France que son journal L’Echo de Paris n’est pas le dernier à accuser, et qui avait déjà donné lieu à des fictions, comme celles de L’Employé de chez Kub et Le Chef des K de Jean Drault, dans L’Ouvrier 4.
Notons à ce propos que l’Allemagne n’est pas le pays préféré de l’auteur, qui y situe rarement ses intrigues, préférant des royaumes d’opérette d’Europe centrale, et qui avait déjà composé avant-guerre des romans, sinon antigermaniques, du moins exposant des personnages d’Allemands fort antipathiques (voir ainsi Dans l’ombre du mystère, dans L’Echo de Paris, 1913).
DansLe Mystère de Ker-Even, Delly utilise sa passion pour la Bretagne comme cadre d’une intrigue exemplaire, destinée à stipendier la perfidie de l’ennemi. Mais Delly multiplie les cadres narratifs, pour donner de la variété et du pittoresque à son récit. Elle nous promène dans les magasins parisiens, qu’elle décrit comme truffés d’agents allemands, à la veille de la guerre (p. 181). Elle nous emmène en territoire ennemi, en Allemagne5, puis dans un hôpital de la région de Lille et de Valenciennes, pour nous faire retraverser les lignes de front, de manière rocambolesque, disons-le. C’est d’ailleurs le seul roman de Delly situé dans le Nord de la France. Il fait aussi partie du petit groupe de romans datés et situés dans l’espace et dans le temps, le temps de la guerre et l’espace géographique réel, avec des notations comme la mention de la gare des Invalides et la rue de Varennes, à Paris (2e partie, chap. 4, p. 148-149), les villes de Reims et Versailles (ville habitée par l’auteur), où un des personnages est en garnison, de Saint-Germain, etc. On mentionne même Amiens et son hôpital (p. 264 et 267).
Tout ceci ne constitue, en fait, qu’un cadre obligé du récit de guerre. Celui-ci présente ici un intérêt supplémentaire, que l’on pourrait qualifier de conjectural. Embarqué dans une intrigue à ramifications multiples, inspiré par ce puissant outil narratif qu’est le roman-feuilleton et ses nécessités structurelles, Delly se met à délirer, ou peut-être à anticiper. Lancé à toute vapeur sur les voies de l’imaginaire débridé, le romancier se fait voyant, et construit une fiction, qu’il n’est peut-être pas tout à fait téméraire de qualifier de scientifique…
Car l’on sait que, de tout temps, le roman d’espionnage se plaît à extrapoler, par exemple à inventer des gadgets un peu en avance sur son époque, à se nourrir d’imaginaire, de conjectures et de suppositions. On y vole les plans et les idées d’inventions nouvelles… Le monde occulte et secret de l’espionnage autorise et encourage ces avancées dans l’imaginaire. Et ce qu’imagine Delly comme « Mystère de Ker-Even » est pour le moins assez grandiose, et même tout à fait délirant.
Qu’est-ce que des touristes allemands, se demande-t-on, peuvent trouver comme intérêt à cette côte bretonne désolée qui fait l’admiration de ses habitants ? Eh bien ! Mais c’est l’endroit idéal pour aménager une base secrète pour sous-marins, dans les grottes qu’on dit y exister. Voilà bien une idée de Frédéric !
Cette inspiration rocambolesque, nouvelle chez Delly, se retrouvera souvent, à divers titres, dans les « Delly doubles », dont la caractéristique commune est d’être systématiquement feuilletonesque et de proposer des aventures extraordinaires, et parfois délirantes. Les personnages de ces fictions longues sont typiques de cet univers de feuilleton. Les personnages négatifs sont abominables jusqu’à la caricature, à un tel point que c’en devient presque comique. Ils se nourrissent littéralement du Mal, ils s’en repaissent et s’en vantent. La jeune Elsa est très fière de se faire traiter de « petite espionne » par sa tante (p. 67), et en tire gloire une fois adulte (« Ce sont les nécessités du métier que j’exerce — du glorieux métier d’espionne allemande », p. 144). La duplicité est revendiquée par ces personnages, fiers de mener double jeu, double vie et de porter des masques pour tromper leur entourage franc et naïf.
Mais cela fait aussi partie du jeu narratif. Ainsi l’ennemi est-il qualifié de « pirate » par le narrateur, et il en a les attributs, pour cause de guerre : une jambe de bois et un bandeau noir sur l’œil… (3e partie, chap. 3, p. 280). Ces personnages sont habités d’un orgueil démesuré, qui sera combattu impitoyablement par les personnages positifs, habités, eux, par une force invincible tournée vers la justice. La capacité de nuisance du monstre moral ne peut cesser que par sa mise hors de combat définitive, ce qui arrive le plus tard possible dans un récit à rebondissements incessants. Le monstre moral féminin n’est pas un personnage inédit chez Delly (que l’on songe à la Walkyrie du roman précédent !), mais il sera souvent réemployé dans les « grands romans ». A cet être malfaisant, s’oppose un ange de bonté, son envers absolu et inconciliable, mais doué de pitié et de commisération pour son antagoniste impitoyable. Le récit tire son énergie de cette machinerie manichéenne traditionnelle inusable. Dans les deux sens, les sentiments sont exacerbés. Ces motivations puissantes sont des moteurs naturels du feuilleton, qui s’épanouissent dans un contexte favorable de lutte dissymétrique, s’appuyant sur les données obligées du genre, telle qu’enlèvement et autres traîtrises, le désir effréné de vengeance de la part du monstre sans cesse tenu en échec, ou l’amnésie du héros qui sait tout du monstrueux complot en cours, mais a tout oublié, nourrissant un suspense de bon aloi… La présence suffocante du secret s’épanouit grâce à un réseau souterrain qui double la surface narrative du récit, réseau qui plonge dans le passé le plus ancien… Le souterrain breton trouvera un nouvel emploi dans un autre « Delly double », Hoëlle aux yeux pers/La Fée de Kermoal (dont certains personnages sont aussi d’origine espagnole). Autre ressort classique, jouant sur les contrastes et l’ascenseur social : la fille du colporteur deviendra comtesse, exploitant la faiblesse morale du meilleur ami du héros qui est, lui, incorruptible — un schéma dellyen classique.
Le crime, motif feuilletonesque essentiel, sature littéralement le récit, et la volonté criminelle est un moteur majeur de l’intrigue. Ici, cette volonté criminelle a comme nom le pangermanisme. Nous la retrouverons à l’œuvre, ô combien, dans le roman suivant de l’auteur,Le Maître du Silence(1917), autre fiction fonctionnant au fantasme. De fait, les monstres moraux vont devenir de plus en plus noirs et monstrueux d’un roman dellyen à l’autre, dans une tentative sans cesse renouvelée d’atteindre à la noirceur sublime et totale, idéal toujours à surpasser, tandis que les anges de bonté opteront pour le chemin symétrique et inverse. Parcourir tous les échelons du Mal chez Delly semble être une source de délice pour cet auteur autant que pour ses lecteurs.
Grand roman d’aventures et d’espionnage, Le Mystère de Ker-Even mérite, à tout point de vue, d’être aussi reconnu comme un remarquable exemple de roman-feuilleton.
1Réédité dans cette collection (« Les Œuvres de la Grande guerre » n°4, 2012)
2C’est en cherchant à localiser un conte de guerre de Léon Groc que Daniel Compère a repéré le nom de Delly dans les contes deL’Echo de Paris.
3Rappelons que Delly est le pseudonyme de Marie Petitjean de la Rosière (1875-1947) et de son frère Frédéric (1877-1949). Mais la question de savoir comment la tâche est répartie entre les deux est ouverte. Certaines hypothèses sont présentées dans le dossier Delly duRocambolen°55-56 (2011). L’impulsion initiale vient de Marie qui, dès l’enfance, se sent une vocation d’écrivain. Elle publie son premier roman tardivement, à 28 ans, en 1903. Frédéric intervient progressivement par la suite, à partir de 1909 environ. L’hypothèse proposée ici est que le tandem met au point une nouvelle méthode de travail à la faveur de la guerre.
4Publiés du 28 novembre 1914 au 25 septembre 1915.
5A la faveur d’un séjour de vacances (p. 186), dans la famille allemande par alliance de l’héroïne (en Prusse rhénane, à Wilnheim, ville imaginaire, correspondant peut-être à Weinheim), lors du fatal été 1914…
Première partie
La fille du colporteur
1.
Il pleuvait depuis le matin — petite pluie fine, serrée, que les marins appellent « crachin ». Elle noyait l’horizon, étendait son triste voile gris, humide, sur la mer sombre presque tranquille aujourd’hui, sauf autour des récifs contre lesquels, toujours, elle écumait en vagues pressées, rageuses, comme demandant aux rocs sournois la proie qu’ils lui avaient si souvent procurée, depuis des siècles.
La route conduisant au petit port de Conestel n’apparaissait pas cependant trop boueuse, grâce à son sol dur — un vrai sol de granit ! comme le répétait le colporteur qui avançait d’un pas lourd, en poussant devant lui une petite voiture recouverte d’une toile cirée.
C’était un homme d’environ quarante-cinq ans, plutôt petit, maigre, les cheveux blonds grisonnants. Des yeux d’un bleu vif brillaient dans sa face blafarde, aux traits mous. Une longue pèlerine en drap verdi tombait sur ses épaules, un large béret noir le coiffait. Des bottes solides montaient jusqu’à ses genoux, et leurs semelles épaisses, leurs talons ferrés martelaient le sol, qui rendait un son mat.
Près de cet homme marchait une petite fille d’une douzaine d’années. Une vieille robe, très propre, habillait son mince corps souple et alerte. Un capuchon de drap gris cachait complètement ses cheveux, encadrant un visage d’une blancheur laiteuse, aux lèvres fines et roses. Des cils blonds frangeaient les paupières, voilant à tout instant les yeux d’un même bleu vif que ceux de l’homme — des yeux à l’expression mobile, changeante, singulière.
En réponse à la réflexion de son compagnon, elle dit avec une moue d’ennui :
— Ce pays est triste, papa !… Y resterons-nous longtemps ?
— Peut-être. Cela dépend des renseignements que j’obtiendrai… Mais quand le soleil sera là, tu verras, Elsa, que cette côte bretonne est très belle.
Tous deux parlaient français, très correctement. L’enfant n’avait presque pas d’accent étranger, mais celui du père, bien que relativement peu prononcé, dénonçait néanmoins une origine germanique.
Elsa secoua la tête.
— Oui, peut-être… Mais pour le moment, ce n’est pas gai !… Puis nous sommes mouillés, papa !… mouillés comme de pauvres chiens ! C’est un dur métier que nous faisons là, vraiment !
— Certes ! Mais les profits vont devenir meilleurs, maintenant que je suis mieux apprécié. Tu seras riche, Elsa, si je vis encore quelques années. Je suis sur une piste intéressante, qui peut me rapporter gros… Mais j’aurais voulu que tu restes chez nos cousins Mülbach, bien tranquille, au lieu de me suivre comme cela, dans ces fatigantes pérégrinations d’un bout de la France à l’autre.
Elle secoua de nouveau la tête.
— Non, je veux être avec toi ! Je ne veux pas te quitter, papa… Et puis, cela m’intéresse tellement, ce que tu fais !
Une sorte de sourire glissa entre les lèvres pâles de l’homme, et ses yeux un peu durs s’adoucirent un instant, en se fixant sur l’enfant.
— Oui, tu es intelligente, tu comprends… Et vraiment, tu es pour moi une précieuse petite collaboratrice, ma fille !
Un éclair d’orgueil brilla dans le regard d’Elsa.
— Je voudrais l’être bien davantage encore ! Oh ! papa, puisque tu es fatigué, je vais t’aider beaucoup ici ! J’irai, je viendrai dans le pays, je questionnerai les gens, je regarderai bien tout…
— Certes, je te le répète, tu m’es précieuse ! Mais il y a des choses que je dois voir par moi-même… Et il s’agit ici d’une question importante. Ce lieu avancé de la côte bretonne peut avoir une grande valeur. Il s’agit de le faire nôtre, de le préparer… Moi, j’indique. D’autres viendront, qui feront le nécessaire. Mais il faut auparavant que je note les points intéressants. Voilà ce que tu ne peux faire, ma fille… du moins pas encore, car d’ici deux ou trois ans, je te crois fort capable d’être devenue aussi forte que moi sur ces sujets-là !
De nouveau, l’orgueil s’alluma dans les yeux de l’enfant.
— Oh ! oui, oui ! Je comprends déjà, papa !… Je comprends très bien ! Tu verras comme nous ferons de bonne besogne, à nous deux ! Tiens, voilà Conestel… Que voit-on, là-bas ?… Un château ?
Elle étendait la main vers la droite. Dans la brume, on distinguait un peu vaguement la masse imposante et les tours d’une vaste construction.
— Oui, le château de Runesto. Il appartient à une famille de Penvalas… Quand je passai une première fois par ici, voilà environ trois ans, le marquis de Penvalas venait de mourir, laissant deux enfants, déjà orphelins de mère… Il y a de la fortune là-dedans… beaucoup de fortune. J’ai pris mes renseignements sur cette famille, à l’époque, car tout peut servir un jour ou l’autre.
« Oui, souviens-toi bien de cela, enfant ! Les plus menus faits, qui te paraissent insignifiants, les plus petits détails ; les paroles oiseuses, en apparence, doivent être notés, catalogués dans ta mémoire. C’est avec cette méthode, ce souci de la moindre chose qu’on arrive au but, dans la vie des individus comme dans celle des nations.
« Et ce sera le triomphe de notre race d’avoir su préparer longuement, patiemment, les routes par où passeront les missionnaires d’une civilisation supérieure.
La voix un peu faible de l’homme s’enflait, prenait un ton d’emphase. Des lueurs s’allumaient dans son regard. Mais elles s’éteignirent aussitôt. Le colporteur pâlit, s’arrêta un moment, en portant la main à sa poitrine.
— Encore cette douleur… qui m’étouffe…
Elsa leva sur lui un regard inquiet.
— Il faudrait voir un médecin, papa ?
— Oui… Mais il n’y en a pas, sans doute, dans ce petit village… J’irai à la prochaine ville… Allons, en route ! C’est passé… Je me reposerai quelques jours à Conestel, avant de reprendre notre chemin.
Ils se remirent en marche. Elsa aidait maintenant son père à pousser la voiture.
Comme ils atteignaient les premières maisons de Conestel, les étrangers croisèrent deux adolescents, chaussés de bottes, serrés dans des manteaux de caoutchouc. L’un était mince, d’allure élégante, brun au fin visage éclairé par de beaux yeux ardents. L’autre, blond et de mine indolente, avait l’apparence d’un gros garçon un peu poseur, mais assez bon enfant.
Au passage, le premier jeta au colporteur ces mots, d’une voix bien timbrée :
— Mauvais temps, hein ! mon pauvre homme, pour s’en aller sur les routes.
— Ah ! dame oui, monsieur ! Mais il faut bien gagner sa vie !
— Allez jusqu’au château ; on vous achètera quelque chose.
Et les jeunes garçons passèrent, tandis que le colporteur et sa fille continuaient d’avancer, sous la pluie menue.
L’homme fit observer :
— C’est sans doute le jeune marquis de Penvalas… Un beau garçon !
Presque à l’entrée du village, le colporteur s’arrêta devant une petite auberge de médiocre apparence. Au-dessus de la porte se dressait une enseigne où se voyait, peint en jaune et vert, une sorte de monstre, moitié serpent moitié poisson, sous lequel étaient inscrits ces mots :Au serpent de mer.
Le colporteur dit à mi-voix, s’adressant à Elsa :
— C’est pauvre, c’est sale, mais il n’y a que ça dans le village. Il faut bien s’en contenter, petite !
Elle répondit sur le même ton :
— Mais oui, papa. D’ailleurs, nous avons eu déjà d’autres logis pas bien agréables, dans nos voyages.
L’homme entra dans l’auberge et s’adressa à une femme en coiffe bretonne qui pelait des pommes de terre près du foyer, où bouillait l’eau d’une marmite, sur un feu de bois.
— Pourrez-vous nous loger, ma fille et moi, s’il vous plaît ?
— Mais oui, monsieur, facilement… Vous êtes colporteur, je vois ça à votre voiture ? On va la rentrer dans la remise… Il fait un si vilain temps !… Etes-vous mouillé, mon pauvre !… Et la petite aussi ! Venez vous chauffer… Je vais vous servir un café, si vous le voulez ?
— Oui, c’est ça, un café bien chaud. Pendant ce temps, je vais remiser ma voiture.
Quelques instants plus tard, le père et la fille étaient installés près du foyer, devant un bol de café. L’aubergiste, si elle manquait de soin dans la tenue de son intérieur, se montrait une bonne femme, très hospitalière. Elle avait enlevé les souliers mouillés d’Elsa et les remplissait de grains d’avoine, « un très bon moyen pour les faire sécher », assurait-elle.
La petite fille, les pieds bien au chaud dans les pantoufles que son père lui avait rapportées de la petite voiture, buvait son café avec une évidente satisfaction. Elle avait retiré son capuchon, et maintenant on voyait ses beaux cheveux noirs, lustrés, aux superbes reflets d’aile de corbeau. Ils formaient avec son teint de blonde, ses sourcils clairs, ses yeux bleus, un contraste étrange, qui ne permettait pas à cette physionomie d’enfant de passer inaperçue.
Le père, lui, touchait à peine à son bol. Il finit par le repousser en disant :
— Ça ne passe pas.
Elsa demanda d’un air inquiet :
— Te sens-tu plus fatigué, papa ?
— Mais non… C’est-à-dire, j’ai un peu d’étouffement… Une bonne nuit m’enlèvera cela. Et demain, fillette, je te ferai faire une promenade intéressante.
L’aubergiste venait de sortir. Le colporteur ajouta, en baissant la voix :
— Tu verras Ker-Even — la maison d’Even — un logis curieux, dont l’origine se perd dans le lointain. Je te raconterai son histoire — ou sa légende… Il appartient à un M. de Valserres, officier de marine, fort savant, marié à une Espagnole, Inès Romanoès.
L’enfant répéta, une lueur de surprise dans le regard :
— Romanoès ?
— Oui… Elle est la sœur de Pepita Romanoès, devenue la femme de notre cousin Otto Mülbach. Ce commandant de Valserres est un parent très éloigné des Penvalas, avec lesquels, d’ailleurs, il n’a aucunes relations. Une brouille est survenue entre les grands-parents, jadis. Puis les Valserres ne revenant plus guère ici, on ne songea pas à se réconcilier par la suite.
« L’officier, un été, amena sa femme à Ker-Even… Mais Inès, qui est une enfant gâtée, mondaine et futile — tellement différente de Pepita ! — s’y ennuya tant au bout de deux jours que M. de Valserres dut l’emmener vers des lieux plus attrayants. Depuis, la maison est fermée. Un vieux marin qui demeure non loin de là s’en occupe un peu, l’aère de temps à autre. Et… Ecoute bien ceci, Elsa…
Il se penchait à l’oreille de sa fille, et sa voix devint un chuchotement :
— C’est cette maison qui m’intéresse… C’est elle que je viens étudier…
Il s’interrompit. L’aubergiste rentrait. Elle s’approcha des voyageurs, et dit, en regardant Elsa :
— Elle est jolie, votre petite… Et comme elle a de beaux cheveux ! C’est drôle, on dirait presque qu’ils sont bleus, quand on les regarde d’une manière…
— Oui, ils ont en effet cette teinte.
— Ça fait très bien… Et puis, elle a un teint si clair… Alors, vous voyagez comme ça tout le temps ?
— Eh oui ! Je suis déjà venu ici, voici trois ans…
— Tiens, je me disais aussi que je connaissais un peu cette tête-là ! Même que je me rappelle maintenant vous avoir acheté des aiguilles et du lacet. Et de quel pays êtes-vous ?
— De la Suisse. Mais je n’y suis pas retourné depuis longtemps.
— Vous n’avez plus votre femme ?
— Non, elle est morte à la naissance de la petite.
— C’est triste ! Alors, vous l’emmenez comme ça sur les routes, cette enfant ?
— Il le faut bien ! Je n’ai plus de famille… et puis, ça lui ferait de la peine de me quitter.
— Je comprends. Mais c’est une vie fatigante.
— Oh ! elle est forte. Vous voyez d’ailleurs qu’elle n’a pas trop mauvaise mine ? Le grand air, rien ne vaut ça !
Il passa une main caressante sur la chevelure de sa fille. Puis, changeant de sujet, il demanda :
— C’est toujours la famille de Penvalas qui habite le château ?
— Toujours, bien sûr ! Runesto est aux Penvalas depuis les temps anciens, et ils n’ont pas envie de le laisser à d’autres !… Avec ça que M. Alain l’aime tant et voudrait ne le quitter jamais.
— Nous avons croisé, tout à l’heure, deux jeunes garçons dont l’un, je suppose, était lui ?
— Oui, c’est ça. M. Alain, le brun, et son cousin, M. Maurice de Ronchay, qui est orphelin et vient passer les vacances à Runesto. Il est gentil aussi, mais il ne vaut pas M. Alain, si intelligent, si joli garçon, et puis bon, aimable… quoiqu’il ait un petit air fier, souvent.
« On dit par ici que c’est l’air des Penvalas. Il n’empêche qu’on les aime bien, nos châtelains !… Mme la marquise est une sainte femme, qui se mettrait en quatre pour obliger le monde. Aussi, les malheureux savent bien où frapper, quand ils ont besoin d’être aidés !
— C’est la grand-mère des enfants ?
— Oui. Elle les a élevés, puisque la mère est morte toute jeune, peu après la naissance de la petite Mlle Armelle… Et bien élevés, on peut le dire. Ce sont des modèles d’enfants !
Sur ce, la brave femme retourna à ses pommes de terre, tandis que le colporteur essayait d’avaler encore quelques gorgées de café, qui parurent passer difficilement.
2.
La pluie avait cessé, le lendemain matin, mais le ciel restait sombre et menaçant.
Elsa s’en alla vers le petit port, regarda un moment la mer, grise et un peu houleuse, les quelques barques demeurées à l’amarre, les autres étant parties de bonne heure pour la pêche. Puis elle erra un peu à travers le village et entra dans la vieille petite église, dont elle fit le tour, considérant curieusement les vitraux, assez beaux, les statues, l’autel garni de roses rouges et de lis dorés, les petits navires pendus à la voûte, ex-voto offerts par les marins sauvés d’un péril de mort.
Comme elle sortait, une voiture attelée de deux beaux chevaux paisibles s’arrêtait devant une maison voisine, très vieille, toute grise, dont la porte était surmontée d’une croix — le presbytère, évidemment. Il en descendit une dame âgée, vêtue de noir, avec de beaux cheveux blancs coiffés en bandeaux, et une fillette d’une douzaine d’années, au visage menu, distingué, tranquille. Toutes deux entrèrent dans la maison, dont une servante ouvrait la porte devant elles. Et Elsa revint en flânant vers l’auberge.
— C’est sans doute la marquise de Penvalas et sa petite-fille que tu as vues là, dit le colporteur, quand sa fille lui eut décrit les étrangères, un instant plus tard.
Il semblait mieux, ce matin. L’étouffement avait disparu. Ce n’était qu’un petit accident nerveux, assurait-il. L’air vif de cette côte y était peut-être pour quelque chose. Aussi presserait-il un peu ce qu’il avait à faire ici, pour retrouver ailleurs un climat plus favorable.
Il alla promener sa petite voiture dans le village, jusqu’à onze heures, vendit aux ménagères, tout en causant, des objets de mercerie, de la bimbeloterie, du papier à lettres décoré de fleurs voyantes. Puis il revint à l’auberge, déjeuna sans hâte et se leva en disant à l’aubergiste :
— Je vais maintenant faire un petit tour avec ma fille, pour lui montrer la côte… Et j’ai l’intention de rester deux ou trois jours ici, pour me reposer, car je me sens vraiment fatigué.
— Vous avez bien raison, mon pauvre homme !… A quoi ça sert de s’esquinter ? Vous tomberiez tout à fait, et votre petite resterait seule. C’est vrai que vous n’aviez pas une fameuse mine, hier ! Mais aujourd’hui, on voit que ça va mieux… Allons, à tout à l’heure !
Le père et la fille s’en allèrent, d’un pas flâneur. Ils quittèrent le village, s’engagèrent dans un sentier qui longeait la côte et montait à mesure que s’élevait la falaise rocheuse contre laquelle venaient s’écraser les vagues écumantes. Parfois, une grotte ou un couloir se creusaient dans le roc ; la mer s’y engouffrait en grondant, et ses embruns arrivaient au visage du colporteur et d’Elsa, penchés pour voir l’impressionnant spectacle.
L’enfant disait :
— Que c’est beau !… Si seulement le soleil donnait là-dessus.
— Oui, c’est dommage… Mais le temps est encore bien pris aujourd’hui. Tout ce point de la côte est ainsi creusé de grottes, d’entonnoirs, et aussi d’abîmes dans lesquels la mer pénètre seulement aux grandes marées.
« Il y aurait là une intéressante topographie à faire… Et d’autant plus qu’on prétend, dans le pays, que des souterrains existent, reliant non seulement Ker-Even au château de Runesto, mais encore permettant d’atteindre ces abîmes, ces grottes… Voilà ce qu’il importerait d’étudier de près. Pour cela, il faudrait que Ker-Even fût à nous !… Otto a sondé son beau-frère pour savoir s’il était disposé à une vente, mais M. de Valserres tient à cette vieille maison, qui ne lui sert à rien, pourtant.
L’homme songea un instant, les sourcils froncés. Puis il murmura, d’un ton résolu :
— Il faudra pourtant bien que nous l’ayons !… d’une façon ou de l’autre !
Le sentier tournait, suivant les sinuosités de la côte. Sur la mer, dont la houle augmentait, des barques dansaient, penchaient, voiles tendues.
Et le colporteur s’arrêta, la main sur l’épaule de sa fille, en disant :
— Tiens, regarde !
Ils arrivaient au point culminant de la falaise. De là, une nouvelle partie de la côte leur apparaissait — un promontoire rocheux, s’avançant comme une proue dans la mer grise, furieusement agitée autour de lui. Presque à son extrémité, une longue maison basse, noire, se trouvait comme tapie. Elle était là, sur le roc inculte, pareille à une sinistre guetteuse, avec ses petites fenêtres étroites et rares, son aspect sournois, inquiétant, de vieux logis clos.
Et le colporteur dit, en étendant la main vers elle :
— C’est Ker-Even.
Elsa murmura :
— Oh ! que c’est triste, cette maison !
— Evidemment !… Et je comprends qu’un joli oiseau comme Inès ait eu un spleen fou après quarante-huit heures passées là-dedans.
—Tu m’as dit, papa, que cette demeure avait une histoire — ou une légende ?
— Les deux s’amalgament, comme il arrive en général. Marchons toujours. Je te raconterai cela chemin faisant.
Ils continuèrent d’avancer, dans le sentier qui descendait, maintenant, suivant l’infléchissement de la côte, à cet endroit.
Le colporteur expliquait :
— Tu vois ces écueils, dont plusieurs émergent à peine en ce moment, tandis que certains ne seront découverts qu’à marée basse, et d’autres restent toujours dissimulés sous les flots, traîtreusement ?… Depuis que cette côte existe, telle que nous la voyons aujourd’hui, combien de navires se sont brisés là, perdus corps et biens !… Aussi, de bonne heure, installa-t-on au-devant de ce point dangereux un phare, d’abord primitif, puis qui se transforma selon le progrès… Tu l’aperçois, là-bas ?
— Oui, papa.
— Or, voici ce qu’on raconte. Dans ce logis vivait, en des temps reculés, un chef de pirates du nom d’Even, farouche et sanguinaire. Avec ses hommes, il entreprenait d’aventureuses expéditions sur mer, attaquant les navires rencontrés, tuant, pillant… Et aux jours de tempête, il faisait allumer des feux sur la côte, pour attirer, vers les écueils, les vaisseaux en détresse, qui s’y brisaient.
« Quand l’aube venait, amenant un peu d’accalmie, les pirates s’en allaient vers l’épave, dans les petites barques qu’ils manœuvraient avec une extrême habileté ; ils la fouillaient, emportaient ce qui était à leur convenance, emmenaient les êtres encore vivants qu’ils y trouvaient.
« Pendant ce temps, leurs femmes et leurs enfants guettaient sur la côte et s’emparaient, avec la dextérité que donne l’habitude, de tous les objets apportés par le flux. Après quoi, il y avait grande ripaille, dans une salle souterraine ; les pirates se livraient à de sanglantes orgies, n’épargnant ni femmes, ni enfants, ni vieillards, s’ils en avaient trouvé dans l’épave… Even se montrait le plus terrible de tous. C’était, dit la tradition populaire, un homme roux, de taille gigantesque, d’une force d’hercule. Son dur visage, ses yeux flamboyants terrifiaient jusqu’à ses plus intimes collaborateurs eux-mêmes, victimes, souvent, de ses fantaisies cruelles.
« Il avait épousé une jeune fille d’une grande beauté, trouvée dans une de ces épaves. Pendant quelque temps, il la combla d’attentions… Puis, son humeur changea, et la pauvre créature martyrisée mourait peu à peu de chagrin, quand Even s’avisa un beau jour de lui faire couper la gorge — sans doute pour lui épargner une plus longue agonie.
Elsa eut un petit frisson.
— Oh ! l’affreux homme ! Et après, papa ?
— Eh bien, il avait eu un fils de cette union. Cet enfant, parvenu à l’adolescence, fut converti par les apôtres venus pour prêcher l’Evangile en Armorique, et devint, assure-t-on, la souche d’où sont sortis les Penvalas.
« Depuis lors, il n’y eut plus de ces grands pillages d’épaves, organisés en quelque sorte officiellement, si on peut parler ainsi… Mais on dit que, pendant longtemps, les nuits de tempête, des habitants de la côte, traîtreusement, faisaient des signaux qui amenaient encore sur les brisants le navire en perdition. Et ils pillaient ensuite, ils massacraient, comme autrefois. Mais Ker-Even ne s’ouvrait plus pour eux, la salle souterraine avait été murée. C’était fini des belles orgies, des ruisseaux de sang coulant sur la table de granit où s’immolaient les victimes. Les descendants d’Even le Roux, avaient une réputation méritée de gens pieux, charitables, et dès que leur était signalé un de ces écumeurs d’épaves, ils le punissaient avec sévérité. Ainsi, peu à peu, disparut la sauvage coutume qui avait coûté la vie à tant de malheureux.
— C’est très intéressant, cette histoire, papa ! Les Penvalas sont donc, ainsi, les descendants de cet horrible Even ?
— Oui, d’après la tradition.
— Et comment cette maison est-elle à M. de Valserres, non à eux ?
— Par un partage qui se fit, autrefois, entre deux cousins germains, dont l’un était le bisaïeul d’André de Valserres… Je crois même que de là date cette brouille dont je te parlais hier. Jusqu’alors, Ker-Even avait toujours fait partie du domaine de Runesto. La branche aînée, sans doute, n’a pas admis qu’on lui enlevât ce lieu des origines de la famille.
Les deux promeneurs continuèrent d’avancer. Ils passèrent près d’une petite crique, où se balançait une barque dont l’amarre s’enroulait à un solide poteau. Une maisonnette basse, demi-croulante, s’abritait entre deux rochers, près d’un figuier anémique poussé là on ne sait comment. Sur un banc de pierre, proche le seuil, un vieux marin fumait sa pipe en regardant venir les étrangers. Le colporteur s’arrêta à quelques pas de lui, en esquissant un geste de salut.
— Fichu temps, hein ?… Nous aurons encore de la pluie ce soir ?
Le vieux ôta la pipe d’entre ses lèvres.
— Pour sûr !… Et demain aussi, probable. Où que vous allez comme ça ?… Vous vous baladez ?
— Oui, comme vous voyez… Je suis colporteur de mon métier. Hier, nous nous sommes arrêtés à Conestel. Et j’y reste deux ou trois jours, pour me reposer… Ce n’est pas de trop, une fois de temps à autre ! Alors, j’en profite pour montrer un peu la côte à la petite. Nous allons nous asseoir là-bas, près de cette vieille maison, et nous y prendrons l’air, tranquillement.
— Oh ! pour de l’air, vous en aurez, à Ker-Even !… et de première qualité ! Ça vous arrive du large en plein !… Mais c’est un jour de tempête qu’il faudrait voir ça !
— Je crois, en effet, que ce doit être effrayant, étant donnée la position de cette demeure. Elle n’est pas habitée ?
— Non, pas habitée, depuis très longtemps. Ce n’est pas un logis bien agréable, pour des gens qui n’ont pas l’habitude. Le commandant de Valserres, qui en est le propriétaire, m’a chargé d’y voir un peu de temps en temps. Quand il y a un brin de soleil, je vais ouvrir, et j’enlève un peu de poussière, j’astique une chose ou une autre.
« J’ai été marin de l’Etat ; alors, ça me connaît de tenir propre un bâtiment. Aussi le commandant m’a complimenté quand il est venu avec sa jeune dame, une fois… Ils sont restés deux jours. La petite dame — une jolie brune, ma foi !… et attifée à la Parisienne, fallait voir ! — disait tout le temps :
« — C’est épouvantable, cette maison !… C’est horriblement triste ! Je ne puis y demeurer huit jours, André !… Emmène-moi ailleurs, sans tarder !
« Alors, le commandant a fait repartir les malles, puis tous les deux ont quitté Ker-Even. Depuis, je ne les ai plus revus.
Le colporteur dit, comme s’il cherchait dans sa mémoire :
— Le commandant de Valserres ?… Il me semble que j’ai déjà entendu ce nom ? N’est-ce pas un lieutenant de vaisseau ?
— Oui, c’est ça… Un bon marin, et surtout un savant, à ce qu’on dit.
— J’aurai vu son nom dans quelque journal… Allons, bien le revoir !… Il n’y a rien de curieux à voir, à Ker-Even ?
— Mais non. C’est vieux, voilà tout… Il y a des murs comme ça…
Et le marin ouvrit très largement ses bras, pour représenter l’épaisseur des murs de Ker-Even.
— …Des meubles anciens, aussi, qu’ont de la valeur, pour ceux qui cherchent les vieilleries.
— On m’a parlé, à l’auberge, de souterrains ?
— Ah ! oui !… Mais on n’y va plus depuis des cent ans. Est-ce qu’on vous a raconté l’histoire d’Even le Roux ?
— Mais oui.
— Eh bien ! tous ces gens qui ont été tués là « reviennent »… On y entend des gémissements, des soupirs… On respire l’odeur du sang… Et puis on voit la pauvre petite femme d’Even, avec la gorge ouverte !
Elsa attachait sur le vieux marin un regard où l’effroi se mêlait à la curiosité. Elle demanda :
— On l’a vue, vraiment ?
— Il paraît, dans les temps… Maintenant on n’y va plus, comme je vous le dis.
Le colporteur fit observer :
— Ce sont des croyances populaires, grossies d’âge en âge par les imaginations toujours prêtes à mettre partout le merveilleux et l’extraordinaire.
Le marin secoua la tête.
— Ben, on ne sait pas… Ça peut être vrai.
Puis, comme l’étranger faisait un mouvement pour continuer sa route, il ajouta :
— Tout de même, si ça vous intéresse de voir la maison, je vous la montrerai bien ?
Le colporteur sembla réfléchir un moment. Puis, il répondit :
— Si ça ne vous dérange pas trop, je ne refuse pas. Cette visite nous fera passer un moment.
— Bah ! y a pas de dérangement pour un vieux bonhomme comme moi, qui ne fait plus grand-chose… Un peu de pêche, par-ci par-là, quand le temps est beau… Avec la petite somme que m’envoie le commandant, on vit tout de même !
Tout en parlant, le vieux se levait.
Il remit la pipe entre ses lèvres, et s’en alla aux côtés de l’étranger, avec sa démarche balancée de vieux loup de mer.
Les deux hommes et l’enfant s’engagèrent sur le promontoire. Des roches s’élevaient du sol dur, lui-même formé de granit. Une herbe rase et courte, quelques ajoncs, quelques arbustes croissaient dans les parties où se trouvait une terre suffisante pour les faire vivre.
Le colporteur fit observer :
— C’est pauvre, la terre, par ici ?
— Oui, plutôt. Pourtant, elle n’est pas mauvaise, du côté de Runesto. Le défunt marquis la faisait bien cultiver, et Mme la marquise y tient la main aussi. Le domaine est d’un bon rapport, c’est sûr… Tant mieux, parce que ces gens-là, ils ont la main sur le cœur !
« Tenez, moi, Yves Gouez, une année, j’ai eu un mal au pied que je ne savais plus comment faire, et que je criais la nuit tant je souffrais. Les médecins n’y voyaient que du feu, et la vieille Annik, cette sorcière, augmentait le mal avec ses herbes mauvaises. Alors, Mme de Penvalas est venue… Oui, mon garçon, tous les jours, et à pied, quoique ce soit une dame âgée, pas bien allante… Elle m’a soigné comme qui dirait une sœur de charité, avec de bonnes paroles par là-dessus. Bref, au bout de quinze jours, j’étais guéri, et je marchais comme avant.
« Aussi, je vous assure bien qu’il ne faudrait pas qu’on touche à cette femme-là, ou à ses petits-enfants !… Ah ! mais non !
Et le vieux marin brandit sa pipe, en fronçant terriblement les sourcils.
Sur ce promontoire, le vent soufflait presque perpétuellement. Elsa tenait son capuchon bien serré autour de sa tête et le colporteur avait enfoncé jusqu’aux oreilles son béret. Il semblait marcher difficilement. Depuis un instant, il ne disait rien, et son visage s’altérait visiblement.
Près du logis, un vieux figuier, un peu tordu, étendait ses branches garnies de feuilles nouvelles. La maison le préservait des vents d’ouest, les plus terribles, comme l’expliquait le marin à ses compagnons.
— C’est un ancien. On dit qu’il a des cents ans… Il paraît que ça vit vieux, ces arbres-là.
Elsa demanda :
— Est-ce qu’il donne encore des fruits ?
— Oui, mais pas grand-chose de fameux… Ah ! c’est à Runesto qu’il y en a des beaux figuiers et des belles figues !… C’est un sucre !… Mme la marquise m’en apporte tous les ans, la chère dame !
Le vieillard, en parlant, s’avançait vers la porte et introduisait une grosse clef dans la serrure.
Elsa, qui regardait à ce moment son père, le vit porter la main à sa poitrine.
— Est-ce que vous souffrez encore, papa ?
— Oui… et j’étouffe… J’ai eu tort de venir ici… Le vent est trop fort !
Le marin se retourna et le regarda attentivement :
— Vous avez une fichue mine, c’est sûr !… Entrez vite, vous allez vous reposer.
Il poussa la porte, entra dans un vestibule sombre et froid, où le suivirent ses compagnons, puis de là dans une grande pièce, dont il ouvrit promptement les volets.
— Là !… C’est le salon… Asseyez-vous, et puis restez bien tranquille, le temps que ça se passe. Vous ne gênez personne, pas vrai ?… et c’est pas le commandant qui dirait quelque chose s’il vous voyait là, car il est bon comme du pain.
Le colporteur se laissa tomber sur un fauteuil. Son teint blafard prenait une nuance livide ; une petite sueur perlait à ses tempes, mouillait son corps. Il s’inquiétait sérieusement, cette fois. De tels malaises, répétés, ce n’était pas chose ordinaire.
Elsa, debout près du fauteuil, attachait sur son père un regard anxieux. Elle lui tenait la main et la sentait glacée, frissonnante.
Le marin, près d’une fenêtre, fumait silencieusement sa pipe. Il considérait avec un intérêt placide les étrangers, en demandant de temps à autre :
— Eh bien ! ça va-t-il mieux ?
Le colporteur répondait :
— Oui, un peu… Ça passe, tout doucement…
Il s’enfonçait dans le grand fauteuil de chêne recouvert de tapisserie fanée. La vaste pièce, entièrement garnie de boiseries grises, contenait quelques beaux vieux meubles disparates, quelques portraits d’une valeur inégale. Un lustre de cristal, énorme, descendait du plafond à caissons jadis peints et dorés. De lourds rideaux de brocart usé, couleur d’écarlate, garnissaient les deux fenêtres étroites et hautes, ouvrant, l’une du côté des terres, l’autre sur la côte sud du promontoire.
Le colporteur, au bout de quelque temps, commença de regarder autour de lui avec intérêt. Visiblement, il se trouvait mieux. Enfin, il se leva, en disant :
— Là, c’est passé ! Un malaise nerveux, certainement… Mais c’est bien pénible ! Je verrai un médecin pour savoir s’il n’y a pas moyen de me débarrasser de ça.
Le marin approuva.
— Oui, faut voir. C’est embêtant à conserver, ces choses-là.
Le colporteur fit quelques pas, en répétant :
— C’est passé… C’est passé tout à fait.
Sa physionomie reprenait l’expression habituelle ; le teint perdait sa lividité.
Il fit le tour de la pièce, regardant les meubles, en murmurant :
— Pas mal !… Pas mal !
Le vieillard demanda :
— Vous vous y connaissez, dans ces machines-là ?
— Un peu… Vous savez, quand on a roulé sa bosse d’un coin de la France à l’autre, on s’instruit sur bien des petites choses, si on n’est pas une bête.
— Eh oui ! c’est comme les marins… On bourlingue, on bourlingue, et ça fait voir du pays, ça vous ouvre l’entendement… Est-ce que vous voulez visiter le reste ?… Peut-être que ça vous fatiguera ?
— Mais non, mais non ! Au contraire, cela me distraira… Et, si c’est nerveux, rien ne vaut la distraction, vous savez.
— C’est sûr !… Venez, alors… Ici, vous avez bien tout vu ?… Hein ! le beau lustre ? Ça doit valoir cher, des machins comme ça ?
— Eh oui !… plus ou moins… Celui-là est très beau, en effet.
La maison, toute en longueur, était composée d’un rez-de-chaussée au-dessus duquel se trouvaient de petites pièces très basses d’étage, mal éclairées, à peine habitables. Un très large corridor, dallé de pierres, aux murs de granit, à la haute voûte sombre, divisait en deux le logis. Toutes les pièces ouvraient sur lui.
Successivement, Yves Gouez les montra aux étrangers. Elles n’avaient rien de particulier, sinon leurs vastes dimensions, l’étroitesse et la rareté des fenêtres, la hauteur des plafonds à poutrelles ou à caissons, et quelques meubles assez intéressants, ici ou là.
— Mme de Valserres voulait que son mari les fît expédier chez eux, dit le vieux marin ; mais le commandant lui déclara que leur appartement de Brest était déjà encombré de meubles… Sans ça, elle avait l’air de trouver ceux-là à son goût.
— Elle n’avait pas tort. Ils ont une certaine valeur, par le temps qui court.
A l’extrémité du corridor, le vieillard s’arrêta devant une large porte de chêne décorée de gros clous de fer très brillants.
— Hein ! c’est frotté, ça ? Le commandant peut venir, la maison est propre. Ici, vous allez voir quelque chose…
Il introduisit une clef dans la serrure et ouvrit le lourd battant. Puis il entra, suivi du colporteur et d’Elsa, tous deux beaucoup plus intéressés que ne le pensait leur cicerone.
Ils se trouvaient dans une grande pièce vide, au sol fait de dalles de granit. Une énorme cheminée, très primitive, ouvrait son âtre noir. Aux murs épais, des lambeaux de tapisseries pendaient. Très haut, deux petites fenêtres sans vitres, à croisillon de fer, laissaient passer un jour avare.
Yves Gouez expliqua :
— Aux jours de très grande tempête, il arrive que la mer déferle jusqu’à la maison, et elle entrerait ici comme chez elle, si les fenêtres n’étaient pas placées là.
Le colporteur, qui regardait attentivement autour de lui, demanda :
— A quoi servait cette salle ?
— C’était la chambre d’Even le Roux. Et tenez, ici…
Le marin s’approcha et frappa du pied sur une dalle.
— C’est l’entrée des souterrains. Voyez l’anneau qui servait à soulever ça…
Le colporteur s’avança, en réprimant avec peine un mouvement d’ardent intérêt.
Dans la dalle, se voyait un énorme anneau rouillé. Par ailleurs, elle ne se distinguait pas autrement des autres, et semblait complètement soudée à ses voisines.
Le colporteur demanda :
— Elle a été scellée, n’est-ce pas ?
— Oui ; voilà bien longtemps. Et maintenant, est-ce que vous voulez voir le bout du promontoire ?
— Mais oui, certainement.
Ils sortirent de la salle, passèrent dans le corridor pour gagner la porte menant au dehors. Puis ils longèrent la maison, et virent devant eux l’extrémité du promontoire, dressé à pic sur la mer.
Ici, la mer demeurait en courroux, sans relâche. Ses vagues se lançaient à l’assaut du roc, le couvraient d’écume, le harcelaient comme des furies, en grondant sourdement.
Le vent, sur ce point, redoublait de violence. Elsa saisit le bras de son père.
— Cela va te faire mal, papa !… Retournons !
— Oui… Attends… Je veux voir… Cette situation est superbe !
Il regardait devant lui, autour de lui, longuement, une flamme dans les yeux.
Le vieux marin opina :
— Oui, c’est beau ! Les étrangers viennent toujours voir ça, quand ils visitent le pays… La mer sauvage, dame ! c’est bien ici !… Et elle ronge la côte, cette coquine !… Si vous voyiez toutes les grottes qu’elle a creusées !… Rien que dans ce promontoire, il y en a plusieurs qui jamais ne se découvrent, même aux plus basses marées… Une surtout, dont on raconte qu’elle communique avec les souterrains, tant elle est profonde.
Le colporteur retint un tressaillement.
— Où cela ?
— Sur le flanc sud… là, tenez. On ne s’en doute pas car son ouverture est toujours sous l’eau. Je ne pourrais même pas vous dire où elle se trouve exactement.
— Comment sait-on qu’elle existe ?… Quelqu’un l’a-t-il vue ?
— Probable, puisque c’est dans l’histoire.
— Dans quelle histoire ?
— Dans celle du pays, donc ! C’est des choses qu’on raconte, qui nous viennent des anciens.
La physionomie de l’étranger se rembrunit.
— Ah ! bon ; c’est une légende !
— Je n’en sais rien… Ça peut être vrai.
— Evidemment. On dit aussi que ces souterrains s’étendent jusqu’à Runesto ?
— Il paraît… Mais l’ancêtre des marquis de Penvalas qui fit bâtir le château, y ayant été voir, un jour, en revint comme un fou, avec des cheveux tout blancs, et ordonna que fût scellée l’entrée de par chez lui. Jamais il ne voulut dire ce qu’il avait vu là-dedans… Et voilà comment personne n’alla plus dans les souterrains.
Elsa tira la manche de son père.
— Papa, viens !… Ce vent est terrible !
— Oui, ma petite.
Ils rebroussèrent chemin.
De temps à autre, l’étranger se détournait, regardait encore la pointe du promontoire, l’horizon de mer voilé par la brume sombre, et murmurait :
— Superbe !… vraiment superbe !
Au moment de s’engager à nouveau dans le sentier menant à Conestel par la côte, le colporteur s’arrêta.
— Je crois que je ferais mieux de revenir par les terres. Cet air marin, si vif, ne me va pas du tout… Voilà que je sens encore ces étouffements…
— Bien oui, si ça vous gêne, rentrez par Runesto. Ce n’est pas plus long, parce que vous pourrez gagner Conestel presque en ligne droite.
— Bonsoir, donc, et merci !
— De rien. Si ça vous a fait plaisir tant mieux !
Et, serrant la main de l’étranger, puis celle que lui tendait Elsa, Yves Gouez s’éloigna, sa pipe à la bouche. Elsa mit sa main sous le bras de son père.
— Marchons doucement, papa, pour ne pas te fatiguer.
— Oui… Cela ira mieux, quand je ne sentirai plus cet air qui fouette… qui serre la poitrine…
Ils avancèrent lentement. La lande s’étendait devant eux, semée de rocs affleurant le sol, couverte d’ajoncs et de maigres petites bruyères. Puis vinrent des champs, des petits vergers, des terrains couverts d’une herbe rase où broutaient des moutons. Peu à peu, la terre prenait un aspect plus fertile, à mesure qu’on approchait du château, dont la grosse tour crénelée apparaissait maintenant entre les frondaisons des vieilles futaies magnifiques.
Près d’un talus bordant une prairie, le colporteur, qui semblait souffrir, s’arrêta, en disant :
— Reposons-nous là.
— Mais, papa, c’est mouillé.
— Etends ma pèlerine, nous nous mettrons dessus. Ils s’assirent, et l’homme, aussitôt, prit dans sa poche un calepin, sur lequel il se mit à écrire, d’une main agitée.
De temps à autre, des mots s’échappaient de ses lèvres :
— Situation parfaite… Et, si les souterrains existent, on peut faire quelque chose de fort intéressant… Il faudrait aussi qu’on fouillât ces grottes sous-marines… Des scaphandriers y arriveront, peut-être… Enfin, c’est à étudier… Je montre une voie, simplement. Mais elle peut être excellente.
Quand il eut fini d’écrire, l’étranger ferma son calepin, et dit d’un ton résolu, en le remettant dans sa poche :
— Il faut absolument que ce Valserres nous vende sa maison. Ce ne sera peut-être pas bien difficile à obtenir, d’ailleurs, car, d’après ce que j’ai compris, sa femme est une dépensière, qui est en train de le ruiner. Alors, il sera trop content qu’on lui paye un prix raisonnable sa vieille bicoque… Allons, petite, repartons ! Ces maudits étouffements ne cessent pas… Et toujours cette douleur qui me tient là…
Ils se levèrent, reprirent leur marche. L’homme semblait avancer avec peine. Bientôt, ils se trouvèrent près de l’entrée de Runesto. Deux massifs piliers de granit se dressaient de chaque côté. La grille était ouverte sur l’avenue des chênes centenaires conduisant au château, dont on apercevait d’ici l’imposante masse grise.
Le colporteur s’arrêta, en portant les deux mains à sa poitrine.
— Je ne peux plus… J’étouffe… Je souffre trop.
Son visage s’altérait de façon effrayante.
Il répéta : « Je souffre ! » et se laissa tomber sur le sol. Elsa jeta un cri d’effroi et se mit à genoux près de lui.
— Papa !… papa !
Il dit, d’une voix à peine perceptible :
— Va au château… demande… du secours… Mais, avant… mes papiers… prends… le calepin surtout…
Il essayait de trouver sa poche. Elsa guida sa main, et il sortit quelques papiers, puis le calepin sur lequel il avait écrit tout à l’heure.
— Prends… Cache bien… Pour remettre à Otto… ou à Ulrich… Et puis, va… vite !
Elle obéit, courut le long de l’avenue, passa le pont jeté sur les douves, traversa l’imposante cour d’honneur fermée d’un côté par la grosse tour ronde à mâchicoulis, de l’autre par un corps de bâtiment un peu postérieur au reste du château et soudé à une tour à poivrière — le tout relié par le principal corps de logis, noble construction d’allure féodale, comme la tour sa voisine.
Une porte était ouverte. Elsa s’y engouffra, au hasard, et se heurta au jeune garçon brun rencontré la veille.
Il s’exclama :
— Eh bien ! qu’est-ce que c’est ?
— Pardon !… Mais papa est malade… Il faudrait qu’on vienne à son secours…
La physionomie d’Alain de Penvalas exprima aussitôt un intérêt compatissant.
— Ah ! pauvre petite !… Où cela ?
— Près de l’entrée de l’avenue. Il étouffe, je ne sais ce qu’il a…
— Eh bien ! je vais vite prévenir ma grand-mère ! Attendez-moi là !
Quelques instants plus tard, il revenait avec la dame aux cheveux blancs qu’Elsa avait aperçue hier, descendant de voiture devant le presbytère, avec une petite fille. Et tous trois se hâtèrent vers le lieu où était demeuré le colporteur.
Chemin faisant, Mme de Penvalas encourageait l’enfant avec de douces paroles… On allait le soigner, son père, et il serait vite remis. Précisément, le médecin de Kerhuel se trouvait chez le jardinier du château, dont les deux petits enfants étaient malades. Un domestique était allé le prévenir, et il viendrait dans un moment.
L’homme était toujours à terre, le dos appuyé contre un arbre. Il étouffait encore, mais semblait souffrir moins.
D’une voix faible, il s’excusa du dérangement qu’il causait. Mais la marquise l’interrompit avec bonté :
—